« Vallée De La Saône »
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prescriptions Générales Et Particulières De Circulation Des Convois Exceptionnels Sur Les Réseaux 72T, 94T Et 120T Dans La Haute-Saône
Annexe 3 : prescriptions générales et particulières de circulation des convois exceptionnels sur les réseaux 72T, 94T et 120T dans la Haute-Saône GESTIONNAIRE CODE RESEAU TE ROUTES — SITUATION ADRESSE MAIL PRESCRIPTIONS PARTICULIERES — DESCRIPTION VOIRIE PRESCRIPTION - Les caractéristiques associées au réseau 72t présente les limites suivantes : l : 4m, L : 25m à l'exception des itinéraires où le gestionnaire aura défini des limites plus contraignantes. - Les caractéristiques associées aux réseaux 94 et 120t présentent les limites suivantes : l : 5m, L : 35m à l'exception des itinéraires où le gestionnaire aura défini des limites plus contraignantes. ATTENTION — l'emprunt de la N19 entre Roye et Le Territoire de Belfort (N1019) est 72, 94 et 120t DREAL BFC PGDREALBFC [email protected] possible aux convois dont la largeur n'excède pas 4,50m et 5,50m de hauteur. Charge maximale à l'essieu : 12t et distance inter-essieux : 1,36m Pour les convois empruntant les réseaux 72, 94 et 120t, le transporteur doit impérativement prévenir par mail, 48 heures avant le passage du convoi, l'ensemble des gestionnaires ci dessous ainsi que la DREAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - TE 70. Lorsqu'une escorte des forces de l'ordre est nécessaire, le pétitionnaire devra les contacter au minimum 15 jours à l'avance pour l'établissement de la convention et 48h avant le passage effectif du convoi. ATTENTION : pour tous les convois exceptionnels dont la largeur est comprise entre 4510 et 5000 mm inclus un guidage privé est prescrit sur l'ensemble -

Siren : 247000367)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC des Combes (Siren : 247000367) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Arrondissement Vesoul Département Haute-Saône Interdépartemental non Date de création Date de création 31/12/1994 Date d'effet 31/12/1994 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président Mme Carmen FRIQUET Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Mairie Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 70360 scey-sur-saone-et-saint-albin Téléphone 03 84 92 72 12 Fax 03 84 92 73 56 Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe taxe de séjour Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) oui Autre redevance non Population Population totale regroupée 7 768 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 27,27 Périmètre Nombre total de communes membres : 27 Dept Commune (N° SIREN) Population 70 Aroz (217000280) 148 70 Baignes (217000470) 108 70 Boursières (217000900) 61 70 Bucey-lès-Traves (217001056) 131 70 Chantes (217001270) 120 70 Chassey-lès-Scey (217001387) 131 70 Chemilly (217001486) 88 70 Clans (217001585) 105 70 Confracourt (217001692) 224 70 Ferrières-lès-Scey (217002328) 129 70 La Neuvelle-lès-Scey (217003862) 184 70 La Romaine (200053056) -

L'avenir Se Construit En Haute-Saône
L’avenir se construit en Haute-Saône Département dynamique situé au carrefour des activités européennes > Action sociale, santé et solidarité > Education, jeunesse, sport > Transports et voies de communication > Economie et tourisme > Environnement et développement durable > Aménagement du territoire > Agriculture et aménagement foncier > Culture www.cg70.fr Connaître le Conseil général Faire connaître et promouvoir le Conseil général, telle est l’ambition de la plaquette de présentation de l’institution départementale. Notre société évolue et les compétences confiées au Conseil général ne cessent de croître. L’Etat, par la décentralisation décidée en 1982 et confirmée par étapes successives, place le Conseil général comme le pivot de l’action au quotidien sur le plan départemental. Malgré les contraintes budgétaires de plus en plus fortes, le Conseil général construit l’avenir en Haute-Saône avec des compétences de plus en plus étendues en matière d’action sociale, de santé et solidarité, d’éducation, de sport et de culture. Il initie, accompagne et contribue au développement de l’économie, du tourisme et de l’agriculture et de toutes les actions d’aménagement du territoire. Vous découvrirez, de manière précise, son fonctionnement, ses compétences et ses principales actions dans ce document. Je souhaite qu’elle soit utile à tous les élus, à tous les décideurs économiques, à tous les partenaires associatifs et à tous les Haut-Saônois. Yves K RATTINGER Sénateur de la Haute-Saône Président du Conseil général Sommaire Connaître le Conseil -
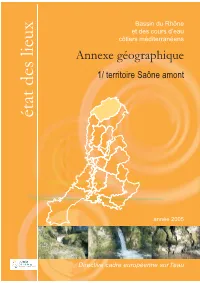
Territoire 01.FH11
Bassin du Rhône et des cours deau côtiers méditerranéens Annexe géographique 1/ territoire Saône amont état des lieux année 2005 Directive cadre européenne sur l'eau Contenu du document Présentation des annexes et des territoires SDAGE-DCE Codes et limites des masses deau superficielle Codes, limites et typologie des masses deau souterraine Les enjeux du territoire Annexe géographique Pressions importantes Masses deau superficielle risquant de ne pas atteindre le bon état en 2015 Masses deau superficielle pré-identifiées comme fortement modifiées Masses deau souterraine risquant de ne pas atteindre le bon état qualitatif Masses deau souterraine risquant de ne pas atteindre le bon état quantitatif Liste des masses d'eau principales et facteurs de risque de non atteinte du bon état Ces annexes sont des documents détape. Elles seront amenées à évoluer lors de lactualisation ultérieure de létat des lieux qui accompagnera la révision du SDAGE. Une homogénéisation de toutes les cartes sera réalisée. Présentation des annexes et des territoires SDAGE-DCE 1 En septembre 2000, la directive cadre sur leau a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil de lUnion européenne. Harmonisant les directives existantes, le nouveau texte définit un cadre général pour la protection et l'amélioration de tous les milieux aquatiques. Il prévoit, après avoir réalisé un état des lieux fin 2004, l'élaboration d'un plan de gestion du district hydrographique, intégré dans le SDAGE qui doit être révisé avant fin 2009. L'objectif général recherché avec la mise en uvre du SDAGE révisé est l'atteinte du bon état pour tous les milieux dici 2015. -

SIED 70 (Siren : 200078111)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 SIED 70 (Siren : 200078111) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte fermé Syndicat à la carte non Commune siège Vaivre-et-Montoille Arrondissement Vesoul Département Haute-Saône Interdépartemental non Date de création Date de création 17/10/2017 Date d'effet 17/10/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Nombre de sièges dépend de la population Nom du président M. Jean-Marc JAVAUX Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 20 avenue des Rives du Lac Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 70000 VAIVRE ET MONTOILLE Téléphone 03 84 77 00 00 Fax 03 84 77 00 01 Courriel [email protected] Site internet www.sied70.fr Profil financier Mode de financement Contributions budgétaires des membres Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population 1/14 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population totale regroupée 242 280 Densité moyenne 45,42 Périmètres Nombre total de membres : 517 - Dont 516 communes membres : Dept Commune (N° SIREN) Population 70 Abelcourt (217000017) 359 70 Aboncourt-Gesincourt (217000025) 217 70 Achey (217000033) 72 70 Adelans-et-le-Val-de-Bithaine (217000041) 306 70 Aillevans (217000058) 143 70 Aillevillers-et-Lyaumont (217000066) 1 624 70 Ailloncourt (217000074) 309 70 Ainvelle (217000082) 150 70 Aisey-et-Richecourt (217000090) -

Contribution À La Connaissance De La Flore De Haute-Saône Matériaux Pour Un Inventaire De La Flore Vasculaire De Haute-Saône (2)
Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne, 3, 2005 – Société Botanique de Franche-Comté Contribution à la connaissance de la flore de Haute-Saône Matériaux pour un inventaire de la flore vasculaire de Haute-Saône (2) par Jean-Christophe Weidmann, avec la participation de C. Brun, M. Demesy, Y. Ferrez, P. Henriot, H. Pinston, A. Piguet, J.-M. Royer et P. Viain. J.-C. Weidmann, Villa Saint Charles, 9 rue Paul Dubourg, F-25720 Beure Courriel : [email protected] Résumé – L’article présente des données complémentaires à celles de FERREZ (2003) et ajoute plusieurs plantes nouvellement découvertes ou redécouvertes pour le département de Haute-Saône. Mots-clés : Haute-Saône, inventaire floristique. Introduction retrouvées récemment. Quelques comm. pers.). Cet arbre n’était pas espèces sont présentées en raison de connu par les anciens floristes. Cet article fait suite à celui de FERREZ la méconnaissance actuelle qui les (2003) et se place dans la lignée de caractérise pour le département. ● Actaea spicata L. ceux de PIGUET (1995) et FILET (1996a ; Cette renonculacée est observée à 1997b ; 2003). Nous présentons ici Les espèces sont traitées par ordre Saulnot (environs du hameau de les données les plus remarquables de alphabétique. Un « ✤ » indique Corcelles) dans le canton d’Héri- la flore vasculaire récoltées depuis celles traitées dans l’Atlas des espè- court. R.L. la signalaient dans cette 1997 au cours de sorties libres et ces rares ou protégées de Franche- localité et les environs d’Héricourt plus occasionnellement au cours Comté. Un « _ » signale les espè- (Couthenans, Chavanne) et de de travaux de stage universitaire ces traitées par FERREZ (2003). -

L'exposition Dresse Le Premier Bilan Sur L'histoire Du Verre Et Du Cristal En Lorraine De L'époque Antique Au Début Du X
Voyage au pays des ancêtres Comte Hennezel d’Ormois VOYAGES AU PAYS DES ANCETRES TABLE DES MATIERES VOYAGES AU PAYS DES ANCETRES 1 VOYAGES AU PAYS DES ANCETRES 4 AVERTISSEMENT 4 AVANT PROPOS 4 PREMIER VOYAGE EN LORRAINE – 1910 8 LA ROCHERE - PREMIER SEJOUR (1) 8 HENNEZEL - PREMIER SÉJOUR (2) 12 LE GRANDMONT (3) 13 VIOMENIL (4) 14 LA PILLE (5) 15 COMPLEMENT AU PREMIER VOYAGE EN LORRAINE - FEVRIER 1911 17 LA PILLE (6) 17 AUTRES VOYAGES (7) 18 PAYS DE VAUD 1911 – ARDENNES 1919– PAYS-BAS et FRANCHE-COMTE 1928 18 SECOND VOYAGE EN LORRAINE - JUILLET 1928 19 VESOUL 19 LUXEUIL 19 PLOMBIERES 19 LE VAL D'AJOL 19 REMIREMONT 20 EPINAL (8) 21 CHARMOIS L‘ORGUEILLEUX (9) 22 LA NEUVE VERRERIE (10) 24 LE TOLLOY (11) 26 LE TOLLOY (12) 28 VIOMENIL (13) 31 GRANDMONT - SECONDE VISITE (14) 36 LA PILLE - SECONDE VISITE (15) 39 LA BATAILLE - PREMIERE VISITE (16) 43 LA BATAILLE - SECONDE VISITE (17) 46 BELRUPT (18) 50 HENNEZEL - DEUXIEME VISITE (19) 52 Site internet de Paul Philippe d’Hennezel 1/257 Voyage au pays des ancêtres Comte Hennezel d’Ormois GRUEY-LES-SURANCES (20) 56 BAINS LES BAINS 56 XERTIGNY 56 ARCHES (21) 58 BRUYERES 59 MATTAINCOURT 61 MIRECOURT (22) 61 BETTONCOUR – VISITE AUX CHATELAINS (23) 64 Comment Abraham, seigneur du Tourchon, tua Jacob, seigneur de Senennes ? (24) 68 VEZELISE (25) 68 TROISIEME VOYAGE EN LORRAINE – OCTOBRE 1928 (26) 72 L’EPINE 72 AUVE 73 STE MENEHOULD (27) 76 CLERMONT-EN-ARGONNE (28) 81 VERDUN 82 NANCY 85 HAROL (29) 87 LA PILLE - TROISIEME VISITE (30) 90 LE TOURCHON – PREMIERE VISITE (31) 94 QUATRIEME VOYAGE EN LORRAINE – -

Schéma Départemental Relatif À L'accueil Et À L'habitat Des Gens Du Voyage
LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE Schéma départemental relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage Révision 2018 - 2024 SOMMAIRE I. PRÉAMBULE 4 Contexte réglementaire et généralités 4 Modalités de révision 6 II. DIAGNOSTIC ET BESOINS 8 La présence des gens du voyage en Haute-Saône 8 Le passage 8 Le grand passage 8 La sédentarisation ou l’ancrage territorial 9 1. L’ancrage en Haute-Saône 9 2. Terrains familiaux et habitat adapté 11 2.1 Les terrains familiaux 12 2.2 Les logements adaptés 13 2.3 Les logements de droit commun 15 III. ÉTAT DES LIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA 16 Rappel des objectifs initiaux du schéma 2012-2018 16 Dispositif d’accueil prévu au schéma départemental 16 Bilan de réalisation et de fonctionnement des aires 18 1. Les aires d’accueil réalisées/à réaliser 18 1.1 Localisation géographique dans le département 18 1.2 Données techniques et fonctionnelles 19 2. Les aires de grand passage réalisées/à réaliser 21 2.1 Localisation géographique dans le département 21 2.2 Données techniques et fonctionnelles 22 3. Les aires à créer 22 3.1 Bilan de réalisation des projets identifiés en 2012 23 4. La fréquentation des aires du département 26 4.1 Les aires d’accueil 26 4.2 Les aires de grand passage 27 4.3 Recensement des installations hors des aires officielles 28 Bilan quantitatif des aires 30 1. Récapitulatif de l’offre territoriale en 2018 30 2. Analyse et conclusion 30 Bilan qualitatif des aires 31 1. -

Projet D'arrêté Cadre Interdépartemental BFC 2021
PRÉFET DE LA COTE-D’OR PRÉFET DU DOUBS PRÉFET DU JURA PRÉFET DE LA NIÈVRE PRÉFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE PRÉFET DE LA HAUTE- SAÔNE PRÉFET DE L’YONNE PRÉFET DU TERRITOIRE-DE-BELFORT Liberté Égalité Fraternité Arrêté cadre interdépartemental n°2021 zzz-yyy relatif à la mise en place des principes communs de vigilance et de gestion de la ressource en eau en période d’étiage en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE VU la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-3 à L.213.3, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, R.211-66 à R.211-70 et R214-1 à R.214-56 ; VU le code du domaine public fluvial et notamment les articles 25, 33 et 35 ; VU le code civil et notamment les articles 640 et 645 ; VU le code de la santé publique et notamment les articles R.1321-1 à R.1321-66 ; VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.2212-5 et l’article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l’État dans un département en matière de police ; VU le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse ; VU les SDAGE Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie en vigueur ; VU l’arrêté n° 2015103-0014 du 13 avril 2014 -

Contribution À La Connaissance De La Flore De Haute-Saône Matériaux Pour Un Inventaire De La Flore Vasculaire De Haute-Saône
Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne, 1 - Société Botanique de Franche-Comté Contribution à la connaissance de la flore de Haute-Saône Matériaux pour un inventaire de la flore vasculaire de Haute-Saône par Yorick Ferrez Yorick Ferrez, 32b rue Plançon, F-25000 Besançon Courriel : [email protected] Résumé - Cet article présente les résultats de divers inventaires floristiques menés depuis 1993 en Haute-Saône. La répartition haut-saônoise de plus de 80 taxons est exposée et analysée au regard des données de la bibliographie ancienne et récente. Quelques cartes de répartition et une liste bibliographique sont également proposées. Summary - This article presents results of various flora inventories since 1993 in Haute-Saône. Over 80 taxons repartitions are explained and analysed with regards to more or less old and recent datas. Some repartition maps and a reading references list can also be found. Mots-clés : Haute-Saône, inventaire floristique, cartographie floristique, bibliographie. e département de la Haute- références. Nous avons retenu dans Comté (Y. FERREZ , J.-F. PRO S T et al., Saône n’a jamais été très pros- ce travail uniquement les articles 2001) propose également une syn- L pecté par les botanistes. En effet, contenant des informations d’ordre thèse des connaissances concer- R. Maire écrivait déjà en 1896 : floristique concernant les végétaux nant les taxons rares à l’échelle de « Différents ouvrages ont été publiés vasculaires. la Franche-Comté dont 95 intéres- sur la flore de la Haute-Saône : le sent la Haute-Saône. premier et le plus complet est le En consultant cette liste, on remar- catalogue raisonné des plantes de que immédiatement que l’essentiel Le présent article ne prétend pas être la Haute-Saône, de M. -

CC Des Hauts Du Val De Saône (Siren : 200036150)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC des Hauts du Val de Saône (Siren : 200036150) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Jussey Arrondissement Vesoul Département Haute-Saône Interdépartemental non Date de création Date de création 27/12/2012 Date d'effet 01/01/2013 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Romain MOLLIARD Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 2 rue de l'Hotel de Ville Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 70500 JUSSEY Téléphone 03 84 77 19 90 Fax Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 8 721 1/6 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 17,73 Périmètre Nombre total de communes membres : 48 Dept Commune (N° SIREN) Population 70 Aboncourt-Gesincourt (217000025) 217 70 Aisey-et-Richecourt (217000090) 105 70 Arbecey (217000256) 255 70 Augicourt (217000355) 182 70 Barges (217000496) 97 70 Betaucourt (217000660) 176 70 Betoncourt-sur-Mance (217000702) 31 70 Blondefontaine (217000744) 260 70 Bougey (217000785) 94 70 Bourbévelle (217000868) 75 70 Bourguignon-lès-Morey (217000892) 46 70 Bousseraucourt (217000918) 49 70 Cemboing (217001122) -

Rapport Sur Le Sevice Des Archives Departementales, Communales Et Hospitalieres
ç; 23 n1tt4/flf ARCHIVES DÉPARTEMENTALES Rapport du conservateur des archives LOCAL Les travaux entrepris pour lagrandissement du bâtiment des archives sont à la veille de prendre fin. Deux étages même sont déjà ocèupés le premier, oh jai mis eu place les séries K, L, M, N, Q, qui sont les plus importantes des archives mo- dernes et dans lesquelles sont compris les documents concernant ladministration générale, départementale et communale, le personnel, la comptabilité et les domaines - le rez-de-chaus- sée où est installée la bibliothèque administrative dont les Précieuses collections sont, àlheure quil est, définitivement classées. Il reste à meubler de rayonnages le troisième étage qui con- tiendra la moitié des archives anciennes, cest-à-dire la série A et la plus grande partie de la série B, - le second étant ré- servé aux séries C, D, E, G et II. Cet étage est mansardé on pourrait y placer, outre la garniture du pourtour, six étagères doubles, soit 2,850 kilog. de fer, ce qui, au prix adopté de 0,80 cent, par kilog., entraînerait une dépense nouvelle de 2,280 fr. Jai lhonneur de vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien solliciter du Conseil général le vote de cette somme qui permet- tra dachever loeuvre commencée et dassurer la conservation indéfinie des richesses historiques du département, RÉINTÉGRATIONS ET DONS DARCHIVES ANCIENNES Je suis heureux de vous apprendre que, se conformant à lavis exprimé par M. le ministre de lintérieur dans sa dépêche du 20 octobre 1883, M. le maire de Luxeuil a fait remettre aux archives départementales les documents de lancien Buea15 de c OL ! .