Stratégie « Null Offall Lëtzebuerg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Shifting Beverage Landscape
IBDEA 2016 The Shifting Beverage Landscape March 19, 2016 Beverage Marketing Capabilities Beverage Marketing Corporation utilizes an integrated model for providing information, analysis and advice to beverage industry clients Unique Beverage Industry Expertise for Providing “Added-Value” to Selected Clients Cutting Edge Insights: New Age Emergence, Multiple Beverage Competition, Specialty Beer Opportunity, Bottled Water Dominance, Hyper-Category Competition, Micro-Marketing Age -2- Copyright © 2016 Beverage Marketing Corp. The Shifting Beverage Landscape Agenda I. Market Overview II. Key Trends III. Category Updates IV. Projections -3- Copyright © 2016 Beverage Marketing Corp. The Shifting Beverage Landscape State of the Industry – The Good and the Bad Beverage Headlines Liquid refreshment beverage market grows for second consecutive year in 2015 after flat performance in 2013 Carbonated soft drinks experience another modest sales decline in 2015 Bottled water continues its solid growth trend led by single-serve water segment Niche categories continue to outperform traditional mass-market categories Wine and spirits lead alcohol growth in 2015, and beer experiences slower growth performance -4- Copyright © 2016 Beverage Marketing Corp. The Shifting Beverage Landscape The economy continues to move in a positive direction with improved GDP growth and lower unemployment, but improvement has been slow due to severity of the recession Quarterly GDP Change Unemployment Rate 2010 – 2015 2000 – 2015 10% 9.6% 9.3% 9.0% 8% 8.1% 7.4% 6.2% 6% 6.0% 5.8% 5.8% 5.5% 5.1% 5.3% 4.7% 4.6% 4.6% 4% 4.0% 2% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 Source: Beverage Marketing Corporation; Bureau of Economic Analysis, Department of Commerce, Department of Labor -5- Copyright © 2016 Beverage Marketing Corp. -

Global Journal of Business Disciplines
Volume 4, Number 1 Print ISSN: 2574-0369 Online ISSN: 2574-0377 GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS DISCIPLINES Editor: Qian Xiao Eastern Kentucky University Co Editor: Lin Zhao Purdue University Northwest The Global Journal of Business Disciplines is owned and published by the Institute for Global Business Research. Editorial content is under the control of the Institute for Global Business Research, which is dedicated to the advancement of learning and scholarly research in all areas of business. Global Journal of Business Disciplines Volume 4, Number 1, 2020 Authors execute a publication permission agreement and assume all liabilities. Institute for Global Business Research is not responsible for the content of the individual manuscripts. Any omissions or errors are the sole responsibility of the authors. The Editorial Board is responsible for the selection of manuscripts for publication from among those submitted for consideration. The Publishers accept final manuscripts in digital form and make adjustments solely for the purposes of pagination and organization. The Global Journal of Business Disciplines is owned and published by the Institute for Global Business Research, 1 University Park Drive, Nashville, TN 37204-3951 USA. Those interested in communicating with the Journal, should contact the Executive Director of the Institute for Global Business Research at [email protected]. Copyright 2020 by Institute for Global Research, Nashville, TN, USA 1 Global Journal of Business Disciplines Volume 4, Number 1, 2020 EDITORIAL REVIEW BOARD Aidin Salamzadeh Rafiuddin Ahmed University of Tehran, Iran James Cook University, Australia Daniela de Carvalho Wilks Robert Lahm Universidade Europeia – Laureate International Western Carolina University Universities, Portugal Virginia Barba-Sánchez Hafiz Imtiaz Ahmad University of Castilla-La Mancha, Spain New York Institute of Technology Abu Dhabi Campus Wei He Purdue University Northwest Ismet Anitsal Missouri State University H. -
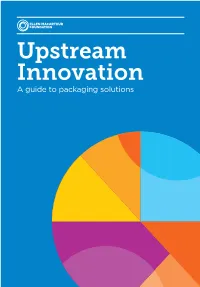
Upstream Innovation a Guide to Packaging Solutions This Guide Is Not About the State of Global Plastic Pollution
Upstream Innovation A guide to packaging solutions This guide is not about the state of global plastic pollution It's about solutions 4 | UPSTREAM INNOVATION UPSTREAM INNOVATION | 5 Foreword This book is intended as a practical guide to help The circular economy is a bigger idea that goes beyond treating the symptoms of the current organisations innovate towards achieving their circular economy to tackle the root causes of many economy goals for packaging. Packed with practical global challenges, including climate change and biodiversity loss, while providing opportunities for tips, decision support frameworks, and case studies, it is better growth. It can scale fast across industries, designed for marketers, product designers, and packaging providing the solutions that people are calling for. engineers new to the idea of a circular economy for It is now widely recognised that a circular economy packaging, as well as for seasoned practitioners. approach is the only solution that can match the scale of the plastic pollution problem.2 It allows us to redesign the entire plastics system to not only In January 2016, the Ellen MacArthur Foundation overcome this global challenge, but to do so in launched the landmark report The New Plastics a way that allows us to build better growth, and Economy – Rethinking the Future of Plastics,1 laying create solutions at speed and scale. More than bare for the first time the enormous environmental 1,000 organisations have united behind the Ellen and economic downsides associated with our MacArthur Foundation’s vision of a circular economy current “take-make-waste” plastics economy. It for plastic, in which we eliminate the plastic we don’t gained global headlines with its estimate that, on need, innovate towards new materials and business current track, there could be more plastic than fish in models, and circulate all the plastic we use. -

Good Design 2014 Awarded Product Designs and Graphics and Packaging
GOOD DESIGN 2014 AWARDED PRODUCT DESIGNS AND GRAPHICS AND PACKAGING THE CHICAGO ATHENAEUM: MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN THE EUROPEAN CENTRE FOR ARCHITECTURE ART DESIGN AND URBAN STUDIES ELECTRONICS 2014 BeoLab 18, 2013 Designers: Torsten Valeur, David Lewis Designers, Copenhagen, Denmark Manufacturer: Bang & Olufsen A/S, Struer, Denmark Carbide Series® SPEC Range PC Gaming Case, 2014 Designers: BMW Group DesignworksUSA, Newbury Park, CA, USA Manufacturer: Corsair, Fremont, CA, USA Simple Audio Listen Speakers, 2013 Designers: BMW Group DesignworksUSA, Newbury Park, CA, USA Manufacturer: Corsair, Fremont, CA, USA Bretford, Inc. PowerRack® for iPad 2, 2012 Designers: Cesaroni Design Associates, Inc., Glenview, IL, USA Manufacturer: Bretford, Inc., Franklin Park, IL, USA JBL GX, 2014 Designers: Kasin Chan, LDA, Irvine, CA, USA Manufacturer: Harman International, Northridge, USA Moto X, 2013 Designers: Consumer Experience Design Team, Motorola Mobility LLC, Chicago, IL, USA Manufacturer: Motorola Mobility LLC, Chicago, IL, USA Big Turtle Shell, 2013 Designers: Caro Krissman, Outdoor Tech, Los Angeles, CA, USA Manufacturer: Outdoor Tech, Los Angeles, CA, USA Motorola Solutions TC55 Touch Computer, 2013 Designers: Innovation & Design, Motorola Solutions, Inc., Holtsville, NY, USA Manufacturer: Motorola Solutions, Inc., Holtsville, NY, USA Logitech Broadcaster, 2012 Designers: Chris Loew, Brett Newman, Leo Kopelow, Sven Newman, Chris Loew, Brett Newman, Leo Kopelow, Sven Newman, Daylight, San Francisco, CA, USA Manufacturer: Logitech, Newark, CA, USA Dropcam Pro, 2013 Designers: Dan Harden, Rob Strickler, Whipsaw Inc, San Jose, CA, USA Manufacturer: Dropcam, San Francisco, CA, USA Good Design Awards 2014 Page 1 of 50 October 31, 2014 © 1992-2015 The Chicago Athenaeum - Use of this website as stated in our legal statement. -

Soda Still on the Menu: Progress, but More to Do to Get Soda Off Restaurant Children’S Menus
July 2019 Soda on the Menu: Progress,Still but More to Do to Get Soda off Restaurant Children’s Menus REPORT WRITTEN BY: Sara Ribakove and Margo G. Wootan, D.Sc. Center for Science in the Public Interest www.cspinet.org Soda Still on the Menu: Progress, but More to Do to Get Soda off Restaurant Children’s Menus About the Center for Science in the Public Interest CSPI is America’s food and health watchdog. We are a rigorous driver of food system change to support healthy eating, safe food, and the public’s health. We transform the built food environment through leading-edge policy innovations grounded in meticulous research and powerful advocacy. We galvanize allies and challenge industry, driving system-wide changes and healthier norms for everyone, leveraging the greatest benefits for people facing the greatest risk. CSPI is fiercely independent; we accept no government or corporate grants. Acknowledgments Peter Lurie, Julia McCarthy, Andrea McGowan, Laura MacCleery, Darya Minovi, and Jillian Morgan provided valuable suggestions and review of the report, for which we are grateful. For more information, contact: Center for Science in the Public Interest [email protected] 202-777-8352 Soda Still on the Menu is available online, free of charge at cspinet.org/KidsMealSoda2019 July 2019 Cover Photos: LightField Studios/shutterstock.com (top left), andresr/iStockphoto.com (top right), yacobchuk/iStockphoto.com (bottom left), mustafagull/iStockphoto.com (bottom right). 2 cspinet.org Soda Still on the Menu: Progress, but More to Do to Get Soda off Restaurant Children’s Menus Executive Summary Americans are eating out more frequently than in the past. -

Sustainability of Reusable Packaging–Current Situation and Trends
Resources, Conservation & Recycling: X 6 (2020) 100037 Contents lists available at ScienceDirect Resources, Conservation & Recycling: X journal homepage: www.journals.elsevier.com/resources-conservation-and-recycling-x Sustainability of reusable packaging–Current situation and trends T ⁎ Patricia Megale Coelhoa, Blanca Coronaa, Roland ten Kloosterb, Ernst Worrella, a Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Princetonlaan 8A, 3584 CB, Utrecht, the Netherlands b Department of Design, Production and Management, Twente University, Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede, the Netherlands ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Packaging plays an important role in safely distributing products throughout today's society and supply chains. Packaging With a consumption of about 40% of plastics and 50% of paper in Europe, the packaging sector is a large user of Reuse materials. Packaging has a lot of environmental impacts, while it also represents a significant cost in the current Refill supply system. Reusable packaging has been suggested as an option to significantly reduce environmental im- Circular economy pacts. In this paper, we review the trends in reusable packaging and the literature on reusable packaging to Environmental impact generate insights into the current state-of-the-art knowledge and identify directions for research and develop- Economics ment. This can help to better understand the key factors underlying the design and impacts of more sustainable packaging systems. 1. Introduction solid waste (Eurostat, 2019). A Dutch consumer uses about 400 g of packaging material a day (Ten Klooster, 2017). The amount of packa- The increasing environmental pressure on the economic system re- ging material has been growing in past years, as a consequence of retail quires a reconsideration of our economic paradigm. -

Sent: Monday, January 05, 2015 5:38 PM To: @NBC Uni LIM DFW
Sent: Monday, January 05, 2015 5:38 PM To: @NBC Uni LIM DFW Feedback On The Site Subject: Viewer E-mail - www.nbcdfw.com - Contact Us (On Air or Online) - Transcript of Story Message: You ran a story on the evening news on 1/4/15 about people becoming more health conscious about drinks over the next 25 years. I caught a portion and would like to hear the entire report. The story was about drinks from vending machines changing even the bottling of drinks to make more healthy drinks. Can you send a link to that story on your website? Thanks From: NBCUniversal Date: Mon, Jan 5, 2015 at 6:23 PM Subject: RE: Viewer E-mail - www.nbcdfw.com - Contact Us (On Air or Online) - Transcript of Story Unfortunately, I do not have a copy of the video, but here is the script. WHAT KINDS OF DRINKS WILL WE BE CONSUMING IN 25 YEARS? BEVERAGE COMPANIES ARE STRUGGLING RIGHT NOW... WITH A LONG-TERM DECLINE IN SODA SALES... AS CONSUMERS DITCH ARTIFICIAL SWEETENERS... AND SUGARY SOFT DRINKS. SARA EISEN SHOWS US WHAT THE FUTURE HOLDS. ( "Orange, vanilla, cherry") CHOICES. PERSONALIZATION. CUSTOMIZATION. THAT'S THE KEY FOR BEVERAGES IN THE NEXT 25 YEARS. PEPSI... IS ALREADY THINKING ABOUT IT.. AS IT PREPARES TO ROLL-OUT DRINKFINITY.. (BRAD JAKEMAN, PEPSICO GLOBAL BEVERAGES GROUP) Q: what does the drinkfinity tell us about the consumer in 25 years A: "it tells us a number of things - firstly consumers are going to look for much more exciting propositions... vast amount of choice available to them" YOU'RE ALREADY STARTING TO SEE THAT IN COKE'S FREESTYLE MACHINE.. -
How Indra Nooyi Turned Design Thinking Into Strategy “A Well-Designed Product Is One You Fall in Love With.” an Interview with Indra Nooyi by Adi Ignatius
HBR.ORG SEPTEMBER 2015 REPRINT R1509F SPOTLIGHT ON THE EVOLUTION OF DESIGN THINKING How Indra Nooyi Turned Design Thinking Into Strategy “A well-designed product is one you fall in love with.” An interview with Indra Nooyi by Adi Ignatius This document is authorized for use only by Ashley Cleckley in Operations Management at Strayer University, 2019. SPOTLIGHT ON THE EVOLUTION OF DESIGN THINKING SPOTLIGHT INTERVIEW 2 Harvard Business Review September 2015 COPYRIGHT © 2015 HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. This document is authorized for use only by Ashley Cleckley in Operations Management at Strayer University, 2019. FOR ARTICLE REPRINTS CALL 800-988-0886 OR 617-783-7500, OR VISIT HBR.ORG How Indra Nooyi Turned Design Thinking Into Strategy “A well-designed product is one you fall in love with.” JUST A FEW years ago, it wasn’t clear whether Indra Nooyi would survive as PepsiCo’s CEO. Many investors saw Pepsi as a bloated giant whose top brands were losing market share. And they were critical of Nooyi’s shift toward a more health-oriented overall product line. Prominent activist investor Nelson Peltz fought hard to split the company in two. These days Nooyi, 59, exudes confidence. The company has enjoyed steady revenue growth during her nine years in the top job, and Pepsi’s stock price is ris- ing again after several flat years. Peltz even agreed to a truce in return for a board seat for one of his allies. All of this frees Nooyi to focus on what she says is now driving innovation in the company: design thinking. -

Alimentacion
1 Alimentación AAlimentaciónlimentacióny gran consumo elEconomista Revista mensual 17 de junio de 2014 | Nº 21 Jaime Aguilera, presidente de Unilever España “Unilever exporta desde Mercadonatiradelcarrocon España más de la mitad de la 400 lanzamientos al año Actualidad | P4-8 producción a 13 países” Entrevista | P12 El 98% de las Alcampo refuerza sus ventas a granel para alimentarias nunca seguir bajando precios invierte en innovación Comercio | P30 2 SUMARIO Alimentación 6. Actualidad Actualidad Industria Mercadona tira del carro Sólo un 2% de las empresas El dueño de ‘Kleenex’ quiere de la innovación alimentarias innovan entrar en las oficinas La cadena valenciana que preside Juan Roig ha El gasto que esta industria ha consagrado a la I+D Kimberly-Clark es ya uno de los principales proveedores de referenciado 400 nuevos productos el último año ha caído un 34,6 por ciento desde 2008 sistemas de dispensación, materiales de limpieza e higiene 12. Entrevista Jaime Aguilera, presidente de Unilever “Unilever exporta desde España más de la mitad de la producción a 13 países” 18. Industria José López, vicepresi- 4 26 dente ejecutivo de Nestlé “España tiene todo lo necesario para ser un actor agroalimentario muy importante” 20. Industria Bodegas Protos refuerza sus ventas en el súper Se adapta al trasvase del consumo de bares a hogares y apuesta por mejorar sus exportaciones 30 34 Comercio Restauración Edita: Editorial Ecoprensa S.A. Presidente de Ecoprensa: AlfonsodeSalas Alcampo refuerza el granel Just Eat mira a Asia y América Vicepresidente: Gregorio Peña Director Gerente: Julio Gutiérrez Director Comercial: Juan Ramón Rodríguez Relaciones Institucionales: Pilar Rodríguez Subdirector de RRII: Juan Carlos Serrano Jefe de Publicidad: Sergio de María para seguir bajando precios Latina tras salir a Bolsa Director de elEconomista: Amador G. -

Good Design 2016 Awarded Product Designs and Graphics and Packaging
GOOD DESIGN 2016 AWARDED PRODUCT DESIGNS AND GRAPHICS AND PACKAGING THE CHICAGO ATHENAEUM: MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN THE EUROPEAN CENTRE FOR ARCHITECTURE ART DESIGN AND URBAN STUDIES ELECTRONICS 2016 Number 3810 Porsche Design 911 Soundbar 2015 Designers: Studio F.A. Porsche, Zellam See, Austria Manufacturer: Porsche Design Gesellschaft mbH., Ludwigsburg, Germany Number 3836 Mini Handsfree 2015-2016 Designers: Habits Srl., Milan (MI), Italy Manufacturer: Comelit Group SpA., Rovetta, San Lorenzo (BG), Italy Number 3840 Busch-easycare® 2013-2015 Designers: Inhouse, Busch-Jaeger Elektro GmbH., Luedenscheid, Germany Manufacturer: Busch-Jaeger Elektro GmbH., Luedenscheid, Germany Number 3851 Audiofrog GB Series Component Mobile Speakers 2015 Designers: Aung Win, Myk Lum LDA, Irvine, California, USA Manufacturer: Audiofrog, Inc., Monrovia, California, USA Number 3853 Connex mini 2015-2016 Designers: Omri Bar Zeev, Etay Amir, David Keller, and Boaz Zemer, Prime.total Product Design, Tel Aviv, Israel Manufacturer: Amimon Ltd., Herzeliya, Israel Number 3877 Si500 Video Speaker Microphone 2015-2016 Designers: Motorola Solutions Innovation Design & Design Engineering teams, Motorola Solutions, Plantation, Florida, USA Manufacturer: Motorola Solutions, Plantation, Florida, USA Number 3878 OZO Virtual Reality Camera 2014-2016 Designers: Nokia Design, Nokia Technologies, Sunnyvale, California, USA Manufacturer: Nokia Technologies, Sunnyvale, California, USA Number 3912 Robin 2015-2016 Designers: NextBit Systems Inc., San Francisco, California, USA Manufacturer: NextBit Systems Inc. San Francisco, California, USA Number 3913 TYPO keyboard for iPad Mini 2014-2015 Designers: Bluemap Design and TYPO, Bluemap Design, New York, New York, USA Manufacturer: TYPO innovations LLC., Las Vegas, Nevada, USA Good Design Awards 2016 Page 1 of 70 December 1, 2016 © 1992-2016 The Chicago Athenaeum - Use of this website as stated in our legal statement. -

Менеджмент: Новые Идеи Harvard Business Review — Россия Содержание
Сборник Статей Менеджмент: новые идеи HARVARD BUSINESS REVIEW — россия Содержание Можно ли у вас в компании говорить начистоту? Джеймс Детерт, Этан Баррис Если людям хорошо, прибыль растет Сигал Барсаде, Оливия О’Нейл Ошибки реформаторов: почему попытки преобразований заканчиваются провалом Джон Коттер Стратегический взгляд на силы конкуренции Майкл Портер Черные лебеди и риск-менеджмент Нассим Талеб, Дэниел Гольдстайн, Марк Шпицнагель Повелители цифр Томас Дейвенпорт Дизайнерское мышление Тим Браун Перехитрить искусственный интеллект Томас Дейвенпорт, Джулия Кирби Мы разные, но мы — одно целое Цедал Нили «Мы должны иначе делать деньги» Ади Игнейшес 2 Можно ли у ваС в коМпании говорить начиСтоту? Можно ли у вас в компании говорить начистоту? При всех своих благих намерениях на деле начальники не очень-то позволяют подчиненным откровенно высказываться. Джеймс Детерт, Этан Баррис полне вероятно, что подчиненные не сообщают в ходе исследований мы выяснили, что, по сравне- вам важную информацию. например, не гово- нию с другими организациями, из компаний, в кото- врят, что забуксовал проект или кто-то из менед- рых о проблемах действительно можно говорить сво- жеров ведет себя непорядочно. или как можно было бодно, люди уходят гораздо реже и работают лучше. бы подстегнуть продажи, отладить рабочие процессы. в частности, в нескольких финансовых фирмах и про- пусть даже вы лично как начальник вполне открыты изводственные, и финансовые результаты были суще- и демократичны, но ваши сотрудники все равно пред- ственно выше в подразделениях, у сотрудников кото- почитают держать язык за зубами — не критиковать рых, по их же оценкам, было больше свободы слова. ваши идеи и не предлагать свои. Менеджерам одной сети ресторанов удалось убедить Это так, даже если вы, подобно большинству руко- корпоративное руководство в необходимости преоб- водителей, верите, что у вас царят «равенство и брат- разований, и благодаря этому текучесть кадров сокра- ство». -

Agosto L 2014
Integridad inigualable nº 78 julio - agosto l 2014 GAMA DE PRODUCTOS: LA DIFERENCIA ES NECTA. Una co- lección extraordinaria de distribuidores automáticos, donde cada una de las máquinas está concebida y fabricada para garantizar una pausa de calidad superior. Para todos los tipos de ambientes, aún los más inesperados y sorprendentes, la gama Necta ofrece la mejor solución para satisfacer todos los deseos de vuestros clientes. Se debe sólo elegir entre las innumerables obras de arte. La diferencia es Necta, el resultado inigualable. Frescura inigualable TANGO: LA DIFERENCIA ES NECTA. Esta nueva obra maestra del Snack and Food permite modular perfectamente la oferta de productos frescos, snack y bebidas para garantizarles siempre la máxima rentabilidad. Además, la extremada exibilidad en la conguración hace que Tango sea la solución ideal para las ubicaciones más exigentes. La diferencia es Necta, el resultado inigualable. Frescura inigualable TANGO: LA DIFERENCIA ES NECTA. Esta nueva obra maestra del Snack and Food permite modular perfectamente la oferta de productos frescos, snack y bebidas para garantizarles siempre la máxima rentabilidad. Además, la extremada exibilidad en la conguración hace que Tango sea la solución ideal para las ubicaciones más exigentes. La diferencia es Necta, el resultado inigualable. Hostel Vending • nº 78 julio - agosto 2014 En la actualidad ExistEn cErca dE dos mil tiEndas SUMARIO 78 HOSTEL VENDING dE VEnding 24 Horas y las pErspEctiVas apuntan a un crEcimiEnto continuado dE EstE modElo dE nEgocio @hostelvending