B La Contribution Partielle Des Poussières Aux Autres Sols Et
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

01. Antarctica (√) 02. Arabia
01. Antarctica (√) 02. Arabia: https://en.wikipedia.org/wiki/Arabian_Desert A corridor of sandy terrain known as the Ad-Dahna desert connects the largeAn-Nafud desert (65,000 km2) in the north of Saudi Arabia to the Rub' Al-Khali in the south-east. • The Tuwaiq escarpment is a region of 800 km arc of limestone cliffs, plateaux, and canyons.[citation needed] • Brackish salt flats: the quicksands of Umm al Samim. √ • The Wahiba Sands of Oman: an isolated sand sea bordering the east coast [4] [5] • The Rub' Al-Khali[6] desert is a sedimentary basin elongated on a south-west to north-east axis across the Arabian Shelf. At an altitude of 1,000 m, the rock landscapes yield the place to the Rub' al-Khali, vast wide of sand of the Arabian desert, whose extreme southern point crosses the centre of Yemen. The sand overlies gravel or Gypsum Plains and the dunes reach maximum heights of up to 250 m. The sands are predominantly silicates, composed of 80 to 90% of quartz and the remainder feldspar, whose iron oxide-coated grains color the sands in orange, purple, and red. 03. Australia: https://en.wikipedia.org/wiki/Deserts_of_Australia Great Victoria Western Australia, South Australia 348,750 km2 134,650 sq mi 1 4.5% Desert Great Sandy Desert Western Australia 267,250 km2 103,190 sq mi 2 3.5% Tanami Desert Western Australia, Northern Territory 184,500 km2 71,200 sq mi 3 2.4% Northern Territory, Queensland, South Simpson Desert 176,500 km2 68,100 sq mi 4 2.3% Australia Gibson Desert Western Australia 156,000 km2 60,000 sq mi 5 2.0% Little Sandy Desert Western Australia 111,500 km2 43,100 sq mi 6 1.5% South Australia, Queensland, New South Strzelecki Desert 80,250 km2 30,980 sq mi 7 1.0% Wales South Australia, Queensland, New South Sturt Stony Desert 29,750 km2 11,490 sq mi 8 0.3% Wales Tirari Desert South Australia 15,250 km2 5,890 sq mi 9 0.2% Pedirka Desert South Australia 1,250 km2 480 sq mi 10 0.016% 04. -

Vol. 1 (1991) (1991.12.25) 原著論文 吉野正敏:新疆の沙漠地域の風と雨
Vol. 1 (1991) (1991.12.25) 原著論文 吉野正敏:新疆の沙漠地域の風と雨:Taklimakan desert, Wind storm, Circulation system schema, Desertification, Rain in desert…1-15 松村一夫・小島紀徳:沙漠緑化による炭素固定のエネルギー収支: Desert Afforestation, Carbon Balance, Irrigation, Green-house effect, Arid Lands…17-26 Kunihiro OTSUBO: Water Balance and Evaporation Property on Bare Soils in Lysimeters under Constant Weekly Water Supply: Water balance, Evaporation, Lysimeter, Bare soil…27-39 Nobuhiko OHGA: Distribution Patterns of Buried Seeds in the Herbaceous Lomas Community over the Entire Plateau on Loma Ancon in the Coastal Desert of Central Peru: Dead seeds, Distribution pattern, Fog, Herbaceous lomas, Viable seeds…41-51 長島秀樹・内田 修:SPOT 衛星画像による沙漠地形の 3 次元解析‐ 1986 年タクラマカン沙漠チーラ地区砂丘地帯の沙漠地形‐: Taklimakan desert, Three dimensional analysis, SPOT images, Sand dunes…53-59 短報 長島秀樹・趙 景峰・岡嵜守良・李 崇舜・夏 訓誠:タクラマカン沙 漠における気象要素と砂面変動の自動観測‐チーラでの 1990 年 10 月~1991 年 3 月の観測から‐:Taklimakan desert, Sand dunes, local wind…61-66 特集:日本沙漠学会沙漠工学研究分科会 沙漠工学を考える-第 1 回沙漠工学講演会講演要旨集- 遠藤 勲:沙漠工学の提唱…68-72 小島紀徳:沙漠にもっと水を…73-76 新田義孝:沙漠での有用物質生産‐沙漠を利用するバイオテクノロ ジー‐…77-81 吉川友章:沙漠を快適居住空間に…82-86 高野義大:日本に沙漠の研究施設を:86-90 総合討論…91 Vol. 2 (1992) (1992.12.25) 口絵 嶋田義仁:ニジェール川湾曲部の稲作 原著論文 嶋田義仁:人間の生産活動から見たサハラ南縁地帯の乾燥化‐マリ 国の事例‐: Drought, Sub-Sahara, The Inner Delta of the Niger, Pastoralism, Flood plains farming…1-17 安部征雄・山口智治・横田誠司・大塚義之・井伊博行:土壌表層に 集積する塩類の捕集法:Soil salt, Accumulation, Capture sheet… 19-17 Akihiko OKADA, Sadayo YABUKI, Cong-Qiang LIU, Zi-Wei HUANG: Distribution of Salt-Constituting Chemical Species in the Desert Soils of the Turpan Basin and Junggar Basin, Xinjiang, China: Desert, Desert soil, Salt, Evaporite, Gypsum, Bassanite, Thenardite, Glauberite, Eugsterite, Xinjiang, Turpan basin, Junggar basin…29-37 Takashi ISHIYAMA, Shigehiko SUGIHARA, Kiyoshi TSUCHIYA, P.J. -

Biodiversity in Sub-Saharan Africa and Its Islands Conservation, Management and Sustainable Use
Biodiversity in Sub-Saharan Africa and its Islands Conservation, Management and Sustainable Use Occasional Papers of the IUCN Species Survival Commission No. 6 IUCN - The World Conservation Union IUCN Species Survival Commission Role of the SSC The Species Survival Commission (SSC) is IUCN's primary source of the 4. To provide advice, information, and expertise to the Secretariat of the scientific and technical information required for the maintenance of biologi- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna cal diversity through the conservation of endangered and vulnerable species and Flora (CITES) and other international agreements affecting conser- of fauna and flora, whilst recommending and promoting measures for their vation of species or biological diversity. conservation, and for the management of other species of conservation con- cern. Its objective is to mobilize action to prevent the extinction of species, 5. To carry out specific tasks on behalf of the Union, including: sub-species and discrete populations of fauna and flora, thereby not only maintaining biological diversity but improving the status of endangered and • coordination of a programme of activities for the conservation of bio- vulnerable species. logical diversity within the framework of the IUCN Conservation Programme. Objectives of the SSC • promotion of the maintenance of biological diversity by monitoring 1. To participate in the further development, promotion and implementation the status of species and populations of conservation concern. of the World Conservation Strategy; to advise on the development of IUCN's Conservation Programme; to support the implementation of the • development and review of conservation action plans and priorities Programme' and to assist in the development, screening, and monitoring for species and their populations. -

Mid-Term Evaluation Report
REPUBLIC OF DJIBOUTI Ministry of Habitat, Urbanism and Environment ---------------------------------------------------------- Direction of Environment and Sustainable Development ----------------------------------------------------------- MID-TERM EVALUATION PROJECT: “Developing agropastoral shade gardens as an adaptation strategy for poor rural communities’’ FINAL REPORT Consultants: Gondo GBANYANGBE, Principal Consultant, Project Management & Evaluation Specialist January 2017 I. Project Summary Note (Summary Table) Project title: Developing agropastoral shade gardens as an adaptation strategy for poor rural communities ' Identification Number: Atlas Award ID: 00066414 ----- Project ID: 00082602 ---- PIMS ID: 4683 Evaluation schedule and evaluation report date: from 02 January to 28 February 2017 Region and country concerned by the project: Republic of Djibouti; RBAS Operational / Strategic Program: Energy and Environment for Development Strategy and Disaster Risk Reduction Implementing partner: DEDD (Directorate for Environment and Sustainable Development) and the United Nations Development Program (UNDP) Members of the evaluation team: Gondo GBANYANGBE, International Consultant, Head of Mission with technical support from DATE (Government) and UNDP Thanks to: This mid-term evaluation report was requested by the United Nations Development Program (UNDP), in Djibouti for the project funded by the Adaptation Fund (AF) for Climate Change. This solicitation meets one of the procedural requirements for all projects that are supported and funded by UNDP. To that end, we convey our sincere appreciation to UNDP, particularly the United Nations System Coordinator and his successful team for all the technical, material and financial support without which this mission could not be successfully accomplished. We also extend our sincere thanks to the Government of Djibouti through the Ministry in charge of the Environment for their support during this mid-term evaluation mission. -

Review of Current and Planned Adaptation Action: East Africa Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, United Republic of Tanzania and Uganda
Review of Current and Planned Adaptation Action: East Africa Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, United Republic of Tanzania and Uganda November 2011 About the Adaptation Partnership The Adaptation Partnership was formed in May 2010 Review of Current in response to a recognized need for development practitioners to share information and lessons on and Planned adaptation efforts. Chaired by Costa Rica, Spain and the United States, the goal of the partnership is to encourage effective adaptation by serving as an Adaptation Action: interim platform to catalyze action and foster communication among the various institutions and East Africa actors engaged in the effort to scale up adaptation and resilience around the world, particularly in the context of fast start finance. The Partnership is synthesizes lessons learned and good practices, highlighting needs and priorities, and identifying opportunities for cooperation and alignment of support to build resilience to the adverse effects of Contributing Authors: climate change. It is also enhancing communities of Hilary Hove, Daniella Echeverría, practice engaged in the adaptation effort. Jo-Ellen Parry Adaptation Partnership International Institute for Sustainable Development Website: http://www.adaptationpartnership.org/ Foreword In response to a growing awareness of the potential adverse effects of climate change and the particular vulnerability of developing countries to this process, a significant increase in adaptation action has been witnessed in recent years in Africa, Asia-Pacific, and Latin America and the Caribbean. These actions are providing opportunities to: increase understanding of the implications of climate change for the achievement of development objectives in the near and long terms; identify strategies and measures that can be taken to reduce climate vulnerability; communicate and build awareness of climate risks, opportunities and potential solutions; and begin implementing actions on the ground that build capacity to adapt to a changing climate. -

Rescue Training at Angel Thunder
June 2013/$5 Rescue Training at Angel Thunder Worldwide Air Force: Operations in Libya, the Horn of Africa, and Cyberspace The future of Light Attack is here. The Beechcraft AT-6 is the world’s finest Light Attack and Armed Reconnaissance aircraft. Purpose-built to leverage prior investment in the U.S. Air Force’s T-6, A-10C, and MC-12W platforms. The AT-6 is available at a fraction of the acquisition, sustainment and training costs of other combat aircraft. The AT-6 provides a full suite of synchronized, ground-based training capabilities and an established global logistics infrastructure. The AT-6 is the only American-made aircraft designed to meet the needs of a world where unpredictability is commonplace and flexibility is crucial. Learn more, visit missionreadyat-6.com ©2013 AT-6 is the trademark of Hawker Beechcraft Defense Company, LLC. ® We build aircraft you can believe in. All rights reserved. Beechcraft is a registered trademark of Hawker Beechcraft Corporation. Beech130259 Air Force Mag Ad - Light Attack 01.indd 1 2/1/13 2:12 PM BAILEY LAUERMAN Beechcraft Air Force Mag Ad - Light Attack 02 Beech130259 Pub: Air Force Mag Color: 4-color Size: Trim 8.125" x 10.875", Bleed 8.375" x 11.125" June 2013, Vol. 96, No. 6 Publisher Craig R. McKinley Editor in Chief Adam J. Hebert Editorial [email protected] Editor Suzann Chapman Executive Editors Michael C. Sirak John A. Tirpak News Editor Amy McCullough Senior Editor Marc V. Schanz Associate Editors 26 Aaron M. U. Church June Lee FEATURES Merri M. -

Ecosystem-Based Adaptation in Africa
Ecosystem-based Adaptation in Africa Rationale, Pathways, and Cost Estimates Tahia Devisscher April, 2010 Sectoral Report for the AdaptCost Study 1 Table of Contents Introduction......................................................................................................................... 3 1. Ecosystem-based Adaptation.......................................................................................... 3 1.1 What is Ecosystem-based Adaptation?..................................................................... 3 1.2 Why Ecosystem-based Adaptation? ......................................................................... 4 1.3 How to Measure the Adaptation Benefits and Costs of EbA?.................................. 5 1.4 The Unknowns........................................................................................................ 10 2. Effects of Climate Change on African Ecosystems...................................................... 14 2.1 African Ecosystems and Biodiversity..................................................................... 14 2.2 Present and Future Climate in Africa...................................................................... 17 2.3 Possible Impacts of Climate Change on Ecosystems ............................................. 19 2.3.1 Climate Change Effects on Ecosystems at the Continental Level................... 20 2.3.2 Economic Impacts of Climate Change on African Protected Areas: An Example of Ecosystem Services Loss...................................................................... -

Ärid-Zone Hydrology Investigations with Sotope Techniques Proceedings of an Advisory Group Meeting, Vienna, 6-9 November 1978
■ . ÄRID-ZONE HYDROLOGY INVESTIGATIONS WITH SOTOPE TECHNIQUES PROCEEDINGS OF AN ADVISORY GROUP MEETING, VIENNA, 6-9 NOVEMBER 1978 Ш W) INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, VIENNA, 1980 ARID-ZONE HYDROLOGY: INVESTIGATIONS WITH ISOTOPE TECHNIQUES STI/PUB/547 CORRIGENDUM Paper IAEA-AG-158/17, by J.Ch. Fontes et al. Page 237, authors’ names F o r P. POUCHON rea d P. POUCHAN (The Contents List should be corrected accordingly) Page 259, equation at top of page F o r 0.3 rea d 0.13 List of Participants Page 265, under ‘International Atomic Energy Agency (IAEA)’ Add the following name: Gonfiantini, R. Section of Isotope Hydrology, (Scientific Secretary) Division of Research and Laboratories ARID-ZONE HYDROLOGY: INVESTIGATIONS WITH ISOTOPE TECHNIQUES The following States are Members of the International Atomic Energy Agency: AFGHANISTAN HOLY SEE PHILIPPINES ALBANIA HUNGARY POLAND ALGERIA ICELAND PORTUGAL ARGENTINA INDIA QATAR AUSTRALIA INDONESIA ROMANIA AUSTRIA IRAN SAUDI ARABIA BANGLADESH IRAQ SENEGAL BELGIUM IRELAND SIERRA LEONE BOLIVIA ISRAEL SINGAPORE BRAZIL ITALY SOUTH AFRICA BULGARIA IVORY COAST SPAIN BURMA JAMAICA SRI LANKA BYELORUSSIAN SOVIET JAPAN SUDAN SOCIALIST REPUBLIC JORDAN SWEDEN CANADA KENYA SWITZERLAND CHILE KOREA, REPUBLIC OF SYRIAN ARAB REPUBLIC COLOMBIA KUWAIT THAILAND COSTA RICA LEBANON TUNISIA CUBA LIBERIA TURKEY CYPRUS LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA UGANDA CZECHOSLOVAKIA LIECHTENSTEIN UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST DEMOCRATIC KAMPUCHEA LUXEMBOURG REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S MADAGASCAR UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLIC OF KOREA MALAYSIA REPUBLICS DENMARK MALI UNITED ARAB EMIRATES DOMINICAN REPUBLIC MAURITIUS UNITED KINGDOM OF GREAT ECUADOR MEXICO BRITAIN AND NORTHERN EGYPT MONACO IRELAND EL SALVADOR MONGOLIA UNITED REPUBLIC OF ETHIOPIA MOROCCO CAMEROON FINLAND NETHERLANDS UNITED REPUBLIC OF FRANCE NEW ZEALAND TANZANIA GABON NICARAGUA . -
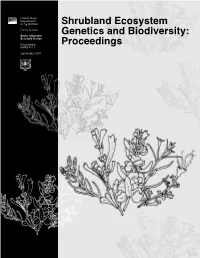
Shrubland Ecosystem Genetics and Biodiversity: Proceedings; 2000 June 13–15; Provo, UT
United States Department of Agriculture Shrubland Ecosystem Forest Service Genetics and Biodiversity: Rocky Mountain Research Station Proceedings Proceedings RMRS-P-21 September 2001 Abstract McArthur, E. Durant; Fairbanks, Daniel J., comps. 2001. Shrubland ecosystem genetics and biodiversity: proceedings; 2000 June 13–15; Provo, UT. Proc. RMRS-P-21. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 365 p. The 53 papers in this proceedings include a section celebrating the 25-year anniversary of the Shrub Sciences Laboratory (4 papers), three sections devoted to themes, genetics, and biodiversity (12 papers), disturbance ecology and biodiversity (14 papers), ecophysiology (13 papers), community ecology (9 papers), and field trip section (1 paper). The anniversary session papers emphasized the productivity and history of the Shrub Sciences Laboratory, 100 years of genetics, plant materials development for wildland shrub ecosystems, and current challenges in management and research in wildland shrub ecosystems. The papers in each of the thematic science sessions were centered on wildland shrub ecosystems. The field trip featured the genetics and ecology of chenopod shrublands of east-central Utah. The papers were presented at the 11th Wildland Shrub Symposium: Shrubland Ecosystem Genetics and Biodiversity held at the Brigham Young University Conference Center, Provo, UT, June 13–15, 2000. Keywords: wildland shrubs, genetics, biodiversity, disturbance, ecophysiology, community ecology Acknowledgments We thank the many people and organizations that assisted in the advance preparation and conduct of the symposium, anniversary celebration, and field trip. Brigham Young University President Merrill J. Bateman, Rocky Mountain Research Station Director Denver P. Burns, and Forest Service Vegetation Management and Protection Washington Office Director William T. -
Restaurants, Cafes, Bars, and Grocery Stores
. Welcome to Djibouti . Welcome to Djibouti Arrive, Survive, and Thrive in the Hottest Country on Earth Rachel Pieh Jones . for the expatriates who have called Djibouti home and for the Djiboutians who warmly welcome us By Rachel Pieh Jones www.djiboutijones.com Copyright 2020 . Table of Contents Introduction All Will Be Well in Djibouti Level 1 Arrive Chapter 1: Hotels and Homes Essay: But What’s Different about an Expat Family? Chapter 2: Restaurants, Cafes, Bars, and Grocery Stores Essay: Bread Baked in the Heat of Hell Level 2 Survive Chapter 3: Get Online, Find a Doctor, Dentist, Pharmacy, or Vet Essay: Land of the Red River Hogs Chapter 4: Care for the Body and Mind: salons, schools, sports Essay: Death by Heartbreak Level 3 Thrive Chapter 5: Worship, Rest, and Play Essay: A Mosque, a Books, and a Banister Chapter 6: Touring and Exploring Essay: White Gold Level 4 More Tips Transportation The Bawadi Mall Etiquette and Health Essay: To Kiss or Not to Kiss Money and Djibouti Resources and Miscellaneous Running, Biking, Sports Essay: Samia, Somalia, and Running for Last Place Suggested Tourist Itineraries Essay: Letter from Bankoulé Final Suggestions Maps Bonus Content (2020): What to wear, what to read, and more FAQ Suggested Packing List for moving to Djibouti and for visiting More essays and articles about Djibouti . Welcome to Djibouti Arrive, Survive, and Thrive in the Hottest Country on Earth . Introduction Welcome to Djibouti. First thing to do: join the Expats of Djibouti FaceBook group. You can ask all the questions I fail to answer here and connect with people. -

Appendix I & II Proposals
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals Secretariat provided by the United Nations Environment Programme PROPOSALS FOR AMENDMENT OF APPENDICES I AND II FOR CONSIDERATION BY THE NINTH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES Rome, 1-5 December 2008 Index PROPOSALS APPENDIX I MAMMALIA CETACEA Delphinidae I/1 Tursiops truncatus ponticus .......................................................................................1 I/2 Orcaella brevirostris ................................................................................................15 I/3 Sousa teuszii .............................................................................................................29 CARNIVORA Felidae I/4 Acinonyx jubatus ......................................................................................................37 SIRENIA Trichechidae I//5 Trichechus senegalensis ...........................................................................................55 ARTIODACTYLA Bovidae I/6 Ammotragus lervia ...................................................................................................71 AVES ANSERIFORMES Anatidae I/7 Aythya baeri .............................................................................................................77 FALCONIFORMES Accipitridae I/8 Neophron percnopterus ............................................................................................81 Falconidae I/9 Falco cherrug ...........................................................................................................87 -
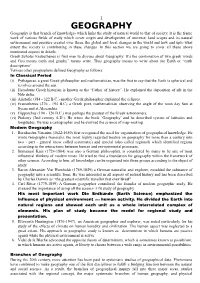
GEOGRAPHY Geography Is That Branch of Knowledge- Which Links the Study of Natural World to That of Society
1 GEOGRAPHY Geography is that branch of knowledge- which links the study of natural world to that of society. It is the frame work of various fields of study which cover origin and development of universe, land scapes and its natural environment and pressure created over them, the global and local changes in the world and how and upto what extent the society is contributing in these changes. In this section we are going to cover all these above mentioned aspects in details. Greek Scholar Eratosthenes is first man to discuss about Geography. It’s the combination of two greek words and Geo means earth and graphy” means write. Thus geography means to write about the Earth or “earth descriptions”. Various other geographers defined Geography as follows: In Classical Period (i) Pythagoras, a great Greek philosopher and mathematician, was the first to say that the Earth is spherical and revolves around the sun. (ii) Herodotus Greek historian is known as the “Father of history”. He explained the deposition of silt in the Nile delta. (iii) Aristotle (384 - 322 B.C.) another Greek philosopher explained the eclipses. (iv) Eratosthenes (276 - 194 B.C) a Greek poet, mathematician observing the angle of the noon day Sun at Syene and at Alexandria. (v) Hipparchus (190 - 120 B.C.) was perhaps the greatest of the Greek astronomers. (vi) Ptolemy (2nd century A.D.). He wrote the book ‘Geography’ and he described system of latitudes and longitudes. He was a cartographer and he evolved the science of map-making. Modern Geography 1. Bernhardus Varenius (1622-1650) first recognised the need for organisation of geographical knowledge.