Dossier Pédagogique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Pièce En Images
LA PIÈCE EN IMAGES Rebecca Marder et Suliane Brahim dans J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Chloé Dabert, 2017, photographie de répétition © Christophe Raynaud de Lage HISTOIRES DE FAMILLE À LA COMÉDIE-FRANÇAISE par Florence Thomas, archiviste-documentaliste à la Comédie-Française, décembre 2017. J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne Jean-Luc Lagarce mise en scène Chloé Dabert 24 janvier > 4 mars 2018 Ce document vous propose un parcours dans les collections iconographiques de la Comédie-Française présentées au sein de la base La Grange, accessible en ligne sur le site de la Comédie-Française : https://www.comedie-francaise.fr/ 1 HISTOIRES DE FAMILLE À LA COMÉDIE-FRANÇAISE Parler d’histoires de famille relève du pléonasme. La famille constitue un cadre privilégié et récurrent pour les scènes de la vie quotidienne et, dès lors qu’elle est le sujet de l’intrigue dans les pièces jouées au Français, l’intensité et l’ambivalence des sentiments qu’elle suscite sont une source d’inspiration inépuisable dont les problématiques sont, dans une large mesure, symptomatiques de l’histoire sociale et familiale et ce, dès le xviie siècle. Une famille d’Henri Lavedan, gravure de Michelet d’après un dessin de Stop et publiée en 1890 © Coll. Comédie-Française 2 L’AUTORITÉ PATRIARCALE - xviie SIÈCLE Chez Molière et des auteurs du xviie siècle comme Dancourt, la famille est essentiellement régie par des rapports d’autorité que femmes et enfants tentent de bousculer. Les pères de famille des comédies-ballets de Molière décident ainsi librement du choix de leur beau-fils qui servira au mieux leurs propres intérêts. -

CONTACT Théâtre Du Nord Nathalie Pousset, Directrice Adjointe
Texte : William Shakespeare Avec : John Arnold, Jean-Claude Durand, Production Théâtre du Nord, Traduction : Jean-Michel Déprats Cécile Garcia-Fogel, Pierre-François CDN Lille-Tourcoing - Hauts de France. Mise en scène : Christophe Rauck Garel, Pierre-Félix Gravière, Jean-François Lombard, Alain Trétout, Mahmoud Saïd, Avec le soutien du Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff Création janvier 2018 Luanda Siqueira (distribution en cours) Spectacle disponible en tournée de mars à mai 2018 Travail de chant Marcus Borja, Dramaturgie Leslie Six, Scénographie Aurélie Thomas, Costumes Coralie Sanvoisin, Lumières Olivier Oudiou, Son Xavier Jacquot Ou comment faire tenir en une comédie une usurpation « Je vais monter la saison prochaine Comme il vous plaira de près de tourner au tragique ; une pastorale austère où Shakespeare. Je n’ai pas encore terminé la distribution mais après souffe le vent d’hiver ; une pastorale plus amène mais Marivaux et Racine, je voulais fnir mon cycle sur l’amour avec où la cour d’amour se fait d’homme à homme, quand Pierre-François Garel et Cécile Garcia Fogel dans les rôles celle à qui elle s’adresse est travestie en Ganymède ; d’Orlando et de Rosalinde. lequel crée la discorde dans un couple de pastoureaux Il y aura un travail sur le chant choral fait avec un jeune chef de dont la femme s’éprend d’une femme, faute de savoir Chœur, Marcus Borja. J’aime beaucoup son approche du chant et qui se cache sous les habits du mystifant berger ; et cela prend tout son sens dans ce projet puisque beaucoup de chansons ponctuent la pièce. -
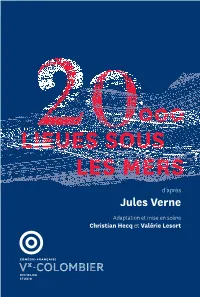
20000 LIEUES SOUS LES MERS D’Après Jules Verne
000 LIEUES SOUS LES MERS d’après Jules Verne Adaptation et mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort 20000 LIEUES SOUS LES MERS d’après Jules Verne Adaptation et mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort 25 janvier > 12 mars 2017 durée 1h20 Scénographie et costumes Avec Éric Ruf Christian Gonon Ned Land, Lumières maître harponneur, et manipulation Pascal Laajili de marionnettes Son Christian Hecq le Capitaine Nemo Dominique Bataille et manipulation de marionnettes Création des marionnettes Nicolas Lormeau le Professeur Carole Allemand Aronnax et manipulation Valérie Lesort de marionnettes Assistanat à la scénographie Benjamin Lavernhe Conseil, Delphine Sainte-Marie serviteur du Professeur Aronnax, et manipulation de marionnettes Assistanat aux costumes Siegrid Petit-Imbert Noam Morgensztern Flippos, second du Capitaine Nemo, et manipulation de marionnettes et Thomas Guerry le Sauvage et manipulation de marionnettes Voix off, Cécile Brune Construction du décor Atelier François Devineau La Fédération nationale des Caisses d’Epargne Fabrication des marionnettes Carole Allemand, est mécène du Théâtre du Vieux-Colombier Sophie Coeffic, Laurent Huet, Valérie Lesort, La Comédie-Française remercie M.A.C COSMETICS I Sébastien Puech, François Cerf (leds) ainsi que Champagne Barons de Rothschild I Baron Philippe Audrey Robin, Perrine Wanegue (stagiaires) de Rothschild SA Conseil à la manipulation des marionnettes Sami Adjali Réalisation du programme L’avant-scène théâtre © Laurent Huet Laurent © LA TROUPE les comédiens de la Troupe présents -

Dossier De Presse FEYDEAU
17 novembre 2010 dossier de presse La troupe de la Comédie-Française présente Salle Richelieu en alternance du 4 décembre 2010 au 18 juin 2011 Un fil à la patte Comédie en trois actes dedede Georges Feydeau mise en scène de Jérôme DeschampDeschampssss Avec Dominique Constanza, la Baronne Claude Mathieu, Marceline Thierry Hancisse, le Général Florence Viala , Lucette Céline Samie, Nini Jérôme Pouly, Jean Guillaume Gallienne, Chenneviette et Miss Betting Christian Gonon, Firmin Serge Bagdassarian, Fontanet Hervé Pierre, Bois d’Enghien Gilles David, Antonio Christian Hecq, Bouzin Georgia Scalliet, Viviane Pierre Niney, Émile et l’Homme en retard Jérémy Lopez, le Concierge et le Militaire Et les élèves-comédiens de la Comédie-Française Antoine Formica , Musicien 1, Invité 1 et le Prêtre Marion Lambert , la Femme aux enfants et Musicienne Ariane Pawin , la Mariée et Invitée 2 François Praud, Musicien 2 et le Marié Et Sandrine Attard , la Femme du couple et Servante Agnès Aubé, la Mère de la Mariée, Musicienne et Invitée 3 Patrice Bertrand, Lantery et le Père de la Mariée Arthur Deschamps, le Fleuriste, Laquais 2 et Agent 2 Ludovic Le Lez, l’Homme du couple, Laquais 1 et Agent 1 Et les enfants, avec la participation de la Maîtrise des Hauts-de-Seine Hadrien Berthonneau, Oscar Cortijos, Chabane Jahrling, Petit Napoléon (en alternance) Suzanne Brunet, Coline Catroux, Margaux Selle, Petite Fée (en alternance) Décors de Laurent Peduzzi Costumes et maquillages de Vanessa Sannino Lumières de Roberto Venturi Assistant à la mise en scène, Laurent Delvert Assistante aux maquillages, Anna Filosa Nouvelle mise en scène Représentations Salle Richelieu, matinée à 14h, soirées à 20h30. -

Dp Le Tartuffe
Dossier de presse Paris, le 10 juillet 2014 LA TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE PRÉSENTE SALLE RICHELIEU DU 20 SEPTEMBRE 2014 AU 17 FÉVRIER 2015 Tartuffe Comédie en cinq actes de Molière mise en scène Galin Stoev avec Claude MATHIEU Madame Pernelle I Michel FAVORY Monsieur Loyal I Cécile BRUNE Dorine I Michel VUILLERMOZ Tartuffe I Elsa LEPOIVRE Elmire I Serge BAGDASSARIAN Cléante I Nâzim BOUDJENAH Valère I Didier SANDRE Orgon I Anna CERVINKA Mariane I Christophe MONTENEZ Damis et les élèves-comédiens de la Comédie-Française Claire Boust, Ewen Crovella, Thomas Guené, Valentin Rolland NOUVELLE MISE EN SCÈNE Collaboration artistique Frédérique PLAIN I Scénographie Alban HO VAN I Costumes Bjanka ADŽIĆ URSULOV I Lumières Elsa REVOL I Musique originale Sacha CARLSON Représentations à la Salle Richelieu , matinées à 14h, soirées à 20h30 . Prix des places de 5 € à 41 €. Renseignements et réservation : tous les jours de 11h à 18h aux guichets du théâtre et par téléphone au 0825 10 16 80 (0,15 € la minute) , sur le site Internet www.comedie-francaise.fr Générales de presse les 22, 24 et 25 septembre à 20h30 Contact presse Vanessa Fresney Tél 01 44 58 15 44 Courriel [email protected] Tartuffe Orgon et sa mère, Madame Pernelle, ne jurent que par Tartuffe, qui se dit dévot et vit à leurs crochets. Les autres membres de la famille partagent quant à eux le sentiment de la suivante Dorine, scandalisée par l’emprise de l’homme d’église sur son maître. Ils vont tout entreprendre pour convaincre Orgon que Tartuffe est un hypocrite de la pire espèce. -

L'œuvre À La Comédie-Française (2001)
MOLIÈRE / ŒUVRE / LE MALADE IMAGINAIRE Comédie en 3 actes et en prose de Molière 2001 Salle Richelieu Mise en scène de Claude Stratz Extrait du programme du Malade imaginaire Le Malade imaginaire, trentième et dernière comédie de Molière, reste indissolublement liée au sort de son auteur. Jouée pour la première fois le 10 février 1673 sur le théâtre de Molière au Palais-Royal, cette comédie-ballet en trois actes et en prose, « mêlée de musique et de danses », avait été écrite initialement pour être représentée à la cour à l'occasion du Carnaval, mais, la faveur de Molière auprès du roi déclinant au profit de Lully, ses services ne furent pas sollicités et la pièce fut créée à la « ville », avec un succès immédiat. Or, le 17 février, au soir de la quatrième représentation, Jean-Baptiste Poquelin mourait, après avoir incarné une dernière fois le rôle d'Argan. Au moment de la cérémonie des médecins, alors qu'il prononçait le troisième « Juro », le comédien fut pris d'une convulsion, qu'il dissimula sous un rictus comique. Dès la toile baissée, il fut transporté chez lui où il succomba de la maladie des poumons qui le faisait souffrir depuis des années. Sa condition de comédien empêcha la célébration d'un office religieux et son cortège funèbre fut conduit à la tombée du jour dans la discrétion jusqu'au cimetière Saint-Joseph. La mort de Molière, au sortir des planches, donne au Malade imaginaire, la pièce certainement la plus autobiographique de son auteur, une dimension sérieuse et émouvante que les années n'ont pas effacée et qui reste gravée dans les mémoires selon les mots du registre de La Grange : « Ce mesme jour, après la comédie, sur les 10 heures du soir, Monsieur de Molière mourust dans sa maison rue de Richelieu, ayant joué le roosle dudit malade imaginaire fort incommodé d'un rhume et fluction sur la poitrine [...] ». -

The Imaginary Invalid (Le Malade Imaginaire ) Comedie-Fran~Aise
2004 Spring Season 2004 Sp[i og Seasoo Brooklyn Academy of Music Alan H. Fishman William I. Campbell Chairman of the Boa rd Vice Chairman of the Board Karen Brooks Hopkins Joseph V. Melillo President Executive Producer presents The Imaginary Invalid (Le Malade imaginaire ) Comedie-Fran~aise Approximate BAM Harvey Theater running time: Jun 9- 12, 2004 at 7:30pm; Jun 13 at 3pm Two hours; no intermission by Moliere Directed by Claude Stratz Set and costume design by Ezio Toffolutti Lighting design by Jean-Philippe Roy Original music by Marc-Olivier Dupin Choreographed by Sophie Mayer Make-up, wigs, and prosthesis design by Kuno Schlegelmilch Engl ish titles by Mike Sens American Stage Manager Kim Beringer Performed in French with English surtitles BAM 2004 Spring Season is sponsored by Altria Group, Inc. Leadership support for The Imaginary Invalid engagement is provided by The Florence Gould Foundation and The Lepercq Foundation. Calyon is the presenting sponsor for The Imaginary Invalid engagement. Additional engagement support is provided by Association Franr;aise d'Action Artistique; Cultural Services of the French Embassy in the United States; Sofitel New York; Lepercq, de Neuflize & Co.; and Tocquevil/e Asset Management. The opening night reception is sponsored by the French-American Foundation. Hors d'oeuvres are provided by A Table, Bacchus, Capsouto Freres, L'Absinthe, and Loulou. Wine is provided by The Charmer Sunbelt Group. Leadership support for BAM Theater is provided by The Peter Jay Sharp Foundation, The Fan Fox and Leslie R. Samuels Foundation, Inc., The Shubert Foundation, The Skirbal/ Foundation, and The Gladys Krieble Delmas Foundation. -

Le Jeu De L'amour Et Du Hasard » Au Théâtre De La Porte Saint-Martin, En Soignant Comme À L'accoutumée Sa Distribution
18 19 Théâtre Le jeu de l’amour et du hasard Marivaux / V. Dedienne / C. Hiegel 3 > 6 avril ATELIER THEATRE ACTUEL Label Théâtre Actuel Présente un spectacle du Théâtre de la Porte Saint-Martin et Canal 33 Le Jeu de l’amour et du hasard Une pièce de Marivaux Mise en scène Catherine Hiegel Avec Laure Calamy, Vincent Dedienne, Clotilde Hesme, Nicolas Maury, Alain Pralon, Cyrille Thouvenin. Assistante à la mise en scène Marie-Edith Roussillon. Décors Goury. Costumes Renato Blanchi. Lumières Dominique Borrini. Production : Théâtre de la Porte Saint-Martin en coproduction avec Atelier Théâtre Actuel et Canal 33 Contact diffusion : Cécile de Gasquet - 01 73 54 19 16 - [email protected] Photos : © Pascal Victor Après le Bourgeois Gentilhomme et Les Femmes Savantes de Molière, Catherine Hiegel revient à la Porte St Martin avec la célèbre pièce de Marivaux. M. Orgon décide de marier sa fille Silvia au jeune Dorante. Les deux promis ne se connaissent pas encore, et inquiets de découvrir leur véritable personnalité avant de s’engager, ils ont la même idée sans le savoir : se présenter à l’abri sous un masque, et scruter le cœur de l’autre. Silvia se fait passer pour sa femme de chambre Lisette, tandis que Dorante endosse le costume d’Arlequin, son valet. M. Orgon et son fils, Mario, qui seuls connaissent le stratagème des quatre jeunes gens, se taisent, et décident de laisser ses chances au jeu de l’amour et du hasard. S’en suivront quiproquos et rebondissements sur un rythme endiablé jusqu’au triomphe de l’amour. -

Jean Le Poulain (1924-1988)
1/27 Data Jean Le Poulain (1924-1988) Pays : France Langue : Français Sexe : Masculin Naissance : 12-09-1924 Mort : 01-03-1988 Note : Acteur, metteur en scène et directeur de théâtre. - Administrateur de La Comédie française ISNI : ISNI 0000 0000 2452 2939 (Informations sur l'ISNI) Jean Le Poulain (1924-1988) : œuvres (180 ressources dans data.bnf.fr) Spectacles (113) Le saut du lit "Un pour la route" (1988) (1987) de Bernard Murat avec Jean Le Poulain (1924-1988) comme Acteur De doux dingues Les Rendez-vous de Molière (1986) (1985) Un Garçon de chez Véry Le Tartuffe (1985) (1985) L'Italiana in Algeri Les joyeuses commères de Windsor (1984) (1984) Tartuffe Tartuffe (1984) (1983) Le Malade imaginaire Le voyage de Monsieur Perrichon (1982) (1982) Macbeth Le Voyage de Monsieur Perrichon (1982) (1982) data.bnf.fr 2/27 Data Le Mariage forcé "Yvonne, princesse de Bourgogne" (1982) (1982) de Jacques Rosner avec Jean Le Poulain (1924-1988) comme Acteur Le Malade imaginaire Oedipe, les pieds gonflés (1982) (1981) La Nuit des rois La Nuit des rois (1981) (1981) Les mamelles de Tirésias Le Bourgeois gentilhomme (1981) (1981) La Nuit des rois Le marchand de Venise (1980) (1980) Le Marchand de Venise L'Alcade de Zalaméa (1979) (1979) "Le malade imaginaire" Miam miam ou le Dîner d'affaires (1979) (1978) de Jean-Laurent Cochet avec Jean Le Poulain (1924-1988) comme Acteur Miam-miam ou Le dîner d'affaires Voyez-vous ce que je vois? (1978) (1976) Le bourgeois gentilhomme La Grosse (1976) (1976) La grosse Le saut du lit (1975) (1975) "Mozart-Pergolèse" Au nom du pèze.. -

La Scène Vivante Fait Sa Dentdée
LA SCÈNE VIVANTE FAIT Faust I et II avec la troupe du Berliner Ensemble, dans la mise en SA RENTRÉE scène de Robert Wilson. Photo © Lucie Jansch APPLI LA TERRASSE Un foisonnement de INDISPENSABLE propositions en Ile-de-France POUR LE PUBLIC et en régions en théâtre, ET LES PROS ! danse, cirque, musiques… Disponible gratuitement : google play et App Store. Ariane Mnouchkine et ww.kazoar.fr le Théâtre du Soleil, Jean Bellorini, Robert Wilson, le Berliner Ensemble, Ivo van Hove, Aurélien Bory, Joël Pommerat, Macha Makeïeff, 246 Christiane Jatahy, Wajdi Mouawad, Catherine Hiegel, LE JOURNAL DE RÉFÉRENCE DES ARTS VIVANTS Frank Castorf, Pina Bausch, SEPTEMBRE 2016 Lucinda Childs, Alexei Ratmansky, Alain Platel, LA TERRASSE 4 avenue de Corbéra 75012 Paris Pierre Rigal, Jonah Bokaer, Tél : 01 53 02 06 60 / Fax : 01 43 44 07 08 Dominique Dupuy, Vincent TOUTES LES INFOS SUR : [email protected] pass.adami.fr Peirani, Skip Sempé, Ramon ouverture de la billetterie le 15 septembre Paru le 7 septembre 2016 Lazkano, Kirill Petrenko, 25e saison / 80 000 exemplaires Prochaine parution le 5 octobre 2016 Maxime Pascal, John Surman, Abonnement p. 57 / Sommaire p. 2 Sara Najafi…Suivez le guide ! Adami, société des artistes-interprètes Directeur de la publication : Dan Abitbol www.journal-laterrasse.fr Et bonne rentrée à tous ! 2 THÉÂTRE SEPTEMBRE 2016 / N°246 la terrasse la terrasse SEPTEMBRE 2016 / N°246 THÉÂTRE 3 p. 61 – OPÉRA BASTILLE sommaire n°246 • septembre 2016 DANSE Philippe Jordan dirige des extraits symphoniques du Ring des Nibelungen de Wagner. ENTRETIENS p. 62 – PHILHARMONIE DU 12 AU 16 OCTOBRE 2016 p. -

Heartbreaker/ L’Arnacoeur
HEARTBREAKER/ L’ARNACOEUR Eine romantische Komödie von Pascal Chaumeil Mit Roman Duris, Vanessa Paradis, François Damiens, Julie Ferrier Dauer: 105 min. Filmstart : 10. Februar 2011 Download: http://www.frenetic.ch/films/734/pro/index.php MEDIENBETREUUNG DISTRIBUTION Charlotte Gubler FRENETIC FILMS AG prochaine ag Bachstrasse 9 • 8038 Zürich Tel. 044 488 44 22 Tel. 044 488 44 00 • Fax 044 488 44 11 [email protected] [email protected] • www.frenetic.ch SYNOPSIS Alex (Romain Duris) ist professioneller Herzensbrecher. Sein Auftrag: Frauen die Augen öffnen. Sein Ziel: Den Mann an ihrer Seite als den grössten Fehler ihres Lebens enttarnen. Seine Auftraggeber: Eltern, Geschwister, Freunde. Seine Methode: Pure Verführung, aber beim ersten Kuss ist es auch schon vorbei. Für Charmeur Alex ein Job wie jeder andere – bis Juliette (Vanessa Paradis) auftaucht. Die erfolgreiche junge Frau aus reichem Hause steht kurz davor, an der Côte d’Azur mit ihrem so attraktiven wie vermögenden Verlobten die perfekte Hochzeit zu feiern. Aus reiner Geldnot – und angeheuert von Juliettes Vater – nimmt Alex zusammen mit seinem Team - seiner Schwester Mélanie (Julie Ferrier) und deren Mann Marc (François Damiens) - die größte Herausforderung seiner Karriere an. Verfolgungsjagden, Abhöraktionen, schlagkräftige Auseinandersetzungen, romantische Tanzeinlagen – Alex zieht alle Register! PRESSENOTIZ Vanessa Paradis ist wieder da! In dieser temporeichen und super witzigen Komödie verdreht das Multitalent („La fille sur le pont“, aktuelles Model für Chanel und Lebensgefährtin von Johnny Depp) nicht nur Romain Duris („De battre mon coeur s'est arrêté“, „L’auberge espagnole“) gehörig den Kopf. Und während es zwischen den beiden heftig zu knistern beginnt, geben die brillant besetzten Nebendarsteller erst richtig Gas: Julie Ferrier („Paris“) und Francois Damiens („Le petit Nicolas“) überzeugen als Herzensbrecher-Team mit Esprit, Charme und reichlich schrägem Humor. -

\376\377\000C\000O\000U\000V\000 \000C\000O\000U\000P\000S
Coups de cœur des discothécaires 2008 Les coups de cœur 20O8 Ce fascicule propose une sélection de disques écoutés et appréciés par les discothécaires de la Ville de Paris. Cette sélection, effectuée au sein de douze commissions d’écoute, recouvre tous les genres musicaux. Ces commissions sont constituées d’une centaine de discothécaires qui se réunissent une fois par mois afin de proposer une liste de disques destinés à l’ensemble des sections discothèque et jeunesse du réseau municipal parisien. Pour retrouver ces coups de cœur, vous disposez du catalogue sur internet TABLE DES MATIERES (www.bibliothèque.paris.fr ), du catalogue en ligne dans les discothèques, et bien sûr des conseils avisés des discothécaires. MUSIQUE CLASSIQUE ………………………………………. 3 Ce travail est coordonné par le secteur Musique et audiovisuel (Catherine TEXTES ENREGISTRES Soubras). ………………………………………. 14 Remerciements pour leur travail de relecture à Françoise Bérard, directrice du CHANSON FRANÇAISE ………………………………………. 15 Service du document et des échanges, à Monique Vacher, Réserve centrale. ENFANTS ………………………………………………………. 23 Le Service du Document et des Echanges des bibliothèques de la Ville de Paris, 46 bis rue Saint-Maur, Paris 11e JAZZ ET BLUES ………………………………………………. 32 Tel : 01.49.29.36.43 - Fax : 01.47.92.12.00 MUSIQUE DE FILM ……………………………………………. 48 juin 2009 MUSIQUE DU MONDE ……………………………………….. 50 MUSIQUE NOUVELLE ………………………………………. 61 MUSIQUES ELECTRONIQUES ………………………………. 66 REGGAE -RAP …………………………………………………. 73 ROCK ET SOUL ……………………………………………….. 76 1 2 Dvorak, Antonin (1841-1904), Symphonies n°3 et n°7 MUSIQUE CLASSIQUE Orchestre philharmonique tchèque, Zdenek Macal, dir. Ces deux symphonies n'ont rien à envier au Nouveau Monde. Zdenek Macal Bach, Johann Sebastian, Transcriptions. Sonate en ré mineur BWV 964.