Nelson Algren Accuse Playboy Frédéric DUMAS
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Thomas Pynchon: a Brief Chronology
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Faculty Publications, UNL Libraries Libraries at University of Nebraska-Lincoln 6-23-2005 Thomas Pynchon: A Brief Chronology Paul Royster University of Nebraska-Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/libraryscience Part of the Library and Information Science Commons Royster, Paul, "Thomas Pynchon: A Brief Chronology" (2005). Faculty Publications, UNL Libraries. 2. https://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 This Article is brought to you for free and open access by the Libraries at University of Nebraska-Lincoln at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications, UNL Libraries by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Thomas Pynchon A Brief Chronology 1937 Born Thomas Ruggles Pynchon Jr., May 8, in Glen Cove (Long Is- land), New York. c.1941 Family moves to nearby Oyster Bay, NY. Father, Thomas R. Pyn- chon Sr., is an industrial surveyor, town supervisor, and local Re- publican Party official. Household will include mother, Cathe- rine Frances (Bennett), younger sister Judith (b. 1942), and brother John. Attends local public schools and is frequent contributor and columnist for high school newspaper. 1953 Graduates from Oyster Bay High School (salutatorian). Attends Cornell University on scholarship; studies physics and engineering. Meets fellow student Richard Fariña. 1955 Leaves Cornell to enlist in U.S. Navy, and is stationed for a time in Norfolk, Virginia. Is thought to have served in the Sixth Fleet in the Mediterranean. 1957 Returns to Cornell, majors in English. Attends classes of Vladimir Nabokov and M. -

Throughout His Writing Career, Nelson Algren Was Fascinated by Criminality
RAGGED FIGURES: THE LUMPENPROLETARIAT IN NELSON ALGREN AND RALPH ELLISON by Nathaniel F. Mills A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (English Language and Literature) in The University of Michigan 2011 Doctoral Committee: Professor Alan M. Wald, Chair Professor Marjorie Levinson Professor Patricia Smith Yaeger Associate Professor Megan L. Sweeney For graduate students on the left ii Acknowledgements Indebtedness is the overriding condition of scholarly production and my case is no exception. I‘d like to thank first John Callahan, Donn Zaretsky, and The Ralph and Fanny Ellison Charitable Trust for permission to quote from Ralph Ellison‘s archival material, and Donadio and Olson, Inc. for permission to quote from Nelson Algren‘s archive. Alan Wald‘s enthusiasm for the study of the American left made this project possible, and I have been guided at all turns by his knowledge of this area and his unlimited support for scholars trying, in their writing and in their professional lives, to negotiate scholarship with political commitment. Since my first semester in the Ph.D. program at Michigan, Marjorie Levinson has shaped my thinking about critical theory, Marxism, literature, and the basic protocols of literary criticism while providing me with the conceptual resources to develop my own academic identity. To Patricia Yaeger I owe above all the lesson that one can (and should) be conceptually rigorous without being opaque, and that the construction of one‘s sentences can complement the content of those sentences in productive ways. I see her own characteristic synthesis of stylistic and conceptual fluidity as a benchmark of criticism and theory and as inspiring example of conceptual creativity. -
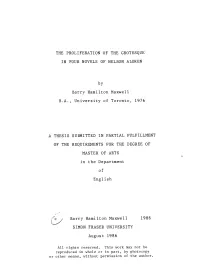
The Proliferation of the Grotesque in Four Novels of Nelson Algren
THE PROLIFERATION OF THE GROTESQUE IN FOUR NOVELS OF NELSON ALGREN by Barry Hamilton Maxwell B.A., University of Toronto, 1976 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in the Department ot English ~- I - Barry Hamilton Maxwell 1986 SIMON FRASER UNIVERSITY August 1986 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without permission of the author. APPROVAL NAME : Barry Hamilton Maxwell DEGREE: M.A. English TITLE OF THESIS: The Pro1 iferation of the Grotesque in Four Novels of Nel son A1 gren Examining Committee: Chai rman: Dr. Chin Banerjee Dr. Jerry Zaslove Senior Supervisor - Dr. Evan Alderson External Examiner Associate Professor, Centre for the Arts Date Approved: August 6, 1986 I l~cr'ct~ygr.<~nl lu Sinnri TI-~J.;~;University tile right to lend my t Ire., i6,, pr oJcc t .or ~~ti!r\Jc~tlcr,!;;ry (Ilw tit lc! of which is shown below) to uwr '. 01 thc Simon Frasor Univer-tiity Libr-ary, and to make partial or singlc copic:; orrly for such users or. in rcsponse to a reqclest from the , l i brtlry of rllly other i111i vitl.5 i ty, Or c:! her- educational i r\.;t i tu't ion, on its own t~l1.31f or for- ono of i.ts uwr s. I furthor agroe that permissior~ for niir l tipl c copy i rig of ,111i r; wl~r'k for .;c:tr~l;rr.l y purpose; may be grdnted hy ri,cs oi tiI of i Ittuli I t ir; ~lntlc:r-(;io~dtt\at' copy in<) 01. -

An American Outsider
Nelson Algren: An American Outsider Bettina Drew VER THE MANY YEARS IHAVE SPENT WRITING AND THINKING ABOUT Nelson Algren, I have always found, in addition to his poetic lyri- clsm, a density and darkness and preoccupation with philosoph- .nl issues that seem fundamentally European rather than Amer- ican. In many ways, Norman Mailer was right when he called Algren "the grand odd-ball of American Ietters."' There is some- thing accurate in the description, however pejorative its intent or meaning at first glance, for Algren held consistently and without doubt to an artistic vision that, above and beyond its naturalism, was at odds with the mainstream of American literature. And cul- ural reasons led to the lukewarm American reception of his work ill the past several decades. As James R. Giles notes in his book Confronting the Horror: The Novels of Nelson Algren, a school of critical thought citing Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Mark Twain, and Walt Whitman argues that nineteenth-century American liter- ature was dominated by an innocence and an intense faith in in- dividual freedom and human potential. But nineteenth-century American literature was also dominated by an intense focus on the American experience as unique in the world, a legacy, perhaps, of --. the American Revolution against monarchy in favor of democ- racy. Slave narratives, Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin (1852),narratives of westward discovery such as Twain's Roughing It (1872), the wilderness tales of James Fenimore Cooper, and Thoreau's stay on Walden Pond were stories that could have taken place only in America-an essentially rural and industrially unde- veloped America. -

Pynchon in Popular Magazines John K
Marshall University Marshall Digital Scholar English Faculty Research English 7-1-2003 Pynchon in Popular Magazines John K. Young Marshall University, [email protected] Follow this and additional works at: http://mds.marshall.edu/english_faculty Part of the American Literature Commons, American Popular Culture Commons, and the Film and Media Studies Commons Recommended Citation Young, John K. “Pynchon in Popular Magazines.” Critique: Studies in Contemporary Fiction 44.4 (2003): 389-404. This Article is brought to you for free and open access by the English at Marshall Digital Scholar. It has been accepted for inclusion in English Faculty Research by an authorized administrator of Marshall Digital Scholar. For more information, please contact [email protected]. Pynchon in Popular Magazines JOHN K. YOUNG Any devoted Pynchon reader knows that "The Secret Integration" originally appeared in The Saturday Evening Post and that portions of The Crying of Lot 49 were first serialized in Esquire and Cavalier. But few readers stop to ask what it meant for Pynchon, already a reclusive figure, to publish in these popular magazines during the mid-1960s, or how we might understand these texts today after taking into account their original sites of publica- tion. "The Secret Integration" in the Post or the excerpt of Lot 49 in Esquire produce different meanings in these different contexts, meanings that disappear when reading the later versions alone. In this essay I argue that only by studying these stories within their full textual history can we understand Pynchon's place within popular media and his responses to the consumer culture through which he developed his initial authorial image. -

Literary Chicago, a Topic That Should Be of Interest to Many of the 20,000 Librarians Who Will Be Here Next Month to Attend ALA’S Annual Conference
time—one’s rummaging options are limited. (Yes, I know, you can google anything, but too often my googling leaves me with only half a fact when I need the thing entire.) So, Joyce, I’m sorry, but quizzes are too demanding for a weary editor like me to produce with anything like the frequency you crave. Still, you did write that introduction, and a favor deserves acknowledgment. o here, at long last, is a quiz—not just any quiz but one that Scelebrates literary Chicago, a topic that should be of interest to many of the 20,000 librarians who will be here next month to attend ALA’s Annual Conference. Chicagoans, of course, enjoy a long and illustrious literary tradition, one that reaches from Theodore Dreiser and Frank Norris through Richard Wright and Ernest Hemingway and on to Saul Bellow and Nelson Algren and on still further to Sandra Cisneros, Sara Paretsky, and many, many others. It’s hardly a challenge to match these authors with their titles set in Chicago, but it may prove just a bit harder to combine those pairings with a neighborhood, a landmark, or an event in Chicago history that plays a significant role in each book. Along with the literary lights above, we’ve included works set in the Chicago area by writers not usually associated with our Literary Chicago city and its suburbs (Philip Roth and Somerset Maugham), books by Booklist staffers (Ilene Cooper and Keir Graff), and a oyce Saricks, who was kind enough to write the introduction to real curiosity: a novel whose setting is ALA’s publishing depart- ALA Editions’ recently released compilation of my Back Page ment. -

Radical Regionalism in the American Midwest, 1930-1950
1 Geographies of (In)Justice: Radical Regionalism in the American Midwest, 1930-1950 A dissertation presented by Brent Garrett Griffin to The Department of English In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the field of English Northeastern University Boston, Massachusetts April, 2015 2 Geographies of (In)Justice: Radical Regionalism in the American Midwest, 1930-1950 A dissertation presented by Brent Garrett Griffin ABSTRACT OF DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in English in the College of Social Sciences and Humanities of Northeastern University April, 2015 3 ABSTRACT In the decades bracketing World War II, a group of Midwestern radical writers promoted a new form of radical literary expression—proletarian regionalism—both to counter burgeoning right-wing extremism in the United States and to renew a spirit of grass-roots democracy, egalitarianism and place-based working class action. For Meridel Le Sueur, Jack Conroy, Nelson Algren, and Mari Sandoz, four of the most regionally conscious and committed writers of the period and the focus of “Geographies of (In)Justice,” proletarian regionalism was a vehicle for interpreting localized social, economic, and environmental injustices and for making connections between these places and larger-scale processes of capitalist accumulation. By tracing regional discourses through a broad range of forms, including social realism, little magazines, conference presentations, fictional autobiography, and political allegory, this recuperative literary history demonstrates that proletarian regionalism appropriated many forms in an attempt to interpret and represent an affective geography of capitalism and capture the socio-spatial experiences of people struggling to live and work in the region. -

The Adaptations of Augie March
The Adaptations of Augie March: A Novel by Saul Bellow, A Play by David Auburn, A Production by Charles Newell, An Exhibit by Special Collections and Court Theatre April 29, 2019 through August 30, 2019 Exhibit Text Exhibit Introductory Panel: In 1953, Saul Bellow published The Adventures of Augie March, the story of a young immigrant coming of age in Chicago and discovering his identity as a writer. The novel launched Bellow’s reputation and established the future Nobel Laureate's literary renown. In 2015, Court Theatre Artistic Director Charles Newell commissioned the Pulitzer Prize-winning playwright David Auburn, AB ‘91, to adapt The Adventures of Augie March for Court’s stage. The same year, the Special Collections Research Center began processing and cataloguing Saul Bellow’s papers for use by scholars, students, and researchers. The Adaptations of Augie March examines the successive transformations of Bellow's original text in the hands of playwright Auburn and his collaborator Newell as they worked closely with a team of theatre artists—including a set designer, costume designer, choreographer and dialect coach—to bring the May 2019 world premiere of The Adventures of Augie March to life at Court Theatre. Among the manuscripts and artifacts on display here are early handwritten drafts of Bellow’s novel and his later revisions; original drafts of David Auburn’s play; Charles Newell’s artistic notes and plans for establishing the world of the play; costume designer Sally Dolembo’s drawings and sketches; the mind-bending work of shadow puppetry collective Manual Cinema, commissioned by Court to generate the play’s special effects; and John Culbert’s minimalist, non-literal design for a set capable of evoking places as disparate as Depression-era Chicago, the mountains of Mexico, post- WWII Italy, and a lifeboat on the open ocean. -

The Secret Faces of Inscrutable Poets in Nelson Algren's Chicago: City On
The Secret Faces of Inscrutable Poets in Nelson Algren’s Chicago: City on the Make by Jeff McMahon May 20, 2002 Advisor: Professor Janice Knight Preceptor: Anthony Raynsford Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts MASTER OF ARTS PROGRAM IN THE HUMANITIES UNIVERSITY OF CHICAGO Algren’s Chicago / 2 Algren revising Chicago: City on the Make “I don’t think anything’s true that doesn’t have it — that doesn’t have poetry in it.” — Nelson Algren Algren’s Chicago / 3 ACKNOWLEDGMENTS My gratitude falls like a lake-effect snow upon: Professor Janice Knight for lighting not only this thesis but also my return to Chicago, and for sympathetic advice peppered with epiphanies; Professors Candace Vogler and Ian Mueller, for guidance into interpretive theory and for their infectious enthusiasm for interdisciplinary studies in the humanities; Writing Program Director Larry McEnerney for his polite skepticism, his generosity with time and ideas, and for sharing his expert eye for style; Professor David Wellbery, for an erudite introduction to narrative theory that provided a lifetime of methods; Professor Bill Savage of Northwestern University, for offering such a warm welcome to the community of Algren scholarship and for his continuing live annotations; Tony Raynsford, for applying the requisite pressure gently enough, and for finding leaks in the plumbing of language and argument; The Maphiosi — students, staff, mentors — for brilliance and lunacy and the unity of the two in a sense of belonging that has been, for many of us, our first; Finally, to Nelson Algren for letting this husky brawling city rage within him in spite of the personal cost, and for lending voice to the helpless useless nobodies nobody knows. -

Writers: Photographs by Nancy Crampton April 2, 2009 - May 9, 2009
Writers: Photographs by Nancy Crampton April 2, 2009 - May 9, 2009 Writers: Photographs by Nancy Crampton is a nationally touring photographic exhibition featuring significant writers of our time. The exhibit offers 48 of an original 100 portraits of American novelists, poets and playwrights. Each artist’s photograph is paired with a text from the writer, highlighting their thoughts on the craft, influential moments in each writer’s career, or a discussion of the social importance of writing. Since the early 1970s, Crampton has been a preeminent portraitist of literary figures. Hundreds of book jackets and magazine articles have featured her photographs. She is the official photographer of the Unterberg Poetry Center in New York City. Novelist Philip Roth describes her exhibit as comprehensive: “Nancy Crampton’s photographs of writers provide a remarkable record of our literary moment. Photographed by Nancy Crampton Novelist, John Irving (‘61) Everybody is here - including those no longer her - and everybody is alive.” Lamont Gallery Director Karen Burgess Smith says, “Nancy Crampton’s photographs of numerous literary luminaries range from John Updike’s ‘artist-at-work’ image in his book-filled study, to Alice Walker’s elegant and direct photo of the ‘artist-at-rest,’ her hands clasped on her lap, perhaps preparing to return to her study. Crampton’s images of writers such as Truman Capote, shown outdoors with his arms behind his head in a signature pose, and Annie Proulx, seated in a rustic chair in the woods, introduce the viewer to -

Contributors, Advertisements
Ontario Review Volume 39 Fall/Winter 1993–94 Article 20 July 2014 Contributors, Advertisements Follow this and additional works at: http://repository.usfca.edu/ontarioreview Recommended Citation (2014) "Contributors, Advertisements," Ontario Review: Vol. 39, Article 20. Available at: http://repository.usfca.edu/ontarioreview/vol39/iss1/20 For more information, please contact [email protected]. CONTRIBUTORS Pinckney Benedict of Lewisburg, West Virginia, is the recipient of the 1986 Nelson Algren Award. He has published two collections of short fiction, Town Smokes (OR Press, 1987) and The Wrecking Yard (Nan A. Talese/Doubleday, 1992). His first novel, Dogs of God (Nan A. Talese/ Doubleday), is scheduled for publication in January 1994 Hayden Carruth has published 28 books, chiefly poetry but including also a novel, four books of criticism, and two anthologies. His most recent books are Suicides andjazzers (1992) and The Collected Shorter Poems, 1946- 91 (1992), the latter winning this year's National Book Critics Circle Award Nicholas Christopher has published four books of poems, most recendy In the Year of the Comet (Viking Penguin, 1992). Viking will bring out his fifth book, 5° and Other Poems in 1994. The recipient of a Guggenheim Fellowship in Poetry for 1993-94, he lives in New York City Cathy N. Davidson's three previously published books include The Book of Love: Writers and Their Love Letters. "Night Moves" is from a new book, 36 Views of Mount Fuji, which will be released by Dutton in October. She is a professor of English at Duke University Annie Dillard's most recent book is her novel The Living (HarperCollins, 1992). -

Contributor Notes
CONTRIBUTOR NOTES Karen Leona Anderson is the author of Punish Honey. Her work has most recently appeared in The Best American Poetry 2012. A graduate of the Iowa Writers’ Workshop and Cornell University, she is currently an assistant professor at St. Mary's College of Maryland. Miki Arndt is a freelance writer, editor, and a book reviewer for Publishers Weekly. Originally from Kobe, Japan, she received her ba in writing from Johns Hopkins University and her mfa in fi ction from Columbia University. She lives in New York and is currently working on her fi rst novel. Corey Campbell’s fi ction has appeared, or is forthcoming, in the Gettysburg Review, the Rattling Wall, Necessary Fiction, Conte, Anderbo, and the Coachella Review, among other publications. A graduate of Warren Wilson’s mfa Program for Writers, she lives in Phoenix, Arizona, where she’s completing her fi rst collection of short stories. Mario Chard is a Wallace Stegner Fellow in Poetry at Stanford University and winner of the 2012 “Discovery”/Boston Review Poetry Prize. He is the former poetry editor of Sycamore Re- view and a graduate of the mfa Program in Creative Writing at Purdue University. He lives in San Jose with his wife and two sons. Mark Conway has written two books of poetry, Dreaming Man, Face Down, and Any Holy City. These poems are from a new manuscript with the working title “Fuse.” Robert Dannenberg lives and works in Chicago. 156 Contributor Notes Edward Hamlin is a Colorado-based writer whose work has ap- peared in the Bellevue Literary Review, In Digest, New Dog, and Cobalt, and has been produced theatrically in Chicago and Denver.