André Durand Présente
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

À La Rencontre De Corinna Bille : Comment Mettre En Valeur Les Auteurs Locaux En Bibliothèque
À la rencontre de Corinna Bille : comment mettre en valeur les auteurs locaux en bibliothèque Travail de Bachelor réalisé en vue de l’obtention du Bachelor HES par : Tania DARBELLAY Mandant : Médiathèque Valais Aline HÉRITIER, responsable de la médiation culturelle Conseillère au travail de Bachelor : Ariane REZZONICO, Chargée d'enseignement HES, Gestion du domaine d'enseignement "Connaissance des sources et recherche d'information" Genève, le 15 juillet 2013 Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE) Filière Information documentaire Déclaration Ce travail de Bachelor est réalisé dans le cadre de l’examen final de la Haute école de gestion de Genève, en vue de l’obtention du titre « Bachelor HES en Science de l’information ». L’étudiant accepte, le cas échéant, la clause de confidentialité. L'utilisation des conclusions et recommandations formulées dans le travail de Bachelor, sans préjuger de leur valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celle du conseiller au travail de Bachelor, du juré et de la HEG. « J’atteste avoir réalisé seule le présent travail, sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie. » Fait à Sion, le 3 juillet 2013 Tania Darbellay À la rencontre de Corinna Bille : comment mettre en valeur les auteurs locaux en bibliothèque DARBELLAY, Tania i Remerciements En premier lieu, je tiens à remercier la Médiathèque Valais qui a accepté de tenir le rôle de mandant dans ce projet. L’intérêt de Damian Elsig, directeur de la Médiathèque Valais, et d’Aline Héritier, responsable de la médiation culturelle, ont permis la concrétisation de ce travail. -

The Idea of a Swiss Nation: a Critique of Will Kymlicka's Account of Multination States
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text direetly from the original or copy submitted. Thus, sorne thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quallty of thl. reproduction 1. dependent upon the quallty of the copy .ubmltted. Broken or indistinct print. colored or poor quality illustrations and photographs. print bleedthrough. substandard margins. and improper alignment can adversely affect reproduction. ln the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Aiso. if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g.. maps. drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing trom left to right in equal sections with small overlaps. ProQuest Information and Leaming 300 North Zeeb Road. Ann Arbor, MI 481Q6.1346 USA 800-521-0600 McGill University Faculty ofGraduate Studies and Research Department ofPolitical Science August 2000 M.A. Thesis Copy no. 1 The Idea of a Swiss Nation A Critique ofWill Kymlicka 's Account ofMultination States • by Nenad Stojanovic Supervisor: Dr. Alan Patten" Assistant Professor Student no.: 9948000 [email protected] 14'1 315 t..... lia" sn.t _ ....W8IiIllQlDh e.-ON K1A0N4 ae..ON K1AGN4 c:.n..- c..Ia The autbor bas gnmted a non L'auteur a accordé une licence non exclusive licence aIIowiDg the exclusive pennettant à la Natioaal Libnry ofCanada ta Bibliothèque natiouale du Canada de reproduce, loan, distnbute or sen reproduire, prêter, distnbuer ou copies oftbis thesis in microf~ vendre des copies de cette thèse sous paper or electroDic fODDats. -

Book Chapter Reference
Book Chapter [Préface et postface à :] Genève. Voix du sud. Ville et littérature LÉVY, Bertrand Abstract Cet ouvrage réunit des textes sur Genève écrits par des écrivains du Sud ou ayant relié Genève à la problématique du Sud : Jorge Luis Borges, Gabriel Garcia Marquez, Carlos Fuentes, Rosa Regas, Georges Haldas, Vahé Godel, Charles-Albert Cingria, Gonzague de Reynold Charles Ferdinand Ramuz, Pierre Gascar, Fama Diagne Sène, Beppe Sebaste, Casanova Reference LÉVY, Bertrand. [Préface et postface à :] Genève. Voix du sud. Ville et littérature. In: Genève. Voix du Sud. Ville et littérature. Genève : Metropolis, 2014. p. 7-10, 229-271 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:41145 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Rosa Regàs, Georges Haldas, Vahé Godel, Charles-Albert Cingria, Gonzague de Reynold, Charles Ferdinand Ramuz, Pierre Gascar, Fama Diagne Sène, Genève Beppe Sebaste, Casanova. «De toutes les villes du monde, de toutes les patries intimes Voix du Sud qu’un homme cherche à mériter au cours de ses voyages, Genève me semble la plus propice au bonheur. Je lui dois d’avoir Jorge Luis Borges découvert, à partir de 1914, le français, le latin, l’allemand, l’expressionnisme, Schopenhauer, la doctrine de Bouddha, le Gabriel Garca Mrquez taoïsme, Conrad, Lafcadio Hearn et la nostalgie de Buenos Carlos Fuentes Aires. Et aussi l’amour, l’amitié, l’humiliation et la tentation de suicide. Dans le souvenir tout est agréable, même l’épreuve.» du Sud Genève Voix Rosa Regs (Jorge Luis Borges, en collaboration avec María Kodama, Atlas, 1988) Georges Haldas Vahé Godel Étrange destinée que celle de cette ville, située aux Charles-Albert Cingria confins occidentaux de la Suisse, entre montagnes et lac, presqu’île enclavée dans la France. -

Promenade En Suisse Romande POUR UN QUESTIONNEMENT DES LIENS ENTRE LANGUE, TERRITOIRE ET IDENTITÉ(S) ______
Promenade en Suisse romande POUR UN QUESTIONNEMENT DES LIENS ENTRE LANGUE, TERRITOIRE ET IDENTITÉ(S) ________ Hélène BARTHELMEBS-RAGUIN (Université du Luxembourg, RU IPSE) Pour citer cet article : Hélène BARTHELMEBS-RAGUIN, « Promenade en Suisse romande – Pour un questionnement des liens entre langue, territoire et identité(s) », Revue Proteus, no 15, (dés)identification postcoloniale de l’art contemporain, Phoebe Clarke et Bruno Trentini (coord.), 2019, p. 53-64. Résumé Longtemps les productions artistiques helvétiques ont été enfermées dans un rapport attrac- tion / répulsion vis-à-vis du voisin français. Pourtant, si les artistes suisses sont proches géographique- ment de la France, usent de la même langue et partagent des références communes, l’effet de frontière est ici tout à fait opérant et ses manifestations se retrouvent au niveau littéraire. La proximité entre ces deux aires culturelles amène les auteur·rice·s à interroger leur place sur la scène des littératures de langue française. Comment, dès lors, envisager ces écritures décentrées ? littérature romande — centre/périphérie — assimilation/marginalisation — langue Abstract For a long time, Swiss artistic productions have been locked in an attraction / repulsion relation with the French neigh- bor. The Swiss artists are geographically close to France, they use the same language, and they share common references, however the border effects are here quite operative and their manifestations impact the literary level. The proximity bet- ween these cultural areas leads the authors -

Indice V Prefazione Di Roger Francillon 3 Avvertenza 7 Introduzione 25 Anelito Preromantico Gli Esordi Lirici in Lingua Tedesca
Indice V Prefazione di Roger Francillon 3 Avvertenza 7 Introduzione 25 Anelito preromantico Gli esordi lirici in lingua tedesca 27 Albrecht von Haller 31 Salomon Gessner 35 Lo spirito e la terra Il cosmopolitismo nella letteratura romanda fra sette e ottocento 39 Isabelle de Charrière 43 Germaine de Staël 47 Benjamin Constant 53 Charles-Victor de Bonstetten 56 Henri-Frédéric Amiel 59 Liberi e svizzeri Scrittori politici di lingua italiana 62 Vincenzo Dalberti 65 Stefano Franscini 69 Chimere dell’assoluto Narrativa svizzera tedesca dell’ottocento 72 Jeremias Gotthelf 84 Gottfried Keller 99 Conrad Ferdinand Meyer 111 Cari Spitteler 117 Rinascita di un’identità La letteratura retoromancia 121 Giachen Caspar Muoth 123 Peider Lansel 127 Idilli lacustri e montani Residui ottocenteschi nella narrativa svizzera italiana 129 Francesco Chiesa 135 Angelo Nessi 139 Giuseppe Zoppi 143 Tra simbolo e realtà La letteratura romanda agli esordi del novecento 146 Charles-Ferdinand Ramuz 155 Gonzague de Reynold 159 Guy de Pourtalès 162 Charles-Albert Cingria 165 Denis de Rougemont 169 Heimatlose Narrativa e poesia svizzere tedesche d’inizio novecento, fra critica sociale e straniamento 171 Jakob Bührer 175 Rudolf Jakob Humm 179 Kurt Guggenheim 183 Meinrad Inglin 188 Ludwig Hohl 192 Hermann Hesse 203 Robert Walser 214 Jakob Schaffner 218 Friedrich Glauser 225 Karl Stamm 227 Basta con le pannocchie al sole Poesia e prosa nella Svizzera italiana dagli anni quaranta 229 Pino Bernasconi 231 Felice Menghini 233 Remo Fasani 236 Amleto Pedroli 239 Ugo Canonica 243 -

Les Écrivains Et La Langue: Le Cas De Charles Ferdinand Ramuz
MÁTHESIS 15 2006 275-289 LES ECRIVAINS ET LA LANGUE: LE CAS DE CHARLES FERDINAND RAMUZ MARIA HERMÍNIA AMADO LAUREL (Universidade de Aveiro) Nous pouvons parler la langue faite, nous ne pouvons faire la langue. Maurice Millioud, 1914. RESUMO Este estudo pretende iniciar o leitor à problemática das relações entretecidas entre os escritores e a língua na qual se exprimem. Trata-se de uma questão particularmente premente no caso dos escritores de língua francesa cuja nacionalidade porém é outra. Se nos casos dos escritores provenientes de países hoje independentes ou em processo de progressiva autonomia, mas outrora sob administração francesa, o uso da língua do “ocupante” adquire várias modulações, entre o sentimento da sua inadequação para traduzir culturas de transmissão oral (Patrick Chamoiseau), e a sua constituição como veículo de comunicação internacional da situação do colonizado (Albert Memmi, ou Assia Djebar, voz da condição feminina), o uso da língua francesa reveste-se de outros contornos no caso dos escritores europeus belgas e suíços, para os quais o francês é também uma língua materna (caso à parte ainda ocupam os escritores flamengos que escrevem em língua francesa), solicitando portanto outros enfoques. Questão crucial no caso da obra de Charles Ferdinand Ramuz, um dos escritores suiços de língua francesa mais emblemáticos da primeira metade do século XX, cujos romances acabam de ser editados na prestigiada colecção Bibliothèque de La Pléiade. É precisamente sobre alguns dos ensaios mais significativos do autor que nos debruçamos neste estudo, comprovando o seu empenhamento no direito à diferença que deve ser reconhecido aos usos não-clássicos da língua francesa como língua literária. -

Inhaltsverzeichnis 13.10.2016
Inhaltsverzeichnis 13.10.2016 Martin Bodmer-Stiftung für einen Gottfried Keller-Preis Utoquai 55 Lieferschein-Nr.: 9755778 Postfach 1425 Abo-Nr.: 3003568 8032 Zürich Themen-Nr.: 840.1 Ausschnitte: 12 Folgeseiten: 11 Total Seitenzahl: 23 Auflage Seite 01.10.2016 Literarischer Monat 4'500 1 Die achtzehn Köpfe der Esther M. 01.10.2016 Literarischer Monat 4'500 7 Vorrede 01.10.2016 Literarischer Monat 4'500 10 Liebe Leserinnen und Leser 01.10.2016 Literarischer Monat 4'500 11 Skizze eines Porträts von Pietro De Marchi 10.10.2016 Der Landbote 27'811 15 Zwischen Alpträumen und Lonely Planet 10.10.2016 Zürcher Unterländer / Neues Bülacher Tagblatt 17'573 16 Zwischen Alpträumen und Lonely Planet 10.10.2016 Zürcher Oberländer 21'930 17 Zwischen Alpträumen und Lonely Planet 10.10.2016 lausanne-tourisme.ch Keine Angabe 18 Carte blanche Esther Montandon à l'AJAR 09.10.2016 agendalugano.ch Keine Angabe 19 La carta delle arance 10.10.2016 Corriere del Ticino 36'108 21 La poesia di De Marchi 10.10.2016 Anzeiger von Uster 6'663 22 Zwischen Alpträumen und Lonely Planet 11.10.2016 La Rivista / Camera di Commercio Italiana 8'000 23 Il Premio Gottfried Keller 2016 assegnato a Pietro De Marchi ARGUS der Presse AG Rüdigerstrasse 15 CH-8027 Zürich Tel. +41(44) 388 82 00 Mail [email protected] www.argus.ch Datum: 01.10.2016 Literarischer Monat Medienart: Print Themen-Nr.: 840.001 8037 Zürich Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften Abo-Nr.: 3003568 044/ 361 26 06 Auflage: 4'500 Seite: 39 www.schweizermonat.ch Erscheinungsweise: 4x jährlich Fläche: 151'818 mm² Die achtzehn Köpfe der Esther M. -

The Personalism of Denis De Rougemont
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! The personalism of Denis de Rougemont: ! Spirituality and politics in 1930s Europe! ! ! ! ! ! Emmanuelle Hériard Dubreuil! ! St John’s College, 2005! ! ! ! ! ! ! ! ! This dissertation is submitted for the degree of! Doctor of Philosophy! !1 ! ! !2 Abstract! ! ! ! ! ! Neither communist, nor fascist, the personalist third way was an original attempt to remedy the malaise of liberal democracies in 1930s Europe. Personalism puts the emphasis on the human person – understood to be an individual in relation to others – as the foundation and aim of society. Yet, because of the impossibility of subjecting the human person to a systematic definition, personalism remains complex and multifaceted, to the extent that it might be best to speak of ‘personalisms’ in the plural. The various personalist movements that emerged in France in the 1930s are little known, and the current historiography in English misrepresents them. ! This dissertation is a study of the various personalist movements based in France in the 1930s, examining their spiritual research and political philosophy through the vantage point of Swiss writer Denis de Rougemont (1906-1985). In Rougemont lies the key to understanding the personalist groupings because he was the only thinker to remain active in the two foremost movements (Ordre Nouveau and Esprit) throughout the 1930s. The personalism of Ordre Nouveau was the most original, in both senses of the term. It deserves particular attention as an important political philosophy and an attempt to justify political and economic federalism in 1930s Europe. Whilst an Ordre Nouveau activist, Rougemont can be looked upon as the mediator and federator of personalisms in the 1930s. ! However, Rougemont’s particular contribution to personalist thought was more spiritual and theological than political or economic. -

Motto 5 CHARLES-FERDINAND RAMUZ Himmlischer Friede •. • • 7 (Aus Dem Französischen Überset2t Von Albert Baur) ROBERT
Motto 5 CHARLES-FERDINAND RAMUZ Himmlischer Friede •. • • 7 (Aus dem Französischen überset2t von Albert Baur) ROBERT WALSER Kleist in Tbun 12 FELIX MOESCHLIN Die Galluspforte steht immer da 20 HANS ALBRECHT MOSER Der Tote 26 CARL JACOB BURCKHARDT Begegnung mit einem Kind 31 MEINRAD INGLIN Daß der Mensch den Garten baue und bewahre 38 ALBIN ZOLLINGER Labyrinth der Vergangenheit 43 RUDOLF JAKOB HUMM Ersatz 5 3 KURT GUGGENHEIM Geistige Landesverteidigung 56 FRIEDRICH GLAUSER Die Begegnung 65 PIERO BIANCONI Schneefäll 77 (Aus dem Italienischen übersetzt) http://d-nb.info/850569494 KARL SCHÖLLY Der ewige Wächter 81 LUDWIG HOHL Das Pferdchen 89 MAURICE ZERMATTEN Das Antlitz der Liebe 101 (Aus dem Französischen übersetzt von Erna Hildebrandt) MAX FRISCH Der andorranische Jude 107 S. CORINNA BILLE Von dem, der auf den Tod wartete 109 (Aus dem Französischen übersetzt von Elisabeth Dütsch) VERENA RENTSCH Die Flügeltür 115 TONI HALTER Kirchengedanken 118 (Aus dem Rätoromanischen übersetzt von Paul Kamer) MAURICE CHAPPAZ Merde den Schlüsselblumen 124 (Aus dem Französischen übersetzt von Pierre Imhasly) GEORGES HALDAS Christi Samenkorn 128 (Aus dem Französischen übersetzt von Elisabeth Dütsch) FELICE FILIPPINI Der Grabstein 135 (Aus dem Italienischen übersetzt von Adolf Saager) GION DEPLAZES Und ein Riß ging durch den Himmel 146 (Aus dem Rätoromanischen übersetzt von Rita Cathomas-Bearth) SILJA WALTER Alle Nonnenklöster dieser Welt 149 RAYMOND PITTET Der verirrte Jude 171 (Aus dem Französischen übersetzt von Hans Rudolf Hilty) CLA BIERT Der Birkenklotz 179 (Aus dem Rätoromanischen übersetzt von Iso Camartin) FRIEDRICH DÜRRENMATT Nächtliches Gespräch mit einem verachteten Menschen 181 KURT MARTI Die obere Hälfte von zwei Birken, in ziemlicher Entfernung . -
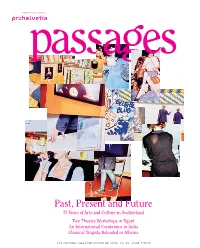
Past, Present and Future
passages Past, Present and Future 75 Years of Arts and Culture in Switzerland Two Theatre Workshops in Egypt An International Conference in India Classical Tragedy Reloaded in Albania THE CULTURAL MAGAZINE OF PRO HELVETIA, NO. 65, ISSUE 2/2015 3 – 31 DOSSIER 32 LOCAL TIME Cairo: Two Workshops, Many Stories Arts and Culture in Transition Innovative exchanges between Swiss and Egyptian theatre This anniversary issue of Passages also features a bonus poster. It was artists. designed by 22 artists whose contributions have helped shape the By Menha el Batraoui magazine over the past 10 years, and portrays their visions of art and 34 New Delhi: Public Art culture 25 years from now. in Global Dialogue A conference in Mumbai brings together performance 3 Timeline collectives from around the globe. Selected milestones from the 75-year history of Pro Helvetia. By Rosalyn D’Mello 7 Looking Into the Past 36 REPORTAGE The birth of Pro Helvetia, in historical context. Medea Mash-Up By Daniel Di Falco A Swiss-Albanian theatre production revisits a classical 10 “Be Brief, and to the Point” tragedy. By Isabel Drews (text) The poet and author Giovanni Orelli in conversation. and Tristan Sherifi (photos) By Yari Bernasconi 40 PRO HELVETIA NEWSFLASH 14 The Meeting of the Accidental and the Planned Cultural Diversity A portrait of the multimedia artist Christian Marclay. Anniversary Publication By Aoife Rosenmeyer Architecture Biennale Swiss Jazz in Bremen 18 The Punk Dance Diva 42 PARTNER An interview with the dancer and choreographer La Ribot. Star Academy By Anne Davier By Elsbeth Gugger 22 Guerilla Tactics, Poetics, and Static Electricity 43 CARTE BLANCHE Crisis and Crossroads An interview with the electronic artist Valentina Vuksic. -

La Catastrophe
Table 1. Introduction : Dans le kaléidoscope des catastrophes 7 Les catastrophes à la cave, 7 - La catastrophe : un phénomène culturel, 9 - La contribution de la littérature à la culture de la catastrophe - dix thèses, 15 - La culture de la catastrophe en Suisse et ses apocalypses littéraires dans les Alpes, 21 - Dans le kaléidoscope des catastrophes, 25 2. Quand le monde fait naufrage en Suisse - le local et le global 33 Introduction, 33 - Secousses transfrontalières : la Suisse, le tremblement de terre de Lisbonne et le rêve de Pestalozzi, 38 - Le héros de la liberté comme sauveur dans la catastrophe : Guillaume Tell de Schiller, 44 - Une tempête divine et son lieu terrestre : La Crue en Emmental de Jeremias Gotthelf, 50 - Les accidents planétaires d’Adolf Wôlfli, 55 - La création d’un monde à partir de rien : Monde de Robert Walser, 59 - L’écri ture des flammes comme script de film : La Fin du monde filmée par Tange de Notre-Dame de Biaise Cendrars, 62 - La Guerre civile espagnole à la radio: ouvertures sonores chez Charles Ferdinand Ramuz, 67 - En train express dans la chute : Albin Zollinger et Friedrich Dürrenmatt, 71 - Les étoiles et la pes tilence : universalisation et retour au local dans l’œuvre tar dive de Dürrenmatt, 77 - Au fond du trou noir: la mise en abyme catastrophique du théâtre dans Le Crépuscule des poètes de Dürrenmatt, 83 - Littérature mondiale à la suisseL'Homme : apparaît au Quaternaire de Max Frisch, 87 3. Le ciment des catastrophes 93 Introduction, 93 - L’éboulement de Goldau en 1806, événe ment fondateur -

Stravinsky and C.-F. Ramuz: a Primitive Classicism Tom Gordon
Document généré le 24 sept. 2021 15:23 Canadian University Music Review Revue de musique des universités canadiennes Stravinsky and C.-F. Ramuz: A Primitive Classicism Tom Gordon Numéro 4, 1983 URI : https://id.erudit.org/iderudit/1013905ar DOI : https://doi.org/10.7202/1013905ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Canadian University Music Society / Société de musique des universités canadiennes ISSN 0710-0353 (imprimé) 2291-2436 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Gordon, T. (1983). Stravinsky and C.-F. Ramuz: A Primitive Classicism. Canadian University Music Review / Revue de musique des universités canadiennes, (4), 218–244. https://doi.org/10.7202/1013905ar © Canadian University Music Society / Société de musique des universités Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des canadiennes, 1983 services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ STRAVINSKY AND C.-F. RAMUZ: A PRIMITIVE CLASSICISM Tom Gordon Aside from a taste for fine paper and simple wines, there were few obvious links between Stravinsky and his Swiss literary collaborator and friend, Charles-Ferdinand Ramuz. Stravinsky was extroverted, socially adept, and direct; Ramuz was introverted, dour, and self-effacing. But from the moment they met there was an immediate empathy.