La Nuit Des Assises Du Guirbaden
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jan 20 Nat.Pdf
PIPEDREAMS Programs, January 2020 - Winter Quarter: The following listings detail complete contents for the year January 2020 Winter Quarter of PIPEDREAMS broadcasts. The first section includes complete program contents, with repertoire, artist, and recording information. Following that is program information in "short form". For more information, contact your American Public Media station relations representative at 651-290-1225/877- 276-8400 or the PIPEDREAMS Office (651-290-1539), Michael Barone <[email protected]>). For last-minute program changes, watch DACS feeds from APM and check listing details on our PIPEDREAMS website: http://www.pipedreams.org AN IMPORTANT NOTE: It would be prudent to keep a copy of this material on hand, so that you, at the local station level, can field listener queries concerning details of individual program contents. That also keeps YOU in contact with your listeners, and minimizes the traffic at my end. However, whenever in doubt, forward calls to me (Barone). * * * * * * * PIPEDREAMS Program No. 202001 (distribution on 1/6/2020) Alsacian Adventure . we preview some instruments to be visited during the upcoming Spring Pipedreams Tour (May 23-June 7, 2020). [Hour 1] J. S. BACH: Prelude in E-flat, BWV 552 –Ute Gremme-Geuchen (1741 Johann-Andrea Silbermann/St. Thomas Church, Strasbourg) Aeolis 10861 BACH: Jesus Christus, unser Heiland, BWV 665 –Ewald Kooiman (1778 J-A Silbermann/Protestant Temple, Bouxwiller) Aeolus 10851 BACH: 2 Chorale-preludes (Nun freut euch, BWV 734; An Wasserflüssen Babylon, BWV 653b) –Helmut Walcha (1780 J-A Silbermann/St. Pierre-le-Jeune, Strasbourg) Archiv 419904 THEODORE PARMENTIER: Andantino. THEOPHILE STERN: Fantasie in d –Yannick Merlin (2003 Koenig/St. -

Planung Radreise Elsass (Elsässische Weinstraße Und Auf Den Spuren Von Andreas Silbermann (Gest
FrankrPla Elsaß Ostroute 31.01.2005 Planung Radreise Elsass (Elsässische Weinstraße und auf den Spuren von Andreas Silbermann (gest. 1734) Land: Variante A Variante B Stand: 31.01.2005 Literatur: Bikeline Radtourenbuch Elsass, mit Karten Maßstab 1 : 75 000 Freier, Peter: Radwandern Elsaß Süd , (18 Touren mit Routenskizzen) Stöppelverlag 1998, 128 S., 29,80 DM Lewandowski, Norbert: Genußradeln im Elsaß (30 Touren) Steigerverlag Augsburg 1996, 126 S.,19,80 DM Monks, Christa: Radtouren im Elsaß Verlag Bruckmann München 1995, ca. 190 S., 44 DM Freizeitkarte mit Radrouten: Haute-Rhin a Velo , (Elsaß: Colmar, Mulhouse, Basel), IGN 1995, Legende französisch/deutsch, Maßstab 1 : 100 000, IGN 2001 Tag Ort Rad Straße Literatur S. Rad Straße Literatur S. Höhe Sehenswürdigkeiten Übernachtung PLZ/DG Tel. Preis Einz.km Etappe Einz.km Etappe Karlsruhe 76137 O721/386291 Morgenstraße 45 1. Lauterbourg Stöppel 12 Steiger 71 Landauer Tor, Stadttürme, Rathaus, ehem. Bischhöfl. Residenz Radweg Bruckmann24 Lauter-Tal (deutsch-franz. Radwanderweg)Hagenbach 76767 O7273/1280 Zeppelinstr. 7 Helmut Rihm Scheibenhardt Scheibenhardt Niederlauterbach Niederlauterbach Bienwaldmühle Schleitthal Welschdorf Bruckmann24 roman. Dorfkirche St. Ulrich 11. Jh. 2. Wissembourg 19 19 Stöppel 12 Kirche St. Pierre et Paul m. Glasfenstern u. Malereien Fachwerkhäuser, Maison de Sel (1450 eh. Salzspeicher) Quartier de Bruch (Vorstadt 15. Jh) ehem. Gerberhaus (Renaissancerker), Maison de l'Ami Fritz 10 Stöppel 42 Burgruine auf Sandsteinmassiv Bruckmann58 Froensburg Bruckmann59 13 Brunnen Burg Lutzelhart Kuhlendorf Kuhlendorf Fachwerkkirche 1820 als Bet- und Schulhaus erbaut, Orgel 1977 Betschdorf Betschdorf Steinguttöpfer (Ton aus dem Tertiär für sehr hartes Steinzeug seit dem 13. Jh. Brenntemperatur 1200 Grad Walbourg Stöppel 37 Klosterkirche 3. -

Visit to Stanford University Martin Pasi and I Met in Palo Alto, California, On
Visit to Stanford University Martin Pasi and I met in Palo Alto, California, on 12 March 1999 to visit organist-scholar Robert Bates, then university organist at Stanford University, and to examine the famous dual-temperament organ by C. B. Fisk from 1984 (Fisk Opus 85) in the university’s Memorial Church. Professor Bates proved to be an invaluable resource throughout our project, having both first-hand experience in playing, explaining and composing for the dual-temperament organ at Stanford and a thorough knowledge of the historical, mathematical and musical dimensions of keyboard temperaments. His early questions and suggestions were important guides to honing an initially amorphous concept. A first-hand encounter with Fisk Opus 85 likewise gave concrete testimony that such a concept could be coherently realized. The assurance we experienced at Stanford had followed momentary panic resulting from a telephone conversation between Martin Pasi and Robert Bates on 8 March 1999.43 Bates had suggested that a dual-temperament scheme in a context such as ours would need to go further in distinguishing between the two temperaments than does Fisk Opus 85 with its fifth-comma meantone and unique Vogel-Fisk well-tempered tunings, resulting from five extra notes per octave. Bates had further wondered if it would be best to relegate the dual-temperament concept to a smaller, secondary instrument at the front of the cathedral.44 43 Deduced from Kevin Vogt to Martin Pasi, electronic mail (printed copy), 9 March 1999, Pasi Shop Records, Roy, Washington. 44 The idea of a smaller “choir” organ emerged with Bedford Presbyterian Church’s signing of the contract for Pasi Opus 13 when it became apparent that Pasi Opus 14 would not be finished in time 86 The idea of expanding the Fisk-Vogel dual-temperament scheme was not new to us. -

Que Jouait-On Sur Les Orgues Silbermann Au Xviiiesiècle ?
CD Caecilia 1-2018 - Orgue et organistes © Union Sainte Cécile - Strasbourg Que jouait-on sur les orgues Silbermann au XVIIIesiècle ? Christian Lutz Ce texte constitue la version remaniée et complétée d’une conférence donnée le 8 octobre 2017 à Eschentzwiller, dans le cadre d’une Journée de l’orgue Silbermann organisée par l’association des Itiné- raires des orgues Silbermann et l’association pour le rayonnement de l’orgue d’Eschentzwiller (ARODE), avec des exemples musicaux donnés par Olivier Wyrwas. Si le répertoire pratiqué sur un orgue Schnitger à la fin du XVIIe siècle ou sur un orgue Cavaillé-Coll deux siècles plus tard est bien connu, il n’en va pas de même pour les Silbermann d’Alsace. La musique qui y était jouée à l’époque de leur construction reste aujourd’hui encore assez énigmatique. Lorsqu’au début du XXe siècle, quelques jeunes organistes alsaciens tombèrent sous le charme des orgues Silbermann, qui étaient passés de mode au siècle précédent, ils y jouèrent la seule musique ancienne qui faisait partie de leur répertoire, à savoir la musique de J.S. Bach. Pour Albert Schweitzer, ces instruments mettaient idéalement en valeur la polyphonie de Bach. Ainsi, à St-Thomas de Stras- bourg, c’était pour lui « un bonheur d’y jouer une fugue de Bach. Je ne connaissais pas d’orgue, où tout ressortait avec autant de clarté et de précision »1. Mais l’orgue de St-Thomas qu’il jouait au début du XXe siècle n’était plus celui de 1741, il n’avait plus que trois rangs de plein-jeu sur les dix rangs d’origine et les Nazards et Tierces avaient cédé la place à des jeux de fonds. -

Publications Des Sociétés D'histoire Et D
Revue d’Alsace 135 | 2009 Les sociétés d'histoire de l'Alsace et leurs fédérations Publications des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace (année 2007-2008) Gabrielle Claerr-Stamm Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/alsace/981 DOI : 10.4000/alsace.981 ISSN : 2260-2941 Éditeur Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace Édition imprimée Date de publication : 1 octobre 2009 Pagination : 579-611 ISSN : 0181-0448 Référence électronique Gabrielle Claerr-Stamm, « Publications des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace (année 2007-2008) », Revue d’Alsace [En ligne], 135 | 2009, mis en ligne le 01 juin 2011, consulté le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/alsace/981 ; DOI : 10.4000/alsace.981 Tous droits réservés Gabrielle CLAERR-STAMM Publications des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace (années 2007-2008) 1. Bas-Rhin SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU BAS-RHIN Bulletin t. CXXVII-CXXVIII 2007-2008 Au chevet de l’humanité soufrante. Les médecins cantonaux ou médecins des pauvres dans le département du Haut-Rhin (1825-1870). Par Eveline MÜNCH-MERTZ. Chapitre 1/ La santé des pauvres : la pensée médicale au service de la création d’une institution : I. La mise en place de l’institution de la médecine cantonale ; II. Les missions coniées aux hommes, les services attendus et les travaux exigés ; III. La pensée médicale au service de la mise en route de l’institution de la médecine cantonale. Chapitre 2/ Les médecins cantonaux : I. La formation des médecins cantonaux et leur carrière ; II. Les dossiers individuels et leur candidature au poste de médecin cantonal ; III. -
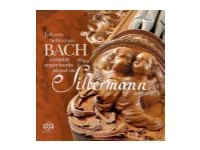
Kooiman-E-R03-B1c[Aeulus-15CD
Recordings / Aufnahmen / Enregistrements: April 2008 (Ewald Kooiman – Ebersmunster, Bouxwiller), June 2008 (Ewald Kooiman – Marmoutier), October 2008 (Ewald Kooiman – Wasselonne, Marmoutier), March 2010 (Gerhard Gnann – Wasselonne), September 2010 (Ute Gremmel-Geuchen – Strasbourg), October 2010 (Bernhard Klapprott – Arlesheim, Ute Gremmel-Geuchen – Marmoutier), November 2010 (Gerhard Gnann – Strasbourg), March 2011 (Ute Gremmel-Geuchen – Villingen), July 2011 (Gerhard Gnann – Soultz Haut-Rhin) Producer / Aufnahmeleitung / Direction artistique: Christoph Martin Frommen Engineering, editing & mastering / Technik, Schnitt & Mastering / Prise de son, montage & mastering: Christoph Martin Frommen Mikrofone / Microphones: 9 x DPA 4006 omnidirectional Photos: Christoph Martin Frommen, Jean-Philippe Grille (cover photo SACD vol.17) Organ maintenance: Gaston Kern, Manufacture d’orgues Daniel Kern, Quentin Blumenroeder, Bernhard Fleig Registranten / Assistants: Anne den Hartigh, Victoria Siegert (Strasbourg, November 2010) Dank an / Acknowledgements / Remerciements: Jean-Philippe Grille (Wasselonne), Père Florent & Hubert Sigrist (Marmoutier), Daniel Maurer, Daniel Leininger, René Gerber (Strasbourg), Anne-Laure Thallinger (Bouxwiller), Bernard Chalté & Henri Keller (Ebersmunster), Ulrich Kolberg (Villingen), Jean-Claude Zehnder & Peter Koller (Arlesheim), Monique Leimbach-Weinzäpfel (Soultz-Haut-Rhin), Quentin Blumenroeder. Greatest thanks to Anne den Hartigh. +© 2012 Postfach 300 226, 41343 Korschenbroich, Germany mail@aeolus–music.com www.aeolus–music.com -

View PDF Editionarrow Forward
THE DIAPASON SEPTEMBER 2019 Faculty, staff, and students of the University of Michigan Organ Department Hill Auditorium, Ann Arbor, Michigan Cover feature on pages 22–24 PHILLIP TRUCKENBROD CONCERT ARTISTS ANTHONY & BEARD ADAM J. BRAKEL THE CHENAULT DUO PETER RICHARD CONTE CONTE & ENNIS DUO LYNNE DAVIS ISABELLE DEMERS CLIVE DRISKILL-SMITH DUO MUSART BARCELONA JEREMY FILSELL MICHAEL HEY HEY & LIBERIS DUO CHRISTOPHER HOULIHAN DAVID HURD MARTIN JEAN HUW LEWIS RENÉE ANNE LOUPRETTE LOUPRETTE & GOFF DUO ROBERT MCCORMICK BRUCE NESWICK ORGANIZED RHYTHM RAéL PRIETO RAM°REZ JEAN-BAPTISTE ROBIN ROBIN & LELEU DUO BENJAMIN SHEEN HERNDON SPILLMAN CAROLE TERRY JOHANN VEXO BRADLEY HUNTER WELCH JOSHUA STAFFORD THOMAS GAYNOR 2016 2017 LONGWOOD GARDENS ST. ALBANS WINNER WINNER IT’S ALL ABOUT THE ART ǁǁǁ͘ĐŽŶĐĞƌƚĂƌƟƐƚƐ͘ĐŽŵ 860-560-7800 ŚĂƌůĞƐDŝůůĞƌ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚͬWŚŝůůŝƉdƌƵĐŬĞŶďƌŽĚ͕&ŽƵŶĚĞƌ THE DIAPASON Announcing the Gruenstein Award Scranton Gillette Communications One Hundred Tenth Year: No. 9, Siegfried Emanuel Gruenstein (March 26, 1877– that essays be between 2,500 Whole No. 1318 December 6, 1957) and 10,000 words. Quality is SEPTEMBER 2019 The Diapason is pleased to announce the creation of The preferred over quantity. All Established in 1909 Gruenstein Award to honor S. E. Gruenstein, founder and accompanying illustrations ISSN 0012-2378 fi rst editor of The Diapason, which commenced publication must be submitted in JPEG, in December 1909. For the journal’s 110th anniversary, The TIFF, and/or PDF formats An International Monthly Devoted to the Organ, Diapason is establishing the Gruenstein Award to recognize the with text and must be of suf- the Harpsichord, Carillon, and Church Music scholarly work of a young author who has not reached her or his fi cient quality to print (300 dpi 35th birthday as of January 31, 2020. -

Chapter Two the Conception of a New Cathedral Organ
CHAPTER TWO THE CONCEPTION OF A NEW CATHEDRAL ORGAN Like many significant and sober things imagined in the course of play, the successor to Casavant Opus 51 was conceived half in jest. No sooner had organ builder Martin Pasi made the whimsical suggestion that he build an organ playable in two different tuning systems did the idea become a serious and plausible proposal. So began an odyssey that would have itself been a remarkable story had a musical instrument never been realized in wood and metal. The whirlwind process of commissioning the organ took only four months, while the subsequent period of research and design took over two years, involving first-hand examination of important historical and modern organs throughout Europe and the United States as well the counsel of many colleagues and international experts. While Pasi brooded over how to realize the organ he had so spontaneously proposed, I searched for an adequate reason to explain why such an esoteric instrument as a dual-tempered organ belongs, of all places, in a church. Commission Each generation of Omaha’s Catholic cathedrals since 1859 has contributed to its musical culture through the establishment and sustenance of choirs and the building and re-building of organs. The opportunity to commission a work of art on 61 the scale of and as unique as Martin Pasi’s Opus 14 is much rarer. A convergence of people and ideas, together with the approaching Year of Jubilee at the turn of the third millennium and the impending centennial celebration of Saint Cecilia Cathedral in 2007, conspired to create the conditions out of which such a commission could be awarded. -

Recherches Sur La Famille Et L'oeuvre Des Silbermann En Alsace
Marc Schaefer Recherches sur la famille et l'oeuvre des Silbermann en Alsace Walcker-Stiftung für orgelwissenschaftliche Forschung 2012 Veröffentlichungen der Walcker-Stiftung für orgelwissenschaftliche Forschung Band 23 publiziert auf http://www.walcker-stiftung.de/ © Walckerstiftung für orgelwissenschaftliche Forschung c/o PD Dr. Roland Eberlein Franz-Raveaux-Str. 16 50827 Köln Avertissement La présente version de ma thèse de doctorat de 3ème cycle est une reproduction quasi inchangée du texte dactylographié d’origine datant de 1984, pour ce qui est du texte et de la mise en page. En particulier il m’a paru important de maintenir inchangée la répartition du texte par rapport à la pagination, afin de permettre au lecteur de retrouver des renvois occasionnels à mon texte faits dans des publications subséquentes. Pour cela il a été nécessaire de maintenir la présentation ainsi que la police et la taille des caractères. Il en va de même de quelques irrégularités au niveau des interlignes et de la pagination. J’ai renoncé délibérément à retravailler et à actualiser le texte. Toutefois quelques erreurs ont été corrigées. Signalons que dans la transcription des pièces justificatives le ß allemand a été remplacé par ss, étant donné que les machines à écrire françaises de l’époque ne comportaient pas de ß. Vorbemerkung Bei der vorliegenden Fassung meiner Dissertation handelt es sich um eine in Text und Layout weitgehend unveränderte Nachschrift des ursprünglichen Typoskripts aus dem Jahr 1984. Insbesondere schien es mir wichtig, daß die Zuordnung des Textes zu den Seitenzahlen weitgehend unverändert bleibt, damit der Leser Verweisen auf meine Arbeit nachgehen kann, die sich in der bisher erschienenen Literatur gelegentlich finden. -

Historic Organs of ALSACE May 22-June 6, 2021 16 Days with J
historic organs of ALSACE May 22-June 6, 2021 16 Days with J. Michael Barone INVITATION Certainly we all benefitted from the deci- ing instruments from Silbermann and his These are unprecedented times, with sion of Andreas Silbermann (1678-1734) son. Since these Silbermann organs also much uncertainty for all of us. Even so, be- to leave his native Saxony and learn the proved themselves as excellent vehicles yond the unravelling of our plans in 2020, craft of organ building in Alsace, where his for the music of Bach, it was not long be- I want to be optimistic about 2021. So, de- instruments represent a canny cohabita- fore Albert Schweitzer, a native Alsacian spite the disappointment of our previous tion of French éclat and German gravitas. from Gunsbach, joined in the fray, and the cancellation, since so much planning had Some of this style was transferred by his ‘organ reform’ movement was begun. been done on its behalf I’d like to take this younger brother and apprentice Gottfried opportunity to re-invite you to participate (1683-1753) when he returned home to Perhaps you will be able to join me over in that same Adventure in Alsace for the work for the Saxon king, building stellar a glass of Alsacian wine to discuss the coming year. instruments quite unlike the central-Ger- distinct qualities of German and French man norm (which some of you may have instruments, the relative merits of histo- The Alsacian region on the west bank seen and heard during our most recent ricity and progress, and the delight we all of the Upper Rhine has been in an active PIPEDREAMS Tour). -

Carillon” Organ Stop: a Short History – with a Special Focus on Cavaillé-Coll
The “Carillon” organ stop: A short history – with a special focus on Cavaillé-Coll Paul Peeters The Carillon serves as imitation of the glockenspiel or steel bars. This stop has always 3 ranks and consists of the trebles of the Fluit or Roerfluit 4 foot, third 13/5 foot, of an average scale, and Flageolet 1 foot; it has no break. The most important merit of this stop is the fast speech of the pipes. In large organs, it is sometimes found in the Rückpositiv, but mostly in the Oberwerk; the latter position creates the best effect, because it is far remote from the audience.1 Origin The origin of this type of Glockenspiel (by means of a compound stop of flue pipes) is to be found in the Rhine region in the early decades of the eighteenth century.2 The organ built in 1727 by Balthasar König (1684– 1756) for the Steinfelden Basilica St. Potentinus (Eifel region) holds a tre- ble stop called Tintinabulum that consists of two ranks (13/5 and 1 foot) and this is so far the earliest known example. In some of his other in- 1 Jan van Heurn, De Orgelmaaker, facsimile ed. (Dordrecht: Blussé, 1804–5; Buren: Knuf, 1988), 3: 265, § 40: “CARILLON diend tot nabootsing van het Klokken of Staafspel. Deze Stem is altoos 3 Sterk, en bestaat uit de Discanten der Fluit of Roerfluit 4 Voet, Terz 13/5 Voet, middelbaare mensuur, en Flageolet 1 Voet; zij wordt niet gerepeteerd. De voor- naamste deugd dezer Stem bestaat in de vlugge aanspraak der Pijpen. -

Journées Européennes Du Patrimoine 2020 : Grand Est
Journées européennes du patrimoine 2020 : Grand Est Journées européennes du patrimoine 2020 19 et 20 septembre 2020 o Programme du département du Bas-Rhin Programme extrait de la base nationale des Journées européennes du patrimoine, au 14 septembre 2020. L’inscription sur ce site relève de la responsabilité des organisateurs d’événements, des modifications peuvent être apportées jusqu’à la date de la manifestation. Les erreurs, omissions et changements ne sauraient engager la responsabilité de la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est qui coordonne cette opération nationale en région. https://openagenda.com/jep-2020-grand-est Sommaire Grand Est......................................................................................................................................................... 8 Bas-Rhin | Allenwiller.............................................................................................................................. 8 Patrimoine agricole d'antan..........................................................................................................8 Bas-Rhin | Andlau................................................................................................................................... 9 Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - centre d'interpretation du patrimoine............................9 Bas-Rhin | Avolsheim............................................................................................................................ 11 Allée du Dompeter......................................................................................................................11