Article 6 BRAB 64 Houedjissin Mutations
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

S a Rd in Ia
M. Mandarino/Istituto Euromediterraneo, Tempio Pausania (Sardinia) Land07-1Book 1.indb 97 12-07-2007 16:30:59 Demarcation conflicts within and between communities in Benin: identity withdrawals and contested co-existence African urban development policy in the 1990s focused on raising municipal income from land. Population growth and a neoliberal environment weakened the control of clans and lineages over urban land ownership to the advantage of individuals, but without eradicating the importance of personal relationships in land transactions or of clans and lineages in the political structuring of urban space. The result, especially in rural peripheries, has been an increase in land aspirations and disputes and in their social costs, even in districts with the same territorial control and/or the same lines of nobility. Some authors view this simply as land “problems” and not as conflicts pitting locals against outsiders and degenerating into outright clashes. However, decentralization gives new dimensions to such problems and is the backdrop for clashes between differing perceptions of territorial control. This article looks at the ethnographic features of some of these clashes in the Dahoman historic region of lower Benin, where boundaries are disputed in a context of poorly managed urban development. Such disputes stem from land registries of the previous but surviving royal administration, against which the fragile institutions of the modern state seem to be poorly equipped. More than a simple problem of land tenure, these disputes express an internal rejection of the legitimacy of the state to engage in spatial structuring based on an ideal of co-existence; a contestation that is put forward with the de facto complicity of those acting on behalf of the state. -

The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte D'ivoire, and Togo
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Togo Public Disclosure Authorized Nga Thi Viet Nguyen and Felipe F. Dizon Public Disclosure Authorized 00000_CVR_English.indd 1 12/6/17 2:29 PM November 2017 The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Togo Nga Thi Viet Nguyen and Felipe F. Dizon 00000_Geography_Welfare-English.indd 1 11/29/17 3:34 PM Photo Credits Cover page (top): © Georges Tadonki Cover page (center): © Curt Carnemark/World Bank Cover page (bottom): © Curt Carnemark/World Bank Page 1: © Adrian Turner/Flickr Page 7: © Arne Hoel/World Bank Page 15: © Adrian Turner/Flickr Page 32: © Dominic Chavez/World Bank Page 48: © Arne Hoel/World Bank Page 56: © Ami Vitale/World Bank 00000_Geography_Welfare-English.indd 2 12/6/17 3:27 PM Acknowledgments This study was prepared by Nga Thi Viet Nguyen The team greatly benefited from the valuable and Felipe F. Dizon. Additional contributions were support and feedback of Félicien Accrombessy, made by Brian Blankespoor, Michael Norton, and Prosper R. Backiny-Yetna, Roy Katayama, Rose Irvin Rojas. Marina Tolchinsky provided valuable Mungai, and Kané Youssouf. The team also thanks research assistance. Administrative support by Erick Herman Abiassi, Kathleen Beegle, Benjamin Siele Shifferaw Ketema is gratefully acknowledged. Billard, Luc Christiaensen, Quy-Toan Do, Kristen Himelein, Johannes Hoogeveen, Aparajita Goyal, Overall guidance for this report was received from Jacques Morisset, Elisée Ouedraogo, and Ashesh Andrew L. Dabalen. Prasann for their discussion and comments. Joanne Gaskell, Ayah Mahgoub, and Aly Sanoh pro- vided detailed and careful peer review comments. -

Monographie Ketou
REPUBLIQUE DU BENIN =-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= MINISTERE DE LA PROSPECTIVE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’EVALUATION DE L’ACTION PUBLIQUE (MPDEAP) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE KETOU DIRECTION DES ETUDES DEMOGRAPHIQUES Décembre 2008 TABLE DES MATIERES LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................................ vi LISTE DES GRAPHIQUES ........................................................................................................ x PREFACE ..................................................................................................................................... xi NOTE METHODOLOGIQUE SUR LE RGPH-3 .................................................................. xiii SITUATION GEOGRAPHIQUE DE KETOU DANS LE BENIN .......................................... 1 SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE DE KETOU DANS LE DEPARTEMENT DU PLATEAU ............................................................................................... 2 1- GENERALITES ........................................................................................................................ 3 1-1 Présentation de la commune .................................................................................................. 3 1-1-1 Le relief .......................................................................................................................... -

Monographie Des Départements Du Zou Et Des Collines
Spatialisation des cibles prioritaires des ODD au Bénin : Monographie des départements du Zou et des Collines Note synthèse sur l’actualisation du diagnostic et la priorisation des cibles des communes du département de Zou Collines Une initiative de : Direction Générale de la Coordination et du Suivi des Objectifs de Développement Durable (DGCS-ODD) Avec l’appui financier de : Programme d’appui à la Décentralisation et Projet d’Appui aux Stratégies de Développement au Développement Communal (PDDC / GIZ) (PASD / PNUD) Fonds des Nations unies pour l'enfance Fonds des Nations unies pour la population (UNICEF) (UNFPA) Et l’appui technique du Cabinet Cosinus Conseils Tables des matières 1.1. BREF APERÇU SUR LE DEPARTEMENT ....................................................................................................... 6 1.1.1. INFORMATIONS SUR LES DEPARTEMENTS ZOU-COLLINES ...................................................................................... 6 1.1.1.1. Aperçu du département du Zou .......................................................................................................... 6 3.1.1. GRAPHIQUE 1: CARTE DU DEPARTEMENT DU ZOU ............................................................................................... 7 1.1.1.2. Aperçu du département des Collines .................................................................................................. 8 3.1.2. GRAPHIQUE 2: CARTE DU DEPARTEMENT DES COLLINES .................................................................................... 10 1.1.2. -

Rapport Final De L'enquete Steps Au Benin
REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LA SANTE Direction Nationale de la Protection Sanitaire Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles RAPPORT FINAL DE L’ENQUETE STEPS AU BENIN Juin 2008 EQUIPE DE REDACTION Pr. HOUINATO Dismand Coordonnateur National / PNLMNT Dr SEGNON AGUEH Judith A. Médecin Epidémiologiste / PNLMNT Pr. DJROLO François Point focal diabète /PNLMNT Dr DJIGBENNOUDE Oscar Médecin Santé Publique/ PNLMNT i Sommaire RESUME ...........................................................................................................1 1 INTRODUCTION....................................................................................... 2 2 OBJECTIFS ................................................................................................ 5 3 CADRE DE L’ETUDE: (étendue géographique).........................................7 4 METHODE ............................................................................................... 16 5 RESULTATS ............................................................................................ 23 6 Références bibliographiques...................................................................... 83 7 Annexes ii Liste des tableaux Tableau I: Caractéristiques sociodémographiques des sujets enquêtés au Bénin en 2008..... 23 Tableau II: Répartition des sujets enquêtés en fonction de leur niveau d’instruction, activité professionnelle et département au Bénin en 2008. ................................................................ 24 Tableau III : Répartition des consommateurs -

BENIN FY2020 Annual Work Plan
USAID’s Act to End NTDs | West Benin FY20 WORK PLAN USAID’s Act to End Neglected Tropical Diseases | West Program BENIN FY2020 Annual Work Plan Annual Work Plan October 1, 2019 to September 30, 2020 1 USAID’s Act to End NTDs | West Benin FY20 WORK PLAN Contents ACRONYM LIST ............................................................................................................................................... 3 NARRATIVE ..................................................................................................................................................... 6 1. National NTD Program Overview....................................................................................................... 6 2. IR1 PLANNED ACTIVITIES: LF, TRA, OV ............................................................................................... 8 i. Lymphatic Filariasis ........................................................................................................................ 8 ii. Trachoma ..................................................................................................................................... 12 iii. Onchocerciasis ............................................................................................................................. 14 3. SUSTAINABILITY STRATEGY ACTIVITIES (IR2 and IR3) ...................................................................... 16 i. DATA SECURITY AND MANAGEMENT .......................................................................................... 16 ii. -

BENIN-2 Cle0aea97-1.Pdf
1° vers vers BOTOU 2° vers NIAMEY vers BIRNIN-GAOURÉ vers DOSSO v. DIOUNDIOU vers SOKOTO vers BIRNIN KEBBI KANTCHARI D 4° G vers SOKOTO vers GUSAU vers KONTAGORA I E a BÉNIN N l LA TAPOA N R l Pékinga I o G l KALGO ER M Rapides a vers BOGANDÉ o Gorges de de u JE r GA Ta Barou i poa la Mékrou KOULOU Kompa FADA- BUNZA NGOURMA DIAPAGA PARC 276 Karimama 12° 12° NATIONAL S o B U R K I N A GAYA k o TANSARGA t U DU W o O R Malanville KAMBA K Ka I bin S D É DU NIGER o ul o M k R G in u a O Garou g bo LOGOBOU Chutes p Guéné o do K IB u u de Koudou L 161 go A ZONE vers OUAGADOUGOU a ti r Kandéro CYNÉGÉTIQUE ARLI u o KOMBONGOU DE DJONA Kassa K Goungoun S o t Donou Béni a KOKO RI Founougo 309 JA a N D 324 r IG N a E E Kérémou Angaradébou W R P u Sein PAMA o PARC 423 ZONE r Cascades k Banikoara NATIONAL CYNÉGÉTIQUE é de Sosso A A M Rapides Kandi DE LA PENDJARI DE L'ATAKORA Saa R Goumon Lougou O Donwari u O 304 KOMPIENGA a Porga l é M K i r A L I B O R I 11° a a ti A j 11° g abi d Gbéssé o ZONE Y T n Firou Borodarou 124 u Batia e Boukoubrou ouli A P B KONKWESSO CYNÉGÉTIQUE ' Ségbana L Gogounou MANDOURI DE LA Kérou Bagou Dassari Tanougou Nassoukou Sokotindji PENDJARI è Gouandé Cascades Brignamaro Libant ROFIA Tiélé Ede Tanougou I NAKI-EST Kédékou Sori Matéri D 513 ri Sota bo li vers DAPAONG R Monrou Tanguiéta A T A K O A A é E Guilmaro n O Toukountouna i KARENGI TI s Basso N è s u Gbéroubou Gnémasson a Î o u è è è É S k r T SANSANN - g Kouarfa o Gawézi GANDO Kobli A a r Gamia MANGO Datori m Kouandé é Dounkassa BABANA NAMONI H u u Manta o o Guéssébani -

(Buruli Ulcer) in Rural Hospital, Southern Benin, 1997–2001 Martine Debacker,* Julia Aguiar,† Christian Steunou,† Claude Zinsou,*† Wayne M
Mycobacterium ulcerans Disease (Buruli Ulcer) in Rural Hospital, Southern Benin, 1997–2001 Martine Debacker,* Julia Aguiar,† Christian Steunou,† Claude Zinsou,*† Wayne M. Meyers,‡ Augustin Guédénon,§ Janet T. Scott,* Michèle Dramaix,¶ and Françoise Portaels* Data from 1,700 patients living in southern Benin were Even though large numbers of patients have been collected at the Centre Sanitaire et Nutritionnel Gbemoten, reported, the epidemiology of BU remains obscure, even in Zagnanado, Benin, from 1997 through 2001. In the Zou disease-endemic countries. In 1997, a first report was pub- region in 1999, Buruli ulcer (BU) had a higher detection rate lished on 867 BU patients from the Republic of Benin (21.5/100,000) than leprosy (13.4/100,000) and tuberculo- (West Africa) for 1989–1996 (4). Our study covers the sis (20.0/100,000). More than 13% of the patients had osteomyelitis. Delay in seeking treatment declined from 4 ensuing 5 years (1997 to 2001), during which a collabora- months in 1989 to 1 month in 2001, and median hospital- tive project was initiated to improve detection and control ization time decreased from 9 months in 1989 to 1 month of BU. This study describes BU in Benin and presents in 2001. This reduction is attributed, in part, to implement- demographic trends and epidemiologic data from the four ing an international cooperation program, creating a nation- southern regions of Benin (Zou, Oueme, Mono, and al BU program, and making advances in patient care. Atlantique), as seen in a rural hospital in the Zou Region. uruli ulcer (BU), caused by Mycobacterium ulcerans, Patients and Methods Bis the third most common mycobacterial disease in Our observations are based on 1,700 consecutive humans after tuberculosis and leprosy (1). -

République Du Bénin Ministère De L'eau Et Des Mines (MEM) Société Nationale Des Eaux Du Bénin (SONEB)
République du Bénin Ministère de l'Eau et des Mines (MEM) Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) Étude de collecte de données pour le développement des eaux souterraines et l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau dans les départements de Couffo et Plateau en République du Bénin Rapport Final Avril 2018 Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) Sanyu Consultants Inc. GE JR 18-047 Table des Matières Carte de localisation de la zone cible du Projet Table des Matières Liste des Tableaux et Figures/Abréviations/Taux de change CHAPTER 1 Présentation de l’Étude ............................................................................................... 1-1 1.1 Contexte et objectifs de l’Étude ........................................................................................... 1-1 1.2 Calendrier de l’étude .............................................................................................................. 1-1 CHAPTER 2 Présentation du secteur de l’eau Bénin .................................................................. 2-1 2.1 Plan de niveau supérieur dans le secteur de l’eau ............................................................ 2-1 2.2 Organisation du secteur de l’eau .......................................................................................... 2-1 2.3 Orientations de la coopération financière du Japon ......................................................... 2-4 2.4 Projets des autres bailleurs de fonds et organismes de coopération ............................. 2-5 CHAPTER -

Policy Brief
Policy Brief Falylath Babah Daouda and Paul T.M. Ingenbleek October 2020 Endogenous Products to Increasing Food Security in Benin Who is this aimed at? • Agricultural policy makers in government and institutions • Agri-businesses Key messages • The white KG with small grain size is highly accepted and strongly demanded in Benin. • The production of KG is the main barrier to its market development. • Farmers’ decision to augment the quantity of their production of KG is based on an assessment of a combination of contract farming attributes. • To be successful in implementing a contract farming on the production of KG, a contracting company needs either to be well-known by the farmers or to rely on a well-known procurement officer by farmers. Policy options • Traditional marketing system may be considered for market development for KG • Institutional arrangements can help to increase the production of KG • Satisfying farmers ultimate needs for producing KG may be a first milestone to insuring KG accessibility and affordability. Executive Summary and was based on a quasi-experiment with 254 farmers in KG growing basin (Central region of Benin). The contract attributes for the supply of KG are pre-production agreements Kersting groundnut (KG) is a crop used mostly in feasts and between the farmer and the eventual buyer to reduce big events and known as Doyiwé in Benin that has been uncertainties and costs related to farm input, output market and neglected because of a lack of incentive, policy and research quality of KG. support for its production. Production and marketing systems for the crop seem to be fragmented as there are many varieties of the grains being cultivated. -

Benin Private Health Sector Census
BENIN PRIVATE HEALTH SECTOR CENSUS December 2014 This document was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Andrew Carmona, Sean Callahan, and Kathryn Banke for the Strengthening Health Outcomes through the Private Sector (SHOPS) project. Recommended Citation: Carmona, Andrew, Sean Callahan, and Kathryn Banke. 2014. Benin Private Health Sector Census. Bethesda, MD: Strengthening Health Outcomes through the Private Sector Project, Abt Associates Inc. Download copies of SHOPS publications at: www.shopsproject.org Cooperative Agreement: GPO-A-00-09-00007-00 Submitted to: Ricardo Missihoun Commodities and Logistics Specialist United States Agency for International Development/Benin Marguerite Farrell, AOR Bureau of Global Health Global Health/Population and Reproductive Health/Service Delivery Improvement United States Agency for International Development Abt Associates Inc. 4550 Montgomery Avenue, Suite 800 North Bethesda, MD 20814 Tel: 301.347.5000 Fax: 301.913.9061 www.abtassociates.com In collaboration with: Banyan Global Jhpiego Marie Stopes International Monitor Group O’Hanlon Health Consulting BENIN PRIVATE HEALTH SECTOR CENSUS DISCLAIMER The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. TABLE OF CONTENTS Acronyms ........................................................................................................................... vi Acknowledgements -
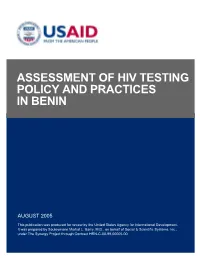
Assessment of Hiv Testing Policy and Practices in Benin
ASSESSMENT OF HIV TESTING POLICY AND PRACTICES IN BENIN AUGUST 2005 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Souleymane Martial L. Barry, M.D., on behalf of Social & Scientific Systems, Inc., under The Synergy Project through Contract HRN-C-00-99-00005-00. Bureau for Global Health Office of HIV/AIDS United States Agency for International Development 1300 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20523 ASSESSMENT OF HIV TESTING POLICY AND PRACTICES IN BENIN The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. CONTENTS ABBREVIATIONS AND ACRONYMS ...................................................vii EXECUTIVE SUMMARY....................................................................... ix BACKGROUND......................................................................................1 HIV/AIDS SITUATION .........................................................................1 HIV/AIDS TESTING IN THE WEST AFRICA SUB-REGION...............3 METHODOLOGY ................................................................................4 KEY FINDINGS ......................................................................................4 DEVELOPMENT OF POLICIES, NORMS, STANDARDS, AND PROTOCOLS ...................................................................................4 AVAILABILITY OF PMTCT, VCT, AND ARV SERVICES ...................5 COMMUNITY