Langues Et Populations Du Nord-Est Centrafricain
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Republique Centrafricaine Autorite Nationale Des Elections
21.1.11.3code VillageQu 21 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Code Préfecture 2021-01-02 AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS Code 21/03/2021 12:38:27 Date et Heure Impression : 21/03/2021 12:38:27 Sous Pref21.1 2021/03/19 ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 MARS 2021 - RESULTATS PROVISOIRES code 21.1.11 Préfecture : BAMINGUI BANGORAN Nbre inscrits : 210 commune Sous Préfecture : NDELE Nbre votant : 83 code 3954 centre Code BV 3954-01 Circonscription : 1ere Circonscription Nbre Blancs Nuls : 7 7 Commune : DAR-EL-KOUTI Taux de participation : 39,52% TOTAL : photo 0 0% Village Quartier : KOUBOU Suffrages Exprimés : 76 centre vote : ECOLE KOUBOU BV : BV01 1/74 Ordre Candidat Parti Politique voix Taux% 1 ALIME AZIZA SOUMAINE MCU 35 46,05% 46,05% 2 AROUN-ASSANE TIGANA P.G.D 41 53,95% 53,95% 100% 1 / 74 21.1.11.3code VillageQu 21 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Code Préfecture 2021-01-02 AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS Code 21/03/2021 12:38:27 Date et Heure Impression : 21/03/2021 12:38:27 Sous Pref21.1 2021/03/19 ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 MARS 2021 - RESULTATS PROVISOIRES code 21.1.11 Préfecture : BAMINGUI BANGORAN Nbre inscrits : 397 commune Sous Préfecture : NDELE Nbre votant : 164 code 3948 centre Code BV 3948-01 Circonscription : 1ere Circonscription Nbre Blancs Nuls : 39 39 Commune : DAR-EL-KOUTI Taux de participation : 41,31% TOTAL : photo 76 54% Village Quartier : DJALABA Suffrages Exprimés : 125 centre vote : MAIRIE DE NDELE BV : BV01 2/74 Ordre Candidat Parti Politique voix Taux% 1 ALIME AZIZA SOUMAINE MCU 108 86,40% 86,40% 2 AROUN-ASSANE TIGANA P.G.D -

Central African Republic Giraffe Conservation Status Report February 2020
Country Profile Central African Republic Giraffe Conservation Status Report February 2020 General statistics Size of country: 622,984 km² Size of protected areas / percentage protected area coverage: 13% Species and subspecies In 2016 the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) completed the first detailed assessment of the conservation status of giraffe, revealing that their numbers are in peril. This was further emphasised when the majority of the IUCN recognised subspecies where assessed in 2018 – some as Critically Endangered. While this update further confirms the real threat to one of Africa’s most charismatic megafauna, it also highlights a rather confusing aspect of giraffe conservation: how many species/subspecies of giraffe are there? The IUCN currently recognises one species (Giraffa camelopardalis) and nine subspecies of giraffe (Muller et al. 2016) historically based on outdated assessments of their morphological features and geographic ranges. The subspecies are thus divided: Angolan giraffe (G. c. angolensis), Kordofan giraffe (G. c. antiquorum), Masai giraffe (G. c. tippleskirchi), Nubian giraffe (G. c. camelopardalis), reticulated giraffe (G. c. reticulata), Rothschild’s giraffe (G. c. rothschildi), South African giraffe (G. c. giraffa), Thornicroft’s giraffe (G. c. thornicrofti) and West African giraffe (G. c. peralta). However, over the past decade GCF together with their partner Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F) have performed the first-ever comprehensive DNA sampling and analysis (genomic, nuclear and mitochondrial) from all major natural populations of giraffe throughout their range in Africa. As a result, an update to the traditional taxonomy now exists. This study revealed that there are four distinct species of giraffe and likely five subspecies (Fennessy et al. -

Relations Interethniques Et Culture Matérielle Dans Le Bassin Du Lac Tchad
RELATIONS INTERETHNIQUES ET CULTURE MATÉRIELLE DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD Actes du lllème ColloqueMEGA-TCHAD Paris : ORSTOM 11 - 12 septembre 1986 Textes réunis par Daniel BARRETEAU et Henry TOURNEUX Editions de I'ORSTOM INSTITUT FRANçAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POURLE DÉVELOPPEMENT EN COOPÉRATION CollectionCOLLOQUES et SÉMINAIRES PARIS 1990 La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les .copies ou reproductions strictement réservéesà l'usage privé du copiste et non des- tinees & une utilisation collectives. et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exempleet d'illustration, .toute représentation ou reproduction intégrale,ou par- tielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ayants cause,est illicite>> (alinéaler de l'article 40). Cette représentationou reproduction, par quelque procede que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code pénal. ISSN 107672896 O BRSTOM 1990 ISBN : 2-7099-0998-7 RE.LATlONS INTERETHNIQUES ET CULTURE MATÉRIELLE DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD Actes du lllème Colloque MEGA-TCHAD Paris : ORSTOM 11 - 12 septembre 1986 5 Pages Daniel BARRETEAU, Henry TOURNEUX Avant-propos 7 Alain MARLIAC Discoursd'ouverture 9 Augustin HOLL Variabilitkmortuaire ettransformations culturelles dansla plaine péritchadienne 13 Werner VYClCHL Les languestchadiques et l'origine chamitique de leur vocabulaire 33 I-Ierrmcum JUNGRAITI-IMAYR Différentshkritages culturels et nonculturels h l'ouest et h l'est du bassin du Tchad selonles données linguistiques 43 Sergio BALDI Premieressai d'évaluation des emprunts arabes en haoussa 53 Pierre NOUGAYROL Langues et populations du nord-estcentrafricain 65 John P. -

Le Congo Et Le Japon Soutiennent La Réforme Du Conseil De Sécurité De L
L’ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CONGO 200 FCFA www.adiac-congo.com N° 2487 - JEUDI 17 DÉCEMBRE 2015 DIPLOMATIE Le Congo et le Japon soutiennent la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU En séjour de travail au Congo du 14 au 16 décembre, le vice-ministre japonais des Affaires étrangères chargé des re- lations avec le parlement a discuté avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Jean Claude Gakosso, de réforme du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Histoshi Kikawada, qui a visité mar- di les locaux des Dépêches de Braz- zaville, a déploré, dans une interview, le manque de candidats congolais aux bourses d’études offertes par son pays. « Lors de la Conférence interna- tionale pour le développement de l’Afrique, en 2013, il a été retenu que les jeunes Africains devraient régulièrement suivre des formations au Japon. Pour le moment, malheu- reusement, il n’y a pas de candidats congolais. J’ai mis à profi t mes ren- contres avec les autorités congolaises pour le leur rappeler », a-t-il indi- qué estimant que la non-maîtrise de la langue anglaise pourrait expliquer cet état de fait. Page 3 Histoshi Kikawada et Jean Claude Gakosso SÉCURITÉ COLLECTIVE ECHÉANCES ÉLECTORALES Afripol peaufine son action L’IDC se dit prête à affronter contre le terrorisme la présidentielle de 2016 Au terme d’une réunion clôturée lundi à terrorisme, la traite des hommes, le Alger, le Mécanisme africain de coopéra- trafi c d’armes et de la drogue, la cyber- tion policière (Afripol) a adopté ses textes criminalité, ainsi que de nouveaux as- juridiques et réaffi rmé sa détermination pects du crime organisé transformant à renforcer ses actions de lutte contre le l’Afrique en un point de passage in- ternational des différentes activités de terrorisme, le crime organisé et autres contrebande », a estimé le ministre algé- menaces visant le continent. -
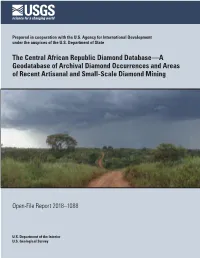
The Central African Republic Diamond Database—A Geodatabase of Archival Diamond Occurrences and Areas of Recent Artisanal and Small-Scale Diamond Mining
Prepared in cooperation with the U.S. Agency for International Development under the auspices of the U.S. Department of State The Central African Republic Diamond Database—A Geodatabase of Archival Diamond Occurrences and Areas of Recent Artisanal and Small-Scale Diamond Mining Open-File Report 2018–1088 U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey Cover. The main road west of Bambari toward Bria and the Mouka-Ouadda plateau, Central African Republic, 2006. Photograph by Peter Chirico, U.S. Geological Survey. The Central African Republic Diamond Database—A Geodatabase of Archival Diamond Occurrences and Areas of Recent Artisanal and Small-Scale Diamond Mining By Jessica D. DeWitt, Peter G. Chirico, Sarah E. Bergstresser, and Inga E. Clark Prepared in cooperation with the U.S. Agency for International Development under the auspices of the U.S. Department of State Open-File Report 2018–1088 U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey U.S. Department of the Interior RYAN K. ZINKE, Secretary U.S. Geological Survey James F. Reilly II, Director U.S. Geological Survey, Reston, Virginia: 2018 For more information on the USGS—the Federal source for science about the Earth, its natural and living resources, natural hazards, and the environment—visit https://www.usgs.gov or call 1–888–ASK–USGS. For an overview of USGS information products, including maps, imagery, and publications, visit https://store.usgs.gov. Any use of trade, firm, or product names is for descriptive purposes only and does not imply endorsement by the U.S. Government. Although this information product, for the most part, is in the public domain, it also may contain copyrighted materials as noted in the text. -

La Savane Des Porou : Environnement Et Genre De Vie D'un Clan Dacpa
LA SAVANE DES POROD Environnement et genre de vie d'un clan dacpa (Centrafrique) Michel BENOIT Département MAA ORSTOM UR Dynamique des Systèmes 1989 de production LASAVANEDESPOROU 3 Un jour de décembre 1987 en Afrique Centrale. Nord de la cuvette du Congo, 6° parallèle. Longitude : 20 degrés Est. La Bamba est une rivière tranquille. Son cours ourlé d'une étroite forêt arrose d'immenses savanes et offre ses eaux claires aux éléphants comme aux premiers matins du monde. La savane des Porou s'étend de part et d'autre de cet affluent de l'Oubangui, à une trentaine de kilomètres au nord d'un ancien poste que les Blancs baptisèrent Grimari après y avoir créé une ville au coeur de l'actuel Centrafrique. Région de collines douces, plantureuse et arrosée (1500 mm de pluies par an répartis sur 120 jours), herbeuse, boisée, giboyeuse et sans hiver, la Haute Bamba abritait le clan des Porou au début de ce siècle lorsqu'ils entrèrent en contact avec l'Adjoint des Affaires Indigènes Lalande qui prenait le contrôle du pays au nom de la France. Les Porou venaient de la Haute Ouaka. Ils avançaient farouches au gré de leurs habitudes et de la guerre. Pour l'étranger -piroguier de l'Oubangui ou marchand du Darfour- les Porou sont des "Bandas". Le mot signifie "filet" et les Porou et leurs voisins chassent effectivement avec ça mais le terme ne vaut guère mieux que son sens littéral. Du massif des Bongo à l'Ombella, en passant par le Bamingui et le Chinko, les hommes se présentent en désignant leur peuple et leur clan. -

Biogeography of the Reptiles of the Central African Republic
African Journal of Herpetology, 2006 55(1): 23-59. ©Herpetological Association of Africa Original article Biogeography of the Reptiles of the Central African Republic LAURENT CHIRIO AND IVAN INEICH Muséum National d’Histoire Naturelle Département de Systématique et Evolution (Reptiles) – USM 602, Case Postale 30, 25, rue Cuvier, F-75005 Paris, France This work is dedicated to the memory of our friend and colleague Jens B. Rasmussen, Curator of Reptiles at the Zoological Museum of Copenhagen, Denmark Abstract.—A large number of reptiles from the Central African Republic (CAR) were collected during recent surveys conducted over six years (October 1990 to June 1996) and deposited at the Paris Natural History Museum (MNHN). This large collection of 4873 specimens comprises 86 terrapins and tortois- es, five crocodiles, 1814 lizards, 38 amphisbaenids and 2930 snakes, totalling 183 species from 78 local- ities within the CAR. A total of 62 taxa were recorded for the first time in the CAR, the occurrence of numerous others was confirmed, and the known distribution of several taxa is greatly extended. Based on this material and an additional six species known to occur in, or immediately adjacent to, the coun- try from other sources, we present a biogeographical analysis of the 189 species of reptiles in the CAR. Key words.—Central African Republic, reptile fauna, biogeography, distribution. he majority of African countries have been improved; known distributions of many species Tthe subject of several reptile studies (see are greatly expanded and distributions of some for example LeBreton 1999 for Cameroon). species are questioned in light of our results. -

L'exploitation Et La Protection Des Ressources Forestières En
L'exploitation et la protection des ressources foresti`eres en R´epublique Centrafricaine de la p´eriode pr´ecoloniale `anos jours. Beno^ıtTchakossa To cite this version: Beno^ıtTchakossa. L'exploitation et la protection des ressources foresti`eresen R´epubliqueCen- trafricaine de la p´eriode pr´ecoloniale`anos jours.. Sciences de l'environnement. UNIVERSITE DE NANTES, 2012. Fran¸cais. <NNT : 2012NANT3006>. <tel-01171560> HAL Id: tel-01171560 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01171560 Submitted on 10 Jul 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. UNIVERSITE DE NANTES UFR D’HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE Année 2012 L’EXPLOITATION ET LA PROTECTION DES RESSOURCES FORESTIERES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE DE LA PERIODE PRECOLONIALE A NOS JOURS THESE présentée et soutenue publiquement en vue d’obtenir le grade de Docteur de l’Université de Nantes par Benoît TCHAKOSSA 13 Avril 2012 Directeur de thèse : Professeur Bernard SALVAING Jury : Monsieur : Michel CATALA, Professeur à l’Université de Nantes Monsieur : Rémi FABRE, Professeur -

Prospection Des Mils Pénicillaires En Afrique De L'ouest : Collecte 1975
I.B.P.G.R. - O.R.S.T.O.M. PROSPECTION DES MILS PENICILLAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST Collecte 1975 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Catalogue O.R.S.T.O.M. J. CLEMENT - J. SEQUJER O.R.8.T.O.M. - PARIS - 1980 SOMMAIRE ET L~GENDE - CARTE DES ISOHYETES ANNUELLES EN MILLIMÈTRES page 3 CARTE DES POINTS DE COLLECTE page 4 AbréPiatlons utilisées dans le catalogue: CH fonne cultivée Pr Mil précoce Hy fonne «Cbibra» SP semi précoce Sv fonne sauvage ST semi tardif TA tardif Le poids de graines indiqué co"espond au lot d'origine J.B.P.G.R. >C" • ..Golong0550 Il" +-~o If" 11 + ." + -t ~ ".. •.. ..of +".. Jr +.. 't t.. + ""'\ BANGUI +• +~O :+ •.. que R- CENTRAFRIQUE isohyetes moyennes annuelles en mm échelle o () +~ o 7 + Répub lique CENTRAFRIQUE Prospection des Mils Pénici Il aires 11 Q Po in 1 de Collecte o Echelle 0\::::::=,-..;5.t:,0=='0ii,°..._01==,;,;200 km c. MILS P~nicillaires - Ann~e de collecte -1975 REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE 5 NO NO NO Nom de Vi liage Poids catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines en grammes OR5TOM sur carte coordonnées P. 151 C. 151 01 Pend~ Clt TA Aria 1558 g P. 152 C. 152 02 B~tokonia CH TA Tein 431 g P. 153 C 153 03 B~daia CH TA Tein 320 g P. 154 C. 154 04 B~toko CH TA Tein 740 g P. 155 C. 155 05 B~daia II Clt TA Tein 250 g P. 156 C. 156 06 B~boura III CH TA Tein 380 g P. -

Patrimoine Mondial 25 BUR
Patrimoine mondial 25 BUR Distribution limitée WHC-2001/CONF.205/INF.6 Paris, le 6 juin 2001 Original : français ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL BUREAU DU COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL Vingt-cinquième session Paris, Siège de l’UNESCO, Salle X 25-30 juin 2001 Point 5.1 de l'ordre du jour provisoire : Rapports sur l’état de conservation de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril Rapport sur la mission interdisciplinaire au Parc national du Manovo-Gounda St. Floris, République centrafricaine, du 5 au 13 mai 2001 RESUME Le Parc national du Manovo-Gounda-St. Floris a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1988 sur la base des critères naturels (ii) et (iv), après que l’Etat partie ait donné toutes les assurances quant à son engagement à améliorer les conditions d’intégrité du Parc. Toute l’importance du Parc réside dans la richesse de sa faune et de sa flore. Depuis l’inscription du Parc sur la Liste du patrimoine mondial, le Comité du patrimoine mondial s’est trouvé confronté aux problèmes sérieux posés par le braconnage sauvage exercé par des groupes armés, venant aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du pays, causant des problèmes de sécurité et la mort, en 1997, de quatre agents du parc. Selon l’UICN, 80 % de la faune du parc ont été décimés à des fins commerciales. Du fait de l’insécurité, le tourisme a été fortement freiné. -

Au-Delà Des Éléphants
MN-02-15-558-FR-C AU-DELÀ DES ÉLÉPHANTS Éléments d’une approche stratégique de l’UE pour la conservation de la nature en Afrique SYNTHÈSE Inputs for an EU strategic approach to wildlife conservation in Africa 978-92-79-49561-8 Coopération internationale et développement Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur l’Union européenne. Un numéro unique gratuit (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques). COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE? Publications gratuites: • un seul exemplaire: sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); • exemplaires multiples/posters/cartes: auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm), AU-DELÀ DES ÉLÉPHANTS des délégations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm), Éléments d’une approche stratégique de l’UE en contactant le réseau Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm) ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*). pour la conservation de la nature en Afrique – Synthèse (*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, Commission européenne hôtels ou cabines téléphoniques). Direction générale de la Coopération internationale et du Développement 1049 Bruxelles Publications payantes: • sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). BELGIQUE De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internet via le serveur Europa (http://europa.eu). -

Central African Republic
Central African Republic (East) 23°E 24°E 25°E 26°E 27°E Gunna Bisellia Biri Ali Golo Kuru Pipi 1 Prefecture Capital Mbali 87 Faraj Allah Town Ouadda Mbangana 1 Large Village Dinga 2 p Airfield Major road Bani Road Yalinga 7°N 7°N Haute-Kotto Prefecture Sub-Prefecture Ndrassa Sudan Djéma Essé 1 p F Yalinga Ndokora 1 Mbihi Ngui 1 Bria Ngouroundou Owou 2 Zoukouzou Haut-Mbomou Nzako DjémaF Ourou 1 6°N 6°N Ouando Zabé Bandé Ndambissoua Rafai Derbissako Fadama Bakouma Ngouyo 1 p Bakouma 89 Légo Bitillifoundi 0 F 2 Ndénguiro F 1 6 0 32 Barroua 1 1 Louagba Tambura Mbomou 2 F Banangui Fodé 1 Aguiné Maboussou Obo 67 0 p 5 Bambouti p F Bambouti Zémio Gambaatouré Manza Karmador p F Bangbi Li Yubu Ouanda Banima Kitessa M'Boki Obo 3 p 18 Gassibala Sélim 5 5 Gbandi 107 Bassigbiri Kitika 9 Gbafourou F 6 F Tambourah Ligoua-Zéwia F Bali-Fondo F 55 F6 Démbia F1 3 Banabongo Bahr 7 1 Voungba 2 Bayélé 4 Gapia 3 Guérékindo Guénékoumba 1 Tabane p 2 F 105 3 Zémio 5°N Yaénikao LabassondakéF p FRafaï 0 F 5°N Bangassou Kafambour 4 Mogba 2 Sukawe Duma Makembé F Mappé Zamoi Niakari Gbanga 1 Democratic Republic of the Congo Gambo p F 18 Kwanza Bagbanda Bondo FF Magazani Adama Barama Douma 47 Dékolo Gwane Doruma FGambo 44 5 Bangassou Zimé Napudu Ukwatutu 2 Usuma F Soa Bagi Djamuse Magamba Dongobe Buye Vula Gandakotto Ngbali Ouango Ndu Balia Wegi 23°E 24°E 25°E 26°E 27°E 030 60 120 180 The boundaries, names and designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.