Croissance Démographique Et Urbanisation Des Ksour
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Amroun L Ksar BEK Ajeau
Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism Vol.2 Nr.2 2018 Typological affiliation of Bent EL Khass Ksar Lila AMROUN, Boualem DJEBRI Received: 28 April 2018• Revised: 29 August 2018 • Accepted: 30 September2018 TYPOLOGICAL AFFILIATION OF BENT EL KHASS KSAR Lila AMROUN PHD Student, Dr. Arch., National School of Architecture and Urbanism of Algiers, E-mail : [email protected] Boualem DJEBRI Lecturer, Dr. Ing., National School of Architecture and Urbanism of Algiers, E-mail : [email protected] Abstract: The architectural typology is defined by the membership of a predefined model, governed by a set of common features. In arid and semi-arid environments, it depends on a certain number of criteria which are: social affiliation, geographical area and climate. In order to define the architectural typology of Bent El Khass ksar, in the region of Brezina, a monographic study was carried out according to different approaches: historical to determine its social, architectural membership to understand its spatial organization, and constructive, to try a dating of the built complex. In comparison with the ksour of El Bayadh wilaya, characterized by their residential and vernacular cachet; it was found that Bent El khass ksar had a singular form and spatial organization. This could be translated by a difference in the function that would be other than residential. Perched on top, hidden from view, it integrates perfectly with its immediate environment, to play the role of collective loft, whose typological similarity would be located in the Moroccan region. Keywords: Earthen architecture, Ksour, typology, Morphology, Ksour mountains, Collective attic Introduction: La Wilaya d’El Bayadh, partie intégrante des Monts des Ksour, dispose d’un patrimoine des plus remarquables et d’une richesse historique particulière. -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets
No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -
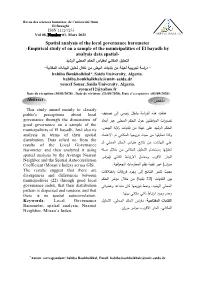
Spatial Analysis of the Local Governance Barometer
Revue des sciences humaines de l’université Oum El Bouaghi ISSN 1112-9255 Vol 08, Number 01, Mars 2021 OEB Univ. Publish. Co. Spatial analysis of the local governance barometer -Empirical study of on a sample of the municipalities of El bayadh by analysis data spatial- التحليل المكاني لمقياس الحكم المحلي الرشيد - دراسة تجريبية لعينة من بلديات البيض من خﻻل تحليل البيانات المكانية- habiba Boukholkhal*, Saida University, Algeria. [email protected] youcef Souar, Saida University, Algeria. [email protected] Date de réception:(30/03/2020) , Date de révision: (23/08/2020), Date d’acceptation :(03/09/2020) Abstract : ملخص : This study aimed mainly to classify هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تصنيف public's perceptions about local تصورات المواطنين حول الحكم المحلي عبر أبعاد governance through the dimensions of good governance on a sample of the الحكم الرشيد على عينة من بلديات وﻻية البيض، municipalities of El bayadh, And also its وكذا تحليلها من حيث توزيعها المكاني تم اﻻعتماد analysis in terms of their spatial distribution. Data relied on from the على البيانات من نتائج مقياس الحكم المحلي ثم results of the Local Governance تحليلها باستخدام التحليل المكاني من خﻻل صلة Barometer and then analyzed it using spatial analysis by the Average Nearest الجار اﻻقرب ومعامل اﻻرتباط الذاتي )مؤشر Neighbor and the Spatial Autocorrelation موران( عبر تقنية نظم المعلومات الجغرافية. .Coefficient (Moran’s Index) across GIS The results suggest that there are بحيث تشير النتائج إلى وجود فروقات واختﻻفات divergences and differences between بين البلديات )22 بلدية( من خﻻل مؤشر الحكم municipalities (22) through good local المحلي الرشيد، ونمط توزيعها كان متباعد وعشوائي governance index, that their distribution pattern is dispersed and random, and that وعدم وجود ارتباط ذاتي مكاني بينها. -

Aba Nombre Circonscriptions Électoralcs Et Composition En Communes De Siéges & Pourvoir
25ame ANNEE. — N° 44 Mercredi 29 octobre 1986 Ay\j SI AS gal ABAN bic SeMo, ObVel , - TUNIGIE ABONNEMENT ANNUEL ‘ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL Abonnements et publicité : Edition originale .. .. .. .. .. 100 D.A. 150 DA. Edition originale IMPRIMERIE OFFICIELLE et satraduction........ .. 200 D.A. 300 DA. 7 9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER (frais d'expédition | tg}, ; 65-18-15 a 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER en sus) Edition originale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années antérleures : suivant baréme. Les tables sont fourntes gratul »ment aux abonnés. Priére dé joindre les derniéres bandes . pour renouveliement et réclamation. Changement d'adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANGAISE) SOMMAIRE DECRETS des ceuvres sociales au ministére de fa protection sociale, p. 1230. Décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux siéges & pourvoir pour l’élection a l’Assemblée fonctions du directeur des constructions au populaire nationale, p. 1217. , ministére de la formation professionnelle et du travail, p. 1230. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général da la planification Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux et de. la gestion industrielle au ministére de fonctions du directeur de la sécurité sociale et lindustrie lourde,.p. -

19 Joumada Ethania 1432 22 Mai 2011
19 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 mai 2011 9 Le comité intersectoriel peut faire appel, dans le cadre Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 de ses travaux, à toute personne utile en raison de ses correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à compétences. l’organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au Art. 11. — Les membres du comité intersectoriel sont 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au période de trois (3) années renouvelable. 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant expiration du mandat. nomination des membres du Gouvemement ; Les représentants des départements ministériels doivent Vu le décret exécutif n° 98-356 du 24 Rajab 1419 avoir au moins rang de cadre supérieur et ne peuvent se correspondant au 14 novembre 1998 fixant les modalités faire représenter aux réunions du comité. d'application des dispositions de la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux Art. 12. — Le comité intersectoriel se réunit trois (3) administratifs ; fois par an, en session ordinaire et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja président. -

La Couverture Sanitaire De La Wilaya D'el Bayadh
La couverture sanitaire de la wilaya d’El Bayadh Pr. Larbi ABID La Wilaya d’El Bayadh est limitée au Nord par les wilayas de Saida et Tiaret, à l’Est et Sud Est par Laghouat, Ghardaïa et Adrar ; à l’Ouest et Sud Ouest par Sidi Bel Abbes, Naâma et Bechar. Occupant une superficie de 71 697 km², soit 3% du territoire national, elle s’étend du Chott Echergui à l’Erg Occidental et est dominée par les monts du djebel Amour de la chaîne Atlas Saharien. Cette wilaya est constituée de 03 zones distinctes qui sont : La zone des Hautes Plaines (8778 Km2) composées de 06 communes. Cette zone se caractérise par la faiblesse et l'irrégularité des précipitations, la gelée (40 à 60 jour) et la présence de vents chaux (sirocco) avec des périodes sèches. Sur le plan bioclimatique, cette zone fait partie de l’étage aride frais. La Zone de l’Atlas Saharien (11846 Km2) composé de 13 communes. Elle présente une situation bioclimatique (semi aride froid) et bénéficie de l'apport en eau et alluvions provenant des sommets et versants des reliefs montagneux. Les précipitations sont relativement plus importantes par rapport aux autres zones. La Zone Pré- Saharienne (51073 Km2) constituée 03 communes, est la partie la plus désavantagée. Elle représente la superficie la plus importante de la Wilaya (71 % de la superficie totale). Les altitudes décroissent du Nord au Sud de 1 000 à 500 m environ à la partie extrême Sud de la Wilaya où en note la présence de l’Erg Occidental qui renforce l'aspect désertique de cette zone avec une période estivale plus longue et plus chaude. -

ANNEXE 1 De L'arrêté 30 Mai 2015 Du Ministre De L'énergie Déterminant
Ministère de l’Energie Autorité de Régulation des Hydrocarbures ANNEXE 1 de l’arrêté 30 mai 2015 du ministre de l’énergie déterminant les canalisations d’hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du réseau de transport du gaz desservant exclusivement le marché national LES CANALISATIONS D’HYDROCARBURES GAZEUX RELEVANT DU SECTEUR DES HYDROCARBURES Annexe 1 de l’arrêté du 30 mai 2015 : première mise à jour de la liste des canalisations d’hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures arrêtée à fin 2016 Ministère de l’Energie Autorité de Régulation des Hydrocarbures RESEAU DE TRANSPORT GAZEUX RELEVANT DU SECTEUR DES HYDROCRABURES RESEAU NORD Dénomination Canalisation Diamètre Longueur Point de départ Point d’arrivée (pouce) (km) GO1 48 549 Hassi R’Mel Oued Saf Saf STC GO1/GO2/GO3 GO2 48 549 Hassi R’Mel Oued Saf Saf GO3 48 549 Hassi R’Mel Oued Saf Saf STC GPDF GPDF 48 521 Hassi R’Mel El Aricha GK1 40 575 Hassi R’Mel Skikda STC GK1/GK2 GK2 42 576 Hassi R’Mel Skikda STC GK3 GK3 48 786 Hassi R’Mel Skikda & El Kala GZ1 40 507 Hassi R’Mel Arzew STC GZ1/GZ2/GZ3 GZ2 40 511 Hassi R’Mel Arzew GZ3 42 511 Hassi R’Mel Arzew STC GZ4 GZ4 48 634 Hassi R’Mel Arzew & Beni Saf RESEAU SUD Dénomination Canalisation Diamètre Longueur Point de départ Point d’arrivée (pouce) (km) GR1 42/48 961 Alrar Hassi R’Mel STC GR1/GR2 et son expansion GR4 GR2 42/48 961 Alrar Hassi R’Mel GR4 48 531 Rhourde Nouss Hassi R’Mel STC : Système de Transport par Canalisation Annexe 1 de l’arrêté du 30 mai 2015 : première -

Mémoire De Fin D'études Année Universitaire : 2016/2017
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIETIFIQUE UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS MOSTAGANEM Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Département d’agronomie Mémoire de fin d’études En vue de l’obtention du diplôme de master Spécialité: Gestion conservatoire des eaux,des sols et de l’environnement Intitulé : Appréciation des risques d’érosion hydrique dans le bassin versant dans la région d’El bayadh (cas d’oued Deffa ) par la télédétection Réalisé par SEHLI Hadjer Devant le jury : Président : M rHADDAD.A Pr U.Mostaganem Examinateur: M r BOUALEM .A.E.K MCB U. Mostaganem Encadreur : M r HARTANI.A MAA U.Mostaganem Année universitaire : 2016/2017 Remerciements Avant tous, je remercie allah tout puissant qui m’a guidé tout au long de ma vie, qui m’a permis de m’instruire et d’arriver aussi loin dans mes études, qui m’a donné courage et pour passer tous les moments difficiles, et qui m’a permis d’achever ce travail. Je tiens à présenter mes humbles et sincères remerciements ainsi que toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude à mon promoteur Monsieur M HARTANI AHMED, pour tout son dévouement lors de mon encadrement, pour tout son aide et ses précieux conseils et ses encouragements incessants, et surtout pour sa patience et sa compréhension. Je tiens aussi à remercier les membres de jury M. HADDAD, pour avoir Accepté de présider le jury et M. BOUALEM pour avoir bien voulu me faire Honneur d’examiner mon mémoire. Ma reconnaissance et gratitude envers tous les enseignants, les responsables et les agents du Département d'Agronomie de l’Université Abd El hamide Ibn Badis de Mostaganem sans exception. -

Article DJELLOULI Fayçal CUB .Docx
FAYÇAL DJELLOULI: Les Ressources En Eau Dans La Wilaya D’EL-BAYADH Les ressources en eau dans la wilaya d’el bayadh ‘’realite, innovation et developpement’’ FAYÇAL DJELLOULI Centre Universitaire Nour Bachir- El Bayadh RÉSUMÉ Les ressources en eau mobilisé au niveau de la région d’El Bayadh sont estimées à 349.63 Hm3/an (eaux de surfaces et eaux souterraines) destinées aux secteurs d’alimentation en eau potable, hydraulique agricole d’une part et 114200 hectares la superficie des périmètres irrigués proposée d’autre part. ces données mettent la wilaya d’El Bayadh en position d’être une région à vocation agricole, dans toutes ses zones : nord ( Kheiter, sidi Amar, Boualem ) et sud ( zone présaharienne et saharienne (Brezina, EL Abiodh sidi cheikh et Bnoud, Boussemghoun , Chelala ET Mehara, Arbaouet ) et pastorale dans les autres régions. Le terrain de la wilaya d’El Bayadh est un laboratoire de recherche à ciel ouvert au profit du centre universitaire, notamment le secteur hydraulique. Ce domaine constitue un objet de recherche d’une gestion intégrée et durable des ressources en eau L’alimentation en eau potable et en assainissement des zones non viabilisés ou en extensions, la protection des zones inondable, protection de l’environnement (traitement et épuration des eaux usées), utilisation des eaux non conventionnelles (réutilisation des eaux usées) à des fins agricoles, ceux sont tous des axes de recherche à entreprendre au sein de centre universitaire. ALINSAN WA ELMADJAL: REVUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE ACADEMIQUE INSTITUT S.H.S-CU-NOUR BACHIR EL-BAYADH (ALGERIE) N°3 AVRIL 2016 (NUMERO SPECIAL) (155) FAYÇAL DJELLOULI: Les Ressources En Eau Dans La Wilaya D’EL-BAYADH Mots clés : El Bayadh, Université, ressources en eau, développement. -

18 19 Dhou El Kaada 1434 25 Septembre 2013 JOURNAL
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 Dhou El Kaada 1434 18 25 septembre 2013 Ressort territorial de la conservation Wilaya Designation de la conservation Daira Commune OUARGLA Ouargla Ouargla , Rouissat SIDI KHOUILED Sidi Khouiled Sidi Khouiled, Ain Beida, Hassi Ben Abdellah N'goussa N'goussa OUARGLA Hassi Messaoud Hassi Messaoud El Borma El Borma TOUGGOURT Touggourt Touggourt, Nezla, Zaouia El Abidia, Tebesbest Megarine Megarine, Sidi Slimane TEMACINE Temacine Temacine, Blidate Ameur El Hadjira El Hadjira, El Alia Taibet Taibet, M'naguer, Bennaceur ORAN EST Secteur urbain : Seddikia, El Makkari, El Manzah, Ibn Sina ORAN CENTRE Secteur urbain : El Emir, Sidi El Houari, Sidi Bachir ORAN OUEST Secteur urbain : El Badr, El Mokrani, El Hamri, El Othmania, Bouamama ARZEW Arzew Arzew, Sidi Benyebka Bethioua Bethioua, Ain Biya, Marsa El Hadjadj ORAN Gdyel Gdyel, Ben Freha, Hassi Mefsoukh, BIR EL DJIR Bir El Djir Bir El Djir, Hassi Bounif, Hassi Benokba, ES SENIA Es Senia Es Senia, Sidi Chahmi, El Kerma OUED TLELAT Oued Tlelat Oued Tlelat, Tafraoui, El Braya, Boufatis AIN TURK Ain Turk Ain Turk, Mers El Kebir, El Ançor, Bousfer Boutlelis Boutlelis, Misserghin, Ain El Kerma EL BAYADH El Bayadh El Bayadh BOUALEM Boualem Boualem, Sidi Amar, Sidi Slimane, Stiten, Sidi Taifour BREZINA Brezina Brezina, Ghassoul, Krakda EL BAYADH BOUGTOB Bougtob Bougtob, El Kheiter, Tousmouline Rogassa Rogassa,, Kef Lahmar, Cheguig LABIODH SIDI Labiodh Sidi Cheikh Labiodh Sidi Cheikh, El Bnoud, Ain El Orak, Arbaout CHEIKH Boussemghoun Boussemghoun Chellala Chellala, El Mehara ILLIZI Illizi Illizi ILLIZI Djanet Djanet, Bordj El Houasse IN AMENAS In Amenas In Amenas, Bordj Omar Driss, Debdeb,. -

The Influence of Soil, Hydrology, Vegetation and Climate On
Desalination and Water Treatment 52 (2014) 2144–2150 www.deswater.com February doi: 10.1080/19443994.2013.782571 The influence of soil, hydrology, vegetation and climate on desertification in El-Bayadh region (Algeria) Karima Belaroui*, Houria Djediai, Hanane Megdad Laboratoire des Sciences, Technologie et Ge´nie des Proce´de´s (LSTGP), Universite´ des Sciences et de la Technologie, Med-BOUDIAF d’Oran, B.P. 1505, EL M’nouer, Oran, Algeria Tel./Fax: +213 41500056; email: [email protected] Received 17 December 2012; Accepted 1 March 2013 ABSTRACT There has always been a link between water and desertification. Water, whether from rain or other sources, provides the ground moisture needed for the growth of vegetation cover. The availability of water resources directly affects the distribution of vegetation cover. Any dam- age to the vegetation cover is almost always accompanied by silting, which accelerates the desertification process. The phenomenon of desertification affects the arid and semi-arid areas of all continents. Its expansion is one of the major environmental problems of our times. According to the United Nations Convention to Combat Desertification, the term desertification signifies ‘‘land degradation resulting from various factors including climatic variations and human activities”. The problem of desertification, which is known as being the process of land degradation resulting principally from anthropogenic factors (plowing of steppe, overgrazing, land clearing, fires, deforestation (illegal logging), etc.) and leading to often irreversible repercussions, is a particular and urgent problem in the arid and semi-arid bioclimatic zones of the Tell Atlas. This work is part of the monitoring of desertification and of the impact of natural factors (soils, hydrology, vegetation and climate) in an area in the heart of south Oran’s high steppe plains, in the El Bayadh region of Algeria. -

La Politique De Mise En Valeur Agricole En Milieu Steppique Algérien : Un Essai De Bilan Dans Les Hautes Plaines Sud Oranaises (Algérie)
Insaniyat n°s 51-52, janvier - juin 2011, pp. 99-118 La politique de mise en valeur agricole en milieu steppique algérien : un essai de bilan dans les Hautes Plaines sud oranaises (Algérie) Mohamed HADEID∗ En Algérie, la politique de mise en valeur agricole a été lancée essentiellement depuis la promulgation de la Loi portant « Accession à la propriété foncière agricole » en 1983. Elle consiste à céder pour un dinar symbolique une portion de terrain en vue de la cultiver et la mettre en valeur principalement par l’irrigation ; le bénéficiaire qui réussit à exploiter cette terre devient propriétaire après cinq ans de travail. Cette politique, appliquée dans des zones aux compétences agro-pédologiques convenables, peut réussir facilement, mais dans la zone steppique à vocation pastorale, n’est-il pas risqué de généraliser cette opération sur ce type d’espace ? Certes, la céréaliculture a été toujours pratiquée dans la steppe, mais dans des zones exploitables sur le plan agricole (bas fond des vallées, daïas...). Aujourd’hui, les mises en valeur agricoles dans la steppe sont présentes dans plusieurs endroits, notamment dans les zones de parcours, sans se soucier de leurs aptitudes culturales. De ce fait, cette opération a suscité l’intérêt d’un grand nombre de personnes, nomades essentiellement, dans un but d’acquérir la propriété du terrain. Pour l’État, l’objectif de cette action, outre la création d’emplois, est l’amélioration des revenus ruraux. Quelles sont donc les contraintes que rencontre l’application de cette politique de mise en valeur agricole dans un espace steppique connu pour sa vocation pastorale, en particulier les Hautes Plaines sud oranaises ? ∗ Enseignant, géographie et aménagement, Université d’Oran, EGEAT (Laboratoire des espaces géographiques et de l’aménagement du territoire), chercheur associé au CRASC, Oran.