European Translation Studies, Une Science Qui Dérange, and Why Equivalence Needn’T Be a Dirty Word Anthony Pym
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Interview with Mary Snell-Hornby Autor(Es): Hornby, Mary Snell
Interview with Mary Snell-Hornby Autor(es): Hornby, Mary Snell; Althoff, Gustavo; Leal, Alice Publicado por: Universidade Federal de Santa Catarina URL persistente: URI:http://hdl.handle.net/10316.2/33059 Accessed : 24-Sep-2021 05:11:42 A navegação consulta e descarregamento dos títulos inseridos nas Bibliotecas Digitais UC Digitalis, UC Pombalina e UC Impactum, pressupõem a aceitação plena e sem reservas dos Termos e Condições de Uso destas Bibliotecas Digitais, disponíveis em https://digitalis.uc.pt/pt-pt/termos. Conforme exposto nos referidos Termos e Condições de Uso, o descarregamento de títulos de acesso restrito requer uma licença válida de autorização devendo o utilizador aceder ao(s) documento(s) a partir de um endereço de IP da instituição detentora da supramencionada licença. Ao utilizador é apenas permitido o descarregamento para uso pessoal, pelo que o emprego do(s) título(s) descarregado(s) para outro fim, designadamente comercial, carece de autorização do respetivo autor ou editor da obra. Na medida em que todas as obras da UC Digitalis se encontram protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e demais legislação aplicável, toda a cópia, parcial ou total, deste documento, nos casos em que é legalmente admitida, deverá conter ou fazer-se acompanhar por este aviso. impactum.uc.pt digitalis.uc.pt INTERVIEW WITH MARY SNELL-HORNBY 1 2 MARY SNELL-HORNBY / GUSTAVO ALTHOFF & ALICE LEAL ince 1989 Mary Snell-Hornby has been Professor of Translation Studies at the University of Vienna. She was a founding member S of the European Society for Translation Studies (EST) and its first President (from 1992 to 1998), she was on the Executive Board of the Eu- ropean Society for Lexicography (EURALEX) from 1986 to 1992 and was President of the Vienna Language Society from 1992 to 1994. -

Machine Translation and Human Creativity
10.00 AM CONFERENCE OPENING: INTERNATIONAL INSTITUTIONAL GREETINGS SPEAKERS CONFERENCE: ELENA PASOLI Exhibition Manager, Bologna Children’s Book Fair JACKS THOMAS Guest Director BolognaBookPlus LARA HOLBLING MATKOVIC Segretaria Generale del CEATL - MACHINE Consiglio europeo delle associazioni di traduttori letterari MODERATOR TRANSLATION SIMONA MAMBRINI BCBF consultant AND 10.30 AM – 12.00 AM HUMAN KEYNOTE CONFERENCE: MACHINE TRANSLATION AND HUMAN CREATIVITY CREATIVITY Thanks to the latest achievements of AI and neural machine translation (MT) technologies, machine support in translation is used every day in many fields. Today, given certain conditions, MT can increase SATURDAY productivity in technical texts translated by humans without affecting the final quality of the product. However, it is commonly held that MT cannot compete with human translation of literary or more creative 13 MARCH 2021 texts precisely because of the machine lack of creativity. But which are the meanings and processes of creativity involved in translating literary The event is curated by BCBF/BBPlus texts? What is creativity in the translating process and how does it relate to the “originality” of the source text? Is translating per se a creative activity? SPEAKERS ANTHONY PYM Translating studies scholar (University of Melbourne, University of Tarragona) KIRSTEN MALMKJAER Translating studies scholar (University of Leicester) ANTHONY PYM is Distinguished Professor of Translation and Intercultural Studies at Rovira i Virgili University in Tarragona, Spain; Professor of Translation Studies at the University of Melbourne, Australia; and Extra-ordinary Professor at Stellenbosch University, South Africa. His publications include Exploring Translation Theories, (Routledge, 2010), On Translator Ethics (Benjamins 2012), Translation Solutions for Many Languages (Bloomsbury 2016) and What is Translation History? A Trust-Based Approach, with Andrea Rizzi and Birgit Lang (Palgrave 2019). -

The Status of the Translation Profession in the European Union 7/2012
Studies on translation and multilingualism The Status of the Translation Profession in the European Union 7/2012 Translation Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed. More information on the European Union is available on the Internet (http://europa.eu). Cataloguing data can be found at the end of this publication. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012 Manuscript completed in January 2012 ISBN 978-92-79-25021-7 doi:10.2782/63429 © European Union, 2012 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. Printed in Belgium PRINTED ON CHLORINE-FREE BLEACHED PAPER The status of the translation profession in the European Union (DGT/2011/TST) Final Report 24 July 2012 Anthony Pym, Universitat Rovira i Virgili, European Society for Translation Studies François Grin, Université de Genève Claudio Sfreddo, Haute école spécialisée de Suisse occidentale Andy L. J. Chan, Hong Kong City University TST project site: http://isg.urv.es/publicity/isg/projects/2011_DGT/tst.html Disclaimer: This report has been funded by the European Commission’s Directorate-General for Translation. It nevertheless reflects the views of the authors only, and the Commission cannot be held responsible for the nature of use of the information contained herein. 1 2 Executive summary This report is a study of the mechanisms by which the status of translators is signalled in the European Union in 2011-12, with comparisons with the United States, Canada and Australia. -

The Importance of Professional Knowledge in Translation
Open Access Library Journal The Importance of Professional Knowledge in Translation Shun-Chih Sun Department of Translation and Interpretation Studies, Chang Jung Christian University, Tainan, Chinese Taipei Email: [email protected] Received 18 February 2015; accepted 5 March 2015; published 9 March 2015 Copyright © 2015 by author and OALib. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Abstract The purposes of this paper are firstly, to point out the importance of professional knowledge in translation; and secondly, to stimulus scholars for further research. The Professional theory of Translation is the current tendency for translators. The translators had better have professional knowledge and ability for the translation fields, such as Modern China, Laws and Politics, Finance and Economy, Mass Media, Science and Technology, Environment, and even Ballroom Dancing in each respect so as to be competent in translation. Professional translation is here meant by: trans- lation as an academic discipline; translation as interdisciplinary; and translation as a profession. The development of Translation theories can be divided into four periods: 1) The Period of Lite- rature theory of Translation, 2) The Period of Linguistics Theory of Translation, 3) The Period of Culture Theory of Translation, and 4) The Period of Professional Theory of Translation. During the Period of Literature theory of Translation, Translators paid special attention to the art and aes- thetics of translation. During the Period of Linguistics theory of Translation, translators paid at- tention to the transfer of grammar, then to the language meaning, and finally to pragmatic linguis- tics. -
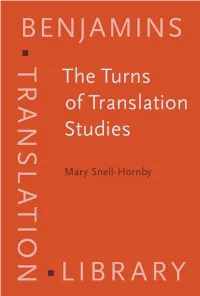
The Turns of Translation Studies: New Paradigms Or Shifting Viewpoints?
<DOCINFO AUTHOR ""TITLE "The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints?"SUBJECT "Benjamins Translation Library, Volume 66"KEYWORDS ""SIZE HEIGHT "240"WIDTH "160"VOFFSET "4"> The Turns of Translation Studies Benjamins Translation Library The Benjamins Translation Library aims to stimulate research and training in translation and interpreting studies. The Library provides a forum for a variety of approaches (which may sometimes be conflicting) in a socio-cultural, historical, theoretical, applied and pedagogical context. The Library includes scholarly works, reference works, post-graduate text books and readers in the English language. EST Subseries The European Society for Translation Studies (EST) Subseries is a publication channel within the Library to optimize EST’s function as a forum for the translation and interpreting research community. It promotes new trends in research, gives more visibility to young scholars’ work, publicizes new research methods, makes available documents from EST, and reissues classical works in translation studies which do not exist in English or which are now out of print. General editor Associate editor Honorary editor Yves Gambier Miriam Shlesinger Gideon Toury University of Turku Bar Ilan University Tel Aviv University Advisory board Rosemary Arrojo Werner Koller Sherry Simon Binghamton University Bergen University Concordia University Michael Cronin Alet Kruger Mary Snell-Hornby Dublin City University UNISA, South Africa University of Vienna Daniel Gile José Lambert Sonja Tirkkonen-Condit Université Lumière Lyon 2 Catholic University of Leuven University of Joensuu Ulrich Heid John Milton Maria Tymoczko University of Stuttgart University of Sao Paulo University of Massachusetts Amparo Hurtado Albir Franz Pöchhacker Amherst Universitat Autónoma de University of Vienna Lawrence Venuti Barcelona Anthony Pym Temple University W. -

Finding Translations. on the Use of Bibliographical Databases in Translation History Sandra Poupaud, Anthony Pym and Ester Torres Simón
Document generated on 09/24/2021 2:11 p.m. Meta Journal des traducteurs Translators' Journal Finding Translations. On the Use of Bibliographical Databases in Translation History Sandra Poupaud, Anthony Pym and Ester Torres Simón Volume 54, Number 2, juin 2009 Article abstract In any study of translations one must first decide what is to be counted as a URI: https://id.erudit.org/iderudit/037680ar “translation” and how such things are to be found, usually through recourse to DOI: https://doi.org/10.7202/037680ar bibliographical databases. We propose that, starting from the maximalist view that translations are potentially everywhere, various distribution processes See table of contents impose a series of selective filters thanks to which some translations are more easily identified and accessible than others. The study of translation must be aware of these prior filters, and must know how to account for them, and Publisher(s) sometimes how to overcome them. Research processes then necessarily impose their own selective filters, which may reduce or extend the number and kinds Les Presses de l'Université de Montréal of translations given by prior filters. We present three research projects where the play of prior and research filters is very different. For one-off large-scale ISSN relational hypotheses, the Index Translationum is found to be relatively cost-efficient. For more detailed objects such as translation flows from Spanish 0026-0452 (print) into French in a specific period, a book-industry database offers significant 1492-1421 (digital) advantages. And for a study marked by a paucity of texts, as is the case of translation from Korean into English following the Korean War, a combination Explore this journal of databases is necessary, the most useful turning out to be Amazon. -

41 a Typology of Translation Solutions 1. Introduction The
The Journal of Specialised Translation Issue 30 – July 2018 A typology of translation solutions Anthony Pym, Universitat Rovira i Virgili / University of Melbourne ABSTRACT An eight-term pedagogical typology of translation solutions has been compiled and taught in two Masters classes, one in the United States and the other in South Africa. The results suggest that the typology is robust enough to be pedagogically effective in the two situations if and when the teaching stresses a series of points: 1) the nature of its “problem- solving” premises has to be explained carefully, 2) the typology should be presented as a list of ways to address problems that cannot be solved using the norms of standard languages or “cruise” mode translation procedures, 3) it should be presented as being open-ended, inviting new solutions and new combinations of the main solution types, 4) its theorisation should be kept as simple as possible, in the interests of pedagogical clarity, and 5) the application of the typology should emphasise its status as a discourse of resistance to the tradition of “either-or” approaches to translation decisions. KEYWORDS Translation solutions, translation pedagogy, translation procedures, theorisation of translation, non-binarism. 1. Introduction The naming of different ways of solving translation problems constitutes a small European tradition that has spawned versions for languages beyond Europe. A Romance-language strand can be traced from the work of the Swiss linguist Charles Bally (1905) through Vinay and Darbelnet (1972[1958]) and Vázquez-Ayora (1977). A Russian tradition might run from somewhere around Fedorov (1927) through Retsker (1950, 2007[1974]), Shveytser (1973), and Barkhudarov (1975), with Fedorov (2002[1953]) then feeding into Loh (1958) at the beginning of a Chinese tradition. -

Why Translation Studies Should Learn to Be Homeless
Why Translation Studies should learn to be homeless Anthony Pym Published in Tradução e multidisciplinaridade, ed. Marcia A. P. Martins. Rio de Janeiro: PUC/Lucerna, 1999, 35-51. The following is a critical survey of possible institutional locations for Translation Studies. The basic question to be asked is whether Translation Studies really requires any of the homes that our institutions currently make available, starting with the fundamental relationship with translator training. The basic answer is that, whether we like it or not, we are heading toward homelessness, and this may well be the best location we can hope to establish. Where is Translation Studies? When Monique Caminade and myself set out to compile a list of all the institutions that train translators and/or interpreters, we were surprised to see the world total climb to about 300 (although only 268 are in our 1995 checklist). This was more than fourteen times the 21 institutions that are currently members of the CIUTI, which is a European and North American club for the mutual recognition of ‘prestigious’ institutions. Clearly, to know what is happening in this field today one has to look at far more than the would-be hegemony of a self-selected top twenty. A second surprise was the great diversity of the institutional locations involved in the training of translators (no, I am not confusing this with Translation Studies as such): independent translation schools, university translation departments, sections of business schools, departments of comparative law, programmes in comparative literature, science departments, European studies, European administrative institutions, straight modern language departments, interdepartmental bodies, national examination bodies, private language schools, paraprofessional training programmes, summer schools, and a few even more miscellaneous structures. -
Illusion” in the Postcolonial Context: Translation Studies Still in Need of a Metalanguage Or the Understated Lack of Ontology of Science
transLogos 2019 Vol 2 Issue 2 Sayın, Ayşe Betül, pp. 180–203 © Diye Global Communications http://dx.doi.org/10.29228/transLogos.18 diye.com.tr | [email protected] “Illusion” in the Postcolonial Context: Translation Studies Still in Need of a Metalanguage or the Understated Lack of Ontology of Science Ayşe Betül SAYIN* The purpose of this article1 is to trace the recurrent metaphor of ‘illusion’ in translation studies. Starting with the pioneering work of Jiří Levý titled The Art of Translation (Umění překladu [1963]), the optical metaphors for the subject matter of studies on translation reflect an ambiguity about the ontology of translation studies. Yet, this ambiguity does not remain in the theoretical sphere and apparently, translates into the very practices of the publishers. Prefaces and critiques by publishing houses and the translators’ footnotes as paratexts suggest an ever-increasing demand for translations that ‘mirror’ the source work. In this respect, the back translations of ethnographic works and semi-ethnographic travelogues provide fertile ground for exploring the boundaries of conceptual determinism in translation theory. After an inquiry on the shifting points of reference between translation norms and illusion, this descriptive study analyzes the Turkish translation of An Englishwoman in a Turkish Harem (1915), a semi-ethnographic work pointing to other works of dubious origin. By considering this translation that is claimed by the publishing house to have been transferred almost unmediated as a product of back translation, the present study illustrates the underlying stance of the seemingly divergent points of view on designations and metaphors for translation (i.e., illusion) in terms of translation studies as an autonomous field of ‘proper’ social science. -
Finding Translations. on the Use of Bibliographical Databases in Translation History
Finding Translations. On the Use of Bibliographical Databases in Translation History sandra poupaud Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain [email protected] anthony pym Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain [email protected] ester torres simón Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain [email protected] RÉSUMÉ Dans toute étude de traductions, il faut tout d’abord déterminer l’objet qui doit être pris en compte comme une « traduction », puis comment le trouver, en général en ayant recours à des bases de données bibliographiques. Partant de la conception maximaliste selon laquelle les traductions sont potentiellement omniprésentes, nous proposons que les différents processus de distribution imposent une série de filtres sélectifs grâce auxquels certaines traductions sont plus facilement identifiées et accessibles que d’autres. L’étude des traductions doit tenir compte de ces filtres préalables et être à même de les expliquer, parfois de les surmonter. Les processus de recherche imposent ensuite, nécessairement, leurs propres filtres sélectifs, qui peuvent réduire ou augmenter le nombre et le genre des traductions issues des filtres préalables. Nous présentons ici trois projets de recherche dans lesquels les rôles respectifs des filtres préalables et des filtres de recherche sont très différents. Pour des hypothèses très spécifiques et à grande échelle, l’Index Translationum peut être relativement efficace. Pour des projets plus détaillés tels que l’étude des flux de traductions entre l’espagnol et le français pendant une période spécifique, une base de données destinée à l’usage des professionnels de l’édition offre des avantages significatifs. Enfin, pour une étude, marquée par la rareté des textes, portant sur les traductions du coréen en anglais après la guerre de Corée, il est nécessaire de combiner plusieurs bases de données, la plus efficace se révélant être celle d’Amazon. -

Studies on Translation and Multilingualism
Studies on translation and multilingualism Translation and language learning: The role of translation in the teaching of languages in the European Union 1/2013 Translation Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed. More information on the European Union is available on the Internet (http://europa.eu). Cataloguing data can be found at the end of this publication. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 Manuscript completed in July 2013 ISBN 978-92-79-30926-7 doi:10.2782/13783 © European Union, 2013 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. Printed in Italy PRINTED ON CHLORINE-FREE BLEACHED PAPER Directorate-General for Translation, European Commission Translation and language learning: The role of translation in the teaching of languages in the European Union A Study 15 July 2013 Anthony Pym, Universitat Rovira i Virgili, European Society for Translation Studies Kirsten Malmkjær, University of Leicester Maria del Mar Gutiérrez-Colón Plana, Universitat Rovira i Virgili Research assistants: Alberto Lombardero, Universitat Rovira i Virgili Fiona Soliman, University of Leicester TLL project site: http://www.est-translationstudies.org/research/2012_DGT/tll.html Disclaimer: This study was carried out on behalf of the Directorate-General For Translation of the European Commission. The views and opinions expressed in the study are those of the authors and do not necessarily represent those of the European Commission. [TYPE TEXT] [TYPE TEXT] [TYPE TEXT] Table of Contents General introduction ............................................................................................ -
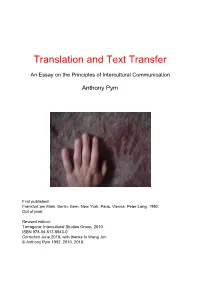
Translation and Text Transfer
Translation and Text Transfer An Essay on the Principles of Intercultural Communication Anthony Pym First published: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Vienna: Peter Lang, 1992: Out of print. Revised edition: Tarragona: Intercultural Studies Group, 2010 ISBN 978-84-613-8543-0 Corrected June 2018, with thanks to Wang Jun © Anthony Pym 1992, 2010, 2018 [Back cover] More than just a linguistic activity, translation is one of the main ways in which intercultural relationships are formed and transformed. The study of translation should thus involve far more than merely defining and testing linguistic equivalents. It should ask what relation translation has to the texts that move Between cultures; it should have ideas aBout why texts move and how translated texts can represent such movement; and it should Be aBle to inquire into the ethics of intercultural relations and how translators should respond them. In short, By relating the work of translators to the problematics of intercultural transfer, translation studies should take its rightful interdisciplinary place among the social sciences. But what kind of conceptual geometry might make this development possiBle? Refusing simple answers, this Book sees the relation Between translation and transfer as a complex phenomenon that must Be descriBed on both the semiotic and material levels. Various connected approaches then conceptualize this relationship as Being causal, economic, discursive, quantitative, political, historical, ethical and epistemological... and indeed transla- tional. Individual chapters address each of these aspects, placing particular emphasis on phenomena that are mostly ignored by contemporary theories. The result is a dense But highly suggestive and hopefully stimulating vision of translation studies.