Web 2.0 Et Bibliothèques
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fall 2011 Section 5T1 Syllabus
GEORGE MASON UNIVERSITY COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT Instructional Technology EDIT 772: Introduction to Web 2.0 / Social Software Tools (2 graduate credit hours) Fall 2011 COURSE DATES: meets online Aug 29, 2011 - Nov 04, 2011 and has a required synchronous meeting the last week of the class. INSTRUCTOR INFORMATION Name: Jane Bozarth, [email protected] / Google Voice 919 789 1611 Virtual Office Hours: Mondays, 6:30-7pm with notification and other times by appointment. COURSE DESCRIPTION The purpose of this course is to explore examples of emerging technology use commonly referred to as Web 2.0. The course focuses, from an e-learning perspective, on the pedagogical applications and implications of a particular group of Web 2.0 or social software tools that facilitate web-based social interaction, content generation, and resource aggregation. Examples of social software include content, media, or collaboration management frameworks such as blogs, wikis, Flickr, YouTube, RSS feed readers, and iTunes, relationship management frameworks such as Facebook and Ning, and distributed classification frameworks (or social bookmarking services), such as Delicious. Students will also be introduced to broader patterns of Web 2.0 technologies, such as rich Internet applications, mash-ups, widgets, and much more. Virtual worlds, augmented reality, mobile devices and gaming are not covered in this course. The course goals bridge three broad areas: to provide an engaging overview of cutting-edge social technologies, to identify and evaluate best educational practices for using these technologies, and to investigate the role of these technologies for online learning. Social software has the potential to transform teaching practices as it supports the creation of highly constructivist learning communities. -
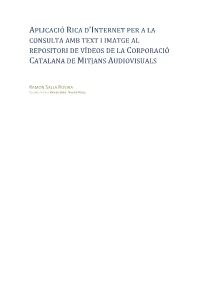
PFC.Pdf (6005Mb)
APLICACIÓ RICA D’INTERNET PER A LA CONSULTA AMB TEXT I IMATGE AL REPOSITORI DE VÍDEOS DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS RAMON SALLA ROVIRA TUTORITZAT PER XAVIER GIRÓ I XAVIER VIVES 1 MOTIVACIÓ Fa més de dos anys vaig entrar a treballar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per donar suport a diferents projectes subvencionats a nivell estatal i europeu. El present document és la memòria del projecte final de carrera realitzat en aquesta empresa durant l’any 2009. La Corporació és una empresa catalana puntera en innovació en el camp dels mitjans de comunicació destinada al servei públic per transmetre informació i entreteniment amb la màxima qualitat possible. Entrar-hi a treballar ha suposat un revulsiu en la meva orientació com a enginyer i m’ha introduït a un sector, destinat a la producció, postproducció, emmagatzematge, cerca, indexació i distribució. Aquesta experiència ha estat, com a mínim, apassionant. El projecte i3media1, subvencionat per l’estat espanyol, pretén unir en un sol marc col·laboratiu empreses punteres del sector per tal d’impulsar els continguts intel·ligents, la personalització i els processos automàtics. Comptar dins d’aquest projecte amb el grup de recerca de processat de la imatge de la Universitat Politècnica de Barcelona (GPI) és una idoneïtat que em permet mantenir les arrels amb la meva universitat. Aquest fet, em porta a tirar endavant aquest projecte final de carrera que culmina la meva aspiració de ser enginyer i permet aportar el meu humil gra d’arena a l’ambiciós projecte del que tinc l’orgull i la sort de formar part. -

A Web Desktop Or Webtop Is a Desktop Environment Embedded in a Web Browser Or Similar Client Application
II BASIC THEORY II.1 What is Web Desktop? A web desktop or webtop is a desktop environment embedded in a web browser or similar client application. A webtop integrates web applications, web services, client-server applications, application servers, and applications on the local client into a desktop environment using the desktop metaphor. Web desktops provide an environment similar to that of Windows, Mac, or a graphical user interface on Unix and Linux systems. It is a virtual desktop running in a web browser. In a webtop the applications, data, files, configuration, settings, and access privileges reside remotely over the network. Much of the computing takes place remotely. The browser is primarily used for display and input purposes. II.2 History In the context of a web desktop, the term Webtop was first introduced by the Santa Cruz Operation (SCO) in 1994 for a web-based interface to their UNIX operating system. Andy Bovingdon and Ronald Joe Record, who both explored the concepts in different directions, are often credited as the inventors. II.3 About eyeOS eyeOS is an open source web desktop written in mainly PHP, XML, and JavaScript. It acts as a platform for web applications written using the eyeOS Toolkit. It includes a Desktop environment with 67 applications and system utilities. It is accessible by portable devices via internet. III.3 eyeOS Implementation III.3.1 Advantages of eyeOS • Convenience: A personalized desktop on every supported client device • Mobility: Access your desktop anywhere there is a supported client device • Session Management: Server-side session management allows roaming users to access restored sessions from anywhere III.3.2 Limitations Security: Due to the fact that all data is transferred over the internet, it might be possible for a hacker to intercept the connection and read data. -
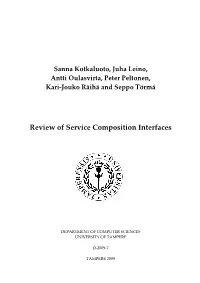
Review of Service Composition Interfaces
Sanna Kotkaluoto, Juha Leino, Antti Oulasvirta, Peter Peltonen, Kari‐Jouko Räihä and Seppo Törmä Review of Service Composition Interfaces DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES UNIVERSITY OF TAMPERE D‐2009‐7 TAMPERE 2009 UNIVERSITY OF TAMPERE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES SERIES OF PUBLICATIONS D – NET PUBLICATIONS D‐2009‐7, OCTOBER 2009 Sanna Kotkaluoto, Juha Leino, Antti Oulasvirta, Peter Peltonen, Kari‐Jouko Räihä and Seppo Törmä Review of Service Composition Interfaces DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES FIN‐33014 UNIVERSITY OF TAMPERE ISBN 978‐951‐44‐7896‐3 ISSN 1795‐4274 Preface This report was produced in the LUCRE project. LUCRE stands for Local and User-Created Services. The project is part of the Flexible Services research programme, one of the programmes of the Strategic Centre for Science, Technology and Innovation in the ICT field (TIVIT) and funded by Tekes (the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation) and the participating organizations. The Flexible Service Programme creates service business activity for global markets. The programme has the aim of creating a Web of Services. The programme creates new types of ecosystems, in which the producers of services, the people that convey the service and the users all work together in unison. As part of such ecosystems, LUCRE will develop an easy-to-use, visual service creation platform to support the creation of context aware mobile services. The goal is to support user-driven open innovation: the end- users (people, local businesses, communities) will be provided with tools to compose new services or to modify existing ones. The service creation platform will build on the technology of existing mashup tools, widget frameworks, and publish/subscribe mechanisms. -

Challenging the Dominant Design of Educational Systems. Scott Wilson University of Bolton, [email protected]
University of Bolton UBIR: University of Bolton Institutional Repository Educational Cybernetics: Journal Articles (Peer- Institute for Educational Cybernetics Reviewed) 2007 Personal Learning Environments : challenging the dominant design of educational systems. Scott Wilson University of Bolton, [email protected] Oleg Liber University of Bolton, [email protected] Mark Johnson University of Bolton, [email protected] Philip Beauvoir University of Bolton, [email protected] Paul Sharples University of Bolton, [email protected] See next page for additional authors Digital Commons Citation Wilson, Scott; Liber, Oleg; Johnson, Mark; Beauvoir, Philip; Sharples, Paul; and Milligan, Colin. "Personal Learning Environments : challenging the dominant design of educational systems.." (2007). Educational Cybernetics: Journal Articles (Peer-Reviewed). Paper 9. http://digitalcommons.bolton.ac.uk/iec_journalspr/9 This Article is brought to you for free and open access by the Institute for Educational Cybernetics at UBIR: University of Bolton Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in Educational Cybernetics: Journal Articles (Peer-Reviewed) by an authorized administrator of UBIR: University of Bolton Institutional Repository. For more information, please contact [email protected]. Authors Scott Wilson, Oleg Liber, Mark Johnson, Philip Beauvoir, Paul Sharples, and Colin Milligan This article is available at UBIR: University of Bolton Institutional Repository: http://digitalcommons.bolton.ac.uk/iec_journalspr/9 Methodologies and scenarios Personal Learning Environments: Challenging the dominant design of educational systems Scott Wilson, Prof. Oleg Liber, Mark Johnson, Phil Beauvoir, Paul Sharples & Colin Milligan University of Bolton, UK; Scott.Bradley.Wilson@gmail. com, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], colin. -
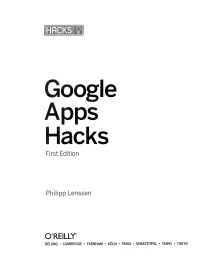
Google Acks First Edition
RflCKSl Google acks First Edition Philipp Lenssen O'REILLT BEIJING • CAMBRIDGE • FARNHAM • KÖLN • PARIS • SEBASTOPOL • TAIPEI • TOKYO :;:;; »p;;;» mmm ;*. ^ P;i?|p:*: JK*S,. FOREWORD xi PREFACE xiii Google's Apps—a Google Office, or a Google OS? xiii How to Use This Book xiv HowThis Book Is Organized xiv Conventions Used in This Book xvi Acknowledgments xvi We'd Like to Hear from You xvii CHAPTER Ol: MEETTHE GOOGLE DOCS FAMILY 2 HACK oi: How to Get Your Google Account 2 HACK 02: Collaborate with OthersThrough Google Docs 5 HACK 03: Make a Desktop Icon to Create a New Document 9 HACK 04: Embed a Dynamic Chart into a Google Document or a Web Page 12 HACK 05: Share Documents with a Group 16 HACK 06: Automatically Open Local Files with Google 17 HACK 07: Google Docs on the Run 19 HACK 08: Back Up All Your Google Docs Files 21 HACK 09: Beyond Google: Create Documents with Zoho, EditGrid, and more 23 CHAPTER 2: THE GOOGLE DOCS FAMILY: GOOGLE DOCUMENTS 28 HACK 10: Let Others Subscribe to Your Document Changes 28 HACK U: Blog with Google Docs 31 HACKI2: Insert Special Characters Into Your Documents 34 HACK 13: Search and ReplaceText Using Regulär Expressions 35 HACK 14: "Google Docs Light" for Web Research: Google Notebook 39 HACKI5: Convert a Word File Intoa PDF with Google Docs 42 HACK 16: Write a JavaScript Bookmarklet to Transmogrify Your Documents 44 HACK 17: Remove Formatting Before PastingText Into a Document 47 HACK 18: Prettify Your Document with Inline Styles 47 v CHAPTER 3: THE GOOGLE DOCS FAMILY: GOOGLE SPREADSHEETS 52 HACK 19: Add -

Mapping Web Personal Learning Environments
Mapping Web Personal Learning Environments Matthias Palmér1,Stéphane Sire2,Evgeny Bogdanov2, Denis Gillet2 and Fridolin Wild3 1 Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden, [email protected] 2 École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerland, {stephane.sire, evgeny.bogdanov, denis.gillet}@epfl.ch 3 The Open University, Milton Keynes, United Kingdom, [email protected] Abstract.A recent trend in web development is to build platforms which are carefully designed to host a plurality of software components (sometimes called widgets or plugins) which can be organized or combined (mashed-up) at user's convenience to create personalized environments. The same holds true for the web development of educational applications. The degree of personalization can depend on the role of users such as in traditional virtual learning environment, where the components are chosen by a teacher in the context of a course. Or, it can be more opened as in a so-called personalized learning environment (PLE). It now exists a wide array of available web platforms exhibiting different functionalities but all built on the same concept of aggregating components together to support different tasks and scenarios. There is now an overlap between the development of PLE and the more generic developments in web 2.0 applications such as social network sites. This article shows that 6 more or less independent dimensions allow to map the functionalities of these platforms: the screen dimensionmaps the visual integration, the data dimension mapsthe portability of data, the temporal dimension mapsthe coupling between participants, the social dimension maps thegrouping of users, the activity dimension mapsthe structuring of end users’ interactions with the environment, and the runtime dimensionmaps the flexibility in accessing the system from different end points. -

Lista Ofrecida Por Mashe De Forobeta. Visita Mi Blog Como Agradecimiento :P Y Pon E Me Gusta En Forobeta!
Lista ofrecida por mashe de forobeta. Visita mi blog como agradecimiento :P Y pon e Me Gusta en Forobeta! http://mashet.com/ Seguime en Twitter si queres tambien y avisame que sos de Forobeta y voy a evalu ar si te sigo o no.. >>@mashet NO ABUSEN Y SIGAN LOS CONSEJOS DEL THREAD! http://blog.newsarama.com/2009/04/09/supernaturalcrimefightinghasanewname anditssolomonstone/ http://htmlgiant.com/?p=7408 http://mootools.net/blog/2009/04/01/anewnameformootools/ http://freemovement.wordpress.com/2009/02/11/rlctochangename/ http://www.mattheaton.com/?p=14 http://www.webhostingsearch.com/blog/noavailabledomainnames068 http://findportablesolarpower.com/updatesandnews/worldresponsesearthhour2009 / http://www.neuescurriculum.org/nc/?p=12 http://www.ybointeractive.com/blog/2008/09/18/thewrongwaytochooseadomain name/ http://www.marcozehe.de/2008/02/29/easyariatip1usingariarequired/ http://www.universetoday.com/2009/03/16/europesclimatesatellitefailstoleave pad/ http://blogs.sjr.com/editor/index.php/2009/03/27/touchinganerveresponsesto acolumn/ http://blog.privcom.gc.ca/index.php/2008/03/18/yourcreativejuicesrequired/ http://www.taiaiake.com/27 http://www.deadmilkmen.com/2007/08/24/leaveusaloan/ http://www.techgadgets.in/household/2007/06/roboamassagingchairresponsesto yourvoice/ http://blog.swishzone.com/?p=1095 http://www.lorenzogil.com/blog/2009/01/18/mappinginheritancetoardbmswithst ormandlazrdelegates/ http://www.venganza.org/about/openletter/responses/ http://www.middleclassforum.org/?p=405 http://flavio.castelli.name/qjson_qt_json_library http://www.razorit.com/designers_central/howtochooseadomainnameforapree -
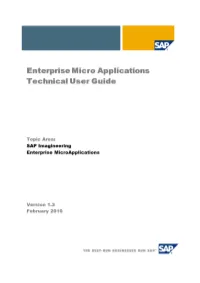
Enterprise Micro Application Technical User Guide
Table of Contents Title Page............................................................................................................................................. 1 Disclaimer............................................................................................................................................ 4 Release Information............................................................................................................................5 Version History................................................................................................................................................................ 5 Notes............................................................................................................................................................................... 5 Contact Information.........................................................................................................................................................5 Typographic Styles and Conventions.............................................................................................. 6 Introduction..........................................................................................................................................7 Purpose........................................................................................................................................................................... 7 What Are Enterprise MicroApps?.................................................................................................................................. -
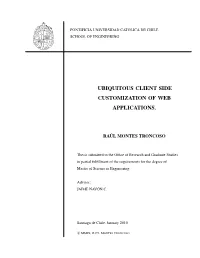
Ubiquitous Client Side Customization of Web Applications
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE SCHOOL OF ENGINEERING UBIQUITOUS CLIENT SIDE CUSTOMIZATION OF WEB APPLICATIONS. RAÚL MONTES TRONCOSO Thesis submitted to the Office of Research and Graduate Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Engineering Advisor: JAIME NAVÓN C. Santiago de Chile, January 2010 c MMIX, RAÚL MONTES TRONCOSO c MMIX, RAÚL MONTES TRONCOSO Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica que acredita al trabajo y a su autor. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE SCHOOL OF ENGINEERING UBIQUITOUS CLIENT SIDE CUSTOMIZATION OF WEB APPLICATIONS. RAÚL MONTES TRONCOSO Members of the Committee: JAIME NAVÓN C. JENS HARDINGS LUIS GUERRERO JUAN DE DIOS RIVERA Thesis submitted to the Office of Research and Graduate Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Engineering Santiago de Chile, January 2010 c MMIX, RAÚL MONTES TRONCOSO Para Mariela. ACKNOWLEDGEMENTS There are many people I would like to thank because, directly or indirectly, they were helpful or they routed me in the right direction. But I want to give special thanks to some of them who were of huge importance in finishing this thesis. I thank Mariela for her unconditional love and constant support and encouragement to complete this thesis. I also thank my parents because they understood and supported me in professional and academic decisions sometimes not so easy to understand. I want to thank Professor Jaime Navón for his guidance, help, trust and also for putting pressure on me to finish this when I needed it. -

Blogging for Engines
BLOGGING FOR ENGINES Blogs under the Influence of Software-Engine Relations Name: Anne Helmond Student number: 0449458 E-mail: [email protected] Blog: http://www.annehelmond.nl Date: January 28, 2008 Supervisor: Geert Lovink Secondary reader: Richard Rogers Institution: University of Amsterdam Department: Media Studies (New Media) Keywords Blog Software, Blog Engines, Blogosphere, Software Studies, WordPress Summary This thesis proposes to add the study of software-engine relations to the emerging field of software studies, which may open up a new avenue in the field by accounting for the increasing entanglement of the engines with software thus further shaping the field. The increasingly symbiotic relationship between the blogger, blog software and blog engines needs to be addressed in order to be able to describe a current account of blogging. The daily blogging routine shows that it is undesirable to exclude the engines from research on the phenomenon of blogs. The practice of blogging cannot be isolated from the software blogs are created with and the engines that index blogs and construct a searchable blogosphere. The software-engine relations should be studied together as they are co-constructed. In order to describe the software-engine relations the most prevailing standalone blog software, WordPress, has been used for a period of over seventeen months. By looking into the underlying standards and protocols of the canonical features of the blog it becomes clear how the blog software disperses and syndicates the blog and connects it to the engines. Blog standards have also enable the engines to construct a blogosphere in which the bloggers are subject to a software-engine regime. -

Travail De Bachelor Caroline Martin Mahrez
Réflexion sur l’organisation et sur la structuration d’un portail institutionnel pour la musique Exemple d’un « Portail musique » pour les trois sections musicales de la BCU/R Travail de Bachelor réalisé en vue de l’obtention du Bachelor HES par : Caroline MARTIN MAHREZ Conseiller au travail de Bachelor : René SCHNEIDER Lausanne, juillet 2009 Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE) Filière ID-bilingue Déclaration Ce travail de Bachelor est réalisé dans le cadre de l’examen final de la Haute école de gestion de Genève, en vue de l’obtention du titre de Spécialiste en information documentaire. L’étudiant accepte, le cas échéant, la clause de confidentialité. L'utilisation des conclusions et recommandations formulées dans le travail de Bachelor, sans préjuger de leur valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celle du conseiller au travail de Bachelor, du juré et de la HEG. « J’atteste avoir réalisé seule le présent travail, sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie. » Fait à Lausanne, le 10.07.2009 Caroline Martin Mahrez Réflexion sur l’organisation et sur la structuration d’un portail institutionnel pour la musique MARTIN MAHREZ, Caroline i Remerciements Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidée tout au long de mon travail. Suzanne Kaufmann , mandante de ce travail, pour tout le soutien qu'elle m’a apporté. Jean-Louis Matthey , responsable de la Section Archives Musicales de la BCU, et Jean-François Wullyamoz , bibliothécaire à la Section Musicologie et Musique Imprimée de la BCU, pour les entretiens qu'ils m’ont accordés.