Les Rendez-Vous Du Patrimoine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Frédéric Auguste Bartholdi, Né Le 2 Août 1834 À Colmar Et Mort Le 4 Octobre 1904 À Paris, Est Un Sculpteur Français
Auguste Bartholdi Frédéric Auguste Bartholdi, né le 2 août 1834 à Colmar et mort le 4 octobre 1904 à Paris, est un sculpteur français. Biographie Frédéric Auguste Bartholdi est un sculpteur français du XIXe siècle. Il est internationalement connu pour avoir été l’auteur de la statue de la Liberté. La ville de Colmar, dont il était originaire, garde de nombreuses traces de son activité professionnelle. Les jeunes années Auguste Bartholdi est né en 1834 à Colmar. Il est issu d'une famille prospère venant de la Rhénanie allemande. Son père, Jean-Charles, était un fonctionnaire ayant su faire fructifier la richesse familiale, ils disposaient de nombreux biens immobiliers qui lui assuraient son train de vie. Malheureusement il décéda jeune, en 1836, alors que son fils Frédéric n'avait que 2 ans. Son épouse Augusta Charlotte gère alors la fortune de son mari avec prudence, permettant à ses fils de profiter d’une manne financière qui les mettront tous à l’abri du besoin. Car Auguste, comme il se nommera par la suite, avait trois frères, dont deux décèderont jeunes. Le survivant fut avocat, mais la maladie l'emporta et il dû être interné. A la mort de son père, la famille emménagea à Paris, au 30, rue des marchands. Cette adresse est aujourd’hui le musée Bartholdi. Auguste étudie au lycée Louis-le-Grand, où il obtient son baccalauréat en 1852, puis à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts, où il étudie l'architecture, la peinture. En 1855 et 1856 il effectue un voyage en Egypte et au Yémen, voyage qui le marquera jusqu'à la fin de sa vie, découvrant des pays contrastés. -

Sculptures Animalières Doct Enseignant 2017
Parcours Sculptures animalières Document enseignant Lieux : Durée : 2h environ selon le cycle - 2 lieux à choisir sur les 3 proposés : Place Stalingrad : Le lion bleu de Xavier Veilhan Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le Place des Quinconces : Les sculptures des fontaines respect des règles simples de sécurité d’utilisation du du Monument aux Girondins de Dumilâtre tramway, le temps de déplacement variable. Place de la Victoire : les tortues et l’obélisque d’Yvan Theimer Encadrement : Selon le cycle , prévoir 2 à 3 adultes - Utilisation du réseau du tramway par classe. Niveaux préférentiels : Les cycles 1, 2 et 3. Matériel nécessaire : appare il photos, feuilles de dessin, crayons, pastels, pâte à modeler. Présentation générale : Ce parcours pédagogique permet aux élèves de : - Rencontrer des œuvres par une approche sensible : tactile et visuelle - Faciliter la prise de parole de chacun - Découvrir des œuvres d’art publiques en ville en utilisant le réseau de transport du tramway Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - L’oral : oser entrer en communication, échanger et réfléchir avec les autres ; comprendre et apprendre Références aux - L’écrit : découvrir la fonction de l’écrit connaissances et Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques compétences - Développer le goût pour les pratiques artistiques visées - Découvrir différentes formes d’expression artistique - Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix Cycle 1 Explorer le monde - Faire l’expérience de l’espace, découvrir -

Télécharger Le Programme De La Métropole De Lyon
PROGRAMME Faites votre programme sur grandlyon.com/jep #jepgrandlyon grandlyon.com/jep #jepgrandlyon 2 AU FIL Partager l’histoire et le devenir de nos territoires : chaque année, c’est l’objectif des Journées européennes du Patrimoine DE L’EAU et des centaines d’animations que la Métropole de Lyon coordonne pendant l’événement. Nous avons choisi de placer cette édition sous le signe de l’eau, en l’intitulant « la Métropole au fil de l’eau ». Ce sujet rassemble tous les Grands Lyonnais, grâce aux deux fleuves et aux cours d’eau qui dessinent notre paysage. Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la Depuis Lugdunum et les aqueducs gallo-romains, les fleuves connaissance et la préservation du patrimoine est un objectif ont en effet façonné la cité et la métropole lyonnaise. prioritaire du ministère de la Culture, les Journées européennes Aujourd’hui, les aménagements de l’Anneau Bleu, des du patrimoine sont placées cette année, pour leur trente-qua- Berges du Rhône et des Rives de Saône marquent la trième édition, sous le thème de la jeunesse. reconquête par notre territoire de cette richesse naturelle. Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera Le thème s’impose d’autant plus que nous célébrons mis en œuvre, partout en France, pour sensibiliser les plus jeunes les 25 ans de la loi du 3 janvier 1992. Ce texte, qui à ces enjeux. Pour leur donner, grâce à une programmation dé- consacre l’eau comme patrimoine commun de la Nation, grandlyon.com/jep diée et adaptée à chacun, quel que soit son âge, les moyens de rappelle notre responsabilité de préserver et protéger s’approprier le patrimoine dans toute sa diversité. -

Histoire Des Arts Dans L'académie De Lyon
19 JOURNÉES LE PROGRAMME 20 EUROPÉENNES Sept. DU PATRIMOINE 2015 Création d’aujourd’hui, patrimoine de demain > www.grandlyon.com/jep En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le Grand Lyon patrimoine de demain : telle est l’invitation que je vous ai faite, Le patrimoine du XXIe siècle, pour ces 32e Journées européennes du patrimoine. Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments et les jardins que les générations une histoire d’avenir précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur au fil du temps. Et chaque année, ces journées sont un succès, car dans le patrimoine, chacun voit à raison une part de sa propre histoire. Cette année encore, 17 000 lieux Pour l’édition 2015 des Journées européennes Nous avons d’ailleurs invité les habitants à écrire seront ouverts au public, en Outre-Mer comme en Métropole. du patrimoine, la thématique proposée par ensemble le récit de cette toute jeune collectivité Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà le Ministère de la culture et de la communication avec Métrophonie, une démarche sensible de ces ouvertures très attendues, met en effet à l’honneur vient épouser le projet de la Métropole de Lyon, qui vise à produire la bande son originale de le patrimoine en train de se faire : les créations architecturales née le 1er janvier dernier. la Métropole. Si la thématique a pu surprendre, et paysagères de ces quinze dernières années. elle se révèle pourtant comme une formidable Les agglomérations permettent d’inventer opportunité d’ouvrir le débat sur ce qui pourra Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de nouvelles manières de penser le fait urbain. -

Circuit Adapté Presqu'ile En Fauteuil Roulant
© Handilol - Informations pratiques PMR à Lyon au 01/01/2016 - Circuit adapté Presqu’île CIRCUIT ADAPTÉ PRESQU’ILE EN FAUTEUIL ROULANT Place Bellecour, statue Louis XIV Depuis l’Office de tourisme, aller au centre de la place voir la statue équestre de Louis XIV. Prendre l’allée goudronnée en diagonale sur la place pour rejoindre la rue de la République. Rue de la République Les amateurs de shopping apprécieront de retrouver de grandes enseignes dans cette rue. Les boutiques sont plutôt bien accessibles avec entrée de plain-pied. Pour la Fnac, l’entrée accessible se trouve rue Bellecordière, parallèle à droite de la rue de la République. Tourner à gauche rue des Archers et marcher tout droit jusqu’à la place des Célestins. Place des Célestins Traverser le trottoir et prendre la rampe abaissée sur le trottoir en face pour monter sur le parvis du Théâtre des Célestins. La longue vue au milieu donne une vision en kaléidoscope du parking. Il n’est malheureusement pas possible de regarder dedans si on ne peut pas l’atteindre (1,50m de haut). L’entrée accessible du Théâtre des Célestins se trouve sur son côté droit, au 4 rue Charles Dullin. Il y a une sonnette pour appeler un agent puis un ascenseur pour monter à l’étage. Revenir en arrière et descendre de la place en prenant la même rampe que pour monter. Reprendre le trottoir d’en face et continuer rue Montcharmont, puis rue Jean Fabre à droite jusqu’à la Place des Jacobins. Place des Jacobins Traverser un passage piétons pour rejoindre le centre de la place et admirer sa magnifique fontaine, qu’il est possible d’approcher de près grâce à de grandes rampes circulaires qui l’encerclent. -

Gadagne, Renaissance ! • the GADAGNE MUSEUMS • P
2009 // 2010 Magazine de l’association des artisans et commerçants du Vieux Lyon (ACVL) // LE MAGAZINE DU VIEUX LYON PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO LE PLUS JEUNE DES VIEUX QUARTIERS ! Vieille ville // Old town Achats & loisirs // Shopping & leisures Restaurants // Restaurants Gadagne, Renaissance ! • THE GADAGNE MUSEUMS • p. 6 & 7 ÉDITO *EDITORIAL 3 Édito. • edItoRIal • OH LYON, MON BEAU LYON ! Moi qui te regarde depuis plus de 200 ans, your OLD LyoN, the very same that saw my je ne me lasse pas de ton évolution. birth. So continue to make yourself beautiful and Aujourd’hui tu es devenue une grande parmi I will still continue to look at you for years and les grandes et tu es prête à recevoir le monde years, I, Guignol, your most faithful servant. You entier. Il t’en aura fallu du temps pour éclore, who read these few lines, carry away with you maintenant c’est chose faite et chaque visiteur this picture of hiDDEN, SECRET, WELCOMING pourra prendre de toi, «Lyon», ce qu’il voudra : AND DAZZliNG Lyon, become our greatest Histoire, culture, gastronomie, ambassadors. And you, inhabitants of Lyon, be nouvelles tecHnologies, DÉtente et aware of how lucky you are to live in Lyon, but bien sûr ton Vieux-Lyon celui-là même qui be careful: the old Lyon proverb says, “Not m’a vu naître. Alors continue à te faire belle everybody can be from Lyon, we need a et je te regarderai encore des années et des few from other places too”. Let us hope that années moi, Guignol, ton plus fidèle serviteur. -

Programme Des Journées Européennes Du Patrimoine 2020
JOURNÉES EUROPÉENNES DU P TRIMOINE dans la Métropole de Lyon 19-20 sept. PROGRAMME 2020 PATRIMOINE ET ÉDUCATION : #jepgrandlyon grandlyon.com/jep EXPOSITION 25 nov. 2020 25 avr. 2021 LYON PHOTOS : S.ILYNE - LUGDUNUM : S.ILYNE PHOTOS La cuisine romaine, de la taverne au banquet CRÉATION lugdunum.grandlyon.com ÉDITOS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE dans la Métropole de Lyon Je veux déconfiner la culture pour Éduquer, c’est permettre l’acquisition de compétences qu’elle soit l’affaire de tous. et de savoirs, mais c’est avant tout construire Qui aurait pu penser au printemps, que les Journées collectivement un patrimoine commun. À Lyon, le européennes du patrimoine pourraient se dérouler, à la date musée Lugdunum nous guide dans ce voyage vers prévue, les 19 et 20 septembre prochain ? les origines de la Ville, parmi les 250 sites ouverts à Nous ne pouvions pas ne pas renouer avec nos monuments l’occasion des Journées du patrimoine. En effet, les et lieux historiques comme nous le faisons depuis 36 ans constructions humaines qui nous environnent ancrent chaque troisième week-end du mois de septembre. notre quotidien dans le temps et dans l’espace. Les Journées du patrimoine sont ainsi une occasion de Et ce lien étroit qui nous unit à notre patrimoine va, j’en suis nous rapprocher du passé, qui éclaire notre route convaincue, se renforcer pendant l’été. dans les moments d’incertitude. Les déplacements de loisirs et les vacances qu’un grand nombre de nos concitoyens envisagent cette année en France Notre patrimoine, c’est aussi l’ensemble du pourront faire la part belle à ce patrimoine de proximité qui patrimoine naturel dont nous avons hérité et qu’il jalonne tout notre territoire. -

Schema Departemental Des Carrieres Du Rhône
PREFECTURE DU RHONE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU RHÔNE Juin 2001 Photo LAFARGE CIMENTS - SNC Carrière de Rivolet - 69 TOME III : DOCUMENTS GRAPHIQUES SG R Rh ôn e- Al p es SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU RHÔNE TOME III : DOCUMENTS GRAPHIQUES SOMMAIRE CARTE ET LISTE DES CARRIERES EN ACTIVITE OU EN COURS DE REAMENAGEMENT CARTE DES RESSOURCES CONNUES EN MATERIAUX DE CARRIERES CARTES DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 1 - LES ESPACES PROTEGES OU ESPACES GERES : - Liste des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope ; - Liste des Monuments Historiques classés et inscrits ; - Liste des Opérations Locales agri-environnementales ; - Liste des Parcs Naturels Régionaux ; - Liste des Réserves Naturelles Volontaires ; - Liste des Sites Classés, naturels et bâtis ; - Liste des Sites Inscrits à l’Inventaire, naturels et bâtis ; - Liste des Zones de Protection ; - Listes des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, et des projets de Z.P.P.A.U.P. 2 - LES INVENTAIRES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE, ET LES SITES PROPOSES AU TITRE DE LA DIRECTIVE « HABITATS » : - Liste des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type I ; - Liste des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type II ; - Liste des Sites proposés au titre de la directive « Habitats ». 3 - LES ESPACES NATURELS SENSIBLES : - Liste des Espaces Naturels Sensibles dotés d’une structure ou d’un plan de gestion ; - Liste des autres Espaces Naturels Sensibles. 4 - LES AUTRES INVENTAIRES : - Liste des Paysages Remarquables ; - Liste des Paysages Exceptionnels ; - Liste des Sites Géologiques d’intérêt majeur. 5 - L'ETAT PHYSIQUE DES MILIEUX AQUATIQUES SUPERFICIELS : LES VALLEES DEGRADEES (CARTE EXTRAITE DU SDAGE RMC) 6 - LES RESSOURCES EN EAU : - Liste des Captages d’Alimentation en Eau Potable ; - Liste des systèmes aquifères et des domaines. -

SOUS SERIE 35 FI Fonds Christiane Pelouse
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’AUDE SOUS SERIE 35 FI Fonds Christiane Pelouse (cartes postales, fin XIXe-début XXe siècle) Répertoire numérique établi par Geneviève Rauzy, attachée de conservation du patrimoine Carcassonne 2013 Introduction Ce fonds est composé de deux albums de cartes postales venant de la famille de Madame Christiane Pelouse et d’un lot de cartes postales, vignettes ou images. Les albums sont anciens et très représentatifs de l’époque à laquelle ils ont été conçus ; ils ont été conservés mais les documents qui y étaient contenus ont été enlevés et placés dans des matériaux neutres de manière à assurer leur préservation. L’ordre des cartes postales dans les albums, ne semblant pas correspondre à une réelle logique, n’a pas été respecté. Il a semblé préférable de regrouper les documents par localités et par thèmes. Dans ces deux albums, de nombreuses cartes sont vierges de tout écrit. Les cartes postales noir et blanc, sépia ou couleurs, ont les dimensions habituelles (9 x 14 cm) ; les vignettes sont de tailles très variées. Composition du fonds 35 Fi 1 à 331 Album de cartes postales ayant appartenu à la famille paternelle de Madame Christiane Pelouse. La plupart des cartes postales ont été envoyées à Marie Bergougnan, sa grand-mère. Marie Bergougnan habite au 63 Grande rue, à Carcassonne, avec ses parents, Sylvain et Joséphine, tamisiers ; puis, lorsqu’elle épouse Antoine Pelouse, fils d’un mécanicien-tourneur et employé chez ses parents, elle s’installe au 27 rue Emile Zola, résidence de la famille Pelouse. Ces cartes postales ont été expédiées entre 1902 et 1918 : certaines par des soldats de la famille durant la Première Guerre mondiale. -

INVENTAIRE 35Fi
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’AUDE SOUS SERIE 35 FI Fonds Christiane Pelouse (cartes postales, fin XIXe-début XXe siècle) Répertoire numérique Carcassonne 2013 Introduction Ce fonds est composé de deux albums de cartes postales venant de la famille de Madame Christiane Pelouse et d’un lot de cartes postales, vignettes ou images. Les albums sont anciens et très représentatifs de l’époque à laquelle ils ont été conçus ; ils ont été conservés mais les documents qui y étaient contenus ont été enlevés et placés dans des matériaux neutres de manière à assurer leur préservation. L’ordre des cartes postales dans les albums, ne semblant pas correspondre à une réelle logique, n’a pas été respecté. Il a semblé préférable de regrouper les documents par localités et par thèmes. Dans ces deux albums, de nombreuses cartes sont vierges de tout écrit. Les cartes postales noir et blanc, sépia ou couleurs, ont les dimensions habituelles (9 x 14 cm) ; les vignettes sont de tailles très variées. Composition du fonds 35 Fi 1 à 331 Album de cartes postales ayant appartenu à la famille paternelle de Madame Christiane Pelouse. La plupart des cartes postales ont été envoyées à Marie Bergougnan, sa grand- mère. Marie Bergougnan habite au 63 Grande rue, à Carcassonne, avec ses parents, Sylvain et Joséphine, tamisiers ; puis, lorsqu’elle épouse Antoine Pelouse, fils d’un mécanicien-tourneur et employé chez ses parents, elle s’installe au 27 rue Emile Zola, résidence de la famille Pelouse. Ces cartes postales ont été expédiées entre 1902 et 1918 : certaines par des soldats de la famille durant la Première Guerre mondiale. -

Assemblée Générale De Concertation 2011
ASSEMBLEE GENERALE DE CONCERTATION DE L’UCIL 24 OCTOBRE 2011 Discours du Président Denis EYRAUD Rapport d’activité 2010-2011 Je remercie en votre nom à tous le Président Gérard COLLOMB qui a bien voulu, comme c’est la tradition, assister à cette Assemblée Générale de l’UCIL qui permet chaque année aux responsables des comités d’intérêts locaux de l’agglomération lyonnaise d’entendre leur premier magistrat et de lui poser des questions d’actualité relative aux nombreux sujets qui préoccupent les habitants. Nous savons, Monsieur le président, que votre agenda est extrêmement chargé, c’est pourquoi nous apprécions d’autant plus le privilège de cette rencontre annuelle attendue avec impatience par tous. Cette impatience était cette année d’autant plus grande que l’an passé l’assemblée programmée le 1er décembre avait dû être annulé à cause de la neige tombée en abondance la veille, bloquant toute circulation. Merci aussi à tous les élus et techniciens de l’agglomération lyonnaise qui nous font également l’honneur et l’amitié d’être présents ce soir, qu’ils m’excusent de ne pas les citer tous. Cette manifestation se déroulera en trois temps : 1 – le rapport d’activité de l’UCIL pour l’année écoulée, 2 – l’intervention du Président Gérard COLLOMB, 3 – les réponses des élus aux questions qui ont été posées par les CIL. Enfin après nos débats nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié. Introduction Certains seront surpris de me voir présider à nouveau cet exercice. En effet, après avoir été à la tête de notre fédération durant 6 ans et demi, du 24 septembre 2001 au 10 mars 2008, j’avais démissionné pour plus me consacrer à ma profession d’architecte et également parce que je pensais, et pense toujours, qu’un président ne doit pas être éternel. -
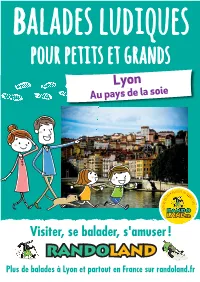
Visiter, Se Balader, S'amuser !
balades ludiques pour petits et grands Lyon Au pays de la soie artout en s p Fr de an la c a e b s e u d r . s . u l p Visiter, se balader, s'amuser ! Plus de balades à Lyon et partout en France sur randoland.fr Diffi cile 3,2 km 2h Lyon Départ : Place des Terreaux Au pays de la soie GPS : 45.767344N / 4.834059E Située dans la région Rhône Alpes, Lyon se trouve au » de la Croix-Rousse sont parsemées de ruelles étroites, confl uent du Rhône et de la Saône. Aujourd’hui, la Croix- de vieux immeubles ayant abrité des ateliers de soieries. Rousse « colline qui travaille » culminant à 254m au-dessus Cet ensemble fait partie du territoire classé au patrimoine de la ville, reste le vestige d’une prospérité économique liée Mondial par l’UNESCO et est ancré dans l’histoire et à la soie. Avec leur architecture caractéristique, « les pentes l’identité des Lyonnais. Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue Road-book sous votre entière responsabilité. La société Randoland décline toute responsabilité en cas d’accident. Débuter sur la place des Terreaux, prendre la montée des Carmélites jusqu’à la montée Saint-Sébastien. devant l’Hôtel de ville. Traverser la place jusqu’à la rue Neyret. Tourner à droite. Tourner à droite dans la montée Saint- et se diriger vers la fontaine Bartholdi Aller tout droit jusqu’à l’église Bon Sébastien, admirer l’église St-Bernard 1 . Pasteur 4 . sur votre droite.