Les Fleurs Bleues (Afterimage)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

May / Maj 2000R
WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI Maj / Czerwiec 2000 W Numerze: Wajda na ustach świata. Obraz pokolenia artykuł Jana NowakaJeziorańskiego Trzy oblicza Brandysa Od Redakcji Podziękowania Ekslibrisy Biblioteka Polskiego Instytutu Naukowego Adam Ulam Exciting New Books Życie Kulturalne WAJDA NA USTACH ŚWIATA ! Dumni jesteśmy z naszego najsłynniejszego reżysera filmowego, Andrzeja Wajdy, którego uhonorowano tej wiosny nawyższym filmowym odznaczeniem Oskarem za całość jego pracy. Nic dziwnego że miłośnicy srebrnego ekranu uważają go za jednego z najważniejszych reżyserów w historii filmu! Osiągnięcia jego są zaiste imponujące. Wajda zrealizował 36 filmów fabularnych, ponad 30 spektakli teatralnych, kilkanaście programów telewizyjnych. Jest najbardziej znanym w świecie polskim reżyserem. Miał mnóstwo sukcesów, zdobył wiele nagród. Wśród szczególnie prestiżowych była w Canne Srebrna Palma w 1957 r. za Kanał i w 1978 r. zaCzłowieka z marmuru nagroda krytyki FIPRESCI. Popiół i diament przyniósł mu nagrodę krytyki w Wenecji w 1959 r. Andrzeja Wajdę wychował polski patriotyczny dom i szkoła. Ojciec jego był zawodowym oficerem, matka nauczycielką. Dzieciństwo spędził w prowincjonalnych garnizonowych miasteczkach. Miał zaledwie 13 lat gdy wybuchła wojna i ojciec ruszył by bronić ojczyzny. Nie zobaczył go więcej, ale dom był zawsze pełen pamiątek, jego pułkowych odznak, jego Krzyża Virtutu Militari, fotogrfii w mudurze i z szablą. W czasie okupcji Andrzej uczył się w Radomiu na tajnych kompletach. W 1942 r. złożył przysięgę swemu dowódcy w podziemiu. Matka drżała o jego życie. Wcześnie ujawniły się jego zamiłowania artystyczne i zdolności malarskie. Wnet po zakończeniu wojny miał swoją pierwszą wystawę malarską. Czas mu było wyrwać się na szerszy świat. Przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia malarskie na Akademii Sztuk Pięknych. -

Bodily Violence and Resistance in Wojtek Smarzowski's Rose
Article Bodily Violence and Resistance in Wojtek Smarzowski’s Rose (Róża, 2011) ELŻBIETA OSTROWSKA, University of Alberta, Canada; email: [email protected] 38 DOI: 10.2478/bsmr-2018-0003 BALTIC SCREEN MEDIA REVIEW 2018 / VOLUME 6 / ARTICLE ABSTRACT The article argues that Wojtek Smarzowski’s filmRose (Róża, Poland, 2011) undermines the dominant bi- gendered logic of screen death and suffering in the Polish films depicting the experience of World War II. In these films, there is a significant absence of images of female suffering and death, which is striking when compared to the abundant images of wounded and dying male bodies, usually represented as a lavish visual spectacle. This unrepresented female death serves as a ‘structuring absence’ that governs the systematic signifying practices of Polish cinema. Most importantly, it expels the female experience of World War II from the realm of history to the realm of the mythical. This representational regime has been established in the Polish national cinema during the 1950s, especially in Andrzej Wajda’s films, and is still proving its longevity. As the author argues, Smarzowski’s Rose is perhaps the most significant attempt to undermine this gendered cinematic discourse. Specifically, the essay explores the ways in which Smarzowski’s Rose departs from previous dominant modes of representation of the World War II experience in Polish cinema, especially its gendered aspect.1 Firstly, it examines how Rose abandons the generic conventions of both war film and historical drama and instead, utilises selected conventions of melodrama to open up the textual space in which to represent the female experience of historical events. -

Andrzej Wajda'nin Kadrajindan Polonya
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI POLONYA DİLİ VE KÜLTÜRÜ BİLİM DALI ANDRZEJ WAJDA’NIN KADRAJINDAN POLONYA EDEBİYATI Doktora Tezi Aybike Kılık Ankara, 2018 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI POLONYA DİLİ VE KÜLTÜRÜ BİLİM DALI ANDRZEJ WAJDA’NIN KADRAJINDAN POLONYA EDEBİYATI Doktora Tezi Aybike Kılık Tez Danışmanı Prof. Dr. Neşe M. Yüce Ankara, 2018 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ……………………………………………………………………..i GİRİŞ ……………………………………………………………………………….1 I. BÖLÜM Sinema ve Uyarlama Üzerine…………………………………………………….11 II. BÖLÜM İkinci Dünya Savaşı Sonrası Polonya Sineması ………………………………...26 III. BÖLÜM Andrzej Wajda Kimdir?.........................................................................................61 III.1. Sinema Geçmişi ……………………………………………………...61 III.2. Tiyatro Geçmişi ………………………………………………….…..70 IV. BÖLÜM Romantizm Dönemi ………………………………………………………………72 IV.1. Bay Tadeusz …………………………………………………………74 IV.2. İntikam ……………………………………………………………….81 V. BÖLÜM Genç Polonya Dönemi ……………………………………………………………91 V.1. Genç Polonya Döneminde Drama ……………………………………93 V.2. Genç Polonya Döneminde Roman ……………………………………95 V.3. Düğün …………………………………………………...……………96 V.4. Vaat Edilmiş Toprak ……………………………..…………………122 VI. BÖLÜM İki Savaş Arası Dönem ………………………………………………………….139 VI.1. Wilkolu Kızlar ……………………...………………………………140 VI.2. Danton .………………………………………………………..……155 i VII. BÖLÜM Savaş Konulu Filmler ………………………………………………...…………164 VII.1. Muharebe -

©2017 Renata J. Pasternak-Mazur ALL RIGHTS RESERVED
©2017 Renata J. Pasternak-Mazur ALL RIGHTS RESERVED SILENCING POLO: CONTROVERSIAL MUSIC IN POST-SOCIALIST POLAND By RENATA JANINA PASTERNAK-MAZUR A dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey In partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Music Written under the direction of Andrew Kirkman And approved by _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ New Brunswick, New Jersey January 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Silencing Polo: Controversial Music in Post-Socialist Poland by RENATA JANINA PASTERNAK-MAZUR Dissertation Director: Andrew Kirkman Although, with the turn in the discipline since the 1980s, musicologists no longer assume their role to be that of arbiters of “good music”, the instruction of Boethius – “Look to the highest of the heights of heaven” – has continued to motivate musicological inquiry. By contrast, music which is popular but perceived as “bad” has generated surprisingly little interest. This dissertation looks at Polish post-socialist music through the lenses of musical phenomena that came to prominence after socialism collapsed but which are perceived as controversial, undesired, shameful, and even dangerous. They run the gamut from the perceived nadir of popular music to some works of the most renowned contemporary classical composers that are associated with the suffix -polo, an expression -

Muzyka W Filmie Tatarak Andrzeja Wajdy
BAnna Al-Araj B „W ogóle jestem niechętny dźwiękom”. Muzyka w filmie Tatarak Andrzeja Wajdy ABSTRACT. Al-Araj Anna, „W ogóle jestem niechętny dźwiękom”. Muzyka w filmie „Tatarak” Andrzeja Wajdy [“As a rule, I am reluctant towards sound”. Music in Andrzej Wajda’s film “Sweet Rush”]. „Przestrzenie Teorii” 27. Poznań 2017, Adam Mickiewicz University Press, pp. 117–137. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2017.27.10. The aim of this article is to interpret the musical layer of Andrzej Wajda’s 2009 movie Tatarak (Sweet Rush ), based on the novel by Jarosław Iwaszkiewicz. In the first part, the author attempts to depict the complex relationship between the literary and film works of these two artists and em- phasizes three main motifs used by both of them: love and death, water and women’s themes. Next, Wajda’s attitude to music is analyzed. He treats sounds as an element of everyday life and, as is typical for our times, he is aware of the “dissolution” of musical works. In the next part, the author articulates the main problems of Sweet Rush , drawing attention to both Iwaszkiewicz’s novel and Wajda’s movie. The director’s adaptation, which is full of intermedia references, re- volves around the theme of death and seems to underestimate the sexual aspect of Iwaszkiewicz’s work. Finally, Pawel Mykietyn’s soundtrack to Sweet Rush is interpreted. The composer used one of his earlier Shakespeare’s Sonnets (2000), which plays the role of a leitmotif , to illustrate the most enigmatic, inexplicable scenes from Wajda’s movie. -

Bdramatyczne Przestrzenie Andrzeja Wajdyb
BDramatyczne przestrzenie Andrzeja Wajdy B ABSTRACT. Krajewska Anna, Dramatyczne przestrzenie Andrzeja Wajdy [Andrzej Wajda’s dramatic space]. „Przestrzenie Teorii” 27. Poznań 2017, Adam Mickiewicz University Press, pp. 7–10. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2017.27.0. This editorial is an impressionistic work on Andrzej Wajda’s output, predominantly emphasising its dramatic nature. The text presents the uniqueness of Andrzej Wajda’s creative work in such diverse forms of art as if they were one – his painting metamorphosed into film, drawing into screenplay, urban space into a theatre stage. Wajda is seen here not only as a director, but also as a contemporary dramatist, who creates the dramatic space of history’s traps, who dramatises the fate of the individual, and who interprets the drama of the philosophical stage. Po śmierci Andrzeja Wajdy ukazywać się zaczęły numery specjalne licznych czasopism literackich poświęcone Jego pamięci – jednego z naj- wybitniejszych artystów związanych z Krakowem, z Polską, wpisującym się równocześnie w światową kulturę i sztukę. Wajda to polska szkoła filmowa, Wajda to współczesna historia Polski, Wajda to myślenie o dzie- jach wykraczające poza refleksję o losach własnego kraju, ku obszarom historiozofii. Wajda to znawca pamięci, czasu, przemijania. Był twórcą niezwykłym także i dlatego, że uprawiał różne rodzaje sztuk tak, jakby były jednością – malarstwo pod Jego ręką przeistaczało się w kadr filmo- wy, dialogi wynikały z tańca, rysunek przekształcał się w scenografię, przestrzeń miasta – w teatralną -

A. Lewicki, Teoria I Historia Mediów Audiowizualnych
2019 TEORIA I HISTORIA MEDIÓW AUDIOWIZUALNYCH SKRYPT DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH DR HAB. ARKADIUSZ LEWICKI, PROF. UWR Teoria i historia mediów audiowizualnych dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr Kurs dla studentów niestacjonarnych Cele kursu: Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z historią radia, kina i telewizji – z podstawowymi datami i chronologią ich rozwoju; z najważniejszymi prądami filmowymi i telewizyjnymi; z najwybitniejszymi twórcami. W trakcie ćwiczeń pojawią się także zagadnienia związane z najważniejszymi teoriami medioznawczymi, historią myśli filmoznawczej i teorią mediów audiowizualnych, w szczególności radia i telewizji. Treści kursu (18 godzin): 1. Początki mediów audiowizualnych. Socjologiczne, techniczne i naukowe podstawy wynalezienia i funkcjonowania fotografii, kinematografu i radia. Początki kina w Europie. Kino popularne i awangarda (francuska). Nieme kino rosyjskie i niemieckie. 2. Nieme kino – USA. Star system. Początki radia i kina dźwiękowego. Amerykańskie kino klasyczne. 3. Filmowy modernizm. Włoski neorealizm i „nowe fale”. Kino amerykańskie od roku 1968. 4. Kino najnowsze. Postmodernizm jako system sygnifikacji w mediach audiowizualnych. 5. Przedwojenne kino polskie. Początki polskiego radia i telewizji. Polskie kino, radio i telewizja lat 1945-70. Polskie media współczesne. 6. Historia radia i telewizji. Genealogia mediów audiowizualnych. Teorie badań medioznawczych. 1 1. Początki mediów audiowizualnych. Socjologiczne, techniczne i naukowe podstawy wynalezienia i funkcjonowania fotografii, -
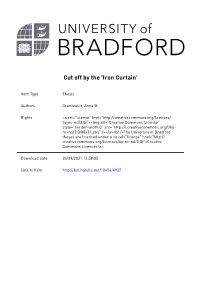
1 INTRODUCTION This Dissertation Will Discuss the Perception of Polish
Cut off by the 'Iron Curtain' Item Type Thesis Authors Draniewicz, Anna B. Rights <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/3.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by- nc-nd/3.0/88x31.png" /></a><br />The University of Bradford theses are licenced under a <a rel="license" href="http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">Creative Commons Licence</a>. Download date 24/09/2021 13:59:05 Link to Item http://hdl.handle.net/10454/4927 INTRODUCTION This dissertation will discuss the perception of Polish Cinema in English- language literature. During the collection of my secondary data, which concentrated mainly on English-language books but also includes newspapers and Internet resources, I encountered many interesting issues. These are divided here into three categories discussed in three chapters: ‘Stereotypes and Errors’ that result from the lack of knowledge thus causing misunderstandings, ‘Deficiencies’ about the absence of some films and directors in the English-speaking world and ‘Different Perspectives’ that reveal some interesting comparisons. The judgements applied to define these sections are respectively: accuracy (correctness of the facts), novelty (unknown trends) and originality of ideas (absent in Polish film criticism). During my research I have discovered the main factors distorting the perception of Polish cinema. I talked about them during my presentation entitled ‘English-Language Critical Engagements with Polish Cinema’ during the ‘Polish Cinema in an International Context’ conference held in Manchester in December 2009. Most of these issues are addressed in Chapter One, which outlines the problems that English-language authors seem to have with the Polish language, the background political issues and the lack of knowledge about some of the periods of Polish cinema. -

New Polish Films 20082 0 0 8 NPF 2008 Okladka S II:Layout 1 28/1/08 11:22 Page 1 New Polish Films 2008
NNPFPF 22008008 ookladkakladka s I.aiI.ai 28/1/0828/1/08 11:57:1811:57:18 NewPolish Films 20082008 C M Y CM MY CY CMY K 2008 Sponsor of PISF: NPF 2008 okladka s II:Layout 1 28/1/08 11:22 Page 1 New Polish Films 2008 New Polish Films 2008 1 2 New Polish Films 2008 Introduction Dear Ladies and Gentleman, We begin the third year of the Polish Film Institute's activity and the second year after the Act on Cinematography was approved by European Commission in May 2006. For last two years the situation of Polish cinema has changed favourably. In 2005 with the introducing the parliamentary act, Polish cinema received a great opportunity. The Polish Film Institute, created according to world's best standards, has become an institution supporting artists at every stage of film production. The PFI also subsidizes film festivals and retrospectives, supports the infrastructure of cinemas' renewal, promotes Polish cinema abroad, grants professional advancement of filmmakers as well as film schools. We are always trying to be where something important is happening in cinema. The new law and establishing the PFI resulted not only in multiplying the State's expenses on cinema – here I would like to remind that in the worst in this case year of 2002 Ministry of Culture assigned 4.3 million zloty for film production, while only this year the Institute assigned almost 80 million zloty for film production and development. The number of last year's feature film production increased up to 37 titles and in 2007 – 39 feature films have been made. -

Pogrom Cries – Essays on Polish-Jewish History, 1939–1946
Rückenstärke cvr_eu: 39,0 mm Rückenstärke cvr_int: 34,9 mm Eastern European Culture, 12 Eastern European Culture, Politics and Societies 12 Politics and Societies 12 Joanna Tokarska-Bakir Joanna Tokarska-Bakir Pogrom Cries – Essays on Polish-Jewish History, 1939–1946 Pogrom Cries – Essays This book focuses on the fate of Polish “From page one to the very end, the book Tokarska-Bakir Joanna Jews and Polish-Jewish relations during is composed of original and novel texts, the Holocaust and its aftermath, in the which make an enormous contribution on Polish-Jewish History, ill-recognized era of Eastern-European to the knowledge of the Holocaust and its pogroms after the WW2. It is based on the aftermath. It brings a change in the Polish author’s own ethnographic research in reading of the Holocaust, and offers totally 1939–1946 those areas of Poland where the Holo- unknown perspectives.” caust machinery operated, as well as on Feliks Tych, Professor Emeritus at the the extensive archival query. The results Jewish Historical Institute, Warsaw 2nd Revised Edition comprise the anthropological interviews with the members of the generation of Holocaust witnesses and the results of her own extensive archive research in the Pol- The Author ish Institute for National Remembrance Joanna Tokarska-Bakir is a cultural (IPN). anthropologist and Professor at the Institute of Slavic Studies of the Polish “[This book] is at times shocking; however, Academy of Sciences at Warsaw, Poland. it grips the reader’s attention from the first She specialises in the anthropology of to the last page. It is a remarkable work, set violence and is the author, among others, to become a classic among the publica- of a monograph on blood libel in Euro- tions in this field.” pean perspective and a monograph on Jerzy Jedlicki, Professor Emeritus at the the Kielce pogrom. -

Retrospektive Andrzej Wajda Andrzej Wajda
Retrospektive Andrzej Wajda DER DIRIGENT Andrzej Wajda 8 Andrzej Wajda und Krystyna – Janda bei den Dreharbeiten zu DYRYGENT Wajda Andrzej Als Martin Scorsese 2014 in den USA und in England immer als politscher Filmkünstler verstanden, dessen das auf seine Initiative hin zustande gekommene Film- künstlerisches Selbstverständnis nicht von seinem programm »Masterpieces of Polish Cinema« präsen- Selbstverständnis als polnischer Patriot zu trennen ist. tierte, befanden sich unter den 24 Filmen der Jahre In unmissverständlichen Worten hat er das 2002 in der 1957 bis 1978 allein vier Filme von Andrzej Wajda. Dankesrede bei der Verleihung des Oscar für sein Le- Scorsese verwies auf den starken Eindruck, den die benswerk zum Ausdruck gebracht: »Ich werde meine von ihm ausgesuchten Filme während seines Filmstu- Rede auf Polnisch halten, da ich das sagen möchte, diums an der New York University in den 1960er Jah- was ich denke, und ich denke immer auf Polnisch. ren hinterlassen hatten und hob Wajdas ASCHE UND Die Themen unserer Filme waren die Brutalität des DIAMANT besonders hervor: »When I first saw ASHES Faschismus und das Unglück, welches der Kommunis- AND DIAMONDS, one of the many highlights in this mus mit sich brachte ...« In Filmen wie EINE GENERA- series and arguably one of the greatest films ever made TION, DER KANAL, ASCHE UND DIAMANT, LOTNA oder – Polish or otherwise – I was overwhelmed by the film: LANDSCHAFT NACH DER SCHLACHT spürt man die the masterful direction, the powerful story, the strik- autobiografischen Erfahrungen des 1926 geborenen ing visual imagery, and the shocking performance by Wajda, der den deutschen Überfall auf Polen und die Zbigniew Cybulski, considered the Polish James Dean, Jahre der Besatzung ebenso bewusst miterlebt hatte for his electrifying presence. -

Agatambor.Pdf
TWÓRCA Nowa polska półka filmowa seria KULTURA i JĘZYK POLSKI dla CUDZOZIEMCÓW „LEKSYKON POLSKI” TWÓRCA Agnieszka Tambor Nowa polska półka filmowa 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien Uniwersytet Śląski Wydawnictwo Gnome Katowice 2018 Współpraca przy tworzeniu haseł ADAM ANTONIEWICZ (aa) AGATA RUDZIŃSKA (ar) JUSTYNA BUDZIK (jb) Recenzent WACŁAW M. OSADNIK © Copyright 2015 by Uniwersytet Śląski w Katowicach Wszelkie prawa zastrzeżone Redakcja i korekta KAROLINA POSPISZIL Projekt okładki i szaty graficznej MAREK FRANCIK Publikacja sfinansowana ze środków UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Współfinansowano ze środków Fotografia na okładce JAROSŁAW ROLAND KRUK Wydanie drugie ISBN 978-83-63268-58-9 Złożono czcionkami Myriad Pro i Minion Pro Printed in UE GNOME — Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne ul. Drzymały 18/6, 40-059 Katowice, Poland tel.: 603370713 e-mail: [email protected] Spis treści Wstęp 9 TWÓRCA trzeba obejrzeć 15 NÓŻ W WODZIE (Knife in the Water) 15 ZIEMIA OBIECANA (The Promised Land) 16 PIERWSZA MIŁOŚĆ (First Love) 18 CHINATOWN 19 BARWY OCHRONNE (Camouflage) 21 SEKSMISJA (Sexmission) 22 EUROPA, EUROPA 24 DRAKULA (Bram Stoker’s Dracula) 25 89 MM OD EUROPY (89 mm from Europe) 26 LISTA SCHINDLERA (Schindler’s List) 28 TRZY KOLORY. BIAŁY (Three Colors: White) 30 ŚMIERĆ JAK KROMKA CHLEBA (Death as a Slice of Bread) 31 HELIKOPTER W OGNIU (Black Hawk Down) 33 MARZYCIEL (Finding Neverland) 34 PLAC ZBAWICIELA (Saviour’s Square) 35 KOPIA MISTRZA (Copying Beethoven) 37 SWEENEY TODD: DEMONICZNY GOLIBRODA Z FLEET