L'expédition De Guillaume, Duc De Normandie, Et Du Comte Harold En
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
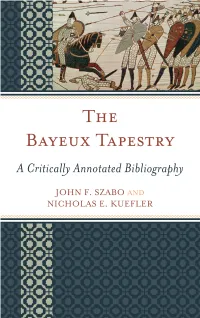
The Bayeux Tapestry
The Bayeux Tapestry The Bayeux Tapestry A Critically Annotated Bibliography John F. Szabo Nicholas E. Kuefler ROWMAN & LITTLEFIELD Lanham • Boulder • New York • London Published by Rowman & Littlefield A wholly owned subsidiary of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. 4501 Forbes Boulevard, Suite 200, Lanham, Maryland 20706 www.rowman.com Unit A, Whitacre Mews, 26-34 Stannary Street, London SE11 4AB Copyright © 2015 by John F. Szabo and Nicholas E. Kuefler All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the publisher, except by a reviewer who may quote passages in a review. British Library Cataloguing in Publication Information Available Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Szabo, John F., 1968– The Bayeux Tapestry : a critically annotated bibliography / John F. Szabo, Nicholas E. Kuefler. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-4422-5155-7 (cloth : alk. paper) – ISBN 978-1-4422-5156-4 (ebook) 1. Bayeux tapestry–Bibliography. 2. Great Britain–History–William I, 1066–1087– Bibliography. 3. Hastings, Battle of, England, 1066, in art–Bibliography. I. Kuefler, Nicholas E. II. Title. Z7914.T3S93 2015 [NK3049.B3] 016.74644’204330942–dc23 2015005537 ™ The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI/NISO Z39.48-1992. Printed -

Hie Est Wadard: Vassal of Odo of Bayeux Or Miles and Frater of St Augustine's, Canterbury?'
Reading Medieval Studies XL (20 14) Hie est Wadard: Vassal of Odo of Bayeux or Miles and Frater of St Augustine's, Canterbury?' Stephen D. White Emory University On the Bayeux Embroidery, the miles identified as Wadard by the accompanying inscription (W 46: Hie est Wadarcf) has long been known as a 'vassal' of William l's uterine brother, Odo of Bayeux (or de Conteville), who was Bishop of Bayeux from 104911050 until his death in 1097; earl of Kent from e. 1067 until hi s exile in 1088; and prior to his imprisonment in 1082, the greatest and most powerful landholder after the king.' Wadard appears just after Duke William's invading army has landed at Pevensey (W 43) and four of his milites have hurried to Hastings to seize food (W 44-5: Et hie milites festinaverunt hestinga lit eibum raperentur).' On horseback, clad in a hauberk and armed with a shield and spear, Wadard supervises as animals are brought to be slaughtered by an axe-wielding figure (W 45) and then cooked (W 46). Writing in 1821, Charles Stoddard was unable to identify Wadard, because written accounts of the conquest never mention him .4 Nevertheless, he cited his image, along with those of two other men called Turold (W 11) and Vital (W 55), as evidence that the hanging must have dated from 'the time of the Conquest', when its designer and audience could still have known of men as obscure as Wadard and the other two obviously were.' In 1833, Wadard was first identified authoritatively as Odo's 'sub-tenant' by Henry Ellis in A General introduction to Domesday Book, though as far back as 1821 Thomas Amyot had I am deeply indebted to Kate Gilbert fo r her work in researching and editing this article and to Elizabeth Carson Pastan for her helpful suggestions and criticisms. -

Domesday Book and Beyond: Three Essays in the Early History of England Frederic William Maitland
Domesday Book and Beyond: Three Essays in the Early History of England Frederic William Maitland Essay One Domesday Book At midwinter in the year 1085 William the Conqueror wore his crown at Gloucester and there he had deep speech with his wise men. The outcome of that speech was the mission throughout all England of 'barons,' 'legates' or 'justices' charged with the duty of collecting from the verdicts of the shires, the hundreds and the vills a descriptio of his new realm. The outcome of that mission was the descriptio preserved for us in two manuscript volumes, which within a century after their making had already acquired the name of Domesday Book. The second of those volumes, sometimes known as Little Domesday, deals with but three counties, namely Essex, Norfolk and Suffolk, while the first volume comprehends the rest of England. Along with these we must place certain other documents that are closely connected with the grand inquest. We have in the so-called Inquisitio Comitatus Cantabrigiae, a copy, an imperfect copy, of the verdicts delivered by the Cambridgeshire jurors, and this, as we shall hereafter see, is a document of the highest value, even though in some details it is not always very trustworthy.(1*) We have in the so-called Inquisitio Eliensis an account of the estates of the Abbey of Ely in Cambridgeshire, Suffolk and other counties, an account which has as its ultimate source the verdicts of the juries and which contains some particulars which were omitted from Domesday Book.(2*) We have in the so-called Exon Domesday -

Medieval Clothing and Textiles
Medieval Clothing & Textiles 2 Robin Netherton Gale R. Owen-Crocker Medieval Clothing and Textiles Volume 2 Medieval Clothing and Textiles ISSN 1744–5787 General Editors Robin Netherton St. Louis, Missouri, USA Gale R. Owen-Crocker University of Manchester, England Editorial Board Miranda Howard Haddock Western Michigan University, USA John Hines Cardiff University, Wales Kay Lacey Swindon, England John H. Munro University of Toronto, Ontario, Canada M. A. Nordtorp-Madson University of St. Thomas, Minnesota, USA Frances Pritchard Whitworth Art Gallery, Manchester, England Monica L. Wright Middle Tennessee State University, USA Medieval Clothing and Textiles Volume 2 edited by ROBIN NETHERTON GALE R. OWEN-CROCKER THE BOYDELL PRESS © Contributors 2006 All Rights Reserved. Except as permitted under current legislation no part of this work may be photocopied, stored in a retrieval system, published, performed in public, adapted, broadcast, transmitted, recorded or reproduced in any form or by any means, without the prior permission of the copyright owner First published 2006 The Boydell Press, Woodbridge ISBN 1 84383 203 8 The Boydell Press is an imprint of Boydell & Brewer Ltd PO Box 9, Woodbridge, Suffolk IP12 3DF, UK and of Boydell & Brewer Inc. 668 Mt Hope Avenue, Rochester, NY 14620, USA website: www.boydellandbrewer.com A CIP catalogue record for this book is available from the British Library This publication is printed on acid-free paper Typeset by Frances Hackeson Freelance Publishing Services, Brinscall, Lancs Printed in Great Britain by Cromwell Press, Trowbridge, Wiltshire Contents Illustrations page vii Tables ix Contributors xi Preface xiii 1 Dress and Accessories in the Early Irish Tale “The Wooing Of 1 Becfhola” Niamh Whitfield 2 The Embroidered Word: Text in the Bayeux Tapestry 35 Gale R. -

Deddington Castle, Oxfordshire, and the English Honour of Odo of Bayeux1 R.J
Deddington Castle, Oxfordshire, and the English Honour of Odo of Bayeux1 R.J. Ivens SUMMARY From an examination of Odo of Bayeux’s estate as recorded in Domesday Book, together with an analysis of the excavated structural phases at Deddington Castle, it is suggested that Deddington may have been the caput of the Oxfordshire and Buckinghamshire parts of Odo’s barony. HISTORICAL EVIDENCE Odo, Bishop of Bayeux and Earl of Kent, was one of the greatest of the tenants-in- chief of his half-brother King William, outstripping in wealth even such a magnate as his own brother Robert, Count of Mortain. Odo held lands in twenty-two English counties, and Domesday Book lists holdings in 456 separate manors. In all, these lands amounted to almost 1,700 hides worth over £3,000, and of these some 274 hides worth £534 were retained in demesne. The extent of these lands is far too great to consider in any detail, so only the distribution of the estates will be discussed here.2 Tables 1 and 2 list the extent of these holdings by county totals.3 The distribution of Odo’s estates may be seen more graphically on the maps, Figs. 1 and 2. Fig. 1, which shows the distribution of the individual manors, demonstrates that this distribution is far from random, and that several distinct clusterings may be observed, notably those around the Thames Estuary, in Oxfordshire and Buckinghamshire, in Suffolk and in Lincolnshire. The maps presented in Fig. 2 are perhaps even more enlightening. These show the proportion of Odo’s estate in each of the twenty-two counties in which he held lands, and illustrate: the distribution of the total hidage; the value of the total hidage; the demesne hidage and the demesne value (the exact figures are listed in Tables 1 and 2). -

The Bayeux Tapestry
THE BAYEUX TAPESTRY With needle, thread, and Latin the Bayeux Tapestry tells the story of the Norman Conquest of England in 1066. Stretching for 230 feet, it consists of a linen background stitched with eight colors of wool yarn, an artistic tour de force . A running commentary describes scene after scene in succinct, simple language. In cartoon format, with a very serious purpose, the Tapestry depicts over 600 people, 190 horses and mules, 35 dogs, 500 other animals, and more than 100 trees, buildings, and ships. It is a valuable document for the study of medieval weapons, warfare, architecture, costumes, folklore, and attitudes. For the Latinist, it is a 230-foot text set in brilliant technicolor. (J. Anderson, “The Bayeux Tapestry,” The Classical Journal 81 [1986] 253) The three principal players in the story of the Norman Conquest of England, as told in the Bayeux Tapestry, are: Harold , the Duke of Wessex and the most prominent military figure in England in the early 1060s CE. Harold came from an important, powerful family. As a “Englishman,” he spoke Anglo-Saxon (Old English). William , the Duke of Normandy. Normandy is in the northwestern corner of France, directly across the English Channel from England. William’s ancestors were Vikings originally from Scandinavia (Northman = Norman), who before William’s day had settled in Normandy. These Vikings had early on abandoned their own Scandinavian (Germanic) language and now spoke dialectally the language of the people they had displaced in France. This dialect (called Anglo-Norman), derived ultimately from Latin, is a modified form of early French. -

Oxford, St George's
27 JULY 2018 OXFORD, ST GEORGE’S 1 actswilliam2henry1.wordpress.com Release date Version notes Who Current version: H1-Oxford St George-2018-1 27/7/2018 Original version RS/DXC Previous versions: — — — — This text is made available through the Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs License; additional terms may apply Authors for attribution statement: Charters of William II and Henry I Project Richard Sharpe, Faculty of History, University of Oxford David X Carpenter, Faculty of History, University of Oxford OXFORD, ST GEORGE’S Collegiate church of St George in Oxford Castle; archive of Osney abbey County of Oxford : Diocese of Lincoln Founded in late eleventh century The church of St George in the castle at Oxford began as a house of secular canons. What is always said about its origins depends wholly on statements in annals of Osney abbey, which, when still a priory, took over the college. Here we are told that Robert d’Oilly built the castle in 1071 and founded St George’s church in 1074, and also that Osney priory was founded by Robert II d’Oilly (nephew of the first), in 1129 (Osney Annals, Annales monastici, iv. 9–10, 19; Salter, Ctl. Oseney, iv. 1, 11). In 1149 the same Robert II d’Oilly and one Geoffrey d’Ivry, the narrative says, gave the church to the canons of Osney (Annales monastici, iv. 26; Salter, Ctl. Oseney, iv. 24). The names of the patrons who made this gift and the year are contradicted by charters of the Empress Matilda and of King Stephen, but they represent the level of falsehood in the history invented for Osney. -

Appendix a William the Conqueror and the Selection Ofwilliam Fitz Rivallon As Abbot of Saint-Florent of Saumur,June 28, 1070
APPENDIX A WILLIAM THE CONQUEROR AND THE SELECTION OFWILLIAM FITZ RIVALLON AS ABBOT OF SAINT-FLORENT OF SAUMUR,JUNE 28,1070 n this appendix I elaborate on the possibility evoked earlier (pp. 30--31) that I William the Conqueror had a personal role in William fitz Rivallon's entry into the monastery of Saint-Florent and his selection as abbot in 1070. Though sparing in detail the successive stages in William fitz Rivallon's conversion to monasticism and selection as abbot are factually documented, as summarized earlier (pp. 23-24). His parents had not destined him for the monastic life from childhood as often happened in the aristocracy. Instead he chose this way of life after already having accepted the succession to his father as secular lord of Dol, and he changed his mind very soon thereafter (prior to 1066). His nomination as abbot in 1070, when thirty or less, came at a very early age, and his novitiate of five years or less prior to accepting the abba rial office was exceptionally short. Moreover his nomination almost immediately after the death of his predecessor, only eleven days later, suggests that his succession had been arranged in advance. Not mentioned earlier but also striking is the silence of historians of the time about the circumstances of William's selection. Whereas they name distinguished personalities from outside the monastery, the abbots ofMarmoutiers and the counts of Anjou, who had exercised a decisive voice in the selection of earlier abbots of Saint-Florent, 1 in William fitz Rivallon's case, they say nothing other than that he took the office. -

Domesday Book and Beyond: Three Essays in the Early History of England Frederic William Maitland
Domesday Book and Beyond: Three Essays in the Early History of England Frederic William Maitland Essay One Domesday Book At midwinter in the year 1085 William the Conqueror wore his crown at Gloucester and there he had deep speech with his wise men. The outcome of that speech was the mission throughout all England of 'barons,' 'legates' or 'justices' charged with the duty of collecting from the verdicts of the shires, the hundreds and the vills a descriptio of his new realm. The outcome of that mission was the descriptio preserved for us in two manuscript volumes, which within a century after their making had already acquired the name of Domesday Book. The second of those volumes, sometimes known as Little Domesday, deals with but three counties, namely Essex, Norfolk and Suffolk, while the first volume comprehends the rest of England. Along with these we must place certain other documents that are closely connected with the grand inquest. We have in the so-called Inquisitio Comitatus Cantabrigiae, a copy, an imperfect copy, of the verdicts delivered by the Cambridgeshire jurors, and this, as we shall hereafter see, is a document of the highest value, even though in some details it is not always very trustworthy.(1*) We have in the so-called Inquisitio Eliensis an account of the estates of the Abbey of Ely in Cambridgeshire, Suffolk and other counties, an account which has as its ultimate source the verdicts of the juries and which contains some particulars which were omitted from Domesday Book.(2*) We have in the so-called Exon Domesday -

WULF the SAXON STUDY GUIDE 1 | P a G E
WULF THE SAXON STUDY GUIDE 1 | P a g e Order the book at this link. Read it online for free at Classic Reader. Listen to a free audio version at Librivox. How to use this study guide: This Study Guide is designed to be used in a variety of situations by teachers, homeschool families or in a homeschool co-op or class setting. It may be used by an individual student or a group of students. It’s suitable for upper elementary and high school (as well as parents who would like to learn along with their children!). I like to read stories like this one aloud to my children, and then have everyone participate in the discussions and activities (according to their ages and abilities). We typically read 1-2 chapters per day (or listen to a quality audio version), look at and mark up the maps, visit a link or two, watch a video clip, or explore other books. Use the RESEARCH AND DISCUSSION sections for further research and fun activities. VOCABULARY WORDS: many of these are medieval terms and may not be easily found in modern dictionaries. For these, an online search with the word “medieval” in front of it will help. Example: “What is a medieval prelate?” By the way, this is a perfect time to learn the spelling of MEDIEVAL. Not every chapter has extensive research topics or vocabulary words. This study guide is not meant to overwhelm with frivolous content. I want every rabbit trail to be fun and to open the mind of students to more excitement and interest! INTERNET LINKS: I have worked to find links that include factual information, enticing illustrations, and family-friendly content. -

Gene Nlo £;I Cal Sket Cli
Gene nlo £;i cal sket cli..... 11 !I'he first Woodward lmovm in nistory11 WOOD YI.ARD I !c.t!ERO!l ROY.AL C C:1licago?l898?l PHOTO, GIBSON, 1898 HALF•TONE ENG, BY O. KOHN THERON ROY AL WOODWARD CHICAGO, ILL. GENEALOGICAL SKETCH. THERON ROYAL10 WOODWARD, b. Clarendon, Vt., May 2.:5, 1848. Son of John Perkins9 Woodward, b. Hancock, Vt., July 11, 1822, d. Kingston, Wis., Nov. 26, 1879 (Zelotes," Beniah,7 Nathan,~ Benajah,6 Israel,' John,3 Nathaniel,:' NathanieP), and Marytl Dodge, b. Starksboro, Vt., June 27, 1826, d. Kingstoi1, . 1 Wis., Dec., 25, 1890 (Joel/ Joel/ Rev. Jordan/ John/ John,=' Israel,2 Tristran1 ). Married, 1st, Kingston, Wis., Jan. 18, 1877, Anna Elizabeth' Stevens, b. Kingston, Wis., Feb. 26, 1856, d. Kansas City, Mo., 1 1 Aug. 12, 1883, daughter of Mortitner Wi11slow= Stevens (Henry B:!., Asa ) b. Aug. 31, 1817, d. July· 18, 1901, and Harriet Valentine; n1.,. 2nd, Oconomowoc, Wis., Sep. 26, 189-1-, Mrs. Estelle10 (Clark) King, of Chicago, b. Barre, Mass., May 31, 1864, daughter of Entory Augustus!' Clark, b. March 8, 1839 (Anson/ Luther/ John/ Capt. John,5 Isaac,' John,=' John,2 Hugh1 b. 1613), and Caroline Elizabeth3 1 Haskins (Nathan,2 Nathan ), h. North New Salen1, Mass., Sep. 28, 18 .. p. l\frs. Woodward ,vas the widow of Dewello J. King, b. Feb. 26, 1853, d. May 30, 1892. By hint she had Ethel Clark King, b. July 10, 1892, d. Feb. i, 1899. Mr. Woodward re111oved with his parents front Rutland, Vt., to Kingston, Wis., April, 1855. In 1869 he entered the transportation business in Chicago, and remained in it until 1883, when he beca111e connected with the Kansas City Daily Tiines. -

Stylistic Variation and Roman Influence in the Bayeux Tapestry
Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture Volume 2 Issue 4 51-96 2009 Stylistic Variation and Roman Influence in the Bayeux Tapestry Gale R. Owen-Crocker University of Manchester Follow this and additional works at: https://digital.kenyon.edu/perejournal Part of the Ancient, Medieval, Renaissance and Baroque Art and Architecture Commons Recommended Citation Owen-Crocker, Gale R.. "Stylistic Variation and Roman Influence in the Bayeux Tapestry." Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture 2, 4 (2009): 51-96. https://digital.kenyon.edu/perejournal/vol2/ iss4/4 This Feature Article is brought to you for free and open access by the Art History at Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture by an authorized editor of Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. Owen-Crocker Stylistic Variation and Roman Influence in the Bayeux Tapestry By Gale R. Owen-Crocker, University of Manchester Introduction It is generally assumed that the Bayeux Tapestry is to be read as a continuous, historical narrative and that it is the work of a single artist, consistently executed. The subject-matter is largely heroic: it deals with kingship and battle, oath and betrayal; it includes scenes of courage and carnage, a rallying eve-of-battle speech and two grand feasts; its chief actors are men of the ruling class, supported by their attendants and knights. The visual effect of the frieze (a point not previously, as far as I know, observed by scholars) exhibits, in general, a rhythmic alternation of the horizontal and the vertical: scenes of motion, in which long-bodied horses and dogs, ships, even King Edward’s funeral cortège, are juxtaposed with static scenes where the protagonists confront one another, or where the forward impetus of the frieze is stopped by a building, a tree, or a hill.