Université Du Québec
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Genealogy for Canadian, French and Metis Study
Canadian-American JOURNAL of History & Genealogy for Canadian, French and Metis Study Publication of the Northwest Territory Canadian & French Heritage Center #3 Spring 1996 ISSN 1075-2366 Contents lntter Fmn~The Editor 102 Baptismal Records 1835- 1887. LaPointe and Bayfield Indian Missions (part 7) . 103 John L. Schade Dictionary of History of the Canadians and the French Metis of the West (part 2) . 117 Fonnd In Other Periodicals . 127 Collection llpdate . 133 Queries 137 Book Reviews 143 Surname Index 1 47 Copyright 6 1996 Northwest Territory Canadian & French Heritage Center Photocopyine. in any manner is prohibited, as is any form of data retrieval. Arlnl~alindex in GPAI (Genealogical Periodical Annual Index, 'I'owle) and in PERsi. U.S. Subscription Rates $14.00 for 4 issues, $26.00 for 8 issues Canadian addresses $15.00 (4 issues), $28.00 (8 issues) US fonds Renewals and new subscriptions, please make checks payable to NWTC&FHC One free query per issue to subscribers. Advertisemenis are $1.00 per typewritlen line, $5.00 minimum. Submit typed copy exactly as it is to appear. Change of Address notification should be sent immediately. You will be billed for remailing charges if nolice was not sent. All correspondence, Queries, Exchange Periodicals, Books for Review and orders for back issues of Lost In Canada? or this Journal should be mailed to: NWTC&FHC, P.O. Box 29397, Brooklyn Center, MN 55429-03997 Canadian-Ameriemn JOURNAL or History & Genealogy for Cenadlen, French & Metls Study 101 Letter from the Staff Two letters arrived since the last issue was mailed that said esser~liallythe same thing. -
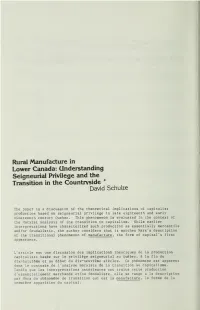
Rural Manufacture in Lower Canada: Understanding Seigneurial Privilege and the * Transition in the Countryside David Schulze
Rural Manufacture in Lower Canada: Understanding Seigneurial Privilege and the * Transition in the Countryside David Schulze The paper is a discussion of the theoretical implications of capitalist production based on seigneurial privilege in late eighteenth and early nineteenth century Quebec. This phenomenon is evaluated in the context of the Marxist analysis of the transition to capitalism. While earlier interpretations have characterized such production as essentially mercantile and/or feudalistic, the author considers that it matches Marx's description of the transitional phenomenon of manufacture , the form of capital's first appearance. L'article est une discussion des implications theoriques de la production capitaliste basee sur le privilege seigneurial au Quebec, a la fin du dix-huitieme et au debut du dix-neuvieme siScles. Ce phenomene est apparent dans le contexte de l'analyse marxiste de la transition au capitalisme. Tandis que les interpretations anterieures ont traite cette production d'essentiellement marchande et/ou feodaliste, elle se range a la description par Marx du phenomene de transition qui est la manufacture , la forme de la premiere apparition du capital. * Theory: The transition The nineteenth century saw the emergence of industrial capitalism in Quebec (Lower Canada); that much is acknowledged by any historian of the period. This implied a transition from a predominantly rural society specializing in agricultural production to a predominantly urban one, characterized by industrial production. Marxist analyses -

La Mixité Culturelle Au Sein Des Élites Québécoises Au Xixe Siècle : L'exemple De La Famille Marchand, 1791-1900
La mixité culturelle au sein des élites québécoises au XIXe siècle : l’exemple de la famille Marchand, 1791-1900 Mémoire Alex Tremblay Maîtrise en histoire Maître ès Arts (M. A.) Québec, Canada © Alex Tremblay, 2014 Résumé Ce mémoire met en lumière la mixité culturelle au sein des élites québécoises entre 1791 et 1900 en se penchant sur une de ses dimensions les plus intimes : la famille. En nous penchant sur l’exemple de la famille de l’ancien premier ministre Félix-Gabriel Marchand, nous montrons que ces couples s’inscrivent dans les mêmes stratégies de reproduction sociale que les élites endogames. Toutefois, la mixité les amène à revoir les structures familiales et à adopter une culture mixte qui n’est pas très éloignée de chacun des deux milieux. En effet, les élites partagent une culture commune tout en ayant leurs particularités à cette époque. En nous appuyant essentiellement sur la correspondance de cette famille et, dans une moindre mesure, sur le journal intime de Joséphine Marchand, nous montrons également que les enfants nés de ces unions adoptent rapidement la culture d’un des deux parents – dans ce cas-ci, celle du père. Cependant, cela ne les empêche pas de conserver une plus grande ouverture au groupe ethnolinguistique duquel est issu leur second parent et de s’imposer comme un pont entre ces deux communautés. iii iv Table des matières RÉSUMÉ III TABLE DES MATIERES V LISTE DES TABLEAUX VII ABRÉVIATIONS VII REMERCIEMENTS XII INTRODUCTION 1 I. HISTORIOGRAPHIE 3 I.1 RELATIONS ENTRE LES ANGLOPHONES ET FRANCOPHONES 3 I.2 L’HISTOIRE DES FAMILLES MIXTES AU QUÉBEC 5 I.3 HISTOIRE DES ÉLITES 9 II. -

Petit Métis a Toute Une Histoire!
Produced by our volunteers / Produit par nos bénévoles ‘Little’ Metis has a lot of history! Petit Métis a toute une histoire! The history of Metis is a colourful tapestry of interwoven threads L’histoire de Métis est une tapisserie colorée de fils entrelacés tirés drawn from First Nations, Scottish, French, Métis, Irish, English and des Premières Nations, des Écossais, des Français, des Métis, des more! It is home to permanent residents, and summer residents with Irlandais, des Anglais et bien plus encore! On y retrouve des résidents ties to Montréal, Quebec City, and parts elsewhere. A small spot on permanents et des résidents d’été ayant des liens avec Montréal, a map, Metis is linked to some big names in Canada’s history. Québec et d’autres parties du pays. À peine un petit point sur une carte géographique, Métis n’en est pas moins étroitement liée à de There are different thoughts about the source of the name grands noms de l’histoire du Canada. Metis (Mitis). Il y a différentes hypothèses possibles sur l’origine du nom • Mitioui, a native word for ‘’meeting place’’ at the mouth of the Métis (La Mitis). Mitis River—an important place where First Nations congregat- • Mitioui, un mot autochtone pour « lieu de rencontre » à l’em- ed to trade with each other and possibly exchanged wares bouchure de la rivière Mitis, un lieu important où les Premières with the French; nations se réunissaient pour commercer entre elles et peut-être échanger des marchandises avec les Français. • Mitisk, Mi’kmaq for ‘little birch’, due to the plentiful birch trees at the mouth of the Mitis River (or in the Malecite language, • Mitisk, pour « petit bouleau » dans la langue micmac, en raison ‘little poplars’); de l’abondance de bouleaux à l’embouchure de la rivière Mitis (ou dans la langue malécite, « petits peupliers »). -

The History of “Metis” - Louise Lapierre
The English-SpeakingSpecial Community edition of the Lower Saint Lawrence Spring 2014 By the Secondary 1 & 2 students of Metis Beach School The History of “Metis” - Louise Lapierre here are three main theories that try to After John Macnider’s death the Mitis Seigniory di$erence is the language. On the “Metis Beach Texplain the origin of the name Métis. !ese was divided into two distinct parts: Grand Metis side” it was more of an anglophone community can be summarized in three words: moitié, and Little Metis. Both of these names come from and on the “Les Boules side” it was more franco- Mitisk and Mitioui (pronounced Metiw). the same root name: Mitis, and Little Metis even- phone. For a short period of time, before Metis tually renamed Métis-sur-Mer, even though most Beach School and L’Envol school made e$orts to !e "rst of the three, moitié is a French term English speakers have tradi- connect, there was very little meaning half. Some people believe that the "rst tionally called it Metis Beach. understanding and collabora- French explorers of the region gave it that name “It’s a small town for tion between the two schools. while navigating. !is is thought to be because Metis has attracted visitors Now, both schools collaborate Metis is located halfway between Gaspé and for a long time because of a lot of history” on a constant basis and share Quebec. the air, its rich geological facilities, programs and proj- composition, the presence ects, helping kids from both !e second theory refers to the name Mitisk, of the river, the beach, "shing, hunting and schools connect with each other and have access which means birch tree in Mi’kmaq since there boating, among others. -

Reference Department
TORONTO PUBLIC LIBRARY. Reference Department THIS BOOK MUST iIIOT BE TAKEN OUT Of THE ROOM . • ~. /' Eu_gY;I: 't'cL ".y E. Ht·,u."t.-../ --v / ../ \ \ / \ \ < / // \ / \ 100 0 <: "at~ o:f Ee En_gl-;l r (l tJ)' b. B I'"" C't . -../ \ ../ \ \ \ \ i \ \ / • F ,. In.: (L J' () \ \ \ / / \ / '\1'" t / \ • / • !rUE QUEBEC DIRECTORY, ~c. THE ~ utbtt IJfrttforYt, FOR 1'8Q~; COrNTAlNING AN A-LPHABETICAL LIST OF TIrE MERCHAN'.l'S, TRADERS,- AND· HOUSE KEEPERS, &c. WITHIN THE CITY, TO WHICH' IS PREFIXi:D A DESCRIf'TIVE SKETCH OF THZ TOWN 'JlOCETI'lER WITH ·AN APPENDIX CONTAINING AN ABSTRAC'£ OF THE llEG rlLATIOSS OF POLICE" <-Ye. "'c~ BY THOMAS HENRI GLEASON~ PRICE, SIX AND 'DHREr PENCE.; QUEBEC: J'RINTED BY. NEILSON AND COWAN, PRINTl!;RS AND EOOICSIl:LIRs', NQ. 15, MOUN·TJ\IN STREET. 18~2. ~ablt of Utfttttttt. --»fgj'.€-c€!-="'- 1. Gun Boat Wharf. A. Castle of St. LOllis. ~. Symes' Wharf. B. Bishops' Palace &c. 3. Heath & Moir. C. Court House, 4. Cape Diamond Brewery. D. English Cathedral. 5. Joncs' Wharf. E. French Cathedral. fi. Andersons' do. F. Seminary:. 7. Irvines' do. G Hotel Dieu Nunn~rY, 8. Finlays' do. Church and Gardens. - 9. King's Wharf and Stores. H. U"sulines do. do. do. 10. Brunettes' Wharf. I. Jesuit's Barrack, and Dl"ill 11. Queens' do. Ground. 12. IVI'Callums'do. K. Presbyterian Church. 1:;. Pattersons' do. L. Gaol. 14. Goudies' do. M. Commissariat Office. 15. Bells" do. N. Con:rreganiste Church. 16. Quirouet,' Brewery. O. King's Works Office. 17. Dumas Wharf. P. St. Louis St. Barrack &c. 1 R. -

Behind the Name…
Behind the Name… Shakespeare said: ‘What’s in a name? A rose by any other name would smell as sweet…”. Well, Metis’s wild roses certainly do smell sweet, but we think that place names at least do have special meanings to people who grew up in an area. Local residents provide the most useful geographical reference system referring to a place, a piece of land, or a natural landmark. The consistency and accuracy of names used becomes essential in referring to a place or landmark, which helps to prevent confusion in a specific area. Whether it be verbal or written, past or present, place names of lands, bodies of water, or landmarks connect us to each other and to our past. The names also may evidence an event in certain places, as well as providing generations with a link to folklore tales and legends that have been passed down – narratives that explain the origins of place names in a community. Although today the origin of many place names is now forgotten, it is often possible to establish likely meanings through consideration of early forms of ancestors' names. This summary has been prepared from sources to be reliable; if you have additional information or corrections, please contact Pam Andersson, Heritage Lower Saint Lawrence Community Liaison & Archive Coordinator, [email protected]; (418) 936-3239, ext. 221. Place Names of Lands Land is a particular geographical location of ground with reference to its nature or composition. Some can be seen from a distance and the name describes the place, while others have a less visible, but no less significant historical event behind their name. -

Le Radicalisme Tory À Travers Le Prisme Du Montreal Herald Et La Mobilisation Des Milices Dans Le District De Montréal (1834-1837)
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL LE RADICALISME TORY À TRAVERS LE PRISME DU MONTREAL HERALD ET LA MOBILISATION DES MILICES DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (1834-1837) MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN HISTOIRE PAR FRANÇOIS DESCHAMPS JUIN 2011 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le" respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs (SDU-522 - Rév.01-200G). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 dU Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication ,de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf ententé contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» REMERCIEMENTS Mes remerciements vont d'abord à ceux qui m'ont communiqué le goût de l'histoire: Maurice Séguin, en tout premier lieu, lors de la session d'automne 1978 à l'Université de Montréal, puis, plus tard, à l'Uqàm, Jean-Paul Bernard, Michel Grenon et Stanley Bréhaut-Ryerson. -

Info Métis – January 2018
Français au verso January 2018 Info Métis Municipal Newsletter and Community Info www.ville.metis-sur-mer.qc.ca www.facebook.com/Metissurmer Metis will turn 200 in 2018! To celebrate Metis’ 200th anniversary, every month over the coming year, Heritage Lower St. Lawrence will publish a timeline featuring some of the key dates in the history of Metis and some historical highlights Our goal is to bring the history alive by allowing some of the early settlers and others Metissers to speak directly to you... (see p.6) th Metis’ 200 Would you like to get involved to help prepare celebrations? Concerts, exhibits, beach bonfire, golf game in period costume, maritime marathon, lighthouse story-telling, Canada Day: these are just some of the ideas on the table to be discussed and organized by the committee and community groups. Metis needs your ideas….and your enthusiasm! Please call us at 418-936-3239 /222 The first planning meeting will be held on Tuesday, January 9 at 7p.m. at the Centre des loisirs -Everyone is welcome! Table of Contents Heritage LSL & Library 2 Metis 200 6 Our Entrepreneurs 9 Health 3 Community services 8 Active Living 10 Community Activities 4 For Sale/Rent/Found/Wanted 8 Municipal Affairs 11 DEADLINE: 15th of the month if the text has to be translated; 20th of the month if it is provided in English and in French -in Word format. Please contact Marie-Claude Giroux at 418 936-3239 #223 www.heritage.ca | www.facebook.com/heritagelsl or by email at [email protected] Heritage Lower Saint Lawrence & Library HERITAGE CULTURAL RESOURCE CENTRE 130 rue Principale, (418) 936-3239 or 1-855 936-3239 OFFICE HOURS: Monday to Friday, 9 a.m.-noon & 1-4:30 p.m.* *PLEASE NOTE THAT OUR OFFICES ARE ALWAYS CLOSED TUESDAY MORNINGS LIBRARY SERVICE HOURS: Monday to Friday : 2 - 4 p.m. -
Fonds Famille-Macnider (1794-1970) Boîte 1
Fonds Famille-Macnider (1794-1970) Boîte 1 Chemise 1 : Documents divers (1794 – 1806) -Lettre manuscrite adressée de Kilmarnock (Écosse) par William Macnider à son fils John, marchant de Québec + retranscription manuscrite et photo de la lettre en n&b (20 mars 1794). -Lettre manuscrite adressée de Kilmarnock (Écosse) par William Macnider à son fils (4 avril 1795). -Lettre manuscrite adressée de Kilmarnock (Écosse) par Anna Macnider à son fils John, marchand de Québec + retranscription (17 mars 1798). -Retranscription dactylographiée d’un acte de vente d’un terrain par Magdelaine Pinguet à Mathew Macnider (29 mai 1802). -Lettre manuscrite adressée de Ayr à John Macnider, marchand de Québec, par sa fille Margaret (11 août 1806). -Texte dactylographié de l’inscription de la tombe des Macnider à l’Église St. Matthews de Québec (Susannah Macnider et ses filles Mary Evans et Susannah Ann) (non daté). -Note manuscrite sur les ancêtres d’Angelica Stuart (Ross), épouse de John Macnider (non datée). -4 pages d’un texte dactylographié intitulé « La famille de Peiras » (non signé, non daté). -3 pages d’un texte dactylographié intitulé « Macnider Seigneury » + copie (non signé, non daté). Chemise 2 : Documents divers (1807-1817) -Lettre manuscrite adressée par Eliza Macnider à son père John Macnider de Québec (29 janvier 1807). -Lettre manuscrite (avec fragments du sceau de cire) adressée de Ayr par Ellen [Maclure ?] à John Macnider de Québec (2 août 1807). -Lettre manuscrite adressée de Québec par [John ?] Macnider à sa fille Margaret (20 octobre 1807). -Lettre manuscrite adressée de Londres par [John ?] Macnider à l’un de ses enfants (3 janvier 1810). -

Étude De Potentiel Archéologique Mrc De La Matapédia
ÉTUDE DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE MRC DE LA MATAPÉDIA Avril 2014 ÉTUDE DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE MRC DE LA MATAPÉDIA Avril 2014 ÉTUDE DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE MRC DE LA MATAPÉDIA Étude présentée par : Ruralys 1650 rue de la Ferme Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec) G0R 1Z0 Téléphone : 418-856-6251 [email protected] www.ruralys.org Avril 2014 RÉSUMÉ La MRC de La Matapédia occupe un emplacement stratégique entre la baie des Chaleurs et le fleuve Saint-Laurent. C’est pourquoi, à l’époque où l’Empire britannique craignait une invasion de sa colonie nord-américaine par les États-Unis, elle a jugé bon d’y aménager une voie d’accès que pourraient emprunter ses troupes. Sur de longs segments, le tracé de cette route se superposa à l’emprise d’un sentier de portage façonné par les Amérindiens, probablement depuis des millénaires. L’ouverture de cet axe de circulation au début des années 1830, le chemin Kempt, permit la colonisation de ce terroir, mais cette dernière a tardé. En effet, il a fallu attendre l’essor de l’industrie forestière à partir des années 1860, pour que des familles s’y installent et qu’enfin naissent des villages dans la région. L’apport de l’histoire de la MRC de La Matapédia à celle du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et du Québec est indéniable. Toutefois, et contrairement à bien d’autres territoires limitrophes, aucun site archéologique n’y a été localisé à ce jour. Pourtant, son terreau aurait déjà dû révéler la présence de vestiges d’occupations amérindiennes aussi anciennes que 10 000 ans AA et d’établissements eurocanadiens des 18e et 19e siècles. -

The Quebec Almanack, and British American Royal Kalendar
THE ©uciw fUma. CONTENTS, ).MfttON Notes and Calen-(Sch.*.l 2 and Schoolman 0dar, p. 1 to 31; > Jfcc. Diameter of the Planets, 32! 'tide Table, Equation Table PUBLIC & CHAHIT/ T ' and Chronological Table, w3 ! H&T 1 TI T I O N S . Remarkable Event* of uurV^Uf.the District »f Quebec, 1 ' own times, 3-i' Do. cn'hrce-IL c.3, T3* I Do. of Montreal, lo a CIVIL LIST OF LOWER-.'fVeenji! m-v 139 CANADA. JSchotiaastetf under 41st Ottvernor, 4,cgis*ature and Geo 3d, 1*0 , | v Executive Council, Public- . Officers and Commission. , ! M1LIT.W BLISTER firs, / X-m ^OR EIHfISH NORTH Courts of Justice, f 57.‘: A‘ v " - m--<m_ ^ w -wjjkiauV tiAt'ces pL the Peace ,? The Carnet ji * An vacates, l % \ ov a- Sc; ti«J| Nerv,-Brun.<* Public Notaries, wiefc ami ft eir Depend . Sur/ eye ’’Tre eMqij Rdipyuda, New* i Physic: anvapd Surg^rrs, 79* ftundLnt!;‘fic. - la? Trinitv Hott»u,Pilol^ Rates. ' £X Officers < the Custom*, APPENDIX. G«ieta3 poet * Ovkier 9 Geographicalr Description V * of the World, ’ | 17C , ECCI.DST \STIPAL STAT;>Account of Great Bflttvn, ITS * Op THE/ A> ADAS. List of H is Majesty * M\, %learfcr*>f toe Cl ah x^Ei.c niters, 175 lart.i, v^dd Rings of England, 17 r C’*r"v jiLfae C'.iixr- nf iGoi'crnors since 1663 17 Ju>r wuu I> and ; AN ACCOUNT of CAN A * lErirbaigrthe (T. State <1C: fl7 CteT^writoe Church ( ourt Terms. • iU9, Scotland,. IMLii** ot Baihffii, ' WesUfyip *oo- \Yeights ana Kates pf Cur- nw^i f * ujujIPr dtish | rent Coin, 2li T ConfrWro* I15jLn.lt to ti\jn oue Current'y f The sani£*v < ar.noctjan to another, *'13 \ with X 4 .gfArtQiat*» (Interest Table, iv> |l ' 115 Roads and Distances, &c li<} Bar*’»t Ministers in Upper- jTable of Duties payable ot j >< )uel ’ e? ^:^" - « — * .1 .