Togo Nov2006.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PDF Et Devra Faire L’Objet De Publication Tant Dans Le Pays Que Sur Le Site Infoshop De La Banque Mondiale
REPUBLIQUE TOGOLAISE Public Disclosure Authorized Travail-Liberté-Patrie ---------- MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE (MEPS) Public Disclosure Authorized PROJET EDUCATION ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL (PERI 2) ------- Public Disclosure Authorized CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) Version actualisée Public Disclosure Authorized Janvier 2014 PERI 2 CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE Sommaire LISTE DES TABLEAUX ..................................................................................................... iv LISTE DES FIGURES .......................................................................................................... iv LISTE DES ANNEXES ........................................................................................................ iv LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES .............................................................................. v EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................. vii RESUME DU CGES .............................................................................................................. x 1. INTRODUCTION ........................................................................................................ 1 1.1. Contexte et justification ............................................................................................... 1 1.2. Objectif du cadre de gestion environnementale et sociale ........................................... 2 1.3. Méthodologie .............................................................................................................. -

Pratique De L'élevage Et Évolution Du Milieu Naturel Dans La Région Des
UNIVERSITÉ DE LOMÉ FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (FLESH) ÉCOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE "Espa Langues et Cultures du monde négro-africain" Laboratoire de Recherches Biogéographiques et d’Études Environnementales (LaRBE) Thèse de Doctorat Unique de Géographie Présentée par : Abdourazakou ALASSANE Pour l’obtention du grade de Docteur de l’Université de Lomé Spécialité : BIOGÉOGRAPHIE PRATIQUE DE L’ÉLEVAGE ET ÉVOLUTION DU MILIEU NATUREL DANS LA RÉGION DES SAVANES (NORD- BIBLIOTHEQUE TOGO) ET DANS LE NORD- -OUEST DU DÉPARTEMENT DE L’ATACORA (BENIN)). Sous la Direction de : Professeur Thiou T. K. TCHAMIE Université de Lomé, Togo Monsieur Lalle Yendoukoa LARE Maître de Conférences, Université de Lomé, Togo CODESRIAComposition du jury Président : Professeur Brice A. SINSIN, Université d’Abomey- Calavi (Bénin) Rapporteurs : Professeur Thiou T. K. TCHAMIE, Université de Lomé (Togo) M. Lalle Yendoukoa LARE, Maître de Conférences, Université de Lomé (Togo) Examinateurs : Professeur Nestor SOKPON, Université de Parakou (Bénin) M. Mondomssiba Kossi BADAMELI, Maître de Conférences, Université de Kara (Togo) M. Komlan BATAWILA, Maître de Conférences, Université de Lomé (Togo) Samedi 03 décembre 2011 DÉDICACE A MON PÈRE ET A MA MÈRE QUI ONT BEAUCOUP SOUFFERT POUR MA RÉUSSITE ; A MES ENFANTS ET A LEUR MÈRE QUI, A PLUSIEURS REPRISES, ONT SUPPORTÉ MON ABSENCE DURANT PLUSIEURS MOIS ; CE TRAVAIL EST LE FRUIT DE LEUR EFFORTBIBLIOTHEQUE ET DE LEUR PATIENCE. - CODESRIA I In addition to all these ; there are also the harsh climatic conditions. This situation raises a question: ‘What can be the state of the plant cover and the natural environment?’ Our work is an attempt at answering the forgoing question. -

Ngo Assessment in Togo
NGO ASSESSMENT IN TOGO: Institutional and Technical Capability Assessement of Non-Governmental Organizations Active in the Health and Population Sector in Togo prepared by: Franklin Baer Eileen McGinn Arthur Lagacd in collaboration with Samuela Bell October 1993 ACKNOWLEDGEMENTS The Phase II NGO Assessment team expresses its sincere thanks to OAR/Togo for its warm hospitality and assistance in conducting this study. A special thanks to Samuela Bell for her Phase I inventory of NGOs which was certainly the richest resource of information for the Phase II team. Thanks also to Sara Clark, John Grant, Karen Wilkens and Barbara McKinney with whom the team worked most closely. The team also acknowledges the devoted hard work of the many NGOs - large or small, national or international, urban or rural - who are working tirelessly throughout Togo to improve the health and well being of the Togolese population. The assessment team hopes that the projects proposed by this report will rapidly develop into practical interventions. EXECUTIVE SUMMARY: NGO ASSESSMENT IN TOGO 1. Assessment Title: Istitutional and Technical Capability Assessment of Non-Govemmenta' Organizations Active in the Health and Population Sector in Togo 2. Objectives: The objectives of Phase II of the NGO assessment were to: " Select a sample of NGOs for in-depth assessment; " Assess the institutional capabilities of these NGOs in HPN sector; " Identify activities NGOs wish to sustain, expand or initiate in the areas of health services, family planning/HIV, and cost recovery/drug supply; * Identify NGOs capable of contracting with OAR/Togo; and * Identify options & modalities for AID assistance to NGOs. -

Analysis of the Technical and Sanitary Constraints of the Traditional Breeding of Guinea Fowl in “Région Des Savanes” of Northern Togo
Journal of Pharmacy and Pharmacology 6 (2018) 77-87 doi: 10.17265/2328-2150/2018.01.009 D DAVID PUBLISHING Analysis of the Technical and Sanitary Constraints of the Traditional Breeding of Guinea Fowl in “Région des Savanes” of Northern Togo Yao Lombo 1, 2, Kokou Tona 2 and Bèdibètè Bonfoh 1 1. Centre de Recherche Agronomique de la Savane Sèche (CRASS), Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA), Lomé BP 1163, Togo 2. Laboratoire des Sciences et Techniques de Production Avicoles, Centre d’Excellence Regionale des Sciences Aviaires (CERSA), Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA), Université de Lomé, Lomé BP 1515, Togo. Abstract: A survey to determine the causes of mortality of guinea fowl and the technical and sanitary constraints of the traditional breeding of guinea fowl was carried out among 106 poultry farmers from the Savannah Region in North Togo. The survey also made it possible to identify the breeding constraints and the endogenous practices of rearing of the guinea fowl. The results obtained from the investigations are: (i) the high rate (69.81%) of illiterates is not conducive to the definition or control of plans for prophylaxis and rationing. (ii) Breeders are unaware of disease-resistant strains of guinea fowl. (iii) Guinea fowl breeding starts with traditional methods, with 33.96% of the breeders who leave the guinea fowl in the wilderness and 13.21% who breed them in conflagration pell-mell. (iv) The formulations of food rations in order to satisfy the nutritional requirements of guinea fowl are virtually non-existent. The sources of proteins sometimes supplemented are only termites. -

TOGO Juillet 2016
TOGO Juillet 2016 Zones et descriptions de moyens d’existence Le présent document a été élaboré avec l’aide de l’Union Européenne. Le contenu de ce document relève de la responsabilité de son auteur et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union Européenne. 0 Table des matières REMERCIEMENTS .................................................................................................................................. 2 ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS ...................................................................................................... 3 INTRODUCTION...................................................................................................................................... 4 LA METHODOLOGIE DU ZONAGE DES MOYENS D’EXISTENCE ............................................... 5 CONTRAINTES DE L’EXERCICE DE ZONAGE .................................................................................. 9 SURVOL DES ZONES DE MOYENS D’EXISTENCE AU TOGO ..................................................... 10 CHRONOLOGIE HISTORIQUE DES ALEAS AU TOGO ................................................................. 13 DESCRIPTIONS DES ZONES DE MOYENS D’EXISTENCE ........................................................... 14 ZONE TG01 Hautes terres : café-cacao, fruits et céréales ............................................................... 14 ZONE TG02 CENTRE: céréales, tubercules, anacarde-soja ............................................................. 17 ZONE TG03 Centre-nord: igname, élevage, -

Etude Morphopédologique Du Nord Du Togo À 1/500
Etude morr>hor>édoloaiaue du nord du Togo Ù 1/500 O00 Roland POSS Pédologue Orstom Éditions de I’Orstom INSTITUT FRANçAIS DE RECHERCHEPOUR LE DÉVELOPPEMENT EN COOPÉRATION Collection notice explicative no709 Paris 1996 Fabrication - coordination : Elisabeth LORNE Maquette de couverture : Michèle SAINT-LÉGER Photo de couverture : RolandPOSS. Plaine de la Fosseaux Lions en contrebas desgrès de Bombouaka. La loi du lsrjuillet 1992 (code dela propriété intellectuelle, première partie) n'autorisant,aux termes des alinéas 2 et 3 de L. 122-5, d'une part, queles It copies ou reproductions strictement réservéesà l'usage du copisteet non destinées à une Utilisation collective II et, d'autre part, que les analyseset les courtes citations dans le but d'exemple et d'illustration,'I toute représentation OU reproduction intégraleOU partielle faite sansle consentementde l'auteur ou de ses ayants droitou ayants causeest illicite " (alinéa ler de l'article L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon passible des peines prévues au titre 111 de la loi précitée. O Orstorn éditions, 1996 ISBN2-7099-1 178-7 INTRODUCTION Cette étude morpho-pédologique du nord du Togo comble un vide dans le vaste travail de cartographie pédologique à moyenne échelle réalisé par I’Orstom depuis 1960. La zone étudiée couvrela partie du territoire togolais située au nord du10e parallèle et à l’ouest des reliefs atacoriens (fig. 1). Elle est limitée à l’ouest par le Ghana, au nord par le Burkina-Fasoet à l’est par le Bénin. Elle rejoint au sud la carte à U100 O00 de Bassar (LE COCQ, 1986), à l’est les cartes dela région de la Kara à 1/50 O00 (FAURE, 1985) et de Natitingou à 1/200 O00 (FAURE, 1977), et au nord la carte du sud du Burkina Faso à V500 O00 (BOULET et LEPRUN, 1969). -

(Deuxieme) Sur Le Projet D'approvisionnement En Eau
Direction Générale de l'Eau et de l'Assainissement Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise République Togolaise RAPPORT DE L’ETUDE PREPARATOIRE (DEUXIEME) SUR LE PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL ET SEMI-URBAIN DANS LES REGIONS MARITIME ET SAVANES EN REPUBLIQUE TOGOLAISE NOVEMBRE 2011 AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE SANYU CONSULTANTS INC. GED JR 11-194 Avant-propos L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a décidé de mener une Etude préparatoire à la coopération pour le Projet d'approvisionnement en au potable et assainissement en milieu rural et semi-urbain dans les régions Maritime et Savanes en République Togolaise, et à confié son exécution à Sanyu Consultants Inc. La mission d'étude s'est rendu au Togo de décembre 2010 à novembre 2011 pour des discussions avec les personnes concernées du gouvernement togolais et pour effectuer une étude sur place dans la zone du projet, et a compilé le présent rapport suite aux travaux après son retour au Japon. Nous souhaitons que le présent rapport contribue à la promotion de ce projet, voire au développement des relations amicales entre les deux pays. Pour terminer, nous voudrions exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes qui nous ont soutenu en collaborant à cette étude. Novembre 2011 Shinya EJIMA Directeur Département de l’environnement mondial Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) Résumé (1) Présentation générale du Togo La République Togolaise (ci-après désignée "le Togo") a une population totale de 5.750.000 habitants, et son territoire national de 56.785 km2 est divisé de biais en son centre par le massif montagneux de l’Atacora qui s’étire du nord au sud. -

Le Peuplement Du Togo : État Actuel Des Connaissances Historiques
UNIVERSITE DU BENIN (Lomé) DEPARTEMENT D'HISTOIRE LE PEUPLEMENT DU TOGO ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES HISTORIQUES SO IiS la direction du Profe seur Nicoué Lodjou GA YIBOR ~p-hF.~ ~r~\ ~ { ~ -t e c r Les Presses de l'US " UNIVERSITE DU BENIN (Lomé) DEPARTEMENT D'HISTOIRE LE PEUPLEMENT DU TOGO ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES HISTORIQUES Directeur de publication: Professeur Nicoué Lodjou GA Y/BOR Les Presses de l'UB L'Agence de la Francophonie (ACCT) a contribué à la publication de cet ouvrage. Les noms de lieux ou de personnes et leurs orthographes, les jugements de valeurs sur les hommes et les faits, les opinions, constatations, interprétations et conclusions exprim ées dans cet ouvrage sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de l'Agence de la Francophonie ou des pays qui en sont membres. Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Agence de la Francophonie aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant à leurs frontières ou limites. L'Agence de la Francophonie ne garantit pas l'exactitude des données figurant dans la présente publication et n'accepte aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utilisation. @ Les Presses de l'UB ISBN 2-9D9886-31-X Lomé, 1996 LISTE DES CONTRIBUTEURS Sous /a direction de Nicoué Lodjou GA Y/BOR professeur à l'UB, historien M. Louis Sényon ADOTEVI, assistant, historien Mme Dola Angèle AGUIGAH, maître-assistant, archéologue M. Zingan ALlHONOU, historien Mme Zokia d'ALMEIDA-HOUNDEDOKE, historienne MM.Koti Antoine AKIBODE, maître de conférences, géographe Yawo AMOUZOUVI, maître-assistant, cartographe Jean-Claude BARBIER, chargé de recherche (ORSTOM), sociologue lébéné Philippe BOLOUVI, professeur, linguiste Adovi Nbùéké GOEH-AKUE, maître-assistant, historien Mme Chantal GUILMAIN-GAUTHIER, ethnologue, chargée d'enseignement à l'IUTB (Université de Bordeaux IV) MM. -

Pachyderm 36
January – June 2004 Number 36 ISSN 1026 2881 IUCN journal of the African Elephant, African Rhino The World Conservation Union and Asian Rhino Specialist Groups January–June 2004 No. 36 1Chair reports / Rapports des présidents 1African Elephant Specialist Group / Groupe des Spécialistes des Eléphants d’Afrique S PECIES Holly T. Dublin S URVIVAL C OMMISSION 8African Rhino Specialist Group / Groupe des Spécialistes des Rhinos d’Afrique Editor Martin Brooks Helen van Houten 11 Asian Rhino Specialist Group / Groupe des Assistant Editor Spécialistes des Eléphants d’Asie Pam Dali Mwagore Mohd Khan bin Momin Khan with Thomas J. Editorial Board Foose and Nico van Strien Holly Dublin 16 Research Esmond Martin Leo Niskanen 16 Monitoring law enforcement and illegal Robert Olivier activities in the northern sector of the Parc National des Virunga, Democratic Republic of Nico van Strien Congo Lucy Vigne Leonard Mubalama and Norbert Mushenzi Design and layout 30 Impact of dam construction on two elephant Damary Odanga populations in northern Cameroon Address all correspondence, Hans H. de Iongh, Martin T. Tchamba, Per including enquiries about Aarhaug and Bas Verhage subscription, to 44 Elephant numbers, group structure and The Editor, Pachyderm movements on privately owned land adjacent PO Box 68200, 00200 to Tsavo East National Park, Kenya Nairobi, Kenya Barbara McKnight tel: +254 20 576461 52 Elephants (Loxodonta africana) of Zoba Gash fax: +254 20 570385 Barka, Eritrea: Part 2. Numbers and email: [email protected] distribution, ecology and behaviour, and Web site: www.iucn.org/afesg fauna and flora in their ecosystem Jeheskel Shoshani, Yohannes Hagos, Yohannes Yacob, Medhanie Ghebrehiwet and Emun Kebrom This document has been produced with the financial 69 Impacts humains sur les aires de distribution et assistance of the European couloirs de migration des éléphants au Togo Commission. -

TOGO Travail - Liberté – Patrie
REPUBLIC OF TOGO Travail - Liberté – Patrie READINESS PREPARATION PROPOSAL (R-PP) COUNTRY: TOGO Date of submission: July 29, 2013 (revised version November 8, 2013) Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Disclaimer: The World Bank and the UN-REDD+ Programme do not guarantee the accuracy of the data included in the Readiness Preparation Proposals (R-PPs) submitted by REDD+ Country Participants and accept no responsibility whatsoever for any consequence of their use. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in the R-PPs do not imply on the part of the World Bank any judgment on the legal status of any territory, or the endorsement or acceptance of such boundaries. MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST RESOURCES Rue SARAKAWA, Quartier Administratif, Tel (00228) 22 21 28 97, Email: [email protected], LOME-TOGO TABLE OF CONTENTS GENERAL GENERAL INFORMATION ................................................................................... 6 Executive Summary ........................................................................................ 9 COMPONENT 1: ORGANIZE AND CONSULT ........................................................... 15 1a. National Readiness Management Arrangements ....................................................................... 15 1.1.1. Various actors involved in the implementation of REDD+ in Togo .......................... 16 1.1.2. The REDD+ management bodies in Togo ........................................................ 17 1b. Information Sharing and Early Dialogue -
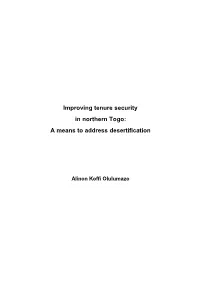
Improving Tenure Security in Northern Togo: a Means to Address Desertification
Improving tenure security in northern Togo: A means to address desertification Alinon Koffi Olulumazo ALINON Koffi Olulumazo was trained in law at the Faculté de Droit of the University of Benin and has followed a number of training courses on natural resource management. For more information about this Issue Paper and land tenure questions in Togo, please contact the author at the following address: B.P. 80677 Lomé, Togo. Fax:+228 21 89 27. E.mail: [email protected] CONTENTS INTRODUCTION 1 BACKGROUND 2 Geographical and socio-economic data 2 The gradual dessication of the Savannah Region 3 TENSIONS OVER TENURE: IS AN EXPLOSION IMMINENT? 4 Instability caused by the 1974 tenure reform 4 The ambiguity of the landholding system 8 WHAT SORT OF SECURITY FOR WHICH STAKEHOLDERS? 9 How to provide greater security of tenure 9 Pre-conditions for greater security of tenure 12 CONCLUSION 16 ANNEXE 1: MAP OF THE SAVANNAH REGION 19 ANNEXE 2: DEMOGRAPHY IN TOGO (1970-2000) 21 REFERENCES 22 i INTRODUCTION Landholding systems in Togo, as in the bulk of French-speaking countries in sub-Saharan Africa, have undergone changes as the original forms of communal tenure have been undermined, although not fatally, by the introduction of state or individual private property, followed by the beginnings of so-called modern tenure reform. One of the most important conclusions reached by research & development in the last few years has been that the confusion prevailing in respect of tenure hinders efforts to combat land degradation and to achieve efficient resource management and human development. The Convention to Combat Desertification (CCD) presents land tenure as an important issue in addressing dryland degradation. -

PROPOSAL for TOGO Increasing the Resilience of Vulnerable
PROPOSAL FOR TOGO Increasing the resilience of vulnerable communities in the agriculture sector of Mandouri in Northern Togo July 2017 DATE OF RECEIPT : ADAPTATION FUND PROJECT ID: (For Adaptation Fund Board Secretariat Use Only) PROJECT/PROGRAMME PROPOSAL TO THE ADAPTATION FUND PART I: PROJECT/PROGRAMME INFORMATION Project/Programme Category: Regular project Country/ies: Togo Title of Project/Programme: Increasing the resilience of vulnerable communities in the agriculture sector of Mandouri in Northern Togo. Type of Implementing Entity: Regional Implementing Agency Implementing Entity: Banque Ouest Africaine de Développement (West African Development Bank) [BOAD] Executing Entity/ies: Ministere de l’Environnement et des Ressources Forestieres African Sustainability Centre (ASCENT) Amount of Financing Requested: 10,000,000 (In U.S Dollars Equivalent) 1. Project Background and Context: Geographical and environmental context Togo is a West African country located between latitudes 60 and 110 north, and longitudes 00 and 1.400 east. It is bounded to the north by Burkina Faso, to the south by the Gulf of Guinea, east by Benin and to the west by Ghana. With an area of 56,600 km², it stretches from north to south over a length of 600 km in a straight line and has a width that varies between 50 and 150 km. It has a coastline of about 50 km, which opens onto the Gulf of Guinea. It is divided into five administrative regions: Savanes, Kara, Central, Plateaux and Maritime where the capital Lomé is located (Figure 1). Togo’s relief consists of rugged terrain, except for the Atakora mountain range that crosses the country in a southwest to northeast line.