La Crise D'idlib
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dynamics Old and New Drive Tunisia's Elections
Issue , Year UK £2 www.thearabweekly.com 222 5 September 15, 2019 EU €2.50 Alexandria Assad’s battles climate propaganda change tours Page 20 Page 9 Peace takes a backseat Dynamics old and new as Netanyahu moves to drive Tunisia’s elections boost electoral chances Mamoon Alabbasi calation” and called for an emergency meeting of the foreign ministers of the 57-member Organisation of Islamic London Cooperation “to discuss the serious Is- raeli escalation.” sraeli Prime Minister Binyamin Netanyahu’s announcement was Netanyahu is making a last-ditch also condemned by the United Arab push to boost his chances in the Emirates and Bahrain, which, like I September 17 Israeli elections Saudi Arabia, share Israel’s concerns but his campaign efforts appear to be regarding Iran’s role in the region. at the expense of reaching a peace deal Netanyahu informed the United with the Palestinians or forming better States before making his announce- ties with the wider region. ment on annexing the Jordan Valley The latest poll, released September and hinted that the move was sup- 12 by the state-owned Kan 11 television ported by the Trump administration. channel, predicted that Netanyahu’s Netanyahu, however, drew criticism Likud party would win 31 seats in par- from Moscow ahead of a trip to meet liament, two fewer than the figure ex- with Russian President Vladimir Putin. pected for his main rival, former mili- Netanyahu’s anti-Palestinian rheto- tary chief Benny Gantz, who heads the ric did not stop at the West Bank. Two Blue and White alliance. -

Foreign Terrorist Fighters from the North Caucasus: Understanding Islamic State Influence in the Region
Connections: The Quarterly Journal ISSN 1812-1098, e-ISSN 1812-2973 Dasha Nicolson, Connections QJ 16, no. 4 (2017): 69-88 https://doi.org/10.11610/Connections.16.4.04 Research Article Foreign Terrorist Fighters from the North Caucasus: Understanding Islamic State Influence in the Region Dasha Nicolson Abstract: At the height of the influence of the ‘Islamic State’ in Syria, it involved in its ranks approximately 30,000 foreign fighters, with about a quarter of them coming form Russia (Chechnya and Dagestan) and the for- mer Soviet Union. This article looks into the phenomenon of North Cauca- sian foreign terrorist fighters and its implications for security in North Cau- casus, the Russian Federation and world-wide. The numbers of fighters re- turning from Syria to the region are not exactly known. Yet, upon returning home, the first wave of foreign fighters has managed to secure and build upon their reputations and expand their experience, skills and networks, establishing different jamaats and, in one instance, a ‘jihadist private mili- tary company.’ Given the opportunity, the second wave will most likely fight in the Caucasus, but if unable to return home they may be motivated to strike elsewhere. Keywords: Russian, North Caucasus, Islamic State, foreign terrorist fight- ers, FTFs, antiterrorist legislation, counter-terrorist operations. We are ashamed that we are going to Syria at a time when the Caucasus is still occupied, but young people are return- ing here once they’ve undergone a training course. – BBC source, ‘close’ to Chechen boeviki Introduction In September 2014, the United Nations Security Council unanimously adopted resolution 2178 concerning the “acute and growing” threat posed by foreign ter- rorist fighters (FTFs). -

The Day That Divided Life in Kabardino
THE FIRST INDEPENDENT MAGAZINE ABOUT EVENTS IN THE CAUCASUS Editorial office in Moscow RF, 103982, Moscow, DIGEST #17 2015 per. Luchnikov 4, entr. 3, room 1. Tel. (495) 621-04-24 30 Tel./fax (495) 625-06-63 E-mail: [email protected] Editor in chief 2 "HE GOT WHAT HE DESERVED" Israpil SHOVKHALOV E-mail: [email protected] Executive Editor Abdulla DUDUEV 4 E-mail: [email protected] A TERRITORY OF LIMITED Department Offices LEGAL FORCE AND EFFECT HISTORY/HUMAN RIGHTS/SOCIETY/CULTURE Maria KATYSHEVA, Zoya SVETOVA, Lidiya MIKHALCHENKO, Inna BUTORINA, Yelena SANNIKOVA 8 OCTOBER 13th Correspondents Taus SERGANOVA (Chechnya) Marem YALKHAROEVA (Ingushetia) Mussa MEISIGOV (Ingushetia) Aida GADZHIEVA (Dagestan) 12 THE PARTICULARITIES Ali MAGOMEDOV (Dagestan) Nadezhda BOTASHEVA Over the past decade, the demo- (Karachayevo-Cherkessia) OF AN ETHNIC SENTENCE Assistant Editor graphic problem has become a Georgiy ZINGER Literary editor of Russian texts 16 Irina VASUTCHENKO HE HOPED FOR AN EARLY RELEASE NEVER major topic of discussion through- English translation by SUSPECTING IT WOULD COME IN DEATH Boris SMIRNOV out the nation. Top government Design and layout Dmitry YAKOVLEV officials and famous politicians This publication has been published since 24 WHY ARE CAUCASIANS TRAVELING 2003 and is registered with the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information TO JOIN THE SYRIAN CIVIL WAR? include this problem in their politi- Technologies and Mass Communications (Roskomnadzor). The certificate of re-registration is: PI No. FS77-46140, cal platforms, discussing it on dated August 11, 2011. Founders and publishers: 28 IN ILES TATIEV, INGUSHETIA GETS ITS Members of the Russian human numerous talk shows. -

Humanitarian Crisis in Syria: a Special Report on the Impact of Syrian Refugees in Turkey and the OSCE Region
Humanitarian Crisis in Syria: A Special Report on the Impact of Syrian Refugees in Turkey and the OSCE Region Humanitarian Crisis in Syria A Special Report on the Impact of the Syrian Refugees in Turkey and the OSCE Region International Secretariat of the OSCE Parliamentary Assembly 1 www.oscepa.org Humanitarian Crisis in Syria Special Report on the Impact of Syrian Refugees in Turkey and the OSCE region 20 November 2012 Authors Research Fellows of the International Secretariat Sarah Robin Wesli Turner Alejandro Marx Matteo De Donà Edited by Nathaniel Parry, Neil H. Simon Cover photo courtesy and copyright of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. This report is a product of the International Secretariat of the OSCE Parliamentary Assembly. It represents the views of the authors and expert sources, which are cited. This report may not be reprinted in whole or in part without the official permission of the International Secretariat of the OSCE Parliamentary Assembly. Spencer Oliver, Secretary General International Secretariat of the OSCE Parliamentary Assembly Tordenskjoldsgade 1, 1055 Copenhagen K, Denmark Tel : +45 33 37 80 40 / [email protected] / www.oscepa.org Humanitarian Crisis in Syria: A Special Report on the Impact of Syrian Refugees in Turkey and the OSCE Region Contents Introduction .................................................................................................................. 2 1. Relations between Turkey and Syria ....................................................................... -

Political and Philosophical Discourse on the Border Between the Caliphate and Terrorism – ISIS
Center for Open Access in Science ▪ Belgrade - SERBIA 2nd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences https://doi.org/10.32591/coas.e-conf.02.05059c 2IeCSHSS ▪ ISBN (Online) 978-86-81294-01-7 ▪ 2018: 59-74 _________________________________________________________________________ Political and Philosophical Discourse on the Border Between the Caliphate and Terrorism – ISIS Vladimir Stefanov Chukov University of Ruse “Angel Kanchev”, Faculty of Business and Management Received 11 October 2018 ▪ Revised 30 November 2018 ▪ Accepted 5 December 2018 Abstract The Islamic terrorism has unleashed the migration wave to Europe from the Middle East countries. On 30 June 2014 the extremist organization the “Islamic State of Iraq and the Levant” (ISIS or ISIL) has announced the establishment of a caliphate. With this act its leaders not only has shocked the region and the world, but also they challenged the contemporary Islamic theologians. As a matter of fact, “khalifa” Abu Bakar al-Baghdadi triggered the most important “takfiri”, apostatizing trend within Muslim world. They formed the dogmatic case which brought to the surface the group as a real entity which has long struggled leadership among the other terrorist formations. After the announcement of the caliphate ISIL, it abolished “Iraq and the Levant” from its name and became only the “Islamic state”, and it does claiming their uniqueness to their competitors. This terrorist organization has had a long history in Iraq. It has appeared on the map of extremist actors of still living former dictator Saddam Hussein. Its “birth date” is about 2000 and its creator is the Jordanian Abu Musaab Zarqawi. -

PERSPECTIVES on TERRORISM Volume 11
ISSN 2334-3745 Volume XI, Issue 2 April 2017 PERSPECTIVES ON TERRORISM Volume 11. Issue 2 Table of Contents Welcome from the Editors..................................................................................................................1 Articles A Mixed Methods Empirical Examination of Changes in Emphasis and Style in the Extremist Magazines Dabiq and Rumiyah .....................................................................................2 by Peter Wignell, Sabine Tan, Kay L. O’Halloran & Rebecca Lange Managing Non-State Threats with Cumulative Deterrence-by-Denial...................................21 by Charles P. Kirchofer Research Notes Tracking Radical Opinions in Polls of U.S. Muslims ................................................................36 by Veronika Fajmonová, Sophia Moskalenko and Clark McCauley The Ambiguous Effect of Population Size on the Prevalence of Terrorism ..........................49 by James M. Lutz and Brenda J. Lutz The Tranquillity Campaign: A Beacon of Light in the Dark World Wide Web ...................58 by Abdullah bin Khaled al Saud Resources Bibliography: Conflict in Syria (Part 3) .......................................................................................65 Compiled and selected by Judith Tinnes Online Resources for the Analysis of Terrorism and Related Subjects.................................108 Compiled and Selected by Berto Jongman Book Review: Shabnam J.Holliday. and Philip Leech (Eds.)Political Identities and Popular Uprisings in the Middle East (2016)............................................................................................136 -
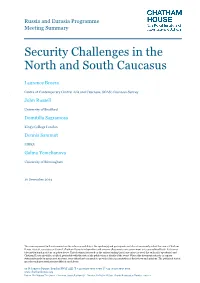
Security Challenges in the North and South Caucasus
Russia and Eurasia Programme Meeting Summary Security Challenges in the North and South Caucasus Laurence Broers Centre of Contemporary Central Asia and Caucasus, SOAS; Caucasus Survey John Russell University of Bradford Domitilla Sagramoso King’s College London Dennis Sammut LINKS Galina Yemelianova University of Birmingham 10 December 2014 The views expressed in this document are the sole responsibility of the speaker(s) and participants and do not necessarily reflect the view of Chatham House, its staff, associates or Council. Chatham House is independent and owes no allegiance to any government or to any political body. It does not take institutional positions on policy issues. This document is issued on the understanding that if any extract is used, the author(s)/ speaker(s) and Chatham House should be credited, preferably with the date of the publication or details of the event. Where this document refers to or reports statements made by speakers at an event, every effort has been made to provide a fair representation of their views and opinions. The published text of speeches and presentations may differ from delivery. 10 St James’s Square, London SW1Y 4LE T +44 (0)20 7957 5700 F +44 (0)20 7957 5710 www.chathamhouse.org Patron: Her Majesty The Queen Chairman: Stuart Popham QC Director: Dr Robin Niblett Charity Registration Number: 208223 2 Security Challenges in the North and South Caucasus This is a summary of an event held at Chatham House on 10 December 2014. At the first session, Galina Yemelianova, Laurence Broers, John Russell and a roundtable of other experts discussed regional actors and the security challenges they pose. -

The War of Jihadists Against Jihadists in Syria
MARCH 2014 . VOL 7 . ISSUE 3 Contents The War of Jihadists Against FEATURE ARTICLE 1 The War of Jihadists Against Jihadists Jihadists in Syria in Syria By Nelly Lahoud and Muhammad al-`Ubaydi By Nelly Lahoud & Muhammad al-`Ubaydi REPORTS 6 The Finnish Foreign Fighter Contingent in Syria By Juha Saarinen 10 The Narco of Narcos: A Profile of Fugitive Mexican Druglord Rafael Caro-Quintero By Malcolm Beith 13 The Caucasus Emirate: From Anti-Colonialist Roots to Salafi-Jihad By Derek Henry Flood 17 The Evolution of the Ethnic Baluch Insurgency in Iran By Chris Zambelis 21 A Profile of the Informal Anarchist Federation in Italy By Francesco Marone 25 Recent Highlights in Political Violence 28 CTC Sentinel Staff & Contacts Rebel fighters after seizing the Aleppo headquarters of the Islamic State in Iraq and the Levant on January 8, 2014. - AFP/Getty Images n february 2, 2014, al- bound by organizational ties to it and is Qa`ida released a statement not responsible for the ISIL’s actions.”2 declaring that “it has no connection” with the “group” This article discusses the context of the Ocalled the Islamic State in Iraq and the statement, its significance, its impact Levant (ISIL).1 The statement further on the jihadist landscape and concludes highlighted that al-Qa`ida was not by assessing its potential consequences responsible for founding the ISIL and on Ayman al-Zawahiri’s leadership. It About the CTC Sentinel was not privy to the deliberations that finds that al-Zawahiri’s once symbolic The Combating Terrorism Center is an led to its establishment. -

Berber-Arab Clashes in Algeria's M'zab Valley
Volume XII, Issue 3 u February 6, 2014 IN THIS ISSUE: briefs ...........................................................................................................................1 “With These Guns WE Will Return to Kurdistan”: The Resurgence of Kurdish Jihadism By Wladimir van Wilgenburg ........................................................................................4 Anti-Balaka Militias Target Muslims in the Central African Republic Algerian men from the Moz- By Nicholas A. Heras .......................................................................................................5 abites community, a Berber minority group in Ghardaia Islamist North Caucasus Rebels Training A New Generation of Fighters in Syria Terrorism Monitor is a publication By Murad Batal al-Shishani ............................................................................................7 of The Jamestown Foundation. The Terrorism Monitor is BERBER-ARAB CLASHES IN ALGERIA’S M’ZAB VALLEY designed to be read by policy- makers and other specialists yet Andrew McGregor be accessible to the general public. The opinions expressed within are solely those of the authors and The ongoing Berber cultural revival in North Africa has gone hand-in-hand with do not necessarily reflect those of a new political assertiveness. In nations such as Libya, Algeria and Mali, this has at The Jamestown Foundation. times resulted in armed clashes and protests demanding linguistic rights and political recognition of Berber (Amazigh) communities. The latest of these confrontations is Unauthorized reproduction now underway in the south Algerian oasis of Ghardaïa, where Chaamba Arabs have or redistribution of this or any clashed repeatedly with the indigenous Mozabite Berbers, forcing Algiers to send Jamestown publication is strictly security forces to restore law and order in the region. prohibited by law. Communal violence broke out in May 2013 following an alleged attempt by Chaamba Arabs to use forged property records to take over a Mozabite cemetery (Algérie Presse Service, May 8, 2013). -

Les Combattants Clandestins Russes Dans Les Groupes Armés En Syrie
FEDERATION DE RUSSIE / SYRIE 3 septembre 2018 Les combattants clandestins russes dans les groupes armés en Syrie Avertissement Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière. Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises. Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le traitement de l’information sur le pays d’origine (avril 2008) [cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ], se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations. Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e) dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence. La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel, sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Fédération de Russie : Les combattants clandestins russes dans les groupes armés en Syrie Table des matières 1. Djihadistes russophones au Moyen-Orient ............................................................. 3 2. Des groupes divisés et décimés mais encore actifs ................................................ -
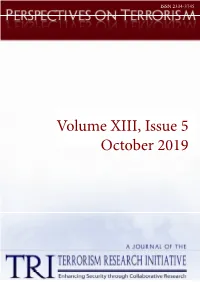
Volume XIII, Issue 5 October 2019 PERSPECTIVES on TERRORISM Volume 13, Issue 5
ISSN 2334-3745 Volume XIII, Issue 5 October 2019 PERSPECTIVES ON TERRORISM Volume 13, Issue 5 Table of Contents Welcome from the Editors...............................................................................................................................1 Articles Islamist Terrorism, Diaspora Links and Casualty Rates................................................................................2 by James A. Piazza and Gary LaFree “The Khilafah’s Soldiers in Bengal”: Analysing the Islamic State Jihadists and Their Violence Justification Narratives in Bangladesh...............................................................................................................................22 by Saimum Parvez Islamic State Propaganda and Attacks: How are they Connected?..............................................................39 by Nate Rosenblatt, Charlie Winter and Rajan Basra Towards Open and Reproducible Terrorism Studies: Current Trends and Next Steps...............................61 by Sandy Schumann, Isabelle van der Vegt, Paul Gill and Bart Schuurman Taking Terrorist Accounts of their Motivations Seriously: An Exploration of the Hermeneutics of Suspicion.......................................................................................................................................................74 by Lorne L. Dawson An Evaluation of the Islamic State’s Influence over the Abu Sayyaf ...........................................................90 by Veera Singam Kalicharan Research Notes Countering Violent Extremism -

CTC Sentinel 7
MARCH 2014 . VOL 7 . ISSUE 3 Contents The War of Jihadists Against FEATURE ARTICLE 1 The War of Jihadists Against Jihadists Jihadists in Syria in Syria By Nelly Lahoud and Muhammad al-`Ubaydi By Nelly Lahoud & Muhammad al-`Ubaydi REPORTS 6 The Finnish Foreign Fighter Contingent in Syria By Juha Saarinen 10 The Narco of Narcos: A Profile of Fugitive Mexican Druglord Rafael Caro-Quintero By Malcolm Beith 13 The Caucasus Emirate: From Anti-Colonialist Roots to Salafi-Jihad By Derek Henry Flood 17 The Evolution of the Ethnic Baluch Insurgency in Iran By Chris Zambelis 21 A Profile of the Informal Anarchist Federation in Italy By Francesco Marone 25 Recent Highlights in Political Violence 28 CTC Sentinel Staff & Contacts Rebel fighters after seizing the Aleppo headquarters of the Islamic State in Iraq and the Levant on January 8, 2014. - AFP/Getty Images n february 2, 2014, al- bound by organizational ties to it and is Qa`ida released a statement not responsible for the ISIL’s actions.”2 declaring that “it has no connection” with the “group” This article discusses the context of the Ocalled the Islamic State in Iraq and the statement, its significance, its impact Levant (ISIL).1 The statement further on the jihadist landscape and concludes highlighted that al-Qa`ida was not by assessing its potential consequences responsible for founding the ISIL and on Ayman al-Zawahiri’s leadership. It About the CTC Sentinel was not privy to the deliberations that finds that al-Zawahiri’s once symbolic The Combating Terrorism Center is an led to its establishment.