Monskkinkuk CHARLES GUAY LETTRES
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Beautiful by Nature !
PRESS KIT Beautiful by Nature ! Bas-Saint-Laurent Gaspésie Côte-Nord Îles de la Madeleine ©Pietro Canali www.quebecmaritime.ca Explore Québec maritime… PRESENTATION 3 DID YOU KNOW THAT… 4 NATIONAL PARKS 5 WILDLIFE OBSERVATION 7 WINTER ACTIVITIES 8 UNUSUAL LODGING 10 GASTRONOMY 13 REGIONAL AMBASSADORS 17 EVENTS 22 STORY IDEAS 27 QUÉBEC MARITIME PHOTO LIBRARY 30 CONTACT AND SOCIAL MEDIA 31 Le Québec maritime 418 724-7889 84, Saint-Germain Est, bureau 205 418 724-7278 Rimouski (Québec) G5L 1A6 @ www.quebecmaritime.ca Presentation Located in Eastern Québec, Québec maritime is made up of the easternmost tourist regions in the province, which are united by the sea and a common tradition. These regions are Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord and the Îles de la Madeleine. A vast territory bordered by 3000 kilometres (1900 miles) of coastline, which alternates between wide fine- sand beaches and small, rocky bays or impressive cliffs, Québec maritime has a long tradition that has been shaped by the ever-present sea. This tradition is expressed in the lighthouses that dot the coast, diverse and abundant wildlife, colourfully painted houses, gatherings on the quays and especially the joie de vivre of local residents. There are places you have to see, feel and experience… Québec maritime is one of them! Did You Know That… The tallest lighthouse in Canada is in Cap-des-Rosiers and is 34 metres (112 feet) high? Jacques Cartier named the Lower North Shore “the land of many isles” because this region’s islands were too numerous to name individually? Lake Pohénégamook is said to hide a monster named Ponik? The Manicouagan impact crater is the fifth largest in the world and can be seen from space? Legendary Percé Rock had three arches in Jacques Cartier’s time? The award winning movie Seducing Dr. -

Just A. Ferronut's
Just A. Ferronut’s May - June 1996 Railway Archaeology Art Clowes Several years ago, my friend and our fellow member parts. They finally came across the mulatto, lying dead in a Keith Pratt asked for some help in trying to locate a replacement hammock, with partially eaten body parts around. They concluded copy of a book he had lost. The book was Donald MacKay’s that he died of indigestion from over-eating. ANTICOSTI – The Untamed Island. Following the finding of a The factual stories, rumours and folk-lore all added to copy, we were discussing Anticosti, and a bit about its railways. the shrouds surrounding Anticosti. Our discussions raised more questions than either of us were able Attempts were made to colonize Anticosti, but these did to answer, so it was time to start collecting information. In addition not succeed, and a failure in 1872, could be said was what started to the material in Donald MacKay’s book, the search turned up a to open the curtain on our story. Following this 1872 failure, the 1973 article by Ray Corley and Major Warren Anderson in the island was finally sold for $101,000 to an English businessman CRHA’s Canadian Rail. Canadian Rail carried another Anticosti named Francis Stockwell. He soon went bankrupted trying to article in 1980 by Robert Samson. This digging turned up another develop the island, for again in an article datelined Ottawa, May book on Anticosti, Époque des Menier à Anticosti, 1895 - 1926, by 26, 1889 listed the island for sale. In 1895, a French chocolate Lionel Lejeune, published in 1987. -

Lettres Sur L'ile D'anticosti À L'honorable Marc-Aurèle Plamondon
'>?< V3HW. 0? Si^ J crt LETTRES SUR L'ILE D'ANTICOSTI MONSEIGNEUR CHARLES GUAY f \ Gc^.'^\k LETTRES L'ILE D'ANTICOSTI L'Honorable MARC-AURÈLE PLAMONDON fuge de ta. Cour Supérieure, en retraite, a. Artabaskaville MONSEIGNEUR CHARLES GUAY Protonotaire AcostoUque (ad instar Participantiam) >«^; MONTREAL C. 0. BEAUCHEMIN & FILS, Libraires-Imprimeurs 266 et 258, rue Saint-Paul 1902 Enregistré, conformément à l'Acte du Parlement du Canada, en l'année mil neuf cent deux, par C. 0. Beauchemin & Fils, de Montréal, au Bureau du Ministre de l'Agriculture à Ottawa. 'V. "IIK' -"«^^ .*^'^» MONSIEUR HENRI MENIEB LETTRES L'ILE D'ANTICOSTI LETTRE I^^ Saint-Joseph de Lévis, le 8 octobre 1899. Mon cher et honorable Juge, Selon ma promesse, je vous adresse aujourd'hui ma première épître sur mon récent voyage à Pile d'Anticosti. Dès qu'on peut se fier à l'humide élément, Sitôt que de l'Auster l'iieureux frémissement Promet à notre course une mer sans naufrage, Le vaisseau reposé s'élance du rivage : On part, on vole au gré d'un vent rapide et doux, Et la ville et le port sont bientôt loin de nous. Le départ s'effectua de Québec, le 18 du mois dernier, par une de nos belles soirées d'automne, à bord du " Sa- voy ", joli yacht à vapeur, d'une capacité de 300 tonneaux, courant lestement ses neuf à dix nœuds à l'heure. M. J.- Bte Bélanger en est l'habile capitaine, toujours poli, tou- jours obligeant envers ses passagers (1) (1) M. Jean-Bte liélanger, chef du service maritime, est né au Cap-Saint-Ignace, le 1er janvier 1852 ; après avoir étudié au collège de Sainte- Anne de la Pocatière, il se donna à l'étude de la navigation. -

Une Excursion De Pêche Au Domaine Menier Renée Lachance and Rénald Lessard
Document generated on 09/27/2021 9:53 a.m. Cap-aux-Diamants La revue d'histoire du Québec Une excursion de pêche au Domaine Menier Renée Lachance and Rénald Lessard Feu vert! : cent ans d’automobile au Québec Number 45, Spring 1996 URI: https://id.erudit.org/iderudit/8496ac See table of contents Publisher(s) Les Éditions Cap-aux-Diamants inc. ISSN 0829-7983 (print) 1923-0923 (digital) Explore this journal Cite this article Lachance, R. & Lessard, R. (1996). Une excursion de pêche au Domaine Menier. Cap-aux-Diamants, (45), 54–54. Tous droits réservés © Les Éditions Cap-aux-Diamants inc., 1996 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ DANS LES ARCHIVES Une excursion de pêche au Domaine Menier e 14 juillet 1904, à 4 heures du matin, La toire de quelque 225 kilomètres de long par 1974, date à laquelle le gouvernement qué LBacchante accoste à Baie-Ellis (aujour 56 kilomètres de large couvert aux trois bécois s'en porte acquéreur. d'hui Port-Menier) ayant à son bord Lord quarts de forêt avec des savanes, des lacs Grey, le gouverneur général du Canada, Ar et des rivières, dont certaines regorgent de L'époque de Menier, au cours de laquelle se thur F. -
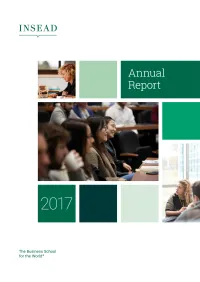
Annual-Report-2017.Pdf
Contents From the Chairman Class Statistics 02 26 From the Dean Career Development Centre 04 28 Faculty and Research World of Talent 08 30 Centres of Excellence Executive Education 10 32 Faculty Recognition Advancement 12 and Awards 36 The Infrastructure Celebrating INSEAD 40 of Excellence 14 Case Studies Finances New Faculty 42 16 Endowment Doctoral Programme 44 20 Our Constituencies INSEAD Knowledge 46 in 2016/2017 22 Master Degree Graduating Classes 24 Programmes 53 02 03 B oard of D irectors ANNUAL REPORT 2016/2017 From the Chairman Board of Directors Honorary Chairman Emma Goltz Mika Salmi Chair, INSEAD Alumni Fund Chair, Remuneration Committee, Claude Janssen INSEAD; Board Director, André Hoffmann CreativeLIVE, Inc Non-Executive Vice-President, Chairman Roche Holdings Ltd; Non-Executive Mirjam Staub-Bisang Andreas Jacobs Vice-President, Givaudan SA Chair, Endowment Management Member of the Board, Committee, INSEAD; President, Philippe Houzé Jacobs Holding AG INSEAD Switzerland Council; President, INSEAD France Council; CEO and Co- Founder, Independent Executive Chairman, Galeries Capital Group AG Vice-Chairman Lafayette Group Gary Wang Claude Rameau Sadia Khan Founder, Light Chaser Animation Emeritus Professor of Decision President, INSEAD Alumni Studio Sciences, INSEAD; Former Dean, Association; CEO, Selar Enterprises INSEAD Daniel Labrecque Permanent Invitees Chairman, International Council, Members INSEAD; Founder and CEO, Ilian Mihov DNA Capital Dean, INSEAD; Professor of Jolyon Barker Economics, INSEAD; The Rausing Chairman, Audit, Finance & Risk Daniel Lalonde Chaired Professor of Economic and Committee, INSEAD; Global Leader, As I look back over INSEAD’s achievements in faces. We greatly appreciate the fresh perspectives President and CEO, SMCP Business Transformation, INSEAD Clients & Industries, Deloitte MCS 2016/2017, there is much for us all to be proud of. -

Réserve De Biodiversité Projetée D'anticosti
Réserve de biodiversité projetée d’Anticosti August 2020 Table of Contents 1. Protection status and geographic name .................................................................................. 1 2. Conservation objectives ............................................................................................................. 1 3. Description of the area ............................................................................................................... 2 3.1. Geographic location, boundaries, and access ............................................................. 2 3.2. Ecological profile ............................................................................................................... 3 3.3. Land use ........................................................................................................................... 10 4. Activities framework ........................................................................................................................ 12 4.1. Introduction ................................................................................................................................... 12 4.2. Activity framework established by the Natural Heritage Conservation Act ......................... 12 4.3. Activities framework established by the conservation plan ................................................... 12 4.4. Zoning ......................................................................................................................................... 14 5. Activities -
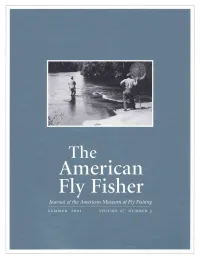
2001-Vol27-No3web.Pdf
Ephemeral Summer Ph oto by John Price The Museum on Festival Weekend 2001. PRING . n's ALWAYS LIKE THIS at the Museum. This year In "Standing on the Shoulders of Giants;' Ken Cameron and found staff updating the galleries, planning for and trav- Andrew Herd discuss an earlier literary tradition, before the Seling to dinner/auctions, hosting a dinner for the recipi- advent of modern copyright law, in which authors would often ent of this year's Heritage Award, receiving television and print reuse parts of previously published works to build on their coverage, publishing the newsletter and journal, and gearing own authority. In particular, Cameron and Herd focus on up for our annual Festival Weekend celebration-at which we three engravings that appeared in the 1760 Hawkins edition of not only invited the public to enjoy the grounds and learn Isaac Walton's The Complete Angler that were picked up in var- about fly fishing, but also welcomed new trustees and honored ious books over the next eighty years. Their article begins on our volunteer of the year. page 12. No wonder our events and membership coordinator took The Compleat Angler inspired this issue's Notes & Comment off for Barbados immediately following. piece as well. Author Jim Repine's love of Izaak Walton and By the time this reaches yo u, though, it will be summer, Charles Cotton's book takes him on a trip to England for a Vermont's ephemeral season. As you read these words, we will look at the world they inhabited. Repine reflects on Walton be feeling the end of it creeping close behind us, and we will and Cotton's words and the thoughts of his guides in England, wear a guise of healthy denial. -

Bulletin-78-TICCIH-F
NUMBER 78 4th quarter, 2017 CONTENTS REPORT • Villes-Usines and Company Towns: International Study Perspectives, Lucie K. Morisset WORLDWIDE • Val-Jalbert, Ghost Town and Living History Museum, Gaston Gagnon • Good Practice Criteria in Heritage Conservation: Zollverein Industrial Complex, Heike Oevermann • Henry Ford’s 1928 IA Holiday, Part I, David Perrett • Ireland, Newfoundland, and the Atlantic Cable, Bill Burns • New Life of the Stanislavsky Factory Theatre, Ekaterina The company town of Kiruna in the far north of Sweden was established at the end of the 19th Khaunina and Valentina Muzychuk century, but is today threatened by the giant iron mine that once gave it life and whose extension requires the removal of a large portion of the town. Lucie Morisett discusses the varied destinies of company towns like Kruna, and initiatives to interpret and conserve them. Photo: Luc Noppen INDUSTRIAL HERITAGE MUSEUMS • Diving Into the Machine: 3-D Techniques For Industrial Collections, Tine Verroken and Tijl Vereenooghe OPINION EDUCATION & TRAINING CHERISHING THE MOTORING HERITAGE • Online Industrial Heritage Training at Athabasca University Kathryn A. Morrison, Historic England Some splendid buildings were erected in England in the early to mid 20th XVII TICCIH CONGRESS SANTIAGO DE century specifically for motor cars, as well as for their drivers and passengers. CHILE - 2018 • Sewell Copper Mining Town The finest are found in London and include the Michelin Building on Fulham Road (1905-10; Grade II), the Wolseley showroom on Piccadilly (1921; Grade II*), the Bluebird Garage on King’s Road (1923; Grade II) and the Daimler TICCIH CONFERENCES • TICCIH Water Heritage Thematic Conference Hire Garage on Herbrand Street (1931; Grade II). -
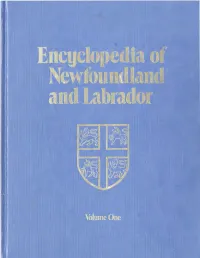
Encyclopedia of Newfoundland and Labrador
AD ...;; "" . .. l · ·~·· / . •, \ : 'I I; .... .;.~ \ 'f' Encyclopedia of Newfoundland and Labrador Editor in Chief Joseph R. S111llllwood P.C. , D.C .L. , LL.D., D . Litt. Managing Editor Robert D. W Pitt H.A.,M.A. Volume One NEWFOUNDLAND BOOK PUBLISHERS (1967) LIMITED @Newfoundland Book Publishers (I 967) Limited First Edition 1981 Canadian Cataloguing in Publication Data Encyclopedia of Newfoundland and Labrador Contents: v.l. A-E. ISBN 0-920508-13-8 (set). -ISBN 0-920508-14-6 (v.1) 1. Newfoundland- Dictionaries and encyclopedias. 2. Labrador- Dictionaries and encyclopedias. I. Smallwood, Joseph R., 1900- II. Pitt, Robert D.W. 1953- FC2154.E52 971.8'003'21 C81-095040-5 F1121.4.E52 Front Endpapers: Giacamo GastaJdi Map, originally engraved from a single wood block that was destroyed by fire in 1557. The map shown was later re-engraved on copper with minor changes from the woodcut. Back Endpapers: J.N. Bellin Map, originally published in 1745, was the official French version of the outline of Newfoundland at that time. Published by Newfoundland Book Publishers (1967) Limited St. John's, Newfoundland, Canada Cover and Text design by Vivant Studio Limited (Sheila Cotton) Rose Bay, Nova Scotia, Canada The Economy design by Wayne C. Stockwood and David Tuck St. John's, Newfoundland, Canada Production co-ordination by B. Dale Russell FitzPatrick St. John's, Newfoundland, Canada Typesetting by General Printers Division of Consolidated Graphics Limited Oshawa, Ontario, Canada Typesetting (The Economy) by Collins Graphics Services Limited St. John's, Newfoundland, Canada Printed and bound by John Deyell Company Lindsay, Ontario, Canada All rights reserved. -

Un Capitalisme Idéal
© by éditions Clancier Guénaud, Paris 1984 I.S.B.N. : 2-86215 -060-6 Bernard MARREY UN CAPITALISME IDÉAL Ouvrage publié avec le concours du Centre National des Lettres Éditions Clancier-Guénaud 49, rue Saint-André-des-Arts - 75006 Paris DU MÊME AUTEUR — Guide de l'art dans la rue à Paris et dans la région parisienne au XX siècle. Les éditions ouvrières - 1974. — Les grands magasins. Librairie Picard - 1979. — Architectures à Paris 1848-1914 (avec Paul Chemetov). Dunod - 1980, ré-édité 1984. — Rhône-Alpes (ouvrage collectif). L'Equerre - 1982. — La ville d'hiver d'Arcachon (participation). Institut français d'architecture - 1983. — La grande histoire des terres et des jardins d'hiver (avec Jean-Pierre Monnet). Graphite - 1984. — La vie et l'œuvre de Gustave Eiffel... Graphite - 1984. A Charlotte. REMERCIEMENTS Je suis très reconnaissant à Jean-Jacques Journet, ami et allié de la famille Menier, de m'avoir aidé de ses conseils, de ses souvenirs et de ses documents. Jean Sterlin, inlassable collectionneur de tout ce qui concerne la Seine-et-Marne, m'a ouvert avec générosité ses trésors. L'un et l'autre m'ont permis de remédier à l'absence de sources directes. La Société Rowntree-Mackintosh m'a autorisé à parcourir les archives dont elle disposait. Mmes Marie-Thérèse Baud, E.Bichot, MM.Albert Ehrmann, Georges Guerrier, Jean- Jacques Gillon, eux-mêmes témoins ou descendants de témoins de cette épopée, m'ont aidé de leurs souvenirs. Mmes Anne Dugat, conservatrice à la Commission du Vieux Paris, et Véronique Laisné, conservatrice à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, ont facilité mes recherches. -

Ces Marques Alimentaires Disparues
Ces marques alimentaires disparues ... 1° Partie Trop petites, trop âgées ou dépassées par la concurrence, des milliers de marques alimentaires et ménagères sont retirées chaque année du marché. Ambassadrices de leur temps elles sont souvent restées imprégnées au fond des mémoires collectives, l'occasion pour nous de redécouvrir les plus fameuses d'entre-elles. Certains produits nous manquent car ils ont longtemps accompagné notre jeunesse et il y a comme un petit goût qui manque à nos papilles. je vous propose de nous replonger dans le passé et de nous rappeler ces quelques marques qui ont fait partie de notre quotidien et puis s’en sont allées… Biscuits Gondolo C’est en 1843 que Paul Gondolo créa une fabrique artisanale de gaufrettes et gressins. La société sera rachetée en 1896 par deux des très connus frères Belin (Camille et Raymond), associés à la société Normand. Ils feront faillite 3 ans plus tard en 1901. La société sera a nouveau rachetée, cette fois-ci par Lucien Mirand en 1902, alors que cette année-là, le 3ème frère Belin, Gustave, crée la société éponyme Belin à Bagnolet. En 1903, Lucien Mirand ouvre une usine à Saint-Maurice en banlieue parisienne puis déménage à nouveau en 1922 pour Maison Alfort où sont installées de nombreuses biscuiteries, dont l’Alsacienne, les biscuits Brun, la biscuiterie Léon. L’entreprise deviendra une des plus importantes de France avec 1000 employés. En 1961 elle sera rachetée par l’américain Nabisco, déjà propriétaire de la marque Belin, qui fusionnera avec Gondolo en 1965 . Mais en 1975, la fermeture de l’usine à Maison Alfort entraînera la disparition de la marque Gondolo . -

Place-Names on Anticosti Island, Que
PLACE-NAMES ON ANTICOSTI ISLAND, QUE. BY Lt.-Col. W. P. ANDERSON, C.M.G., F.R.G.S., Member Geographic Board of Canada. Reprinted from the 17th Report of Geographic Board ufc- OTTAWA F. A. ACLAND PRINTER TO THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY 1922 The EDITH WLORNE PIERCE COLLECTION of CANADIANA Queens University at Kingston PS PLACE-NAMES (V ON ANTICOSTI ISLAND, QUE. BY Lt.-Col. W. P. ANDERSON, C.M.G., F.R.G.S., Member Geographic Board of Canada. Reprinted from the 17th Report of Geographic Board. OTTAWA F. A. ACLAND PRINTER TO THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY 1922 no.cc-a. A i Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from Queen's University - Universityof Toronto Libraries http://archive.org/details/placenamesQna.ntOOande PART III. PLACE-NAMES ON ANTICOSTI ISLAND, QUE. BY Lt.-Col. W. P. Anderson, C.M.G., F.R.G.S., Member Geographic Board of Canada. In May, 1915, the writer, in his capacity of Chief Engineer of the Marine Department of Canada, was sent to select sites for new lighthouses and fog- alarm stations to safeguard shipping navigating the channel north of the island of Anticosti and on that occasion, as many times previously, he circumnavigated the island. The master of the C.G.S. Montcalm, on which the trip was made, had for reference a copy of the British chart, No. 1621, of the island, borrowed from Captain Pouliot, master of the Anticosti Company's steamer Savoie, on which had been inserted in manuscript a large number of place-names used by the company which were not on the original chart or otherwise published.