Dsire Schyns
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guerre Algérie 23/08/05 17:23 Page 1 2°-Guerre Algérie 23/08/05 17:23 Page 2 2°-Guerre Algérie 23/08/05 17:23 Page 3
2°-Guerre Algérie 23/08/05 17:23 Page 1 2°-Guerre Algérie 23/08/05 17:23 Page 2 2°-Guerre Algérie 23/08/05 17:23 Page 3 La Guerre d’Algérie: une histoire apaisée? 2°-Guerre Algérie 23/08/05 17:23 Page 4 Du même auteur La Torture et l’Armée pendant la guerre d’Algérie (1954-1962) Gallimard, 2001 La Documentation photographique, n° 8022 La guerre d’Algérie (en coll. avec Sylvie Thénault) Documentation française, 2001 2°-Guerre Algérie 23/08/05 17:23 Page 5 L’Histoire en débats Raphaëlle Branche La Guerre d’Algérie: une histoire apaisée? Éditions du Seuil 2°-Guerre Algérie 23/08/05 17:23 Page 6 COLLECTION «POINTS HISTOIRE» FONDÉE PAR MICHEL WINOCK Ce livre est publié sous la responsabilité de Christian Delacroix dans la série «L’Histoire en débats» qu’il dirige avec François Dosse et Patrick Garcia. ISBN 2-02-058951-6 © Éditions du Seuil, octobre 2005 Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. www.seuil.com 2°-Guerre Algérie 23/08/05 17:23 Page 7 Introduction 7 Introduction Quand la guerre d’Algérie apparaît dans le débat public en France, c’est presque autant comme un sujet d’histoire que comme un sujet d’actualité. -

The Iowa Historical Review
The Iowa Historical Review The University of Iowa Undergraduate History Journal Volume 4, Issue 1 Fall 2013 Department of History 1 Table of Contents The Iowa Historical Review Editorial Board 3 “We Must Shout the Truth to the Rooftops:” Gisèle Halimi, Djamila Boupacha, and Sexual Politics in the Algerian War of Independence By Ryan Kunkle (University of Iowa) 4 Torture: Henri Alleg and the Algerian War By Jeff Erickson (University of Iowa) 29 2 The Iowa Historical Review Editorial Board Heidi Kuchta Ryan Kunkle Kat Dvorak History Faculty Advisor: Professor Douglas Baynton The Iowa Historical Review is published once a semester and is available through the University of Iowa History Department website. A student-run publication, it accepts submissions from former and current undergraduate students at the University of Iowa. For more information, please contact us at [email protected]. 3 “We Must Shout the Truth to the Rooftops:” Gisèle Halimi, Djamila Boupacha, and Sexual Politics in the Algerian War of Independence Ryan Kunkle The University of Iowa Spring 2013 Colloquium for History Majors (World) Subtitle: France and Algeria at War 16W:051 Instructor: Dr. Mériam Belli 4 Ryan Kunkle On 3rd June, 1960, Simone de Beauvoir, a prominent French feminist, published an article in the newspaper Le Monde, which “aroused the most extraordinary storm, not only in France but all over the world.”1 In the article, she detailed the story of Djamila Boupacha, a female Algerian nationalist, seeking Algerian independence from France, who was arrested for allegedly bombing a café and was subsequently tortured by French military forces. -

Osu1199254932.Pdf (640.26
FROM MUSE TO MILITANT: FRANCOPHONE WOMEN NOVELISTS AND SURREALIST AESTHETICS DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Mary Anne Harsh, M.A. ***** The Ohio State University 2008 Dissertation Committee: Approved by Professor Danielle Marx-Scouras, Advisor Professor Karlis Racevskis ______________________________ Advisor Professor Sabra Webber French and Italian Graduate Program ABSTRACT In 1924, André Breton launched the Surrealist movement in France with his publication of Manifeste du surréalisme. He and his group of mostly male disciples, prompted by the horrors of World War I, searched for fresh formulas for depicting the bizarre and inhumane events of the era and for reviving the arts in Europe, notably by experimenting with innovative practices which included probing the unconscious mind. Women, if they had a role, were viewed as muses or performed only ancillary responsibilities in the movement. Their participation was usually in the graphic arts rather than in literature. However, in later generations, francophone women writers such as Joyce Mansour and Suzanne Césaire began to develop Surrealist strategies for enacting their own subjectivity and promoting their political agendas. Aside from casual mention, no critic has formally investigated the surreal practices of this sizeable company of francophone women authors. I examine the literary production of seven women from three geographic regions in order to document the enduring capacity of surrealist practice to express human experience in the postcolonial and postmodern era. From the Maghreb I analyze La Grotte éclatée by Yamina Mechakra and L'amour, la fantasia by Assia Djebar, and from Lebanon, L'Excisée by Evelyne Accad. -

The French Revolution in the French-Algerian War (1954-1962): Historical Analogy and the Limits of French Historical Reason
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 9-2016 The French Revolution in the French-Algerian War (1954-1962): Historical Analogy and the Limits of French Historical Reason Timothy Scott Johnson The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1424 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] THE FRENCH REVOLUTION IN THE FRENCH-ALGERIAN WAR (1954-1962): HISTORICAL ANALOGY AND THE LIMITS OF FRENCH HISTORICAL REASON By Timothy Scott Johnson A dissertation submitted to the Graduate Faculty in History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2016 © 2016 TIMOTHY SCOTT JOHNSON All Rights Reserved ii The French Revolution in the French-Algerian War (1954-1962): Historical Analogy and the Limits of French Historical Reason by Timothy Scott Johnson This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in History in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy Richard Wolin, Distinguished Professor of History, The Graduate Center, CUNY _______________________ _______________________________________________ Date Chair of Examining Committee _______________________ -

“A Man Has Disappeared”: Gender, Social Frameworks, and Narrative
“A MAN HAS DISAPPEARED”: GENDER, SOCIAL FRAMEWORKS, AND NARRATIVE CONSTRUCTION IN THE AUDIN AFFAIR AND ITS MEMORIAL AFTERLIVES, 1957 – 2018 Emilia Kate Flack Undergraduate Senior Thesis History Department Columbia University 17th April, 2020 Second Reader: Professor Emmanuelle Saada Seminar Leader: Professor George Chauncey Flack 2 ACKNOWLEDGEMENTS I never anticipated writing my acknowledgments at home in Virginia on day whatever-it- is-now of social distancing. The past few weeks have been filled with fear, grief, and uncertainty but through it all this thesis has remained a happy constant. For the opportunities it has given me to delve into the archives, hone my language skills, interview remarkable individuals, foster relationships with phenomenal professors, and rediscover a love of learning that I had perhaps briefly lost, this thesis represents almost everything that I wanted my Columbia undergraduate experience to be… the cap toss will have to wait for now. First of all, I thank everyone at Columbia who has given me the gift of this education. To Professor Chauncey, I thank you for your invaluable advice when I needed it most. To Professor Saada, I am grateful for your guiding hand, expertise, and patience when I turned in far longer drafts than you were expecting! Thank you to the History Department, Professor Mass, Professor Pizzigoni, Professor Coleman and many others for helping me find my home on this campus. I am especially grateful for the Senior Thesis Fellowship for Research in European Archives that enabled me to conduct the interviews and archival research at the heart of this project. To the French Department and Reid Hall, to Professor Taraud and Serge Ollivier, and to Professor Dodman, I express enormous thanks. -
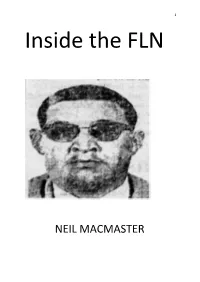
Neil Macmaster
1 Inside the FLN NEIL MACMASTER 2 Inside the FLN: the Paris massacre and the French Intelligence Service Neil MacMaster March 2013. The moral right of the author has been asserted. The author welcomes any e-mail comment: <[email protected]> Cover photograph: Mohamed Zouaoui. 3 Contents Introduction 4 1 “Operation Flore” and the arrest of Mohamed Zouaoui 10 2 The Zouaoui network: the role of the Contrôleurs 21 3 The European Support Network, Renault, and FLN Propaganda 33 4 The Problem of Violence and the Federation U-Turn 43 5 Assassination of police officers and the Federation crisis 54 6 At the grass-roots: Mohammed Ghafir and Amala 12 (13th Arrondissement) 66 7 Planning the demonstrations of 17-20 October 84 8 Abderrahmane Farès and the financial network 98 9 After the massacre: the impact of the crisis on the FLN 108 Conclusion 123 Jean-Luc Einaudi and the Sacralisation of Mohammedi Saddek: An Essay 127 Appendix 1 Who was Mohammedi Saddek? 132 Appendix 2 La guerre des chiffres: how many Algerians died? 140 Short bibliography of publications, 2006-2013 145 Note on the author 147 4 INTRODUCTION By 2006, when I and Jim House published Paris 1961. Algerians, State Terror, and Memory, a number of books, by Jean-Luc Einaudi, Jean-Paul Brunet, Alain Dewerpe, Linda Amiri, Rémy Valat, and others, meant that the main features of the Paris massacre and the demonstration of 17 October were quite well understood.1 Political controversy has continued to rage, mainly in relation to the contested issue of the numbers of Algerians that were killed, but in general the bulk of the publications that have appeared since Paris 1961 have had to do with the cultural, artistic and memorial aspects of the events, rather than with further research into primary archival sources.2 This shift from the further excavation of archives, to differing interpretations of cultural and political meanings, was exemplified by the debates surrounding Michael Haneke’s film Caché,3 and the commemoration of the 50th anniversary in October 2011. -

Memory, Empire, and Postcolonialism: Legacies of French Colonialism' and Singer and Langdon, 'Cultured Force: Makers and Defenders of the French Colonial Empire'
H-French-Colonial Barrows on Hargreaves, 'Memory, Empire, and Postcolonialism: Legacies of French Colonialism' and Singer and Langdon, 'Cultured Force: Makers and Defenders of the French Colonial Empire' Review published on Friday, January 15, 2010 Alec G. Hargreaves, ed. Memory, Empire, and Postcolonialism: Legacies of French Colonialism. Lanham: Lexington Books, 2005. 272 pp. $32.95 (paper), ISBN 978-0-7391-0821-5.Barnett Singer, John W. Langdon. Cultured Force: Makers and Defenders of the French Colonial Empire. Madison: University of Wisconsin Press, 2004. xi + 483 pp. $45.00 (cloth), ISBN 978-0-299-19900-5; $29.95 (paper), ISBN 978-0-299-19904-3. Reviewed by Leland Barrows (Voorhees College) Published on H-French-Colonial (January, 2010) Commissioned by Jyoti Mohan Myths and Realities: Conflicting Perceptions of French Colonial History and Postcolonialism Postcolonial studies came later to the Francophone than to the Anglophone world probably because of the trauma associated with much of French decolonization. There was also a felt need in France to come to terms with the Vichy era before turning to the almost as traumatic end of French rule in Algeria. But by the 1990s, French colonial studies were rapidly coming into vogue. The two books under review, Cultured Force, a revisionist history of the French empire that stresses a biographical approach to historical narrative, andMemory, Empire, and Postcolonialism, which publishes the proceedings of an interdisciplinary conference on cultural memory, are good examples of the varied types of writing that the rekindled interest in the French empire is spawning. “Biographical study,” the authors ofCultured Force inform their readers, “provides a relatively painless way to introduce people to an era’s subtleties,”enabling them to develop an awareness of the relativity and the contradictions of received truths, particularly those reflecting the history of modern imperialism and colonialism (p. -

President Macron Admits French Assassination of Ali Boumendjel in the Algerian War
افغانستان آزاد – آزاد افغانستان AA-AA چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم از آن به که کشور به دشمن دھيم www.afgazad.com [email protected] زبانھای اروپائی European Languages Kumaran Ira 14.03.2021 President Macron admits French assassination of Ali Boumendjel in the Algerian war Last week, French President Emmanuel Macron acknowledged “in the name of France” that Ali Boumendjel, a lawyer and activist for the National Liberation Front (Front de Libération National—FLN), was “tortured and murdered” by French General Jacques Massu’s paratroopers in 1957, during the Algerian war. His execution was made to look like a suicide. Portrait of Ali Boumendjel [Source: Wikimedia Commons] Macron’s statement was published on March 2 by the Elysée Palace. The same day, Macron met with Boumendjel’s grandchildren. During the Battle for Algiers, Boumendjel [email protected] ١ www.afgazad.com “was arrested by the French army, placed in solitary confinement, tortured and then executed on March 23, 1957,” the statement read. Boumendjel was born in 1919 and was the son of a Kabyle schoolteacher, a Berber ethnic group in the Kabylia region of northern Algeria. In 1946, he joined Ferhat Abbas’s Democratic Union of the Algerian Manifesto, and became one of the main lawyers for the Algerian nationalists. He joined the FLN in 1955, the year after the start of the Algerian war, while working for the Shell oil company. The criminal colonial war waged by French imperialism left half a million people dead in Algeria. -

Syria's War Within the War Expected to Continue Despite Downing Of
Issue 174, Year 4 September 23, 2018 UK £2 www.thearabweekly.com EU €2.50 Interview Saudi writer Tripoli Ahmed al-Duwaihi spinning on prospects out of control of modernity Page 22 Page 10 Syria’s war within the war expected to continue despite downing of Russian plane ► Israel says its F-16 fighter jets attacked a facility in northern Syria to prevent “systems to manufacture accurate and lethal weapons” from being “transferred on behalf of Iran to Hezbollah in Lebanon.” Thomas Seibert Russia said Syrian air-defence sys- tems shot the plane down shortly after Israeli jets hit the area and Istanbul accused Israel of creating the dan- gerous conditions by failing to srael could face some limits give sufficient notice. The Russian on its ability to strike Iranian Embassy in Tel Aviv spoke of “irre- targets in Syria following the sponsible and unfriendly actions” I downing of a Russian mili- by the Israeli Air Force. tary plane but is unlikely to suf- In 2015, the Kremlin put rela- fer a crippling setback for its war tions with Turkey into the deep within the war in the neighbour- freeze for a year after the Turkish ing country. Air Force shot down a Russian mil- To contain the political and mili- itary plane on the Syrian border. tary fallout from the September 17 Russia, however, shows no inten- incident over northern Syria, Isra- tion of doing the same with Israel el sent its air force chief, Amikam after the loss of the IL-20. Norkin, to Moscow. He briefed Israel says its F-16 fighter jets at- Russian officials on the initial Is- tacked a facility in northern Syria raeli investigation into the crash in to prevent “systems to manufac- which a Russian IL-20 surveillance ture accurate and lethal weapons” Clashes ahead. -

Re-Viewing the Battle of Algiers with Germaine Tillion Author(S): Donald Reid Source: History Workshop Journal, No
Re-Viewing the Battle of Algiers with Germaine Tillion Author(s): Donald Reid Source: History Workshop Journal, No. 60 (Autumn, 2005), pp. 93-115 Published by: Oxford University Press Stable URL: https://www.jstor.org/stable/25472817 Accessed: 25-09-2018 11:09 UTC REFERENCES Linked references are available on JSTOR for this article: https://www.jstor.org/stable/25472817?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents You may need to log in to JSTOR to access the linked references. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms Oxford University Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to History Workshop Journal This content downloaded from 130.235.66.10 on Tue, 25 Sep 2018 11:09:52 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms Germaine Tillion in discussion at St Mande, date and companion unknown. Re-viewing The Battle of Algiers with Germaine Tillion by Donald Reid Whatever the outcome of this Algerian war, it is certain that in fifty years, one hundred years, the Algerians will remember. They will teach their children what that year 1957 was. Legends will be born of the time when the Casbah, the most profound symbol of their community, was night and day under siege, when terror reigned as absolute master, when each of the inhabitants could at any time say: 'In an hour, maybe they will knock on my door and take me away forever Pierre Leulliette, a paratrooper in Algiers1 I learned from the newspapers that in the Algiers Casbah a leader of the FLN [Yacef Saadi] and his young woman companion [Zohra Drif ] were holding out against the assaults of the French army. -

Apprendre Et Enseigner La Guerre D'algérie Et Le Maghreb Contemporain
« LES ACTES DE LA DESCO » Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain ©CRDP de l'académie de Versailles, 2002 Sous la direction de Dominique Borne, Jean-Louis Nembrini et Jean-Pierre Rioux actes de l’université d’été organisée du 29 au 31 octobre 2001 à l’Institut du Monde Arabe Programme national de pilotage Inspection générale de l’éducation nationale Direction de l’Enseignement scolaire Bureau de la formation continue des enseignants Ministère de l'Education nationale CRDP de l'académie de Versailles Enseigner la guerre d'Algérie et le Maghreb contemporain - actes de la DESCO Université d'été octobre 2001 Ouverture des travaux .....................................................................................3 Jack Lang Comprendre et faire comprendre .....................................................................8 Jean-Pierre Rioux Géographie et géopolitique du Maghreb aujourd’hui ....................................... 13 Armand Frémont Repères sur l’historiographie algérienne de la guerre ..................................... 16 Benjamin Stora Entendre et enseigner l’expérience du combattant français de la guerre d’Algérie ............................. 21 Jean-Charles Jauffret Retour sur la décolonisation de la Tunisie et du Maroc .................................... 34 Daniel Rivet Justice et torture à Alger en 1957 : apports et limites d’un document.............. 44 Raphaëlle Branche Sylvie Thénault L’Algérie d’une guerre à l’autre ..................................................................... -

Senses of Vulnerability: Gender, Embodiment, and Dis-Orientation from the Algerian War To
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Santa Barbara Senses of Vulnerability: Gender, Embodiment, and Dis-Orientation from the Algerian War to the War in Iraq A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Comparative Literature by Alexandra Magearu Committee in charge: Professor Maurizia Boscagli, Co-Chair Professor Dwight Reynolds, Co-Chair Professor Catherine Nesci Professor Eric Prieto Professor Elisabeth Weber September 2018 The dissertation of Alexandra Magearu is approved. ____________________________________________ Catherine Nesci ____________________________________________ Eric Prieto ____________________________________________ Elisabeth Weber ____________________________________________ Maurizia Boscagli, Committee Co-Chair ____________________________________________ Dwight Reynolds, Committee Co-Chair September 2018 Senses of Vulnerability: Gender, Embodiment, and Dis-Orientation from the Algerian War to the War in Iraq Copyright © 2018 by Alexandra Magearu iii ACKNOWLEDGEMENTS This project could not have come into being without the support of mentors, family, and friends. I am deeply grateful to my mentors in the American Studies department at the University of Bucharest, Mihaela Precup and Ruxandra Rădulescu. Their warmth, their passion, their dedication and their integrity have inspired me to pursue a degree in the humanities and research social justice issues. Mihaela’s friendship, her sense of humor, her energy, and her feminist commitments have provided a model of ethical living for me. Ruxandra’s wisdom, her kindness, and her empathy have inspired me to become a better person. I am also grateful to my committee, whose feedback, critical comments, and invaluable advice have considerably shaped and improved this book. I would like to thank Maurizia Boscagli for her unwavering support, her critical intensity, and for encouraging me to persevere in my writing in moments of disorientation.