L'affaire Valérie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Società Giustizia E Sicurezza Al Personale Di Polizia Penitenziaria Anno XXV • N
PoSoclieitz àiaPen Giustiziiat ee nSizciua rerziza a anno XXV •n.264 • settembre 2018 2421-2121 www.poliziapenitenziaria.it 8 0 0 2 / 4 1 . T U A / M R / C / T A - P M T U A a m o R % 0 7 e l a t s o p o t n e m a n o b b a n i e n o i z i d e p s a p s e n a i l a t i e t s o P 08 10 14 26 04 38 36 In copertina: L’immagine della campagna di sensibilizzazione Polizia Penitenziaria del Sappe contro le aggressioni Società Giustizia e Sicurezza al personale di Polizia Penitenziaria anno XXV • n. 264 • settembre 2018 04 EDITORIALE 12 DIRITTO E DIRITTI 26 CRIMINI & CRIMINALI Il Sappe protesta per pretendere più sicurezza La concussione - di Giovanni Passaro Il mostro del plenilunio: Roberto Succo di Donato Capece di Pasquale Salemme 14 REPORTAGE 32 MONDO PENITENZIARIO 05 IL PULPITO La vergogna delle nostre caserme La Champions league del Sappe Uno spiraglio nell’oscurità di Francesco Campobasso di Giovanni Battista de Blasis 19 MONDO PENITENZIARIO Stipendi delle Forze di polizia europee a confronto 33 SICUREZZA SUL LAVORO 06 IL COMMENTO di Emanuele Ripa La segnaletica di sicurezza - di Luca Ripa Le omissioni del Rapporto Antigone sulle caceri di Roberto Martinelli 20 LO SPORT 34 LETTURE Fiamme Azzurre: Coppa Campioni di Tiro a volo 08 L’OSSERVATORIO POLITICO Il carceriere Schiller - di Giuseppe Romano Governo Conte: è arrivato il momento di fare 22 MA CHI SIAMO 36 OPINIONI qualcosa anche per la Polizia Penitenziaria Si lamenta chi non si accontenta di Giovanni Battista Durante Quando il Colombo come il lupo perde il pelo di Chiara Sonia Amodeo di Roberto Martinelli 10 CRIMINOLOGIA 25 CINEMA DIETRO LE SBARRE 38 LETTERE AL DIRETTORE Le bande criminali minorili Sulla mia pelle Ancora sul maneggio di denaro pubblico di Roberto Thomas a cura di G. -

November 14Th-25Th 2018 IFI French Film Festival Schedule November 14Th-25Th 2018
www.ifi.ie IFI French Film Festival November 14th-25th 2018 IFI French Film Festival Schedule November 14th-25th 2018 WED 14 OPENING FILM TUES 20 IFI Principal Funder 20.00 Real Love (C'est ça l'amour) 18.15 Young and Alive (L’époque) followed by a Q&A with Claire Burger 20.10 Knife + Heart & The Sunday Friend and a wine reception (Un couteau dans le Coeur & L'Amie du dimanche) THURS 15 Festival Sponsors 16.15 Sofia WED 21 18.00 Sorry Angel (Plaire, aimer et courir vite) 18.10 Memoir of War (La douleur) 20.40 Sink or Swim (Le Grand Bain) 20.45 Our Struggles (Nos batailles) Alliance Française Screening FRI 16 16.40 Our Struggles (Nos batailles) THURS 22 Festival partners 18.40 Sofia 16.10 Place publique 20.20 The Prayer (La prière) 18.15 Amin + Q&A with Cédric Kahn 20.15 Little Tickles (Les chatouilles) + Q&A with Andréa Bescond and Eric Métayer SAT 17 FRI 23 cultural Partners 13.00 Cédric Kahn Masterclass 13.30 The Raven (Le corbeau) 16.00 Memoir of War (La douleur) + intro by Douglas Smith 18.30 The Trouble with You (En liberté!) 15.00 Roberto Succo 20.40 Sauvage + intro by Cédric Kahn 15.30 At War (En guerre) SAT 24 18.00 School’s Out (L'Heure de la sortie) 13.10 Les diaboliques 20.15 Sorry Angel (Plaire, aimer et courir vite) + intro by Tara Brady 15.40 The Prayer (La prière) Booking Information SUN 18 18.00 Sink or Swim (Le Grand Bain) 13.00 The Wages of Fear (Le salaire de la peur) 20.30 I Feel Good Tickets cost €11 each, except for the Membership: is required for all 13.10 Little Tickles (Les chatouilles) opening film which includes a post- films. -

Scuola, Fine Anno Di Fuoco Ora Si Tratta Ad Oltranza
Giornale Anno 65*. n. 113 Spedizione in abb- post. or. 1/70 del Partito L. 1000/ arretrati L. 2000 comunista Martedì ritolta italiano 24 maggio 1988 * A Cannes una Palma CONTRATTO INSEGNANTI L'ultimatum dei sindacati scade venerdì Le tesi per la Conferenza d'oro sulla base di un compromesso danese ______________ Dal governo minacce di nuove imposte e precettazione A Cannes finale a sorpresa: la Palma d'oro è finita in Danimarca con Pelle il conquistatore di Bilie August (nella foto) con uno strepitoso Max Von Sydow. Il resto del «palmarès» si è diviso equamente sui film migliori del festi D plenum val: miglior attore Foresi Whitaker protagonista di Bird, II film di Ctlnt Eastwood, per Un mondo a parte due premi, quello speciale della giuria e quello per Barbara Hershey Scuola, fine anno di fuoco migliore attrice. Riconoscimenti a Peter Greenaway e Fer dà via libera nando Solanas. A PAGINA 21 Il ministero della Sanità ha Sequestrato deciso che l'olio extravergi aGorbaciov olio extravergine ne di oliva, con scadenza Ora si tratta ad oltranza novembre '88, della ditta Carapelli Carapelli e che conterreb be tetracloruro di etilene, con solvente un solvente incolore del Si rivedranno oggi pomeriggio alle 18 a palazzo Vi- Le tesi di Gorbaciov per la prossima conferenza m^amm^mmmm^^mmm grassi, venga sequestrato su doni governo e sindacati per riprendere I estenuante del partito sono state approvate ieri dal plenum del tutto il territorio italiano. La misura di sicurezza è scattata Quella tassa trattativa per la scuola, sospesa ieri a notte inoltrata Ce del Pcus, che ha dato ufficialmente al segreta dopo che gli esami, ordinati dall'Usi di Teramo, avevano con una paniate intesa sul regime dell'orario. -

VII a Dark and Furious Murderer
Venetian Thrillers – Episode VII A Dark Furious Murder The double homicide was discovered only a few days after it had happened, in a modest but dignified apartment in Favorita, a small town in the Venice hinterland on the border of the province of Treviso. The agents of the San Marco police station, their suspicions having been aroused by the unreported absence of their colleague, Inspector Nazario Succo, decided to go and look for him and also doublecheck at the man’s house. The scene that met their eyes was terrible: the policeman was upside-down in the bathtub, with a plastic bag over his head and numerous blade wounds all over his body, and as if insufficient, further ferocious injuries had been inflicted with an ice pick. Under his body was that of his wife, slashed with a knife over the breast, neck and face. Only a few days were needed to bring the assassin into custody: the couple’s son, Roberto, a taciturn nineteen year old who at the “Morin” Lyceum – where he studied – had no friends, but had never shown any signs of mental imbalance. He had attacked his mother pitilessly because the woman had refused to let him use the family car, an Alfa Sud. He then also killed his father, as he himself explained, “because I didn’t want him to suffer seeing his wife dead”. The homicide took place on April the 9 th , 1981. Roberto Succo would be declared mentally ill and interned at the psychiatric hospital in Reggio Emilia, where he finished his studies, went to the gym and in general was a “good boy”. -

Mise En Page 1
RENCONTRES PROFESSIONNELLES ARTISTIQUES Les nouvelles écritures du spectacle vivant musique, danse, théâtre TOULON, DU LUNDI 5 AU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2007 Les actes 1 Ces rencontres professionnelles artistiques sur le thème des “nouvelles écritures du spectacle vivant - musique, danse, théâtre” ont été organisées par le Conseil Général du Var, dans le cadre des actions de préfiguration du Centre Départemental d’Echanges et de Transmission Artistiques de l’Abbaye de La Celle. Elles se sont tenues à l’Espace Comédia, 10 rue Orves à Toulon, du lundi 5 au vendredi 16 novembre 2007. En collaboration avec : L’ADIAM 83 http://www.adiam83.com La compagnie Rialto- Fabrik Nomade http://www.cie-rialto.com L’Institut d’Etudes Théâtrales Paris 3 Sorbonne Nouvelle http://www.univ-paris3.fr L’Espace Comédia http://www.theatremediterranée.fr La Compagnie Hors Champ http://www.ciehorschamp.fr La Compagnie Le Bruit des Hommes http://www.lebruitdeshommes.com La Bibliothèque de théâtre Armand Gatti http://www.orpheon-theatre.org Le Centre National de la Danse http://www.cnd.fr Karwan http://www.karwan.info La pensée de midi http://www.lapenseedemidi.org L’arcade http://www.arcade-paca.com Le Pôle Jeune Public du Revest les Eaux http://www.polejeunepublic.over-blog.com Le Théâtre Massalia - Centre Ressources Jeune Public http://www.theatremassalia.com Des spectacles étaient également présentés lors de ces rencontres. Il s’agit de : Le parti pris des choses, théâtre de corps et de cirque par le Collectif Petit Travers proposé par Karwan, Pôle de développement et de diffusion des arts de la rue et des arts du cirque en région PACA. -

Arquivo Dissertação Um Estudo De Roberto Zucco, Peça Teatr…
FERNANDA VIEIRA FERNANDES UM ESTUDO DE ROBERTO ZUCCO , PEÇA TEATRAL DE BERNARD-MARIE KOLTÈS Porto Alegre Julho 2009 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE LETRAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS ÁREA: ESTUDOS DE LITERATURA ESPECIALIDADE: LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS ÊNFASE: LITERATURAS FRANCESA E FRANCÓFONAS Linha de Pesquisa: Literatura, imaginário e história UM ESTUDO DE ROBERTO ZUCCO , PEÇA TEATRAL DE BERNARD-MARIE KOLTÈS Mestranda: Fernanda Vieira Fernandes Orientador: Prof. Dr. Robert Ponge Dissertação de Mestrado em Estudos de Literatura (Literaturas Estrangeiras Modernas, Literaturas Francesa e Francófonas), apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre Julho 2009 2 “Je ne veux pas espérer le soir, car je ne veux pas pleurer le matin.” B.-M. Koltès, Le Retour au désert 3 AGRADECIMENTOS Ao final desta jornada, gostaria de agradecer: ao Programa de pós-graduação do Instituto de Letras da UFRGS; ao Departamento de Arte Dramática da UFRGS; ao CNPq, pela bolsa concedida; ao professor Flávio Mainieri, que generosamente me apresentou ao universo de Koltès; às professoras Zilá Bernd e Rita Schmidt por me ensinarem novas formas de pensar; às professoras da banca examinadora, Mirna Spritzer, Jane Tutikian e Beatriz Gil, pela leitura atenta e comentários preciosos; à professora Heloísa Solassi pelos anos de ensino da língua francesa; aos colegas que tão afetuosamente me acolheram: Alcione, Camila, -
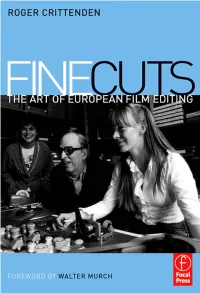
Ÿþf I N E C U T S : T H E a R T O F E U R O P E a N F I L M E D I T I
K51684-Prelims.qxd 10/18/05 5:12 PM Page i Fine Cuts This page intentionally left blank K51684-Prelims.qxd 10/18/05 5:12 PM Page iii Fine Cuts: The Art of European Film Editing Roger Crittenden AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON • NEW YORK • OXFORD PARIS • SAN DIEGO • SAN FRANCISCO • SINGAPORE • SYDNEY • TOKYO Focal Press is an imprint of Elsevier K51684-Prelims.qxd 10/18/05 5:12 PM Page iv Focal Press is an imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803 First published 2006 Copyright © 2006, Roger Crittenden. All rights reserved The right of Roger Crittenden to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988 No part of this publication may be reproduced in any material form (including photocopying or storing in any medium by electronic means and whether or not transiently or incidentally to some other use of this publication) without the written permission of the copyright holder except in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, 90 Tottenham Court Road, London, England W1T 4LP. Applications for the copyright holder’s written permission to reproduce any part of this publication should be addressed to the publisher Permissions may be sought directly from Elsevier’s Science and Technology Rights Department in Oxford, UK: phone: (ϩ44) (0) 1865 843830; fax: (ϩ44) (0) 1865 853333; e-mail: [email protected]. -

AFI PREVIEW (ISSN-0194-3847) Is Published Every Six Weeks by the American Film Institute’S Office at 8633 Colesville Road, Silver Spring, MD
THE AMERICAN FILM INSTITUTE GUIDE January 23 - March 4, 2004 ★ AFITO THEATRE AND MEMBER EVENTS PREVIEWVOLUME 1 • ISSUE 8 French Film Festival: The Festival of JanuaryFRANCE 23 – March 4 Featuring Actress Jeanne Moreau Plus: The Films of Directors Jerzy Kawalerowicz and Steven Soderbergh, Russell Crowe Film Series, Denzel Washington Showcase TAKING SIDES NEAPOLITAN HEART CARNIVAL ROOTS ROBOT STORIES ACADEMY AWARD-NOMINATED SHORTS NOTORIOUS EYES WITHOUT A FACE ABC AFRICA Cary Grant 100th Birthday Tribute A HARD DAY’S NIGHT VIVE LA FRANCE! French Film Festival 2-7 3Featured Showcase—Jeanne Moreau 4 Films from Alain Resnais French Film Festival: 6New French Cinema 7AU HASARD, BALTHAZAR 7 PLAYTIME The Festival Of France 7 EYES WITHOUT A FACE Features 8, 16-17 January 23 – March 4 8TAKING SIDES 16 NEAPOLITAN HEART As part of the John F. Kennedy Center for the 16 CARNIVAL ROOTS Performing Arts’ four-month Festival of 16 2004 Academy Award-Nominated Shorts France, AFI, in conjunction with the French 17 ROBOT STORIES Film Board, presents a celebration of the best 17 ABC AFRICA and most acclaimed films from the treasury of Film Series 8, 13-15, 18 French cinema—including classics, rarities and 8 The Films of Director Steven Soderbergh, the most riveting new pictures from France. including the 15th Anniversary Engagement of AFI’s French Film Festival will feature a great SEX, LIES AND VIDEOTAPE 13 Cary Grant 100th Birthday Tribute star, a great director and a core sample of 14 The Films of Russell Crowe, including MASTER AND outstanding recent French films. AFI Silver COMMANDER: THE FAR SIDE OF THE WORLD thanks Roland Celette, Patrick Renault, 15 The Films of Director Jerzy Kawalerowicz, with Marie Bonnel, and Estelle Carpentier of the the director LIVE at the Feb 4 screening of QUO VADIS Embassy of France, and Catherine Verret of 18 Montgomery College Film Series Unifrance USA for their invaluable aid in mak- Calendar 10-11 ing this series possible. -

Liberoquotidiano.It
Giovedì 14 marzo 2013 +%!"!@!#
Ds, Prima I Sindaci Poi Il Congresso Una «Reggenza» Fino Alle Assise
ARRETRATI L IRE 3.000 – EURO 1.55 SPEDIZ. IN ABBON. POST. 45\% anno 78 n.48 giovedì 17 maggio 2001 lire 1.500 (euro 0.77) www.unita.it ART. 2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 – FILIALE DI ROMA «La testimonianza che accogliente, una città civile della tolleranza, della fratellanza » vogliamo dare è quella di una che sa guardare al futuro e Carlo Maria Martini città aperta, dialogante, non ha paura della diversità 26 ottobre 2000 La destra smonta la scuola Intervista a Cannes Vogliono spezzare la riforma e insegnare la storia di Buttiglione Prima promessa flop: l’imposta regionale non si può più abolire ROMA È cominciata la grande corsa. Via a smontare, pezzo dopo pezzo, la scuola ECCO IL FILM italiana. La destra si prepara a distrugge- re tutte le riforme. Ma non basta. Gli DELL’ TALIA DI ERLUSCONI studenti saranno costretti a studiare la I B storia secondo la versione di Buttiglione Paolo Leon (ministro in pectore) per il quale il nazi- orrei fare un elenco dei fia). Non vi sarà una riduzione dei smo c’è stato per colpa del comunismo. miei timori, dopo la sconfit- tempi dei processi Non ci sarà biso- Intanto cade la prima promessa di Ber- V ta elettorale. Non penso che gno di riformare il CSM, perché la lusconi: l’Irap non sarà abolita. la destra vorrà mettere le mani sul- nuova maggioranza parlamentare la costituzione formale, ma quella troverà riscontro in una nuova ALLE PAGINE 4e6 materiale subirà cambiamenti maggioranza tra gli stessi magistra- sconvolgenti. Ecco i primi punti ti. -

A La Recherche De L'autre : L'oeuvre Dramatique De Bernard-Marie Koltes
Title: A la recherche de l'Autre : l'oeuvre dramatique de Bernard-Marie Koltes Author: Grażyna Starak Starak Grażyna. (2014). A la recherche de l'Autre : l'oeuvre Citation style: dramatique de Bernard-Marie Koltes. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego À la recherche de l’Autre L’œuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès NR 3155 Grażyna Starak À la recherche de l’Autre L’œuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego · Katowice 2014 Redaktor serii: Historia Literatur Obcych Magdalena Wandzioch Recenzent Krystyna Modrzejewska Car Je est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute. Cela m’est évident : j’assiste à l’éclosion de ma pensée : je la regarde, je l’écoute : je lance un coup d’archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d’un bond sur la scène. Arthur Rimbaud, Lettre à Paul Demeny, Charleville, 15 mai 1871 Avant-propos Bernard-Marie Koltès est un écrivain dont l’œuvre fascine ou irrite mais ne nous laisse jamais indifférents. Il est impossible de cotoyer cette œuvre et d’en rester indemne, de ne pas se poser de graves ques- tions de nature philosophique, éthique, morale. Son théâtre touche ce qui est enfui, caché dans les coins les plus profonds de notre âme, ce dont nous avons oublié, depuis bien longtemps, de parler : le désir, le besoin de l’Autre. Koltès était un homme jeune quand il a écrit ses plus grandes pièces. À l’âge de 41 ans son œuvre et sa vie étaient déjà terminées. -

Il Giorno Del Falco
presenta Per vedere questa immagine occorre QuickTime™ e un decompressore Photo - JPEG. 61ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia GIORNATE DEGLI AUTORI IL GIORNO DEL FALCO un film di RODOLFO BISATTI Italia 2004, colore, 87 min., Dolby Digital PERSONAGGI E INTERPRETI Il cinese STEFANO CASSETTI Il vecchio MARIO RODIGHIERO Giornalista GIACOMO DE DOMENICO Operatore TV MARIO PIGATTO Poliziotta BENEDETTA CESQUI L’amico Carlo GIOVANNI BENI La slava ALISA BYSTROVA Direttore TV DAVI DONA’ Irene LAURA SESLER La prostituta LETIZIA LEONE L’industriale EZIO PARISE CAST TECNICO Regia RODOLFO BISATTI Sceneggiatura RODOLFO BISATTI MAURIZIO PASETTI Fotografia FABIO OLMI Scenografia LAURA ZILIOTTO Montaggio PAOLO COTTIGNOLA GIOVANNI ZIBERNA Fonico di presa diretta FRANCESCO LIOTARD Costumi GEMMA SPINA Musiche originali ALESSANDRO CAMANINI MAURIZIO PASETTI Organizzazione ELISABETTA OLMI Produzione Esecutiva IPOTESI CINEMA Produzione IPOTESI CINEMA in collaborazione con RAI CINEMA MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI WORLD DISTRIBUTION ADRIANA CHIESA ENTERPRISES Via B. Oriani 24a - 00197 Roma-Italy tel. +39 068086052 In Venice: ADRIANA CHIESA DI PALMA Hotel Excelsior, tel +39 0415260201 Ufficio Stampa MIKADO FILM: ROBERTA AVOLIO, cell. 338-3674679 MARIA SILVIA FIENGO, cell. 348-3833239 IL GIORNO DEL FALCO Dal laboratorio di “Ipotesi Cinema” un film sul nulla barocco del Nord-Est italiano. Una televisione locale, una rapina da disperati, un canto alla “Spoon River” sulla terra del troppo benessere. Protagonisti: un ex professore universitario convertito al giornalismo televisivo, il suo operatore senza più illusioni, due balordi che hanno dato l’assalto ad una banca come Butch Cassidy e Sundance Kid, una poliziotta senza volto, un amico che non vorrebbe essere dov’è.