Hommes & Migrations, 1281
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Inventory of Botanical Curiosities in Pierre-François-Xavier
O inventário das curiosidades botânicas da Nouvelle France de Pierre-François-Xavier de Charlevoix (1744) KOBELINSKI, Michel. O inventário das curiosidades botânicas da Nouvelle France de Pierre-François-Xavier de Charlevoix (1744). História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.20, n.1, jan.-mar. 2013, p.13-27. O inventário das Resumo Verifica a extensão dos aportes botânicos curiosidades botânicas de Pierre-François-Xavier de Charlevoix em Histoire et description générale de la da Nouvelle France de Nouvelle France em relação a trabalhos de pesquisadores anteriores, suas valorações Pierre-François-Xavier das representações iconográficas e discursivas e aplicabilidade no projeto de Charlevoix (1744) de colonização francesa. Investiga- se o que o levou a preterir o modelo taxionômico de Lineu e o que pretendia com seu catálogo de curiosidades The inventory of botânicas. O desenlace de sua trajetória filosófico-religiosa permite compreender botanical curiosities in seu posicionamento no quadro de classificação da natureza, os sentidos Pierre-François-Xavier das informações etnológicas, as formas de apropriação intelectual e os usos de Charlevoix’s Nouvelle da iconografia botânica e do discurso como propaganda político-emotiva para France (1744) incentivar a ocupação colonial. Palavras-chave: história do Canadá; história e sensibilidades; história e natureza; Pierre-François-Xavier de Charlevoix (1682-1761); botânica. Abstract The article explores the botanical contributions of Pierre-François-Xavier de Charlevoix’s book Histoire et description générale de la Nouvelle France vis-à-vis the contributions of previous researchers, his use of iconographic and discursive representations and its relevance to the project of French colonization. It investigates why he refused Linnaeus’ taxonomic model and what he intended with his catalogue of botanical curiosities. -

MILLER, CHRISTOPHER L. the French Atlantic Triangle: Literature and Culture of the Slave Trade
Universidade Estadual de Goiás Building the way - Revista do Curso de Letras da UnU-Itapuranga THERE ARE NO SLAVES IN FRANCE!?! MILLER, CHRISTOPHER L. The French Atlantic Triangle: Literature and Culture of the Slave Trade. Durham & London: Duke University Press, 2010, 572 p. ISBN: 9780822341512. Thomas Bonnici Departamento de Letras / Universidade Estadual de Maringá The history of the 20 th century has shown how difficult it is for a nation to accept its past and to come to terms with shameful and degrading events practiced in centuries gone by. If even mere apologies are not easily wrenched from post-war Spain and Germany, Australia and New Zealand and the treatment of the Aborigines and Maoris, Latin America and its dictatorship periods, South Africa and its Apartheid policies, just to mention a few, can one imagine the healing processes required for more in-depth reconciliation? More than two hundred years had to pass so that whole nations would grapple with their slave-haunted history. London, Bristol, Birmingham and other British cities are only now accepting their long-term involvement with slavery, the slave trade, transatlantic economy, plantation system, enrichment on slave-produced goods. And Africa has still a lot of research to undertake to understand its almost endemic participation in different slave trades and in the selling of its children to Europeans. If Spain, Portugal, the Netherlands, Britain and Brazil are highly touchy on what they consider a taboo subject, how does France fare in the fray with more than one million Africans in 3,649 recorded trans-Atlantic voyages sent to its Caribbean colonies of Martinique (1635), Guadeloupe (1635), Guyane (1663) and Saint-Domingue / Haiti (1697) during from the 17 th to the early 19 th centuries? Christopher Miller, professor of African-American Studies and French at Yale University, provides readers interested in the history of slavery within the context of literature with a breakthrough book. -

The French Language in the Digital Age
White Paper Series Collection de Livres Blancs THE FRENCH LA LANGUE LANGUAGE IN FRANÇAISE THE DIGITAL À L’ÈRE DU AGE NUMÉRIQUE Joseph Mariani Patrick Paroubek Gil Francopoulo Aurélien Max François Yvon Pierre Zweigenbaum White Paper Series Collection de Livres Blancs THE FRENCH LA LANGUE LANGUAGE IN FRANÇAISE THE DIGITAL À L’ÈRE DU AGE NUMÉRIQUE Joseph Mariani IMMI-CNRS & LIMSI-CNRS Patrick Paroubek LIMSI-CNRS Gil Francopoulo IMMI-CNRS & TAGMATICA Aurélien Max LIMSI-CNRS & U. Paris Sud 11 François Yvon LIMSI-CNRS & U. Paris Sud 11 Pierre Zweigenbaum LIMSI-CNRS Georg Rehm, Hans Uszkoreit (Éditeurs, editors) PRÉFACE PREFACE Ce livre blanc fait partie d’une collection qui a pour ob- is white paper is part of a series that promotes jectif de faire connaître le potentiel des technologies de knowledge about language technology and its poten- la langue. Il s’adresse en particulier aux journalistes, po- tial. It addresses journalists, politicians, language com- liticiens, communautés linguistiques, enseignants mais munities, educators and others. e availability and aussi à tous. La disponibilité et l’utilisation des techno- use of language technology in Europe vary between logies de la langue variant grandement d’une langue à languages. Consequently, the actions that are required l’autre en Europe, les actions nécessaires au soutien des to further support research and development of lan- activités de recherche et développement peuvent être guage technologies also differ. e required actions très différentes en fonction des langues selon des fac- depend on many factors, such as the complexity of a teurs multiples, comme leur complexité intrinsèque ou given language and the size of its community. -

THE SEVENTEENTH CENTURY PAUL SCOTT, University of Kansas
THE SEVENTEENTH CENTURY PAUL SCOTT, University of Kansas 1. GENERAL Orientalism and discussions of identity and alterity form part of an identifiable trend in our field during the coverage of the two calendar years. Another strong current is the concept of libertinage and its literary and social influence. In terms of the first direction, Nicholas Dew, Orientalism in Louis XlV's France, OUP, 2009, xv+301 pp., publishes an overview of what he terms 'baroque Orientalism' and explores the topos through chapters devoted to the production of texts by d'Herbelot, Bernier, and Thevenot which would have an important reception and influence during the 18th century. The network of the Republic of Letters was crucial in gaining access to and studying oriental works and, while this was a marginal presence during the period, D. reveals how the curiosity of vth-c. scholars would lay the foundations of work that would be drawn on by the philosophes. Duprat, Orient, is an apt complement to Dew's volume, and A. Duprat, 'Le fil et la trame. Motifs orientaux dans les litteratures d'Europe' (9-17) maintains that the depiction of the Orient in European lit. was a common attempt to express certain desires but, at the same time, to contain a general angst as a result of incorporating scientific progress and territorial expansion. Brian Brazeau, Writing a New France, 1604-1632: Empire and Early Modern French Identity, Farnham, Ashgate, 2009, x +132 pp., selects the period following the end of the Wars of Religion because this early period of colonization gave rise to some of the most enthusiastic accounts as well as the fact that they established the pioneering debate for future narratives. -

La Mémoire De La France Antarctique
La mémoire de la France Antarctique Frank LESTRINGANT* Résumé: Les fortunes de la France Antarctique du Brésil sont sans commune mesure avec la brièveté d'une expérience coloniale d'un lustre à peine, de novembre 1555 à mars 1560, restreinte de surcroît à un îlot et à l'immédiate proximité du littoral de la baie de Rio de Janeiro. Je partirai du jugement de l'abbé Prévost, l'auteur de l'immortelle Manon Lescaut, mais aussi de l'Histoire générale des voyages pour retracer la mémoire de la France Antarctique dans l'historiographie française. Mots-clés: France Antarctique; Mémoire; Prévost. Les fortunes de la France Antarctique du Brésil sont sans commune mesure avec la brièveté d'une expérience coloniale d'un lustre à peine, de novembre 1555 à mars 1560, restreinte de surcroît à un îlot et à l'immédiate proximité du littoral de la baie de Rio de Janeiro. Je partirai du jugement de l'abbé Prévost, l'auteur de l'immortelle Manon Lescaut, mais aussi de l'Histoire générale des voyages. Dans ce dernier ouvrage, Prévost recopie d'après Jean de Léry le "Colloque de l'auteur et d'un sauvage, montrant qu'ils ne sont si lourdauds qu'on les estimait"¹, passage que reprend l'abbé Raynal dans l'Histoire des deux Indes et qu'il commente ainsi : L'unique monument précieux de leurs courses infructueuses, est un dialogue qui peint d'autant mieux le bon sens naturel des sauvages, qu'il est écrit dans ce style naïf qui * Centre de recherche sur la création littéraire en France à la Renaissance – Université de Paris IV-Sorbonne – 75230 – Paris – França. -

Life Writing As Political Critique in the Spanish Habsburg Empire (1545-1557)
Life Writing as Political Critique in the Spanish Habsburg Empire (1545-1557) by Margaret Malia Spofford Xavier This thesis/dissertation document has been electronically approved by the following individuals: Garces,Maria Antonia (Chairperson) Cheyfitz,Eric T. (Minor Member) Castillo,Debra Ann (Minor Member) Cohen,Walter Isaac (Minor Member) LIFE WRITING AS POLITICAL CRITIQUE IN THE SPANISH HABSBURG EMPIRE (1545-1557) A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Margaret Malia Spofford Xavier August 2010 © 2010 Margaret Malia Spofford Xavier LIFE WRITING AS POLITICAL CRITIQUE IN THE SPANISH HABSBURG EMPIRE (1545-1557) Margaret Malia Spofford Xavier, Ph.D. Cornell University 2010 This dissertation examines works of life writing by “outlaws” —individuals who defied the sovereign’s law while remaining engaged with it— in the Spanish Habsburg Empire under Charles V, from 1545 to 1557. Life writing, as State-sponsored, official history (historia pro persona), focused on the lives of illustrious men and sovereigns, and was used during the early modern period as a tool of the Spanish Crown to reinforce its sovereignty. Such lives also held a synecdochal relationship to Spain’s emerging sense of national identity. As Emperor, Charles V accorded life writing unprecedented importance. Even as he sought after monarchia univeralis, he faced extreme challenges to his sovereignty during the period I study, including the crisis with the corsairs and the Ottoman Empire in the Mediterranean, the rebellion of the conquistadors in the Americas, and the schism of the Church and Empire as a result of the Reformation in Europe. -

Redalyc.La Mémoire De La France Antarctique
História (São Paulo) ISSN: 0101-9074 [email protected] Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Brasil LESTRINGANT, Frank La mémoire de la France Antarctique História (São Paulo), vol. 27, núm. 1, 2008, pp. 101-133 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho São Paulo, Brasil Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=221014796007 Comment citer Numéro complet Système d'Information Scientifique Plus d'informations de cet article Réseau de revues scientifiques de l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Espagne et le Portugal Site Web du journal dans redalyc.org Projet académique sans but lucratif, développé sous l'initiative pour l'accès ouverte La mémoire de la France Antarctique Frank LESTRINGANT* Résumé: Les fortunes de la France Antarctique du Brésil sont sans commune mesure avec la brièveté d'une expérience coloniale d'un lustre à peine, de novembre 1555 à mars 1560, restreinte de surcroît à un îlot et à l'immédiate proximité du littoral de la baie de Rio de Janeiro. Je partirai du jugement de l'abbé Prévost, l'auteur de l'immortelle Manon Lescaut, mais aussi de l'Histoire générale des voyages pour retracer la mémoire de la France Antarctique dans l'historiographie française. Mots-clés: France Antarctique; Mémoire; Prévost. Les fortunes de la France Antarctique du Brésil sont sans commune mesure avec la brièveté d'une expérience coloniale d'un lustre à peine, de novembre 1555 à mars 1560, restreinte de surcroît à un îlot et à l'immédiate proximité du littoral de la baie de Rio de Janeiro. Je partirai du jugement de l'abbé Prévost, l'auteur de l'immortelle Manon Lescaut, mais aussi de l'Histoire générale des voyages. -
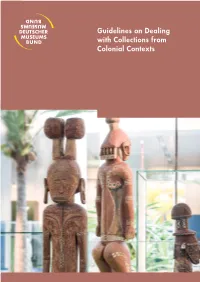
Guidelines on Dealing with Collections from Colonial Contexts
Guidelines on Dealing with Collections from Colonial Contexts Guidelines on Dealing with Collections from Colonial Contexts Imprint Guidelines on Dealing with Collections from Colonial Contexts Publisher: German Museums Association Contributing editors and authors: Working Group on behalf of the Board of the German Museums Association: Wiebke Ahrndt (Chair), Hans-Jörg Czech, Jonathan Fine, Larissa Förster, Michael Geißdorf, Matthias Glaubrecht, Katarina Horst, Melanie Kölling, Silke Reuther, Anja Schaluschke, Carola Thielecke, Hilke Thode-Arora, Anne Wesche, Jürgen Zimmerer External authors: Veit Didczuneit, Christoph Grunenberg Cover page: Two ancestor figures, Admiralty Islands, Papua New Guinea, about 1900, © Übersee-Museum Bremen, photo: Volker Beinhorn Editing (German Edition): Sabine Lang Editing (English Edition*): TechniText Translations Translation: Translation service of the German Federal Foreign Office Design: blum design und kommunikation GmbH, Hamburg Printing: primeline print berlin GmbH, Berlin Funded by * parts edited: Foreword, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Background Information 4.4, Recommendations 5.2. Category 1 Returning museum objects © German Museums Association, Berlin, July 2018 ISBN 978-3-9819866-0-0 Content 4 Foreword – A preliminary contribution to an essential discussion 6 1. Introduction – An interdisciplinary guide to active engagement with collections from colonial contexts 9 2. Addressees and terminology 9 2.1 For whom are these guidelines intended? 9 2.2 What are historically and culturally sensitive objects? 11 2.3 What is the temporal and geographic scope of these guidelines? 11 2.4 What is meant by “colonial contexts”? 16 3. Categories of colonial contexts 16 Category 1: Objects from formal colonial rule contexts 18 Category 2: Objects from colonial contexts outside formal colonial rule 21 Category 3: Objects that reflect colonialism 23 3.1 Conclusion 23 3.2 Prioritisation when examining collections 24 4. -

Colonial Failure in the New World in the Sixteenth Century: a French and German Comparison
1 School of History and Cultures Department of History Colonial Failure in the New World in the Sixteenth Century: a French and German Comparison Stefan Lang Supervisor: Dr Margaret Small 2 Abstract During the first half of the sixteenth century attempts were made by Europeans to colonise Venezuela and Canada, as the rush for land in the New World increased at pace. Yet these colonial attempts have largely been forgotten by history despite the legacies they left both for Europe and the American continent itself. There are two reasons why these ventures have been overlooked. Firstly, they were non-Iberian. Secondly, they both failed. The efforts of the Welser merchant-banking company to colonise Venezuela (1528-1556) and the French Crown to settle Canada (1541-1543) have been subordinated in the historical literature to the successful colonisation carried out by the Spanish and the Portuguese in the New World, which began at the end of the fifteenth century, and led to imperial empires. Indeed, the phenomenon of colonial failure as a whole has remained relatively unpopular amongst academics. Whilst some more “popular” failed colonies have been studied individually, there has been no comparative approach to determine the shared causes for failure amongst a number of unsuccessful enterprises during the sixteenth and seventeenth centuries. This work shall look to produce such a comparative, using the Welser and French colonies as case studies, given their underrepresentation in the literature. It shall use the few available primary sources, as well as foreign-language studies, to give a detailed understanding of the factors that caused the colonies to fail. -

BIBLIOTHÈQUE DU DOCTEUR POIRIER - 06 07 20 Docteur Poirier Docteur Bibliothèque Du Du Bibliothèque Lundi 6Juillet 2020 -Paris VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS
Bibliothèque du Docteur Poirier Lundi 6 juillet 2020 - Paris 06_07_20 BIBLIOTHÈQUE DU DOCTEUR POIRIER - POIRIER DOCTEUR DU BIBLIOTHÈQUE Pierre Bergé & associés Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 Paris 92 avenue d’Iéna 75116 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 Bruxelles Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65 www.pba-auctions.com VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS Bibliothèque du Docteur Poirier DATE DE LA VENTE / DATE OF THE AUCTION Lundi 6 juillet 2020 à 17 heures Monday, 6 July 2020 at 5:00 pm LIEU DE VENTE / LOCATION Atelier Richelieu 60, rue de Richelieu 75002 Paris EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIC VIEWING Dimanche 5 juillet de 12 heures à 18 heures 30 Lundi 6 juillet de 10 heures 30 à 17 heures Sunday, 5 July from 12:00 am to 6:30 pm Monday, 6 July from 10:30 am to 5:00 pm EXPOSITION PRIVÉE / PRIVATE VIEWING Librairie Rossignol - 2 rue Casimir Delavigne, 75006 Paris Vendredi 26 juin, samedi 27 juin et du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet 2020 de 10h à 12h et 14h à 18h From Monday 6 to Friday 10, April from 10:00 am to 12:30 am and 2:00 pm to 6:00 pm TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION PUBLIQUE ET LA VENTE CONTACT DURING VIEWINGS AND THE SALE T. +33 (0)9 63 21 03 15 CONTACTS POUR LA VENTE / CONTACTS FOR THE AUCTION Eric Masquelier T. -

Ideas, Beliefs, Strategic Culture, and Foreign Policy: Understanding Brazil's Geopolitical Thought
University of Central Florida STARS Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 2016 Ideas, Beliefs, Strategic Culture, and Foreign Policy: Understanding Brazil's Geopolitical Thought Marcos Rosas Degaut Pontes University of Central Florida Part of the Political Science Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/etd University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Doctoral Dissertation (Open Access) is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. STARS Citation Rosas Degaut Pontes, Marcos, "Ideas, Beliefs, Strategic Culture, and Foreign Policy: Understanding Brazil's Geopolitical Thought" (2016). Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019. 5105. https://stars.library.ucf.edu/etd/5105 IDEAS, BELIEFS, STRATEGIC CULTURE, AND FOREIGN POLICY: UNDERSTANDING BRAZIL’S GEOPOLITICAL THOUGHT by MARCOS DEGAUT M.A. Universidade de Brasília, 1999 B.A. Centro Universitário do Distrito Federal, 2005 B.A. Centro Universitário de Brasília, 1992 A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Political Science in the College of Sciences at the University of Central Florida Orlando, Florida Summer Term 2016 Major Professor: Roger Handberg © 2016 Marcos Degaut ii ABSTRACT Brazil is an important player both at regional and global levels, figuring prominently in almost all lists of emerging states and regional powers. It is one of the world's largest democracies, the fifth most populous country in the world, the world's seventh-largest economy, and Latin America's largest economy, accounting for approximately 60% of South America's GDP, 47% of South America's territory and 49% of South American population, a G20 member, and an active contributor to United Nations peacekeeping operations. -

LE MONDE/PAGES<UNE>
EN ÎLE-DE-FRANCE a Dans « aden » : tout le cinéma et une sélection de sorties Demandez notre supplément www.lemonde.fr 56e ANNÉE – Nº 17371 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE JEUDI 30 NOVEMBRE 2000 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Ethique Présidentielle : Lionel Jospin accélère et médecine b Partisan, pour 2002, d’une présidentielle avant les législatives, le premier ministre veut obtenir a Sondage : très vite cette inversion du calendrier b Les Verts, le PCF et le RPR y sont hostiles b VGE, Charles Pasqua, les Français François Bayrou, Raymond Barre la soutiennent b Les Français aussi b Jacques Chirac réfléchit font plus confiance RÉTICENT, dans un premier de file de la droite, François Bayrou, temps, à une inversion du calendrier président de l’UDF, Valéry Giscard aux scientifiques électoral de 2002, peu pressé d’en d’Estaing, Raymond Barre et Charles découdre sur ce sujet avec le prési- Pasqua sont favorables à l’inversion qu’aux politiques dent de la République, Lionel Jospin de l’ordre des élections. Un sondage a subitement décidé d’accélérer le IFOP-Le Figaro indique que 64 % des pour trancher mouvement. Il veut que l’élection Français sont pour, mais que 51 % VOYAGES les débats présidentielle ait lieu avant les élec- jugent qu’il s’agit d’une « manœuvre tions législatives, contrairement à ce politique ». que prévoit le calendrier actuel. Jacques Chirac, que cette affaire Plaisirs de a Euthanasie : Dimanche 26 novembre, devant le embarrasse, a fait donner ses relais congrès du Parti socialiste, il avait RPR, qui ne cessent de qualifier les les Pays-Bas simplement émis ce souhait afin de initiatives socialistes de « tripatouilla- la glisse « rétablir la cohérence » de l’exécutif.