Version Definitive Pour Site Limag
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PRISM Syrian Supplemental
PRISM syria A JOURNAL OF THE CENTER FOR COMPLEX OPERATIONS About PRISM PRISM is published by the Center for Complex Operations. PRISM is a security studies journal chartered to inform members of U.S. Federal agencies, allies, and other partners Vol. 4, Syria Supplement on complex and integrated national security operations; reconstruction and state-building; 2014 relevant policy and strategy; lessons learned; and developments in training and education to transform America’s security and development Editor Michael Miklaucic Communications Contributing Editors Constructive comments and contributions are important to us. Direct Alexa Courtney communications to: David Kilcullen Nate Rosenblatt Editor, PRISM 260 Fifth Avenue (Building 64, Room 3605) Copy Editors Fort Lesley J. McNair Dale Erikson Washington, DC 20319 Rebecca Harper Sara Thannhauser Lesley Warner Telephone: Nathan White (202) 685-3442 FAX: (202) 685-3581 Editorial Assistant Email: [email protected] Ava Cacciolfi Production Supervisor Carib Mendez Contributions PRISM welcomes submission of scholarly, independent research from security policymakers Advisory Board and shapers, security analysts, academic specialists, and civilians from the United States Dr. Gordon Adams and abroad. Submit articles for consideration to the address above or by email to prism@ Dr. Pauline H. Baker ndu.edu with “Attention Submissions Editor” in the subject line. Ambassador Rick Barton Professor Alain Bauer This is the authoritative, official U.S. Department of Defense edition of PRISM. Dr. Joseph J. Collins (ex officio) Any copyrighted portions of this journal may not be reproduced or extracted Ambassador James F. Dobbins without permission of the copyright proprietors. PRISM should be acknowledged whenever material is quoted from or based on its content. -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Im Meer der Stadt 14 ■ Gedichte beschreiben und deuten Städte erleben - Ich in der Stadt 16 Herbert Grönemeyer: Bochum (Lied) 16 Meni & Dave: Stuttgart-Hymne 17 „Ein Blick ins Auge, und vorüber schon“ - Der Einzelne und die Menge 19 Emil Nicolai: Straßenbild (Gedicht) 19 Erhard Rumpf: Industrialisierung und soziale Frage - Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen ändern sich (Sachtext) 20 Detlev von Liliencron: In einer großen Stadt (Gedicht) 22 Franz Werfel: Der rechte Weg (TraumJ(Gedicht) 23 Alfred Wolfenstein: Städter (Gedicht) 25 Carl Guesmer: Verkehrsunfall (Gedicht) 27 Peter Schneider: Auf der Straße (Gedicht) 28 „Die Zeit fährt Auto“ - Industrie und Technik, Kommerz und Konsum 29 Erich Kästner: Die Zeit fährt Auto (Gedicht) 29 Wolfdietrich Schnurre: Angriff (Gedicht) 31 Uwe Greßmann: Moderne Landschaft (Gedicht) 32 Olaf n. Schwanke: Fußgängerzone (Gedicht) 34 „Die Stadt beginnt ihr Lied“ - Von der Schönheit der großen Städte 35 Stefan Zweig: Sonnenaufgang in Venedig (Gedicht) 35 Wolf Graf von Kalckreuth: Amsterdam (Gedicht) 36 Siggi Weidemann: Entdecken Sie Amsterdam (Sachtext) 36 Heinz Zucker: Abend (Gedicht) 38 Eva Strittmatter: Herbst in Berlin (Gedicht) 39 Cassandra Steen featuring Adel Tawil: Stadt (Song) 40 Lernfortschritte im Blick 42 Kurze Geschichten, tiefer Sinn 44 ■ Erzähltexte beschreiben und deuten Alltägliche und andere Katastrophen 46 Peter Bichsei: Der Milchmann (Kurzgeschichte) 46 Ilse Aichinger: Das Fenstertheater (Kurzgeschichte) 49 Heinrich Böll: Monolog eines Kellners (Kurzgeschichte) 53 -
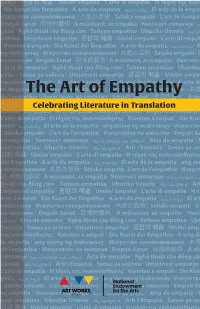
The Art of Empathy Translation.Pdf
共感の芸術 • Sztuka empatii • L’art de l’empathie • Изкуството на емпатия • Empati Sanat • 同情的藝術 • A Arta de empatie • Nghệ thuật của đồng • هبئاش یب یدردمه زا رنه • művészet, az empátia • Уметност емпатије -Arti i Empatia • Sanaa ya uelewa • Umjetnost em • فطاعتلا نف • cảm • Taiteen empatiaa • Ubuciko Uzwela patije • 공감의 예술 • Umění empatie • L’arte di empatia • Η τέχνη της ενσυναίσθησης • Kunsten å empati • El arte de la empatía • ang sining ng makiramay • یلدمه رنه • Die Kunst der Empathie • A arte da empatia • National Endowment for the Arts Искусство сопереживания • 共感の芸術 • Sztuka empatii • L’art de l’empathie • Изкуството на емпатия • -Arta de em • هبئاش یب یدردمه زا رنه • Empati Sanat • 同情的藝術 • A művészet, az empátia • Уметност емпатије Arti i Empatia • Sanaa ya • فطاعتلا نف • patie • Nghệ thuật của đồng cảm • Taiteen empatiaa • Ubuciko Uzwela uelewa • Umjetnost empatije • 공감의 예술 • Umění empatie • L’arte di empatia • Η τέχνη της ενσυναίσθησης El arte de la empatía • ang sining • یلدمه رنه • Kunsten å empati • Die Kunst der Empathie • A arte da empatia • ng makiramay • Искусство сопереживания • 共感の芸術 • Sztuka empatii • L’art de l’empathie • Изкуството هبئاش یب یدردمه زا رنه • на емпатия • Empati Sanat • 同情的藝術 • A művészet, az empátia • Уметност емпатије -Arti i Em • فطاعتلا نف • Arta de empatie • Nghệ thuật của đồng cảm • Taiteen empatiaa • Ubuciko Uzwela • patia • Sanaa ya uelewa • Umjetnost empatije • 공감의 예술 • Umění empatie • L’arte di empatia • Η τέχνη El arte de • یلدمه رنه • της ενσυναίσθησης • Kunsten å empati • Die Kunst der Empathie -

Berg Literature Festival Committee) Alexandra Eberhard Project Coordinator/Point Person Prof
HEIDELBERG UNESCO CITY OF LITERATURE English HEIDEL BERG CITY OF LITERATURE “… and as Carola brought him to the car she surprised him with a passionate kiss before hugging him, then leaning on him and saying: ‘You know how really, really fond I am of you, and I know that you are a great guy, but you do have one little fault: you travel too often to Heidelberg.’” Heinrich Böll Du fährst zu oft nach Heidelberg in Werke. Kölner Ausgabe, vol. 20, 1977–1979, ed. Ralf Schell and Jochen Schubert et. al., Kiepenheuer & Witsch Verlag, Cologne, 2009 “One thinks Heidelberg by day—with its surroundings—is the last possibility of the beautiful; but when he sees Heidelberg by night, a fallen Milky Way, with that glittering railway constellation pinned to the border, he requires time to consider upon the verdict.” Mark Twain A Tramp Abroad Following the Equator, Other Travels, Literary Classics of the United States, Inc., New York, 2010 “The banks of the Neckar with its chiseled elevations became for us the brightest stretch of land there is, and for quite some time we couldn’t imagine anything else.” Zsuzsa Bánk Die hellen Tage S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2011 HEIDEL BERG CITY OF LITERATURE FIG. 01 (pp. 1, 3) Heidelberg City of Literature FIG. 02 Books from Heidelberg pp. 4–15 HEIDELBERG CITY OF LITERATURE A A HEIDELBERG CITY OF LITERATURE The City of Magical Thinking An essay by Jagoda Marinic´ 5 I think I came to Heidelberg in order to become a writer. I can only assume so, in retro spect, because when I arrived I hadn’t a clue that this was what I wanted to be. -
The Cambridge Companion to the Modern German Novel Edited by Graham Bartram Frontmatter More Information
Cambridge University Press 978-0-521-48253-0 - The Cambridge Companion to the Modern German Novel Edited by Graham Bartram Frontmatter More information The Cambridge Companion to the Modern German Novel The Cambridge Companion to the Modern German Novel provides a wide- ranging introduction to the major trends in the development of the German novel from the 1890s to the present. Written by an international team of ex- perts, it encompasses both modernist and realist traditions, and also includes a look back to the roots of the modern novel in the Bildungsroman of the late eighteenth and nineteenth centuries. The structure is broadly chronologi- cal, but thematically focused chapters examine topics such as gender anxiety, images of the city, war and women’s writing; within each chapter, key works are selected for close attention. Unique in its combination of breadth of cover- age and detailed analysis of individual works, and featuring a chronology and guides to further reading, this Companion will be indispensable to students and teachers alike. © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-0-521-48253-0 - The Cambridge Companion to the Modern German Novel Edited by Graham Bartram Frontmatter More information © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-0-521-48253-0 - The Cambridge Companion to the Modern German Novel Edited by Graham Bartram Frontmatter More information THE CAMBRIDGE COMPANION TO THE MODERN GERMAN NOVEL EDITED BY -

GERM 452.01: 20Th Century Literature Since 1945
University of Montana ScholarWorks at University of Montana Syllabi Course Syllabi 1-2002 GERM 452.01: 20th Century Literature since 1945 Hiltrudis Arens University of Montana - Missoula, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/syllabi Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Arens, Hiltrudis, "GERM 452.01: 20th Century Literature since 1945" (2002). Syllabi. 3378. https://scholarworks.umt.edu/syllabi/3378 This Syllabus is brought to you for free and open access by the Course Syllabi at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Syllabi by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. Deutsch 452 Frühling 2002 20th Century Literature since 1945 Professor Hiltrud Arens Büro: LA 436 Sprechstunden: Die: 9:00- 10:00 Uhr; 12:00-13:00 Uhr MoMiFr :12:00-13:00 Uhr oder nach Vereinbarung Telefon: 243-5635 (Büro); 829-0636 (Privat) Email: [email protected] Ziel des Kurses ist folgendes: 1) eine Einführung in die deutsche Literatur dieser Zeit im Kontext literarischer, künstlerischer und sozialhistorischer (als auch politischer) Bedingungen und Bewegungen; 2) ausgewählte Texte (Prosa und Dramen) und einige Verfilmungen von 1945 bis zum Ende des 20.Jahrhunderts zu lesen, zu besprechen, zu interpretieren, zu sehen, und sie in ihre literarische / künstlerische Periode einzuordnen; Texte: Wolfgang Borchert Draussen vor der Tür Kurztexte/Gedichte von: Günter Eich, Erich Fried, Peter Weiss, Helmut Heissenbüttel, Paul Celan, M.L. Kaschnitz, Thomas Mann, etc. Ulrich Plenzdorf Die neuen Leiden des Jungen W. -

Bibliographie Germanistischer Bibliographien
Übersetzungen und Übersetzungstraditionen; Präsenz übersetzter Literatur in be- stimmten Zeiträumen hier wäre auch an kommentierte Bibliographien / Kataloge zu denken Orte der Wahrnehmung und des Austausches; Städte etwa, wie das Prag Karls IV. aber auch geographische Räume, etwa Grenzgebiete wie Triest und Südtirol Aufeinander bezogene Wissenschaftsgeschichte (z. B. Italianistik in Weimar, Ger- manistik in Florenz) Bildungserlebnisse von Literaten in der anderen Kultur Vermittler und vermittelnde Institutionen (Verlage und Verleger etwa, Kulturinstitute wie die Villa Massimo beispielsweise) Anfragen und Beiträge zum Rahmenthema werden an die Adresse der Redaktion oder an den Leiter des Themas erbeten: Prof. Dr. Michael Dallapiazza, Università di Urbino, Istituto di Lingue, Piazza Rinascimento 7, I-61029 Urbino (PU), [email protected] Bibliographie germanistischer Bibliographien Beschreibendes Auswahlverzeichnis germanistischer Sach- und Personalbibliographien 2004/2005 Von Winfried Giesen, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a. M. Hinweise Die vorliegende Folge verzeichnet neue selbständige und versteckte Bibliographien zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, die vom Mai 2004 bis November 2005 in den Bestand der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg aufgenommen worden sind. Die Auswahlkriterien der Materialerfassung sind unverändert geblieben. Die verzeichneten Titel werden systematisch erschlossen, um die Orientierung zu erleichtern und ggf. über den Sachinhalt zu informieren. -

The Construction of Ethnoreligious Identity Groups in Syria: Loyalties
Bridgewater State University Virtual Commons - Bridgewater State University Honors Program Theses and Projects Undergraduate Honors Program 5-13-2014 The onsC truction of Ethnoreligious Identity Groups in Syria: Loyalties and Tensions in the Syrian Civil War Eliott Rousseau Follow this and additional works at: http://vc.bridgew.edu/honors_proj Part of the Anthropology Commons Recommended Citation Rousseau, Eliott. (2014). Theon C struction of Ethnoreligious Identity Groups in Syria: Loyalties and Tensions in the Syrian Civil War. In BSU Honors Program Theses and Projects. Item 66. Available at: http://vc.bridgew.edu/honors_proj/66 Copyright © 2014 Eliott Rousseau This item is available as part of Virtual Commons, the open-access institutional repository of Bridgewater State University, Bridgewater, Massachusetts. The Construction of Ethnoreligious Identity Groups in Syria: Loyalties and Tensions in the Syrian Civil War Eliott Rousseau Submitted in Partial Completion of the Requirements for Commonwealth Honors in Anthropology Bridgewater State University May 13, 2014 Dr. Sandra Faiman-Silva, Thesis Director Dr. Jabbar Al-Obaidi, Committee Member Dr. Curtiss Hoffman, Committee Member Rousseau 2 Abstract The ongoing civil war in Syria is characterized by its inherent complexity, often leaving non-Syrian onlookers and geopolitical stakeholders confused and fatigued. In a war with such a high human toll—refugees hemorrhaging from Syria’s borders, the death toll ever-climbing, and a generation of children growing up with the fighting—there is no room for mystification. This research project contextualizes the Syrian Civil War using anthropological concepts of religion and ethnicity. The ways in which religion and ethnicity help construct identity and group loyalty among Syria’s diverse population are examined. -

BRINING-DISSERTATION-2016.Pdf
Copyright by Holly Renee Brining 2016 The Dissertation Committee for Holly Renee Brining Certifies that this is the approved version of the following dissertation: Spouses, Lovers, and Other Strangers: Men, Women, and Relationships in the Works of Rafik Schami Committee: Kirsten Belgum, Supervisor Kirkland Fulk Barbara Harlow Peter Hess Sandra Straubhaar Spouses, Lovers, and Other Strangers: Men, Women, and Relationships in the Works of Rafik Schami by Holly Renee Brining, B.S., M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May 2016 Dedication For my parents, Robert and M. Judith Brining, my grandparents, Arthur and Doris Hancock, and my husband, Scott Stuhlmann. Spouses, Lovers, and Other Strangers: Men, Women, and Relationships in the Works of Rafik Schami Holly Renee Brining, Ph.D. The University of Texas at Austin, 2016 Supervisor: Kirsten Belgum Syrian-German author Rafik Schami has a literary career spanning approximately thirty years. Although his native Syria often forms the backdrop for his stories, Schami’s intended audience is clearly German-speaking because he composes his works in German. As most of the discourse on minority literature in Germany focuses on Turkish- German literature, an examination of Schami’s texts would offer another perspective on this phenomenon. This dissertation project focuses on several novels from Rafik Schami, including Reise zwischen Nacht und Morgen, Die dunkle Seite der Liebe, Die Sehnsucht der Schwalbe, and Das Geheimnis des Kalligraphen, all of which thematize various types of interpersonal relationships, including familial and romantic. -

LEKTÜRELISTE Zur Deutschsprachigen Literatur Für Das Bachelor-Studium (Beschlossen Durch Die Institutsversammlung Vom 07
Institut für Germanistik II LEKTÜRELISTE zur deutschsprachigen Literatur für das Bachelor-Studium (Beschlossen durch die Institutsversammlung vom 07. Juni 2006) Vorbemerkung: Die nachstehende Lektüreliste ist dem Hauptfach und dem Nebenfach Deutsche Sprache und Literatur im BA-Studiengang obligatorisch zugeordnet. Das Abarbeiten dieser Liste wird im Hauptfach und im Nebenfach mit jeweils 3 LP kreditiert. Die Inhalte der in der Lektüreliste vorgesehenen Literatur sind im Haupt- und Nebenfach nach Maßgabe einer Verabredung mit dem jeweiligen Prüfer bzw. der jeweiligen Prüferin Bestandteile der Modulprüfungen in der Vertiefungsphase. – Als Hinweis zum praktischen Umgang mit der Liste sei angefügt, daß die genannten Titel nicht als einzige Vorschläge zu verstehen sind; innerhalb des Werks eines Autors können auch andere, ähnliche Werke gewählt werden. 1620 – 1700 LYRIK EPIK Von 2 der folgenden Verfasser je 4 2 der folgenden Erzählwerke: Gedichte: Hans Jacob Christoffel von Simon Dach Grimmelshausen: Paul Gerhardt Der abenteurliche Simplicissimus Paul Fleming Teutsch; Andreas Gryphius Lebensbeschreibung der Christian Hofmann von Hofmannswaldau Landstörzerin Courasche; Angelus Silesius Das Wunderbarliche Vogelnest Catharina Regina von Greiffenberg Heinrich Anshelm von Zigler und DRAMA Kliphausen: 2 der folgenden Dramen: Die Asiatische Banise Andreas Gryphius: Christian Reuter: Carolus Stuardus; Schelmuffskys wahrhaftige und Catharina von Georgien; curiöse Reisebeschreibung Papinian WEITERES Daniel Casper von Lohenstein: Eine der folgenden Schriften: Cleopatra; Sophonisbe Martin Opitz Buch von der Deutschen Poeterey Christian Weise: Bäurischer Machiavellus; Friedrich von Logau: Masaniello Sinngedichte (Auswahl) Johann Rist: Das alleredelste Naß; Das alleredelste Leben 2 1700–1770 LYRIK EPIK Von 2 der folgenden Verfasser je 4 Eines der folgenden Erzählwerke: Gedichte: Johann Gottfried Schnabel: Barthold Hinrich Brockes Die Insel Felsenburg (Bd. -

Collecting to the Core — Gegenwartsromane, Contemporary German-Language Novels
Against the Grain Manuscript 8447 Collecting to the Core — Gegenwartsromane, Contemporary German-Language Novels Heidi Madden Anne Doherty Follow this and additional works at: https://docs.lib.purdue.edu/atg Part of the Library and Information Science Commons This document has been made available through Purdue e-Pubs, a service of the Purdue University Libraries. Please contact [email protected] for additional information. Interview — Theodore Pappas from page 46 Collecting to the Core — seconds. That’s why verified, reliable, curated Gegenwartsromane, Contemporary content like that offered by Britannica is only growing in importance in an age of fake news German-Language Novels and misinformation. That’s why an increasing number of companies (and the ministries of ed- by Heidi Madden (Librarian for Western European Studies, Duke University; ucation of countries around the world) want to Germanic Languages and Literature Subject Editor, Resources for College Libraries) partner with Britannica, because they realize <[email protected]> the importance of reliable information and the companies that produce it. Column Editor: Anne Doherty (Resources for College Libraries Project Editor, ATG: However, you still do some print CHOICE/ACRL) <[email protected]> publishing. We noticed that Britannica’s 250th anniversary collector’s edition — your final yearbook — is a print product. In fact, Column Editor’s Note: The “Collecting popular attention with her book Feuchtgebiete / you are listed as the author. Can you tell us to the Core” column highlights monographic Wetlands (2008), but she is not (yet) considered about that project? works that are essential to the academic li- a core author. Similarly, Jenny Erpenbeck (b. -

INFORMATIONEN ZUR DEUTSCHDIDAKTIK Ktassiker Mnm Miniaturen
I Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule INFORMATIONEN ZUR DEUTSCHDIDAKTIK 19. Jahrgang, Heft 211995 (neue Folge) Thema: Ktassiker Mnm Miniaturen Edltott¡l J oham Holmer lWerner Wíntersteiner : Edifonal 4 U¡gEzln Veranstaltungen 7 Der gute Tip I Baza¡ 10 Neue Bücher T3 Konzepte Werner WíntersteinerlJohnnn Holmer : Die östeneichische Literatur im Deutschunterricht. Anmerkungen zur Kanonfrage . 17 Ernst Seibert: Zweifellose und zweifelhafte Klassiker. Der Platz der Kinder- und Jugendliteratur in der österreichischen Literatur- geschichte 27 Eda Sagarra.' Osteneichische Literatur - ar¡s der Ferne 36 Beschciftlgung mtt der Karcryfrage Ist unuerzlchtbar.. Dle antl- tradtttonaltsttsche, antt-kanonlsche Geste entgeht dem nlcht, uas ste verwtdt: Entschetdungen über Llteratur zu tre;ffen, Dlese Ent' scheldungen sollen mögllchst bewr$t und tranæparent seln. (H oLzN ER / W INTERs r¿¡¡æR) Mlntatu¡en Gerhard Scheit: Die Komik des Traurigen: Ferdinand Raimund 46 Gerhard Scheit: Der christlich-versöhnliche Theatercoup. Über den Schluß von Grillparzers >Jüdin von Tbledo< 58 Primus-Heinz Kuclrcr: "The happiness of still life?". Ztt Charles Sealsfields Gteneichschrift >Austria as it is< . .,,,62 ts. rc.E[2tss 3 Jürgen Hein: Zwischen Unterhaltung und Sozialkritik: Johann Nestroy 66 Klaus Amann: Adalbert Stifter: >Die Sonnenfinsterniß am 8. July 1&12< 72 Karlheinz Rossbacher: Der Föderalismus des Gefühls: Marie von Ebner-Eschenbach 80 Konstanze Fliedl: Ich, Arthur Schnitzler . 86 Gerald Krieghofer.' Karl K¡aus als Dummheitsforscher und Sprachlehrer 9I Arno Rufiegger.' Aufklärer. Spion. Soldat. Dichter. Privatmann. Die Selbstentrvürfe des Robert Musil 99 Juliane Vogel: Hugo von Hofmannsthal: >Age of Innocence< . 110 Hans Höller.' "Der größte Experte der Macht". Kafkas Verfrem- dungstechnik. rt4 Klemens Renoldner: Erinnerungen an Europa. Stefan Zweig: >Welt von gestern< LL7 Walter Methlagl: Georg Trakl: >In ein altes Stammbuch< t20 Karlheinz Rossbacher: Der Einbruch des Journalisten in die Nach- welt: Joseph Roth 128 Daniela" Strigl: Die Sprache der Knechte.