Consulter/Télécharger
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
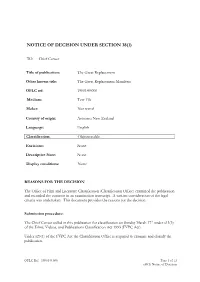
Download the Classification Decision for the Great
NOTICE OF DECISION UNDER SECTION 38(1) TO: Chief Censor Title of publication: The Great Replacement Other known title: The Great Replacement Manifesto OFLC ref: 1900149.000 Medium: Text File Maker: Not stated Country of origin: Aotearoa New Zealand Language: English Classification: Objectionable. Excisions: None Descriptive Note: None Display conditions: None REASONS FOR THE DECISION The Office of Film and Literature Classification (Classification Office) examined the publication and recorded the contents in an examination transcript. A written consideration of the legal criteria was undertaken. This document provides the reasons for the decision. Submission procedure: The Chief Censor called in this publication for classification on Sunday March 17th under s13(3) of the Films, Videos, and Publications Classification Act 1993 (FVPC Act). Under s23(1) of the FVPC Act the Classification Office is required to examine and classify the publication. OFLC Ref: 1900149.000 Page 1 of 13 s38(1) Notice of Decision Under s23(2) of the FVPC Act the Classification Office must determine whether the publication is to be classified as unrestricted, objectionable, or objectionable except in particular circumstances. Section 23(3) permits the Classification Office to restrict a publication that would otherwise be classified as objectionable so that it can be made available to particular persons or classes of persons for educational, professional, scientific, literary, artistic, or technical purposes. Synopsis of written submission(s): No submissions were required or sought in relation to the classification of the text. Submissions are not required in cases where the Chief Censor has exercised his authority to call in a publication for examination under section 13(3) of the FVPC Act. -

How White Supremacy Returned to Mainstream Politics
GETTY CORUM IMAGES/SAMUEL How White Supremacy Returned to Mainstream Politics By Simon Clark July 2020 WWW.AMERICANPROGRESS.ORG How White Supremacy Returned to Mainstream Politics By Simon Clark July 2020 Contents 1 Introduction and summary 4 Tracing the origins of white supremacist ideas 13 How did this start, and how can it end? 16 Conclusion 17 About the author and acknowledgments 18 Endnotes Introduction and summary The United States is living through a moment of profound and positive change in attitudes toward race, with a large majority of citizens1 coming to grips with the deeply embedded historical legacy of racist structures and ideas. The recent protests and public reaction to George Floyd’s murder are a testament to many individu- als’ deep commitment to renewing the founding ideals of the republic. But there is another, more dangerous, side to this debate—one that seeks to rehabilitate toxic political notions of racial superiority, stokes fear of immigrants and minorities to inflame grievances for political ends, and attempts to build a notion of an embat- tled white majority which has to defend its power by any means necessary. These notions, once the preserve of fringe white nationalist groups, have increasingly infiltrated the mainstream of American political and cultural discussion, with poi- sonous results. For a starting point, one must look no further than President Donald Trump’s senior adviser for policy and chief speechwriter, Stephen Miller. In December 2019, the Southern Poverty Law Center’s Hatewatch published a cache of more than 900 emails2 Miller wrote to his contacts at Breitbart News before the 2016 presidential election. -

Different Shades of Black. the Anatomy of the Far Right in the European Parliament
Different Shades of Black. The Anatomy of the Far Right in the European Parliament Ellen Rivera and Masha P. Davis IERES Occasional Papers, May 2019 Transnational History of the Far Right Series Cover Photo: Protesters of right-wing and far-right Flemish associations take part in a protest against Marra-kesh Migration Pact in Brussels, Belgium on Dec. 16, 2018. Editorial credit: Alexandros Michailidis / Shutter-stock.com @IERES2019 Different Shades of Black. The Anatomy of the Far Right in the European Parliament Ellen Rivera and Masha P. Davis IERES Occasional Papers, no. 2, May 15, 2019 Transnational History of the Far Right Series Transnational History of the Far Right Series A Collective Research Project led by Marlene Laruelle At a time when global political dynamics seem to be moving in favor of illiberal regimes around the world, this re- search project seeks to fill in some of the blank pages in the contemporary history of the far right, with a particular focus on the transnational dimensions of far-right movements in the broader Europe/Eurasia region. Of all European elections, the one scheduled for May 23-26, 2019, which will decide the composition of the 9th European Parliament, may be the most unpredictable, as well as the most important, in the history of the European Union. Far-right forces may gain unprecedented ground, with polls suggesting that they will win up to one-fifth of the 705 seats that will make up the European parliament after Brexit.1 The outcome of the election will have a profound impact not only on the political environment in Europe, but also on the trans- atlantic and Euro-Russian relationships. -

Reading Houellebecq and His Fictions
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2018 Reading Houellebecq And His Fictions Sterling Kouri University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Recommended Citation Kouri, Sterling, "Reading Houellebecq And His Fictions" (2018). Publicly Accessible Penn Dissertations. 3140. https://repository.upenn.edu/edissertations/3140 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/3140 For more information, please contact [email protected]. Reading Houellebecq And His Fictions Abstract This dissertation explores the role of the author in literary criticism through the polarizing protagonist of contemporary French literature, Michel Houellebecq, whose novels have been both consecrated by France’s most prestigious literary prizes and mired in controversies. The polemics defining Houellebecq’s literary career fundamentally concern the blurring of lines between the author’s provocative public persona and his work. Amateur and professional readers alike often assimilate the public author, the implied author and his characters, disregarding the inherent heteroglossia of the novel and reducing Houellebecq’s works to thesis novels necessarily expressing the private opinions and prejudices of the author. This thesis explores an alternative approach to Houellebecq and his novels. Rather than employing the author’s public figure to read his novels, I proceed in precisely the opposite -

Page 9 H-France Review Vol. 1 (February 2001), No. 3 Alice Kaplan
H-France Review Volume 1 (2001) Page 9 H-France Review Vol. 1 (February 2001), No. 3 Alice Kaplan, The Collaborator: The Trial and Execution of Robert Brasillach. Chicago: University of Chicago, 2000. xvi + 308pp. Notes and index. $25.00 (cl). ISBN 0-226-42414-6. Megan Koreman, The Expectation of Justice: France 1944-1946. Durham: Duke University Press, 1999. xviii + 340pp. Notes, maps, index and bibliography. ISBN 0-8223-2373-7. Review by Robert Zaretsky, Honors College, University of Houston. Alice Kaplan’s important book brings Camus' name to mind. Albert Camus, of course: editor of the resistance paper Combat, author of the classic account of Occupied France, The Plague, and embattled conscience of postwar France. Camus played a signal role in the Brasillach affair, crossing swords with François Mauriac over the competing imperatives of justice and mercy. Camus at first held that France’s future depended upon delivering exemplary, severe punishment to those who had betrayed the nation. Yet, when presented with a petition to commute the death sentence of Brasillach, accused of treason, Camus signed it. He explained: “I’ve always held the death penalty in horror and judged that, at least as an individual, I couldn’t participate in it, even by abstention. That’s all. And this is a scruple that I suppose would make Brasillach’s friend laugh.” Camus signed neither for the writer, whom he found insignificant, nor the individual, whom he despised; instead, moral scruple dictated his decision. A second Camus, however, hovers over this book: Renaud Camus. During most of 2000, Paris intellectuals were boxing one another’s ears over the publication of the lesser Camus’ journal La Campagne de France. -
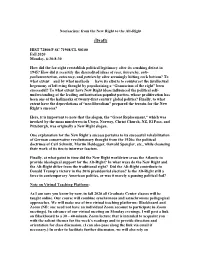
Wolin Neofascism
Neofascism: from the New Right to the Alt-Right (Draft) HIST 72800/P SC 71908/CL 80100 Fall 2020 Monday, 6:30-8:30 How did the far-right reestablish political legitimacy after its crushing defeat in 1945? How did it recertify the discredited ideas of race, hierarchy, anti- parliamentarism, autocracy, and patriarchy after seemingly hitting rock bottom? To what extent – and by what methods – have its efforts to counteract the intellectual hegemony of left-wing thought by popularizing a “Gramscism of the right” been successful? To what extent have New Right ideas influenced the political self- understanding of the leading authoritarian populist parties, whose proliferation has been one of the hallmarks of twenty-first century global politics? Finally, to what extent have the depredations of “neo-liberalism” prepared the terrain for the New Right’s success? Here, it is important to note that the slogan, the “Great Replacement,” which was invoked by the mass murderers in Utoya, Norway, Christ Church, NZ, El Paso, and Pittsburgh, was originally a New Right slogan. One explanation for the New Right’s success pertains to its successful rehabilitation of German conservative revolutionary thought from the 1920s: the political doctrines of Carl Schmitt, Martin Heidegger, Oswald Spengler, etc., while cleansing their work of its ties to interwar fascism. Finally, at what point in time did the New Right worldview cross the Atlantic to provide ideological support for the Alt-Right? In what ways do the New Right and the Alt-Right differ from the traditional right? Did the Alt-Right contribute to Donald Trump’s victory in the 2016 presidential election? Is the Alt-Right still a force in contemporary American politics, or was it merely a passing political fad? Note on Virtual Teaching Platform: As I am sure you know by now, in fall 2020 all Graduate Center classes will be taught online. -

Inter-Ethnic Relationships in Franco-Arab Literature Mehammed Mack Smith College, [email protected]
Masthead Logo Smith ScholarWorks French Studies: Faculty Publications French Studies 2014 Untranslatable Desire: Inter-Ethnic Relationships in Franco-Arab Literature Mehammed Mack Smith College, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.smith.edu/frn_facpubs Part of the Comparative Literature Commons, and the French and Francophone Literature Commons Recommended Citation Mack, Mehammed, "Untranslatable Desire: Inter-Ethnic Relationships in Franco-Arab Literature" (2014). French Studies: Faculty Publications, Smith College, Northampton, MA. https://scholarworks.smith.edu/frn_facpubs/3 This Article has been accepted for inclusion in French Studies: Faculty Publications by an authorized administrator of Smith ScholarWorks. For more information, please contact [email protected] Untranslatable Desire: Inter-Ethnic Relationships in Franco-Arab Literature Mehammed Amadeus Mack Upon their emergence, a certain generation of North Africa-born Francophone writers—Rachid Boudjedra, Assia Djebar, and Tahar Ben Jelloun—met with a critical reception that focused a special attention on the exploration of gender and sexuality in their work. They were celebrated for boldly discussing “alternative” sexuality and non-normative gender expressions at the fringes of North African culture. Yet what might be considered “fringe” was perhaps not intended as such by the authors, who often located outwardly transgressive acts in longstanding precedents, as Tahar Ben Jelloun did with cross-dressing in The Sand Child.1 This introduces the seemingly paradoxical notion of the “traditionally eccentric,” or that common space within most every society for the expression of eccentricity. By exploring sexuality, and especially sexual “eccentricity,” Franco-Arab and North African immigrant writers can become intelligible to, and resonate with, a French readership already curious about gender and sexual transgression in the Muslim world, a world often defined in terms of stricture. -

Charles Maurras and His Influence on Right-Wing Political
1 THE REVENGE OF DREYFUS: CHARLES MAURRAS AND HIS INFLUENCE ON RIGHT-WING POLITICAL DISCOURSE by Samuel D. Jenkins Honors Thesis Appalachian State University Submitted to the Department of History and The Honors College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts May, 2019 Approved by: _____________________________________________________ Michael C. Behrent, P.h.D., Thesis Director _____________________________________________________ Garrett McDowell, P.h.D., Second Reader _____________________________________________________ Ralph E. Lentz II, M.A., Third Reader _____________________________________________________ Michael C. Behrent, P.h.D., Department of History, Honors Director _____________________________________________________ Jefford Vahlbusch, P.h.D., Dean, The Honors College 2 Abstract This thesis was born out of an interest in the recent surge of far-right nationalism in the 21st century and a curiosity about whether or not an analysis of the far-right surge in the early twentieth century can be used to better understand it. It includes an analysis of Charles Maurras, the founder of the French far right tradition, as well as a comparison between his ideas and the ideas of his ideological successors. In this thesis, I argue that Maurras employs a synthesis of two elements of thought: an aesthetic traditionalism, which prioritizes tradition, order, and cultural continuity, and a territorial xenophobia, which attacks foreigners and anti-French influences as unhealthy for France. Elements of aesthetic traditionalism are found to be admired and used by thinkers such as T.S. Eliot, while elements of his territorial xenophobia are found in the discourse surrounding contemporary far right movements. Both elements, although never both found together, are reflected in the ideas of nationalist figures and movements post-Maurras in order to respond to a perceived national degradation. -
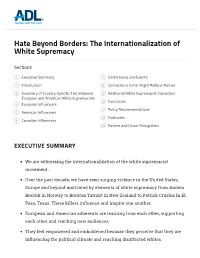
Hate Beyond Borders: the Internationalization of White Supremacy
Hate Beyond Borders: The Internationalization of White Supremacy Sections 1 Executive Summary 7 Conferences and Events 2 Introduction 8 Connections to Far-Right Political Parties 3 Summary of Country-Specific Ties Between 9 Additional White Supremacist Interaction European and American White Supremacists 10 Conclusion 4 European Influencers 11 Policy Recommendations 5 American Influencers 12 Footnotes 6 Canadian Influencers 13 Partner and Donor Recognition EXECUTIVE SUMMARY We are witnessing the internationalization of the white supremacist movement. Over the past decade, we have seen surging violence in the United States, Europe and beyond motivated by elements of white supremacy from Anders Breivik in Norway to Brenton Tarrant in New Zealand to Patrick Crusius in El Paso, Texas. These killers influence and inspire one another. European and American adherents are learning from each other, supporting each other and reaching new audiences. They feel empowered and emboldened because they perceive that they are influencing the political climate and reaching disaffected whites. 1 / 75 Global access to white supremacist ideology, and its easy dissemination across borders via various social media platforms, means many of the ideas promoted by the white supremacist movement — curtailing of non-white immigration, attacks on globalization and the accompanying conspiracies about elitist globalists — are increasingly part of mainstream political and social rhetoric. Exposing and understanding the connections among white supremacists and the paths by which they spread their hate are the first steps toward countering them. This report lays that groundwork, but continued vigilance and urgent action are necessary. Political leaders, law enforcement, social media companies, and educators have important roles to play and responsibilities to uphold. -

"In My Church We Don't Believe in Homosexuals": Queer Identity and Dominant Culture in Three Texts of the AIDS Era
University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School 5-31-2010 "In My Church We Don't Believe in Homosexuals": Queer Identity and Dominant Culture in Three Texts of the AIDS Era Steven Cooper University of South Florida Follow this and additional works at: https://scholarcommons.usf.edu/etd Part of the American Studies Commons Scholar Commons Citation Cooper, Steven, ""In My Church We Don't Believe in Homosexuals": Queer Identity and Dominant Culture in Three Texts of the AIDS Era" (2010). Graduate Theses and Dissertations. https://scholarcommons.usf.edu/etd/3439 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. “In My Church We Don't Believe in Homosexuals”: Queer Identity and Dominant Culture in Three Texts of the AIDS Era by Steven C. Cooper A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Department of English College of Arts and Sciences University of South Florida Major Professor: Gary Lemons, Ph.D. Hunt Hawkins, Ph.D. Ylce Irizarry, Ph.D. Date of Approval: April 16, 2010 Keywords: Angels in America, Blackbird, Tricks, Larry Duplechan, Renaud Camus, Tony Kushner © Copyright 2010 , Steven C. Cooper Dedication For David Acknowledgments I would like to express special gratitude to all of the members of my committee for their thoughtful input and consideration of my work. I am also indebted to the tireless work of the Department of English's faculty and staff. -

Panique Sécuritaire Et Panique Identitaire: Quelques Usages De 'L
Panique sécuritaire et panique identitaire : quelques usages de ‘l’insécurité’ Laurent Mucchielli To cite this version: Laurent Mucchielli. Panique sécuritaire et panique identitaire : quelques usages de ‘l’insécurité’. Paniques identitaires. Identité(s) et idéologie(s) au prisme des sciences sociales, Editions du Cro- quant, 2017, 9782365121118. hal-01631143 HAL Id: hal-01631143 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01631143 Submitted on 21 Mar 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Panique sécuritaire et panique identitaire Laurent Mucchielli Aix Marseille Univ, CNRS, LAMES, Aix-en-Provence, France Laboratoire méditerranéen de sociologie UMR 7305 - Aix Marseille Université - CNRS Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647 13094 Aix-en-Provence http://lames.cnrs.fr Panique sécuritaire et panique identitaire : quelques usages de « l’insécurité » Laurent Mucchielli 1 A Nice, le 14 juillet 2016, à 22h30, au volant d’un camion de 19 tonnes, un meurtrier-suicidaire fonçait dans la foule et tuait 86 personnes venues assister au traditionnel feu d’artifice de la fête nationale sur la Promenade des Anglais. Quelques heures plus tard, au petit matin, tandis que les enquêteurs de police étaient en train d’étudier la « scène de crime » à quelques dizaines de mètres de là et que de nombreuses personnes cherchaient encore leurs proches dont ils étaient sans nouvelle, Christian Estrosi se présentait devant les micros des journalistes. -

Uniting the Far Right: How the Far-Right Extremist, New Right, and Populist Frames Overlap on Twitter – a German Case Study
European Societies ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/reus20 Uniting the far right: how the far-right extremist, New Right, and populist frames overlap on Twitter – a German case study Reem Ahmed & Daniela Pisoiu To cite this article: Reem Ahmed & Daniela Pisoiu (2020): Uniting the far right: how the far-right extremist, New Right, and populist frames overlap on Twitter – a German case study, European Societies, DOI: 10.1080/14616696.2020.1818112 To link to this article: https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1818112 Published online: 13 Oct 2020. Submit your article to this journal Article views: 4 View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=reus20 EUROPEAN SOCIETIES https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1818112 Uniting the far right: how the far-right extremist, New Right, and populist frames overlap on Twitter – a German case study Reem Ahmed a and Daniela Pisoiu b aUniversity of Hamburg, Hamburg, Germany; bAustrian Institute for International Affairs, Austria ABSTRACT Recent elections in Europe have demonstrated a steady rise in the success of right-wing populist parties. While advancing an anti-immigration agenda, these parties have been adamant to distance themselves from ‘right-wing extremism’. This article analyses a sample of tweets collected from the Twitter accounts of the German AfD, Identitarian Movement and the Autonomous Nationalists by employing frame analysis. We conclude that the frames of far-right actors classified as extremist, New Right, and populist in fact converge and we discuss our findings in the context of related case studies in other European countries.