Memoria Satului Românesc 2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre Their History and Their Traditions
Center for Basque Studies Basque Classics Series, No. 6 The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre Their History and Their Traditions by Philippe Veyrin Translated by Andrew Brown Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada This book was published with generous financial support obtained by the Association of Friends of the Center for Basque Studies from the Provincial Government of Bizkaia. Basque Classics Series, No. 6 Series Editors: William A. Douglass, Gregorio Monreal, and Pello Salaburu Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada 89557 http://basque.unr.edu Copyright © 2011 by the Center for Basque Studies All rights reserved. Printed in the United States of America Cover and series design © 2011 by Jose Luis Agote Cover illustration: Xiberoko maskaradak (Maskaradak of Zuberoa), drawing by Paul-Adolph Kaufman, 1906 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Veyrin, Philippe, 1900-1962. [Basques de Labourd, de Soule et de Basse Navarre. English] The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre : their history and their traditions / by Philippe Veyrin ; with an introduction by Sandra Ott ; translated by Andrew Brown. p. cm. Translation of: Les Basques, de Labourd, de Soule et de Basse Navarre Includes bibliographical references and index. Summary: “Classic book on the Basques of Iparralde (French Basque Country) originally published in 1942, treating Basque history and culture in the region”--Provided by publisher. ISBN 978-1-877802-99-7 (hardcover) 1. Pays Basque (France)--Description and travel. 2. Pays Basque (France)-- History. I. Title. DC611.B313V513 2011 944’.716--dc22 2011001810 Contents List of Illustrations..................................................... vii Note on Basque Orthography......................................... -

Biarritz France
BIARRITZ FRANCE MEETING & TRAVEL PLANNER GUIDEGUIDE DESDES PROFESSIONNELSPROFESSIONNELS DUDU TOURISMETOURISME D’AFFAIRESD’AFFAIRES ETET DEDE LOISIRS.LOISIRS. 1 SOMMAIRE /SUMMARY P.3D ‣ ESTINATION BIARRITZ ‣ BIARRITZ ‣ P.18 ‣ À FAIRE & À VOIR ‣ TO DO AROUND P.34 ‣ CENTRES DE CONGRÈS ‣ CONVENTION AND EXHIBITION CENTERS I P. 36 ‣ LE BELLEVUE p. 40 ‣ LE CASINO MUNicipal p. 44 ‣ LA GARE DU MIDI p. 48 ‣ LA HALLE D’IRATY B P.54 ‣ HEBERGEMENT R ‣ accoMModation P.70G ‣ A ENCES RÉCEPTIVES ‣ DMC/PCO A P. 86 ‣ LIEUX ÉVÈNEMENTIELS ‣ VENUES 1 P. 98 ‣ SERVICES & PRESTATAIRES ‣ SERVICES RI Z DESTINATION « JE NE SACHE PAS D’ENDROIT PLUS CHARMANT ET PLUS « I KNOW OF NO OTHER PLACE MORE CHARMING OR ‣ MAGNIFIQUE QUE IARRITZ ICTOR UGO MAGNIFICENT THAN IARRITZ ICTOR UGO B … » V H B … » V H VOILÀ PEUT-ÊTRE POURQUOI NOS CLIENTS REVIENNENT PLUS TTHIS MAY EXPLAIN WHY OUR CUSTOMERS COME BACK MORE SOUVENT QUE D’HABITUDE ET QUE LE NOMBRE DE PARTICI- OFTEN AND WHY THE NUMBER OF PARTICIPANTS AT PANTS À UN CONGRÈS EST TOUJOURS PLUS IMPORTANT SUR A CONGRESS IN BIARRITZ IS ALWAYS LARGER. BIARRITZ. 2 3 ‣ LES accÈS ACCESS EN avion… EN TRAIN… EN voiture… /BY PLANE… /By TRAIN… /BY CAR… BIARRITZ BIARRITZ AUtoroUTE NORD-SUD ET FRANCE : PARIS Orly, PARIS PARIS MONTparNASSE, Est-OUest DE LA FRANCE : CDG, MARSEILLE, LyoN, Bordeaux. HIGWAYS NORTH-SOUTH STRASBOURG, LILLE, NICE. HendaYE : AND EAST-WEST EUROPE : DUBLIN, GENÈVE, MADRID BarceloNE, Bilbao, STOCKHOLM, LONDRES, TOULOUSE Bordeaux, MADRID, Bruxelles, COPENHAGUE, MARSEILLE, MONTPELLIER, HELSINKI, BOURNEMOUTH, NANTES, PARIS, Pau, BIRMINGHAM. Toulouse… PAU vols DIRECTS / DIRECT FLIGHT PARIS Orly, PARIS CDG, MARSEILLE, LyoN, AJaccio, BASTIA. -

Particularities of the Functional Profile and Urban Relations in Post-Socialist Lugoj Municipality
PARTICULARITIES OF THE FUNCTIONAL PROFILE AND URBAN RELATIONS IN POST-SOCIALIST LUGOJ MUNICIPALITY IOAN SEBASTIAN JUCU∗ Key-words: functional profile, urban functions, urban relations, economic transition, Lugoj municipality. Quelques considérations sur le spécifique du profil fonctionnel et des relations urbaines dans la période post-socialiste de la municipalité de Lugoj. Le profil fonctionnel d’une ville est déterminé par son héritage historique, son évolution sociale et économique, par ses traditions mises en évidence petit à petit et par les effets des systèmes politiques qui l’a gouverné à diverses périodes. Le profil fonctionnel de la ville de Lugoj est le résultat de son évolution historique à partir de la vieille fonction de marche jusqu’aux fonctions urbaines actuelles, dominées par l’industrie et des services. La dynamique fonctionnelle de la ville a été influencée par la position de la municipalité en ce qui concerne le rôle politique et administratif dans cette partie du pays. Ainsi, à bref délai, ses fonctions de marché, celle commerciale, politique et administrative ont été complétées par d’autres fonctions, générées par l’évolution économique de la ville. La méthodologie de recherche utilisée est basée sur l’étude bibliographique, l’analyse des données statistiques et l’étude du terrain. On expose, d’une manière objective, quelques considérations sur le profil fonctionnel de la ville en accord avec la restructuration urbaine, de l’économie planifiée à celle de marché, spécifique pour les sociétés développées. On analyse ainsi, les fonctions urbaines dans le contexte des principaux domaines d’activité économique aussi que dans le contexte de la polarisation spatiale de celles-ci dans l’espace rural de la proximité de la municipalité Lugoj. -

Parlamento Europeu
16.5.2013 PT Jornal Oficial da União Europeia C 137 E / 1 IV (Informações) INFORMAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA PARLAMENTO EUROPEU PERGUNTAS ESCRITAS E SUA RESPOSTA Perguntas escritas apresentadas por deputados ao Parlamento Europeu e respetiva resposta dada por uma instituição da União Europeia (2013/C 137 E/01) Indice Página E-003605/12 by Nikolaos Chountis to the Commission Subject: Statements by Klaus Regling on the cost of supporting Greece Ελληνική έκδοση ................................................................................................................................................................. 13 English version .................................................................................................................................................................. 14 E-003606/12 by Auke Zijlstra to the Council Subject: Germany wants more border controls Nederlandse versie ............................................................................................................................................................ 15 English version .................................................................................................................................................................. 16 P-003607/12 by Nessa Childers to the Commission Subject: Pádraig Flynn's pension entitlements English version ................................................................................................................................................................. -

Les Mobilités Du Pays Basque
vers Dax vers Dax 7 Gare Routière Gare M/D LANDES Biarrotte Les mobilités 7 Salle des Fêtes 26 Garros 2 TARNOS M/D Le réseau Mairie Chronoplus du Pays Basque 26 38 Boucau Centre SAMES Cial SAMATZE CHRONOPLUS Salle BOUCAU A63Biarrotte T1 2 4 6 BOKALE Lac r 4 12 de Sames 32 38 50 52 u Sainsontan o CHRONOPLUS D810 d A BAYONNE CAR EXPRESS ’ T1 2 5 30 48 L BAIONA Hauts de Port La B 3 11 12 13 14 Bayonne SNCF / TER id 12 ou Village 61 62 65 TGV ze RÉGIONAL T1 32 GUICHE Puyoo 26 GARE RÉGIONAL GIXUNE Gare BIARRITZ L’Adour BIARRITZ PLACE DE BAYONNE 7 26 DES BASQUES LAHONCE Urt LEHUNTZE Château Centre Place 12 CEF Mairie de Biarritz T1 d'eau D257 de secours Lac Barrière de Bourg de Guiche CHRONOPLUS C. Cial Bourg Les Coteaux Mouguerre Destinée 12 URT CHRONOPLUS Ametzondo Abbaye 809 4 36 AHURTI D123 4 5 6 38 46 52 6 Tellechea URCUIT CAR EXPRESS AÉROPORT ANGLET URKETA ANGELU A64 HEGOBUS 3 DE BIARRITZ 48 Doria Place 51 du Fronton CAME D936 Bascule AKAMARRE CAR EXPRESS 2 BRISCOUS Qu. La Place GARE Technocité Mendilaskor D11 3 BESKOITZE D936 Commune DE BIARRITZ Lot. D936 Orthez 809 OCÉAN SNCF / TER Garatia Imistola Gare SNCF 13 D936 Les Salines 61 TGV 50 11 Bourg BARDOS ATLANTIQUE SAINT-PIERRE- A64 Le Battan BIDACHE BASSUSSARRY L D'IRUBE BARDOZE BIDAXUNE BASUSARRI a D932 N D137 HIRIBURU 11 i 4 v Izarbel e MOUGUERRE 11 Lore MUGERRE Pagoeta Landa VILLEFRANQUE oury Uhabia ih ZAC MILAFRANGA L 52 e GUÉTHARY Makila L 809 BIDART HEGOBUS GETARIA BIDARTE ARANCOU 39 41 43 45 47 49 51 Villefranque Le car ERANGO 3 A63 ARBONNE ARCANGUES M/D ARBONA D255 14 CAR EXPRESS -

Citește ,,Morisena”.Pdf Nr 3 2020
Revistă trimestrială de cultură istorică Dr. Constantin-Tufan Stan După cursurile primare şi gimnaziale (Şcoala Confesională Ortodoxă Română și Gimnaziul de Stat (Lugoj) din urbea natală) a urmat studii academice, finalizate prin obţinerea licenţei de medic chirurg la Facultatea de Constantin Rădulescu Jr. – Medicină din Budapesta (1881), fiind chiar premiat pentru o lucrare teoretică din domeniul chirurgiei („Familia”, Eminentul chirurg lugojean Oradea, XVIII, 20, 1882, 247). După un an de practică la Budapesta, s-a stabilit la Bucureşti, ca medic chirurg la al Bucureștilor Spitalul Eforiei, unde a devenit unul dintre cei mai apreciaţi medici. Într-o scrisoare adresată fiicei sale Elena (21 mai Abstract: Constantin Rădulescu Jr. was a 1884, epistolă păstrată în fondul Rusalin, Arhiva Muzeului distinguished surgeon at the Eforiei Hospital in Bucharest. Național al Banatului Timişoara), Paulina Rădulescu His correspondence with doctor George Dobrin, his sublinia succesul profesional al fiului său, Constantin: brother-in-law and the first Romanian Prefect of Caraș- „Aşa era de căutat Severin County after the Great Union, describes episodes ca medic chirurg, că un representative for the social, political and cultural life general, I. Potescu, din of Bucharest at the turn of the twentieth century: the Galaţi, care trebuia să arrival of Ferdinand, the crown prince, in the capital of se supună unei operaţii the Kingdom of Romania and the vehement reaction of the grave, în loc să se ducă la anti-monarchist press, a long list of state institutions and Paris, unde era sfătuit de Romanian Members of Parliament in 1895, the celebration medicii săi să se opereze, of 10 May 1934. -

Ilbarritz 38 Le Plateau Nota : Vos Suggestions Et Remarques Sont Les Bienvenues
1 1 Sommaire 3 Edito 5 Numéros utiles 7 Infos pratiques 9 Histoire et patrimoine 13 Culture et traditions Guide VACANCES 2012 19 Activités et loisirs Réalisation : Sport et balades Service Communication / Office de Tourisme 25 Mairie de Bidart Tél. 05 59 54 67 97 Pour les pitchouns [email protected] 29 www.bidart.fr Création, conception : 31 Quoi faire quand il pleut ? Monique / Boomacom / 06 38 99 85 60 Impression : 33 Aux alentours Imprimerie Abéradère / Imprim’vert® Publicité : Mairie Bidart 37 Les bonnes adresses : Bastienne Beziat - Tél. 06 80 87 27 10 où manger, où sortir Photos : Service communication / Office de Tourisme 37 Littoral 38 Ilbarritz 38 Le Plateau Nota : vos suggestions et remarques sont les bienvenues. 39 Centre 41 Uhabia 42 Agoretta-Chutiqueta 44 Côté Campagne 46 Le lexique Edito… 3 Bienvenue à Bidart, le village basque sur la mer… Sur la Côte Basque, visitez un village qui a su vivre dans le présent tout en préservant son caractère typique et authentique. Découvrez notre patrimoine architectural, nos arti- sans, pratiquez toutes sortes d’activités et réveillez L’activité touristique est essentielle à la vie de vos papilles pendant votre séjour ! Dégustez les Bidart. Nous avons choisi de la soutenir. recettes de terroir proposées par nos restaurants et Vous pourrez ainsi découvrir dés cet été un profitez de nos hébergements de qualité. Office de Tourisme flambant neuf pour mieux L’équipe de l’Office de Tourisme est heureuse de vous vous accueillir mais aussi, plus globalement, un accueillir et vous souhaite un agréable séjour. village en mouvement qui travaille à la préser- Visit Bidart, a village on the Basque coast, where we vation de ses atouts séculaires. -

Cultural Heritage, Local Identity and Urban Regenration: the Case Study of Lugoj Municipality, Romania
Geographica Timisiensis, vol. 21, nr. 1, 2012 (pp. 17-36) • CULTURAL HERITAGE, LOCAL IDENTITY AND URBAN REGENRATION: THE CASE STUDY OF LUGOJ MUNICIPALITY, ROMANIA Ioan Sebastian JUCU West University of Timişoara, Department of Geography, Blvd. V. Pârvan, No. 4, 300223, Timişoara, Romania, e-mail: [email protected] Abstract: As a medieval settlement, but with a longer history than this layer of time, the Municipality of Lugoj disposes by an important cultural heritage less known at the national and European level. Known for a long time in the past as the cultural capital city of the Romanian Banat, during the communist and post-socialist periods this settlement loses this status with real valences more than the metaphoric mean. The old communist regime through its particular way of development fades and ignores the cultural potential of the town, this political attitude being against of the cultural affirmation of the town on the local, regional and national level. In a globalized world, marked by neoliberal trends of development, in connection with the promotion of the international values, the (re)construction of the local identity represents a prior condition for sustainable development of the town. On the other hand between the local cultural potential, the contemporary trends of development and the urban dynamics can be create a close connection that could offer new opportunities for further evolutions of the town. With an important cultural heritage and as an old model of inter- and multiculturality, the municipality of Lugoj could evolve in the future as a settlement with a cultural function beside the other ones outlined in time grounded by particular political, economic, social and cultural frames developed in this geographical space from Romania. -

Arbonne Plan Local D'urbanisme
Commune d’ ARBONNE PLAN LOCAL D’URBANISME Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 20 juillet 2019 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) ANNEXES Agence Publique de Gestion Locale - Service d’Urbanisme Intercommunal Maison des Communes - rue Auguste-Renoir – CS 40609 - 64006 PAU CEDEX Téléphone 05.59.90.18.28 - Télécopie 05.59.84.59.47 - [email protected] SOMMAIRE Pièces de procédure Pièces écrites PPRI Plan des servitudes d’utilité publique Plan du réseau public d’assainissement collectif Plan du réseau public d’alimentation en eau potable Etude de faisabilité zone d’activité Le Lana secteur Pouy – approche spatiale, économique et financière – CASPB – SEPA – 2010 Etude hydraulique réalisée secteur POUY Etudes de sols réalisés pour les secteurs constructibles non desservis par l’assainissement collectif Plan des secteurs à l’intérieur desquels s’exerce le droit de préemption urbain Etude ARTELIA Schéma Directeur du système d’assainissement de la STEP de Bidart, décembre 2016 (synthèse) Commune d’Arbonne – Plan local d'urbanisme (PLU) – ANNEXES 2 Commune d’ ARBONNE PLAN LOCAL D’URBANISME Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 20 juillet 2019 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) ANNEXES – pièces écrites Agence Publique de Gestion Locale - Service d’Urbanisme Intercommunal Maison des Communes - rue Auguste-Renoir – CS 40609 - 64006 PAU CEDEX Téléphone 05.59.90.18.28 - Télécopie 05.59.84.59.47 - [email protected] Commune d’Arbonne – Plan local d'urbanisme (PLU) – Annexes Pièces écrites - Commune d’Arbonne – Plan local d'urbanisme (PLU) – Annexes Pièces écrites - 2 TABLE DES MATIÈRES 1 SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE ............................................................................................................... -
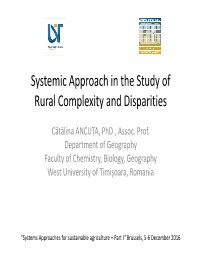
Systemic Approach in the Study of Rural Complexity and Disparities
Systemic Approach in the Study of Rural Complexity and Disparities Cătălina ANCUȚA, PhD , Assoc. Prof. Department of Geography Faculty of Chemistry, Biology, Geography West University of Timișoara, Romania "Systems Approaches for sustainable agriculture – Part I" Brussels, 5-6 December 2016 Territorial System Geographers have had long ago the intuition of the need to study ensembles constituted of elements whose combination ensures a certain aspect of the whole. After dedicated their study to humanized region (and the genres de vie ) in the first part of the twentieth century, then to the polarized region , in the second half of the century, human geography recovers the system , as the most suitable grid to interpret the so complex reality called territory . • Definition The territorial system is a set of components which interact, determine and influence each other. The complexity of the territorial system (cf. Ianoș, 2000) SOCIAL COMPONENTS BUILT ECONOMIC COMPONENTS NATURAL COMPONENTS COMPONENTS PSICHOLOGICAL COMPONENTS "Systems Approaches for sustainable agriculture – Part I" 5-6 December 2016 in Brussels Sets of components inside the territorial system Natural system : relief, climate (temperatures, precipitations, early frost, late frost, winds regime etc. ), hidrography (density, types, quality of water), vegetation, fauna, soils (agricultural potential), natural risks . Social system : number of inhabitants, natural dynamic, territorial mobility, density, spatial concentration, demographic structures (labour resources) Built system : housing (architecture, built density, confort of living), types of settlements and neighbourhood, territorial equipment, transport infrastructures, functional areas,. Economic system : economic activities, no of companies, companies density, SMS density, no of jobs, output, level of efficency, economic environment, economic tradition. Psichological system : values, normes, rules, mentality, identity (resorts of behaviour), lows, preferences, expectations, attitudes, behaviour... -
Geographica Timisiensis
ISSN – L: 1224 – 0079 ISSN (on-line): 2248 - 1877 WEST UNIVERSITY OF TIMIŞOARA FACULTY OF CHEMISTRY, BIOLOGY AND GEOGRAPHY DEPARTMENT OF GEOGRAPHY GEOGRAPHICA TIMISIENSIS Vol. XXI, nr.1, 2012 TIMIŞOARA ` EDITORS: Editor-in-Chief: Prof. Dr. Nicolae POPA Assistant Editors: Prof. Dr. Martin OLARU, Lect. Dr. Cătălina ANCUŢA Technical Editors: Ass Prof. Dr. Constantin VERT, Lect. Dr. Sorin PAVEL, Lect. Dr. Ramona IŞFĂNESCU Editorial Secretary: Claudia MUŢULESCU, Florina ARDELEAN EDITORIAL BOARD: Prof. Dr. Dan BĂLTEANU (member of the Romanian Academy), University of Bucharest, Prof. Dr. Alexandru UNGUREANU (corresponding member of the Romanian Academy), University „Al. I. Cuza” of Iaşi, Lect. Dr. Cătălina ANCUŢA, West University of Timişoara, Prof. Dr. Joan Serafi BERNAT MARTI, „Jaume I” University of Castellon, Spain, Prof. Dr. Milan BUFON, „Primorska” University of Koper, Slovenia, Prof .Dr. Nicolae CIANGĂ, „Babeş-Bolyai” University of Cluj- Napoca, Prof. Dr. Pompei COCEAN, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Prof. Dr. Remus CREŢAN, West University of Timişoara, Prof. Dr. Branislav DJURDJEV, University of Novi Sad, Serbia, Prof. Dr. Liliana DUMITRACHE, University of Bucharest, Prof. Dr. Vasile EFROS, University of Suceava, Prof. Dr. Javier ESPARCIA PÉREZ, University of Valencia, Spain, Prof. Dr. Horst FÖRSTER, „Eberhard Karls” University of Tübingen, Germany, Prof. Dr. Jean Baptiste HUMEAU, University of Angers, France, Prof. Dr. Ioan IANOŞ, University of Bucharest, Prof. Dr. Corneliu IAŢU, University „Al. I. Cuza” of Iaşi, Prof. Dr. Alexandru ILIEŞ, University of Oradea, Prof. Dr. Sebastian KINDER, „Eberhard Karls” University of Tübingen, Germany, Ass Prof. Dr. Duncan LIGHT, Liverpool Hope University, Great Britain, Prof. Dr. Ionel MUNTELE, University „Al. I. Cuza” of Iaşi, Prof. -
Au Courant De Luhabia N°1.Pdf
e l’ Uh rant d abia ou Bulletin o ° Contrat de Bassin c n 1 Au d’information Le syndicat de l’Uhabia à l’écoute des poissons migrateurs Les cours d’eau du bassin de l’Uhabia sont perturbés ponctuellement par des seuils qui peuvent constituer QU’EST CE QUE LE CONTRAT DE BASSIN DE L’UHABIA ? des obstacles à la circulation des poissons. C’est le cas notamment de l’Anguille, bien représentée sur EDITO l’aval de l’Uhabia alors que les effectifs sont en nette diminution plus en amont. Le syndicat de l’Uhabia composé Le « contrat de bassin » est un programme d’actions mis en place sur un bassin Le Syndicat de l’Uhabia a donc engagé une réflexion pour « revenir à un fonctionnement plus naturel des communes d’Arbonne, Ahetze versant hydrographique visant à reconquérir la qualité de l’eau et les milieux de la rivière ». et Bidart est heureux de vous aquatiques d’ici 2015 comme le préconise la directive cadre sur l’Eau. Il est prévu de lancer une étude qui proposera des solutions adaptées à chaque ouvrage faisant obstacle présenter le premier numéro de ce Le contrat de bassin contractualise pour 3 ans les engagements des maîtres à la circulation des poissons et assurer ainsi une meilleure continuité écologique sur l’Uhabia. journal, “au courant de l’Uhabia”, d’ouvrages et des partenaires financiers. Outre l’intervention globale et cohérente à l’échelle du bassin versant, cette démarche offre l’avantage pour les habitants du bassin versant. pour un propriétaire privé de pouvoir bénéficier de subventions et d’un accompagnement technique Pour cette première édition, personnalisé.