Roulet, P.A. Zonage ZCV 2010
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

En Republique Centrafricaine L'experience De La Zone Pilote De Sangba
LES CAHIERS FORESTIERS DE GEMBLOUX LE "PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD" EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE L'EXPERIENCE DE LA ZONE PILOTE DE SANGBA N° 9 T. d'ESPINEY, J. TELLO, W. DELVINGT ISSN : 0777-9992 D/2002/6026/09 2 LES CAHIERS FORESTIERS DE GEMBLOUX visent à faire connaître les travaux (documents techniques, rapports de recherche, publications, articles de vulga- risation) émanant des Unités des Eaux et Forêts de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gem- bloux et de ses groupes de recherche, financés par des organismes internationaux, nationaux ou régionaux. Adresse de contact : Unité de Gestion et Economie forestières Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux B - 5030 Gembloux – Belgique Tél : 32 (81) 62 23 20 Fax : 32 (81) 62 23 01 E-MAIL : [email protected] http://www.fsagx.ac.be/gf 3 LE "PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD" EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE L'EXPERIENCE DE LA ZONE PILOTE DE SANGBA T. d'ESPINEY(1), J. TELLO(2), W. DELVINGT(3) Résumé En vue d'établir une barrière contre l'avancée du Sahel, le Gouvernement Centrafricain et la Commission des Communautés Européennes financent, dans le cadre du 6ème Fonds Européen de Développement, un "Programme de Développement de la Région Nord" en Centrafrique. Les ressources naturelles, et particulièrement la grande faune, constituent les facteurs clés en vue d'une mise en valeur de cette région, s'étendant sur plus de 105.000 km2 en zone médio- soudanienne. Les recherches pour une utilisation de la faune se sont concentrées sur la zone pilote de Sangba (8.500 km2) et en particulier sur la zone de chasse coutumière (750 km2) du village d'Idongo (300 habitants). -

Republique Centrafricaine Autorite Nationale Des Elections
21.1.11.3code VillageQu 21 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Code Préfecture 2021-01-02 AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS Code 21/03/2021 12:38:27 Date et Heure Impression : 21/03/2021 12:38:27 Sous Pref21.1 2021/03/19 ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 MARS 2021 - RESULTATS PROVISOIRES code 21.1.11 Préfecture : BAMINGUI BANGORAN Nbre inscrits : 210 commune Sous Préfecture : NDELE Nbre votant : 83 code 3954 centre Code BV 3954-01 Circonscription : 1ere Circonscription Nbre Blancs Nuls : 7 7 Commune : DAR-EL-KOUTI Taux de participation : 39,52% TOTAL : photo 0 0% Village Quartier : KOUBOU Suffrages Exprimés : 76 centre vote : ECOLE KOUBOU BV : BV01 1/74 Ordre Candidat Parti Politique voix Taux% 1 ALIME AZIZA SOUMAINE MCU 35 46,05% 46,05% 2 AROUN-ASSANE TIGANA P.G.D 41 53,95% 53,95% 100% 1 / 74 21.1.11.3code VillageQu 21 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Code Préfecture 2021-01-02 AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS Code 21/03/2021 12:38:27 Date et Heure Impression : 21/03/2021 12:38:27 Sous Pref21.1 2021/03/19 ELECTIONS LEGISLATIVES DU 14 MARS 2021 - RESULTATS PROVISOIRES code 21.1.11 Préfecture : BAMINGUI BANGORAN Nbre inscrits : 397 commune Sous Préfecture : NDELE Nbre votant : 164 code 3948 centre Code BV 3948-01 Circonscription : 1ere Circonscription Nbre Blancs Nuls : 39 39 Commune : DAR-EL-KOUTI Taux de participation : 41,31% TOTAL : photo 76 54% Village Quartier : DJALABA Suffrages Exprimés : 125 centre vote : MAIRIE DE NDELE BV : BV01 2/74 Ordre Candidat Parti Politique voix Taux% 1 ALIME AZIZA SOUMAINE MCU 108 86,40% 86,40% 2 AROUN-ASSANE TIGANA P.G.D -

Central African Republic Giraffe Conservation Status Report February 2020
Country Profile Central African Republic Giraffe Conservation Status Report February 2020 General statistics Size of country: 622,984 km² Size of protected areas / percentage protected area coverage: 13% Species and subspecies In 2016 the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) completed the first detailed assessment of the conservation status of giraffe, revealing that their numbers are in peril. This was further emphasised when the majority of the IUCN recognised subspecies where assessed in 2018 – some as Critically Endangered. While this update further confirms the real threat to one of Africa’s most charismatic megafauna, it also highlights a rather confusing aspect of giraffe conservation: how many species/subspecies of giraffe are there? The IUCN currently recognises one species (Giraffa camelopardalis) and nine subspecies of giraffe (Muller et al. 2016) historically based on outdated assessments of their morphological features and geographic ranges. The subspecies are thus divided: Angolan giraffe (G. c. angolensis), Kordofan giraffe (G. c. antiquorum), Masai giraffe (G. c. tippleskirchi), Nubian giraffe (G. c. camelopardalis), reticulated giraffe (G. c. reticulata), Rothschild’s giraffe (G. c. rothschildi), South African giraffe (G. c. giraffa), Thornicroft’s giraffe (G. c. thornicrofti) and West African giraffe (G. c. peralta). However, over the past decade GCF together with their partner Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F) have performed the first-ever comprehensive DNA sampling and analysis (genomic, nuclear and mitochondrial) from all major natural populations of giraffe throughout their range in Africa. As a result, an update to the traditional taxonomy now exists. This study revealed that there are four distinct species of giraffe and likely five subspecies (Fennessy et al. -

Zon Nes C Cyné Égét Tique Es V Villag Geois
Répub lique centrafricain e C ommission E uropée nne F o nds E u ropéen de D évelop pemen t Zones Cynégétiques Villageoises SCHÉMA D'ORIENTATION POST ECOFAC IV Informations générales Evaluation interne Prospectives à 10 ans VERSION PROVISOIRE Août 2010 GROUPEMENT BRL Ingénierie -SECA / GFA GmbH / DFS ZCV, Evaluation interne et perspectives post ECOFAC IV – Version provisoire 2 TABLE DE MATIERES Préambule _____________________________________________________________________ 5 Synthèse du complexe écologique de la zone Nord‐est de la RCA (zone d'intervention de la composante ZCV du programme ECOFAC) ____________________________________________ 6 Informations générales _________________________________________________________________ 6 Valeur pour la conservation _____________________________________________________________ 9 Politique nationale en matière de gestion des Aires Protégées _________________________________ 9 Cadre juridique ______________________________________________________________________ 11 Cadre réglementaire du tourisme cynégétique en RCA ______________________________________________ 11 Cadre institutionnel __________________________________________________________________ 11 Evolution de la structure de gestion des ZCV ______________________________________________________ 12 Contexte territorial ___________________________________________________________________ 14 Population humaine __________________________________________________________________ 14 Héritage culturel _____________________________________________________________________ -

Le Congo Et Le Japon Soutiennent La Réforme Du Conseil De Sécurité De L
L’ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CONGO 200 FCFA www.adiac-congo.com N° 2487 - JEUDI 17 DÉCEMBRE 2015 DIPLOMATIE Le Congo et le Japon soutiennent la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU En séjour de travail au Congo du 14 au 16 décembre, le vice-ministre japonais des Affaires étrangères chargé des re- lations avec le parlement a discuté avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Jean Claude Gakosso, de réforme du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Histoshi Kikawada, qui a visité mar- di les locaux des Dépêches de Braz- zaville, a déploré, dans une interview, le manque de candidats congolais aux bourses d’études offertes par son pays. « Lors de la Conférence interna- tionale pour le développement de l’Afrique, en 2013, il a été retenu que les jeunes Africains devraient régulièrement suivre des formations au Japon. Pour le moment, malheu- reusement, il n’y a pas de candidats congolais. J’ai mis à profi t mes ren- contres avec les autorités congolaises pour le leur rappeler », a-t-il indi- qué estimant que la non-maîtrise de la langue anglaise pourrait expliquer cet état de fait. Page 3 Histoshi Kikawada et Jean Claude Gakosso SÉCURITÉ COLLECTIVE ECHÉANCES ÉLECTORALES Afripol peaufine son action L’IDC se dit prête à affronter contre le terrorisme la présidentielle de 2016 Au terme d’une réunion clôturée lundi à terrorisme, la traite des hommes, le Alger, le Mécanisme africain de coopéra- trafi c d’armes et de la drogue, la cyber- tion policière (Afripol) a adopté ses textes criminalité, ainsi que de nouveaux as- juridiques et réaffi rmé sa détermination pects du crime organisé transformant à renforcer ses actions de lutte contre le l’Afrique en un point de passage in- ternational des différentes activités de terrorisme, le crime organisé et autres contrebande », a estimé le ministre algé- menaces visant le continent. -
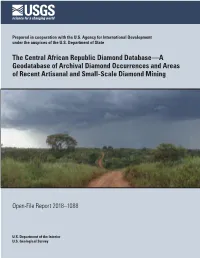
The Central African Republic Diamond Database—A Geodatabase of Archival Diamond Occurrences and Areas of Recent Artisanal and Small-Scale Diamond Mining
Prepared in cooperation with the U.S. Agency for International Development under the auspices of the U.S. Department of State The Central African Republic Diamond Database—A Geodatabase of Archival Diamond Occurrences and Areas of Recent Artisanal and Small-Scale Diamond Mining Open-File Report 2018–1088 U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey Cover. The main road west of Bambari toward Bria and the Mouka-Ouadda plateau, Central African Republic, 2006. Photograph by Peter Chirico, U.S. Geological Survey. The Central African Republic Diamond Database—A Geodatabase of Archival Diamond Occurrences and Areas of Recent Artisanal and Small-Scale Diamond Mining By Jessica D. DeWitt, Peter G. Chirico, Sarah E. Bergstresser, and Inga E. Clark Prepared in cooperation with the U.S. Agency for International Development under the auspices of the U.S. Department of State Open-File Report 2018–1088 U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey U.S. Department of the Interior RYAN K. ZINKE, Secretary U.S. Geological Survey James F. Reilly II, Director U.S. Geological Survey, Reston, Virginia: 2018 For more information on the USGS—the Federal source for science about the Earth, its natural and living resources, natural hazards, and the environment—visit https://www.usgs.gov or call 1–888–ASK–USGS. For an overview of USGS information products, including maps, imagery, and publications, visit https://store.usgs.gov. Any use of trade, firm, or product names is for descriptive purposes only and does not imply endorsement by the U.S. Government. Although this information product, for the most part, is in the public domain, it also may contain copyrighted materials as noted in the text. -

Biogeography of the Reptiles of the Central African Republic
African Journal of Herpetology, 2006 55(1): 23-59. ©Herpetological Association of Africa Original article Biogeography of the Reptiles of the Central African Republic LAURENT CHIRIO AND IVAN INEICH Muséum National d’Histoire Naturelle Département de Systématique et Evolution (Reptiles) – USM 602, Case Postale 30, 25, rue Cuvier, F-75005 Paris, France This work is dedicated to the memory of our friend and colleague Jens B. Rasmussen, Curator of Reptiles at the Zoological Museum of Copenhagen, Denmark Abstract.—A large number of reptiles from the Central African Republic (CAR) were collected during recent surveys conducted over six years (October 1990 to June 1996) and deposited at the Paris Natural History Museum (MNHN). This large collection of 4873 specimens comprises 86 terrapins and tortois- es, five crocodiles, 1814 lizards, 38 amphisbaenids and 2930 snakes, totalling 183 species from 78 local- ities within the CAR. A total of 62 taxa were recorded for the first time in the CAR, the occurrence of numerous others was confirmed, and the known distribution of several taxa is greatly extended. Based on this material and an additional six species known to occur in, or immediately adjacent to, the coun- try from other sources, we present a biogeographical analysis of the 189 species of reptiles in the CAR. Key words.—Central African Republic, reptile fauna, biogeography, distribution. he majority of African countries have been improved; known distributions of many species Tthe subject of several reptile studies (see are greatly expanded and distributions of some for example LeBreton 1999 for Cameroon). species are questioned in light of our results. -

MEURTRES IMPUNIS RIGHTS Crimes De Guerre, Crimes Contre L’Humanité Et La Cour Pénale Spéciale WATCH En République Centrafricaine
HUMAN MEURTRES IMPUNIS RIGHTS Crimes de guerre, crimes contre l’humanité et la Cour pénale spéciale WATCH en République centrafricaine Meurtres impunis Crimes de guerre, crimes contre l’humanité et la Cour pénale spéciale en République centrafricaine Droits d’auteur © 2017 Human Rights Watch Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis d’Amérique. ISBN : 978-1-6231-34945 Couverture conçue par Rafael Jimenez Human Rights Watch s’engage à protéger les droits humains de toutes et de tous à travers le monde. Nous menons des enquêtes rigoureuses sur les violations des droits humains, les dévoilons au grand jour et incitons les détenteurs du pouvoir à respecter ces droits et à s’assurer que justice est rendue en cas d’abus. Human Rights Watch est une organisation indépendante et internationale qui travaille dans le cadre d’un mouvement dynamique mondial pour défendre la dignité humaine et faire avancer la cause des droits humains pour tous. Human Rights Watch travaille à l’échelle internationale, avec des équipes présentes dans plus de 40 pays et des bureaux à Amsterdam, Beyrouth, Berlin, Bruxelles, Chicago, Genève, Goma, Johannesburg, Londres, Los Angeles, Moscou, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington et Zurich. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet : http://www.hrw.org/fr JUILLET 2017 ISBN : 978-1-6231-34945 Meurtres impunis Crimes de guerre, crimes contre l’humanité et la Cour pénale spéciale en République centrafricaine Résumé ............................................................................................................................. -

Langues Et Populations Du Nord-Est Centrafricain
65 LANGUES ET POPULATIONS DU NORD-EST CENTRAFRICAIN Pierre NOUGAYKOL CNRS-LACITO Par nord-estcentrafricain, on entend lalisière sud-est du bas-sin Tchaddu située RCpubliqueen Centrafricaine, et particulièrementl'espace circonscrit au nord parle Bahr Aouk et I'Aoukalé, qui marquent la frontikre avec leTchad, et au sud par le Bamingui, le Koukourou et laligne de partage des eaux entre le bassin secondaire de 1'Aouk etcelui de la Kotto. Cetterégion qui bCnCficia longtempsl'autonon~iede adrninistrative du fait de son isolement, est il tous 6gards mCconnue. D'unesuperficie de 104700 km2 pour 52000Iubitantsl, elleest actuellement divisCe endeux préfectures, le Bamingui-Bangoran au sud-ouest(52200 km*, 25000 hab.) et la Vakaga au. nord-est (46500 km2, 27000 hab.). La premikre - notke BB - se subdivise B son tourendeux sous-préfectures, Ndé16 (20700 hab. etdeux com~nunes: con~~nunede plein-exercice du Dar el Kuti, 17900 hab., et communeet rurale de Mbolo-Kpatn, 2800 hab.) Baminguiet (4300hab.), et la seconde (VK) comporteles sous-préfectures de Birao (2500 hab.) et de Ouanda-Djallé (2000hab.). Les renseignementsdont il est fait 6tat dnns ce texte ont CtC recueillis nu coursdetrois missions deterrain firlancbcs par le LACITO pour les prcnlièrcs et par I'ATP' du CNRS intitul6e"Distances et limitesdialectales dansl'aire banda (Afrique Cerltralc : RCA, Soudan) : RealitCs linguistiques CL perceptionssocio-culturcllcs", pour la troisihmc.Elles eurent successivement pour cadre Ic Dar cl Kuti(janvier-fdvricr 1983). la préfecture de Io Vakaga(novembre-décembre 1984 : dc conserveavec PascalBOYELDIEU) et le Dar Banda(commune de Mbolo-Kpata et sous- prbfecturc de Bamingui ; mars 1986). Les chiffres de populationcit6s ont Cti établis sur la base des donn6cs fournies par les autoritCs administratives localcs. -

Patrimoine Mondial 25 BUR
Patrimoine mondial 25 BUR Distribution limitée WHC-2001/CONF.205/INF.6 Paris, le 6 juin 2001 Original : français ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL BUREAU DU COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL Vingt-cinquième session Paris, Siège de l’UNESCO, Salle X 25-30 juin 2001 Point 5.1 de l'ordre du jour provisoire : Rapports sur l’état de conservation de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril Rapport sur la mission interdisciplinaire au Parc national du Manovo-Gounda St. Floris, République centrafricaine, du 5 au 13 mai 2001 RESUME Le Parc national du Manovo-Gounda-St. Floris a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1988 sur la base des critères naturels (ii) et (iv), après que l’Etat partie ait donné toutes les assurances quant à son engagement à améliorer les conditions d’intégrité du Parc. Toute l’importance du Parc réside dans la richesse de sa faune et de sa flore. Depuis l’inscription du Parc sur la Liste du patrimoine mondial, le Comité du patrimoine mondial s’est trouvé confronté aux problèmes sérieux posés par le braconnage sauvage exercé par des groupes armés, venant aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du pays, causant des problèmes de sécurité et la mort, en 1997, de quatre agents du parc. Selon l’UICN, 80 % de la faune du parc ont été décimés à des fins commerciales. Du fait de l’insécurité, le tourisme a été fortement freiné. -

Au-Delà Des Éléphants
MN-02-15-558-FR-C AU-DELÀ DES ÉLÉPHANTS Éléments d’une approche stratégique de l’UE pour la conservation de la nature en Afrique SYNTHÈSE Inputs for an EU strategic approach to wildlife conservation in Africa 978-92-79-49561-8 Coopération internationale et développement Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur l’Union européenne. Un numéro unique gratuit (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques). COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE? Publications gratuites: • un seul exemplaire: sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); • exemplaires multiples/posters/cartes: auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm), AU-DELÀ DES ÉLÉPHANTS des délégations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm), Éléments d’une approche stratégique de l’UE en contactant le réseau Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm) ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*). pour la conservation de la nature en Afrique – Synthèse (*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, Commission européenne hôtels ou cabines téléphoniques). Direction générale de la Coopération internationale et du Développement 1049 Bruxelles Publications payantes: • sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). BELGIQUE De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internet via le serveur Europa (http://europa.eu). -

Central African Republic
Al Muglad 15°0'0"E 20°0'0"E Am Timan 25°0'0"E AM TIMAN ZAKOUMA MAROUA SALAK BOUSSO Vakaga Am Dafok Dahal Yagoua BONGOR Hadjèr BIRAO Bongor C h a d Takalama Birao Mamoun Lac Iro Djéziré Kididji Kokab 10°0'0"N Madjia 10°0'0"N Haraze S u d a n Délimbé Mélé Sergobo Lac de Lere LAI Manou Tiroungoulou PALA Kyabé KELO Tala Laï GORDIL Pala Ouandjia Garba Gounda PAOUA Sarh SARH Golongoso - WFP: 1200 MT KOUMRA Délé Doum Vasso Lag - Dedicated Cluster: 200 MT OUANDA do R ese Koumra Miaméré DJALLE Ouanda Djallé - Avairlvaobir le Trucks: 2 Soulemaka Danamadji Koundi Uwayl DOBA Gaïta MOUNDOU Maïnda Manga Doba AWEIL N'DELE Ouandjia Moundou KOME Koubou KOUMALA Kotto MARO AWAKABA Aliou III Tcholliré Maïkouma Ngoudjaka RAGA Ndélé Kotto I Sido Mbolo Said Sakoumba Bandas BOUAR Dacpa Ouadda Mindou Ndagra - WFP: 1500 MT Mbo Pata KAVADJA - Dedicated Cluster: 300 MT YALIGAMBO Bamingui-bangora OUADDA Mura Dangavo - Available Trucks: 2 Bara Birini Maïko Kinga Mouroumoudou Bekobien Kabo Békoro C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c Balteze Ouogo Bamingui Touga I Bédaïa Bendoulabo Takara Katé Zoumbanga Gribinzi KAGA-BANDORO Mbere Benamkor Dimba Bilsem Kakosso Dinga Be - WFP: 1200 MT Nzakoundou Debo III Blalo Tougounda Kaga Nzé Mann Bandoro-Kété Bokambay Carré Kounan BATANGAFO de Ngamba Bouyay-Lim Bogo Batangafo - Dedicated Cluster: 300 MT Pougol PAOUA Yapara Yambala Mouka Mbere Bindanga Paoua Cangomo Bada Bakara Botéré Nana Grebizi Koudouvélé Hautte-kotto Poulao III Kouki Badene - Available Trucks: 2 Guili Gripendé Zole Bouara Cagoro Gono Sikoum Bélé Zara Kamassoubourou