Rjp Hs Xi D Ap Et Chapitres
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The 2008 Election: Reviewing Seat Allocations Without the Māori Electorate Seats June 2010
working paper The 2008 Election: Reviewing seat allocations without the Māori electorate seats June 2010 Sustainable Future Institute Working Paper 2010/04 Authors Wendy McGuinness and Nicola Bradshaw Prepared by The Sustainable Future Institute, as part of Project 2058 Working paper to support Report 8, Effective M āori Representation in Parliament : Working towards a National Sustainable Development Strategy Disclaimer The Sustainable Future Institute has used reasonable care in collecting and presenting the information provided in this publication. However, the Institute makes no representation or endorsement that this resource will be relevant or appropriate for its readers’ purposes and does not guarantee the accuracy of the information at any particular time for any particular purpose. The Institute is not liable for any adverse consequences, whether they be direct or indirect, arising from reliance on the content of this publication. Where this publication contains links to any website or other source, such links are provided solely for information purposes and the Institute is not liable for the content of such website or other source. Published Copyright © Sustainable Future Institute Limited, June 2010 ISBN 978-1-877473-56-2 (PDF) About the Authors Wendy McGuinness is the founder and chief executive of the Sustainable Future Institute. Originally from the King Country, Wendy completed her secondary schooling at Hamilton Girls’ High School and Edgewater College. She then went on to study at Manukau Technical Institute (gaining an NZCC), Auckland University (BCom) and Otago University (MBA), as well as completing additional environmental papers at Massey University. As a Fellow Chartered Accountant (FCA) specialising in risk management, Wendy has worked in both the public and private sectors. -

Hate Speech: Balancing Expresssion, Religion, Discrimination and Harm
POLICY PAPER Law and Human Rights | June 2004 Hate Speech: Balancing expresssion, religion, discrimination and harm I INTRODUCTION In 1869, John Stuart Mill considered that the question application of the New Zealand Bill of Rights Act 1990 of a legislature or executive prescribing what opinions and provides a brief overview of “hate speech” laws in were and were not allowed to be spoken had been so the international community. “triumphantly enforced” that as a writer, he need not This policy paper is necessarily broad in its scope, pay any attention to the topic:1 so as to highlight the number and range of issues It is not in constitutional countries, to be apprehended, involved and provide an accurate background to the that the government, whether completely responsible to issue. Ultimately this paper aims to determine whether the people or not, will attempt to control the expression of legislative intervention is required in the area of “hate opinion, except when in doing so it makes itself the organ of speech” by focusing on the rights and freedoms that the general intolerance of the public. compete for priority. Mill would be disappointed to know that many The paper fi nds that restricting the fundamental constitutional and other western countries are and protected right to manifest religion and have debating the limits of expression with renewed free expression must be balanced with a similarly enthusiasm and many writers are indeed paying close fundamental and important right and concludes that attention to the topic. there is no such fundamental right in law or policy New Zealand is such a country. -

A Politics and the Campaign
Notes Resources Processor Time 00:00:00.24 Elapsed Time 00:00:00.00 Frequency Table jinterest A1: how interested in politics Frequency Percent Valid Percent Valid Very interested 412 16.7 16.7 16.7 Fairly interested 1157 46.8 47.0 63.7 Slightly interested 769 31.1 31.2 94.9 Not at all interested 125 5.0 5.1 100.0 Total 2463 99.5 100.0 Missing System 12 .5 Total 2475 100.0 jrefbefore A2: knowledge of referendum before the fact Frequency Percent Valid Percent Valid Yes 2192 88.6 89.3 89.3 No 167 6.7 6.8 96.1 Don't know 95 3.8 3.9 100.0 Total 2453 99.1 100.0 Missing System 22 .9 Total 2475 100.0 Frequency Percent Valid Percent Valid Yes 2041 82.5 83.3 83.3 No 300 12.1 12.2 95.6 Don't know 108 4.4 4.4 100.0 Total 2449 99.0 100.0 Missing System 26 1.0 Total 2475 100.0 jintnt_work A4: access to the Internet at work Frequency Percent Valid Percent Valid 0 1444 58.3 58.3 58.3 Internet access at work 1031 41.7 41.7 100.0 Total 2475 100.0 100.0 jintnt_home A4: access to the Internet at home Frequency Percent Valid Percent Valid 0 524 21.2 21.2 21.2 Internet access at home 1951 78.8 78.8 100.0 Total 2475 100.0 100.0 Page 3 jintnt_mob A4: access to the Internet on a mobile device Frequency Percent Valid Percent Valid 0 1843 74.5 74.5 74.5 632 25.5 25.5 100.0 Total 2475 100.0 100.0 jintnt_else A4: access to the Internet somewhere else Frequency Percent Valid Percent Valid 0 2345 94.7 94.7 94.7 130 5.3 5.3 100.0 Total 2475 100.0 100.0 jintnt_none A4: no access to the Internet Frequency Percent Valid Percent Valid 0 2096 84.7 84.7 84.7 No Internet access -

Hauraki-Waikato
Hauraki-Waikato Published by the Parliamentary Library July 2009 Table of Contents Hauraki-Waikato: Electoral Profile......................................................................................................................3 2008 Election Results (Electorate) .................................................................................................................4 2008 Election Results - Party Vote .................................................................................................................4 2005 Election Results (Electorate) .................................................................................................................5 2005 Election Results - Party Vote .................................................................................................................5 Voter Enrolment and Turnout 2005, 2008 .......................................................................................................6 Hauraki-Waikato: People ...................................................................................................................................7 Population Summary......................................................................................................................................7 Age Groups of the Māori Descent Population .................................................................................................7 Ethnic Groups of the Māori Descent Population..............................................................................................7 -

Electoral Commission Releases Full List of Parties and Candidates for 2011 Election
Electoral Commission releases full list of parties and candidates for 2011 election The Electoral Commission has released the nominations for the 2011 General Election, with 13 registered political parties and 544 candidates contesting the election. Registered Parties Seeking the Party Vote The registered parties seeking the party vote are: ACT New Zealand Alliance Aotearoa Legalise Cannabis Party Conservative Party Democrats for Social Credit Green Party Labour Party Libertarianz Mana Māori Party National Party New Zealand First Party United Future There were 19 registered political parties and 682 candidates contesting the election in 2008. Candidates A total of 544 candidates (electorate and list) are standing in this year’s election. This compares with 682 candidates in the 2008 election. 91 candidates are on the party list only and 73 are standing as electorate candidates only. 30 electorate candidates are standing as independents or representing unregistered parties (only registered parties are eligible to contest the party vote). The number of candidates standing both as an electorate candidate and on a party list is 380. The electorate with the most candidates is Wellington Central with 12 and the electorate with the lowest number of candidates is Waiariki with 3. 397 men and 147 women are standing in the 2011 General Election. In 2008 there were 488 men and 194 women standing. 1 The elections website www.elections.org.nz has a full list of electorate candidates http://www.elections.org.nz/voting/voting-info and the party lists http://www.elections.org.nz/elections/party-lists. Below is the number of list candidates and the number of electorate candidates representing those parties seeking the party vote. -

The Politics of Maori Affairs Policy
Copyright is owned by the Author of the thesis. Permission is given for a copy to be downloaded by an individual for the purpose of research and private study only. The thesis may not be reproduced elsewhere without the permission of the Author. , I I CLOSING THE GAPS? THE POLITICS OF - MAORI AFFAIRS POLICY A thesis presented in partialfulfi lment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology at Massey University, Albany, New Zealand. Louise Virginia Humpage 2002 iii ABSTRACT In searching for ways to decolonise, indigenous peoples have promoted indigenous models of self-determination. Governments, in response, have attempted to protect state legitimacy through the depoliticisation of indigenous claims. An analysis of 'Closing the Gaps', a policy strategy introduced by the Labour-Alliance government in June 2000, illustrates that this has certainly been the case in Aotearoa New Zealand. The policy strategy provides an entry point into exploring the conceptual tensions contained within government policy for Maori, the indigenous peoples of Aotearoa New Zealand. Based on an analysis of government documents and interview data, the thesis focuses on three main initiatives incorporated under the 'Closing the Gaps' umbrella. Each initiative highlights a number of bureaucratic, political and conceptual factors that explain why the strategy failed to match political rhetoric. The thesis argues that, in its eagerness to demonstrate a 'commitment' to Maori, the Labour-Alliance government neglected to distinguish between two different socio political projects. The first, 'social inclusion' for all disadvantaged peoples, was framed by a broader 'social development' approach whose ultimate goal was 'national cohesion'. -

Word Style Book
Word Style Book ABOUT THIS MANUAL The Word Style Book has been prepared in the Hansard Office to function in conjunction with the 10th edition of the Concise Oxford Dictionary as the dictionary for that office, to be consulted in the preparation of the parliamentary debates for publication. It is a guide to how to treat words in the text of Hansard, and not a guide to precedents or setting up members’ names. The use of hyphens is being kept to a minimum, in line with COD practice as stated in the preface to the 10th edition. For guidance on how a word or expression is treated in Hansard, consult the Word Style Book before the COD. The treatment of words not covered in either reference text will need to be confirmed for inclusion in the Word Style Book updates, which are published regularly. USER GUIDE to the HANSARD WORD STYLE BOOK I ENTRIES IN WORD STYLE BOOK (WSB) accounts alphanumeric classifications animals chemicals and organic compounds cities, countries, geographical features, etc., if not in atlas or Wises compound words diseases drugs (generic) foreign words and phrases games indices Māori words (listed separately) measurements misused or misspelt words mottos and proverbs new words “non-words” that may be used (eg., bikkie) parliamentary terms and organisations, positions, etc. associated with Parliament plants qualifications religions statutory holidays taxes technical terms words that reflect a specifically NZ usage or spelling that differs from that in the COD II ENTRIES IN REFERENCE LIST airports, ports computer programs -

Liberty Magazine March 1997.Pdf Mime Type
Bill Clinton, Welfare March 1997 Vol. 10, No.4 $4.00 Dad ''Equal liberty is the essence ofequity. " -Charles T. Sprading LIBERTY HAS NO HOME But libertarians taken together have the strength of a little nation. What stops us from building it? "FNF fills a void in the libertarian movement by addressing how a free nation could come into being and exactly how it might function ... Mary J. Ruwart, author ofHealing Our World: The Other Piece ofthe Puzzle Join philosopher Roderick T. Long, FNF founder Richard O. Hammer, and others in building our vision of the critical institutions in a free nation. How will borders be defended? dangerous criminals corralled? contracts enforced? Free Nation Foundation 111 West Corbin Street Hillsborough, NC 27278 Subscriptions to Formulations: $15 per year (four issues). Single sample issue: $5. Membership: $30 per year. (In addition to Formulations, members receive: Annual Reports, invitations to attend meetings of Board of Directors, use of the FNF library, more inclusion in the process.) Daylong Forums address topics vital to the vision of a successful free nation. Family Structure, Saturday, 19 April 1997, Hillsborough, North Carolina. International Relations, October 1997. (Specific date and place to be announced later.) Call 919-732-8366 for details. Web site at: HTTP://FREENATION.ORG/AFNF.HTM drawing FNF, incorporated in 1993, is an IRS 501 (c)(3) tax-exempt educational foundation. copyright 1994 by Peggy Combs "Criticizing the state is easy; FNF is moving to the front of the libertarian charge by describing real alternatives." Bruce L. Benson, Distinguished Research Professor, Department of Economics, Florida State University, author o( The Enterprise ofLaw: Justice Without the State WE CAN BUILD HER A NEW HOME IRI .> ·b t March 1997 Inside L 1 er Yvolumelo,Number4 4 Letters Your missives, should we choose to accept them. -

Liberty Magazine January 1998 Mime Type
The Crash of '97: J_an_u_ar:.-y1_99_8 ..:..-V_ol_,1_l,_N_o,_3 $4_,_00 Prelude to Disaster? "Individuality is the arm ofpolitical liberty. " -James Fenimore Cooper This specialseries oftalks andpanels is yoursfor only $105 (video) orjust $35 (audiocassette): The Problems and Challenges ofWriting Rand's Biography. Featuring Barbara Branden. (Audio: A225; Video: V225) Arguing with Ayn Rand. Featuring Rand's friend, eminent philosopher John Hospers. (Audio: A226; Video: V226) Ayn Rand's Ethics. Is egoism ancient? The Russian Radical . .. Featuring Nietzsche scholar Lester Chris Sciabarra's breakthrough study ofRand's Hunt. (Audio: A227; Video: philosophical origins has challenged thousands of V227) readers. A fascinating re-interpretation ofRand's whole That Fountainhead Rape. A approach to philosophy. discussion ofRand's sex '~The most thorough and scholarly work ever scenes, featuring Barbara done on Ayn Rand. " -John Hospers Branden. (Audio: A228; We offer Ayn Rand.· The Russian Radical in a beautiful Video: V228) hardcover edition for only $21.95 (list price: $55.00), Ayn Rand and Libertarianism. while supplies last! 477 engrossing pages. ($2.00 s&h) Featuring R.W. Bradford. (Audio: A229; Video: V229) Also: Letters ofAyn Rand, edited by Michael Berliner. What Is Living and What We offer this hardcover edition for $24.95 - $10.00 Is Dead in the Philosophy offthe publisher's price! 681 pages ofabsorbing ofAyn Rand. Featuring reading. ($2.00 s&h) Barbara Branden, John Hospers, Lester Hunt, and R.W. Bradford. (Audio: The Passion ofAyn Rand, by Barbara Branden. The classic, definitive biography ofRand, explores both the A230; Video: V230) light and the dark.ofthis brilliant woman's life. -

Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Masters of Health Science
A Fine Balance Children’s Community Nurses perceptions and practices regarding children’s rights to health: A Discourse analysis. Jill Sye A thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Health Science Auckland University of Technology New Zealand February 2008 Attestation of Authorship I hereby declare that this submission is my own work and that, to the best of my knowledge and belief, it contains no material published or written by another person nor material which to a substantial extent has been accepted for the qualification of any other degree or diploma or university or other institution of higher learning, except where due acknowledgment is made in the acknowledgments. Acknowledgements Firstly, I thank my partner Tim and children Rowan and Leith for their tolerance and support. My special thanks to my friends and neighbours, the "village" that I hold dear, in particular: Gaelene, Kate, Jenz, and Anne for listening, reading and commenting. I also want to express appreciation for the services of my very capable transcriber Jan and computer formatting advisor Sue. Also, to the global village- the international children's rights commentators that replied to my emails when I was grappling with the big issues. Thanks to: my colleagues and the management at Waitemata District Health Board for their support, and CTA funding; NZNO for the conferences, the opportunity to participate in child health at a national level, and the NERF scholarship awarded to assist with financing the study; I particularly want to thank the participants who shared their insights and demonstrated their love and care for the children and families that they strive to serve. -

Environmental Sellout
INSIDE: Al Gore Poster - The REAL Inconvenient Truth! OR F F R S E E W D O O L 7272 M B NZ $8.50 September-November 2006 R National National Rational That is the extent of Nick Smith’s Wet Green vision: more government and less freedom; more rights for trees, rocks and mud puddles, and fewer rights for human beings. Maximum controls, and the avoidance of The Great National Party ‘unnecessary’ freedom. A “consensus” achieved by wholesale sell-out – a Environmental competition as to who can shackle industry most effectively – such Sellout is the extent of the Wet Bluegreen is the new ‘wet’ Green vision. -Peter Cresswell, page 10 ALSO in this issue: NOT Darnton Vs Clark update! • Civil War In New TAXPAYER Zealand? • The Australian Who Is Too Liberal! FUNDED Editorial Lindsay Perigo Stepping Down ... and Stepping Up! Lindsay Perigo says goodbye! Twelve years and seventy-one issues after He was alluding to a pattern here: several of reason-and-freedom advocacy to American launching it, I have decided to step down as years ago I anointed him Libertarianz leader airwaves for the fi rst time. Whatever, FreeRad editor of The Free Radical. in my place … and one of the projects on my editor or not, I’ve no intention of being idle for agenda now is a Lanza bio to coincide with my second fi fty years! When I say, as I often do, that The Free Radical the 50th anniversary of Mario’s death in 2009. is the world’s sassiest, ‘KASSiest’ Objecti- I’ll be doing this in collaboration with Lanza’s The future will be interesting for Mr. -
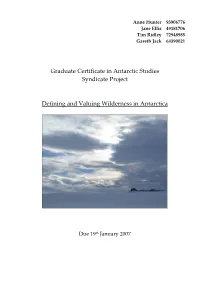
Graduate Certificate in Antarctic Studies Syndicate Project Defining
Anne Hunter 93906776 Jane Ellis 49181706 Tim Ridley 72948985 Gareth Jack 64390021 Graduate Certificate in Antarctic Studies Syndicate Project Defining and Valuing Wilderness in Antarctica Due 19th January 2007 Summary Wilderness is a difficult term to define as it is a subjective concept. This paper uses three paradigms as a framework for discussing wilderness in general, and the Antarctic wilderness in particular. It looks at the Utilitarian view of wilderness; the view that wilderness is there to be used by man to ensure the greatest benefit for the greatest number. In contrast it looks at the Deep Ecology view of wilderness. This view sees wilderness as of intrinsic valuable, and human beings as just another part of the ecosystem with no right to damage it for any purpose. According to this view, man should get out of Antarctica and just allow the continent to be; to remain the last great wilderness. Finally, it looks at Libertarianism; the view that the Antarctic wilderness only has value in terms of its usefulness to human beings. This philosophy promotes private ownership as the way to protect the wilderness. The Antarctic Treaty System is then analysed in terms of these paradigms. It looks at which paradigm shaped the Treaty, finding that it was largely informed by the Utilitarian view. This changed in the 1980s when, with the failure of CRAMRA, there was a move towards a Deep Ecology paradigm with its emphasis on the intrinsic worth of the wilderness, and therefore the necessity of putting measures in place to protect it. This approach has been consistent up until today.