Comptoir Voltaire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lukáš Ureš České Vysoké Učení Technické V Praze Fakulta
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2019 LUKÁŠ UREŠ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského inženýrství Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Analýza globálního terorismu na území Evropské unie Analysis of Global Terrorism in the European Union Bakalářská práce Studijní program: Ochrana obyvatelstva Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací Vedoucí práce: Ing. Břetislav Čupr Lukáš Ureš Kladno, květen 2019 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Analýza globálního terorismu na území Evropské unie vypracoval samostatně pouze s použitím pramenů, které uvádím v seznamu bibliografických odkazů. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Kladně dne 15.05.2019 ………………………. Podpis Poděkování Byl to boj, ale rád bych tímto poděkoval svému vedoucímu práce Ing. Břetislavovi Čuprovi za jeho pomoc a připomínky. Díky patří také rodičům a přítelkyni, kteří mi byli psychickou oporou. Abstrakt V bakalářské práci jsem se věnoval problematice globálního terorismu na území Evropské unie. V teoretické části jsem se zaměřil na základní pojmy spojené s terorismem, jeho vývoj a teroristické organizace. Součástí teoretické části je také protiteroristická politika Evropské unie. V rámci analýze jsem sepsal dosud proběhlé útoky v členských zemích od roku 2005. V praktické části bakalářské práce jsem detailněji popsal proběhlý útok v Paříži, Bruselu a Berlíně. Díky získání dat a údajů jsem útoky po podrobnější analýze porovnal. Část dále obsahuje bezpečnostní opatření. Cílem práce je uvést pohled na proběhlé útoky a působení terorismu na území Evropské unie. -

Attentats Du 13 Novembre 2015 En France
Attentats du 13 novembre 2015 en France Les attentats du 13 novembre 2015 en France, sur- et de l'État islamique, commettent une série d'attentats venus dans la soirée du vendredi 13 novembre 2015, et — qui commence par la tuerie au siège du journal Char- revendiqués par l'organisation terroriste État islamique, lie Hebdo et se termine par la prise d'otages de l’Hyper sont une série de fusillades et d’attentats-suicides qui Cacher — faisant dix-sept victimes. s’est produite en Île-de-France, pour l’essentiel à Paris e e D'autres attentats de moindre échelle ont eu lieu depuis dans les 10 et 11 arrondissements (rue Bichat, rue de la fin de l'année 2014. En avril 2015, Sid Ahmed Gh- , rue de Charonne, au Bataclan, et la Fontaine-au-Roi lam échoue dans son projet d'attentat, mais tue néan- boulevard Voltaire), ainsi qu’à Saint-Denis aux abords du moins Aurélie Châtelain à Villejuif (Val-de-Marne). Le stade de France. 26 juin, Yassin Salhi étrangle et égorge son patron, puis Des coups de feu visant des terrasses de restaurants et tente de faire exploser une usine de production de gaz cafés font plusieurs dizaines de morts dans les 10e et industriels et médicaux classée Seveso à Saint-Quentin- 11e arrondissements de Paris. Dans le même temps, des Fallavier (Isère). Le 13 juillet, quatre jeunes de 16 à 23 terroristes kamikazes se font exploser aux abords du stade ans, dont un ancien militaire, sont soupçonnés de pro- de France, où se déroule un match amical de football jeter une attaque contre le camp militaire du fort Béar, France-Allemagne. -

Myanmar Holds Election
Page 8 • Terror strike in Paris • COM: Tonga is cool El Gato • Friday,World December 4, 2015 • Los Gatos High School • www.elgatonews.com Tragedy spreads throughout Paris after series of attacks by Jessica Blough and Rowyn Van Miltenburg band Eagles of Death Metal was playing a sold out Hollande has since called a three-month state world have reached out to France, offering their Center Editor and News Editor show when three attackers stormed into the hall of emergency for France. The day after the attacks, support. Monuments ranging from the Sydney Opera On Nov. 13, Paris fell victim to a series of coor- and opened fire on the crowd. Eighty-nine people he deployed ten thousand soldiers throughout Paris House to the Empire State Building temporarily lit dinated terrorist attacks that took the lives of 130 died immediately and ninety-nine were critically and other cities. Hollande also announced that the up their exteriors in red, white, and blue, mimicking people. The attacks occurred at six separate loca- injured. The attackers shouted “Allahu akbar” army, police force, and gendarmerie will all expand the Tricolore to show solidarity with Paris. tions in the city and a suburb, Saint Denis. These and referenced Iraq and Syria, the first evidence in the upcoming year. The European Union has After the attacks, Obama spoke of the attacks attacks come less than a year after two masked that the Islamic State might have a role in the also instituted stricter border controls. The United saying, “Our hearts broke too.” He added, “Nous gunmen targeted Charlie attacks. -

Financing of the Terror Attacks in France Introduction
Financing of the terror attacks in France Introduction France became a more targeted country for Islamic terror in the past 6 years. From a single individual terror attack to a major multi-targeted attacks. In four reports we made a comparative study on four major attacks which took place from 2012 to 2016 in Toulouse, Paris and Nice. The main target of this report is to unravel the financing scheme of these attacks. We divided the financing into two main aspects, financing the recruiting and radicalization of the terrorists, and funding the specific terror attacks. As far as we see there is luck of information, in the overt media regarding the financial activity, yet, the few info available show the following: Financing of the recruitment in mosques and imams is generated mostly out of the Muslim Brotherhood entities, as UOIF, Qatar (directly and through Qaradawi and his foundation) and the French government. The actual funding for the attacks was made mostly by local assistance and the attackers themselves, yet, we do not know mostly what the source of the finances was (the finances to the Bataclan attack was given probably by ISIS representative in Europe). The terror attacks The Toulouse Attack [1] [2] The Toulouse and Montauban shootings were a series of three guns attacks committed by Mohammed Merah from March 11 to 19, 2012, targeting first French Army soldiers, later children and a teacher from a Jewish school in the cities of Montauban and Toulouse in the Midi-Pyrenees region of France. In total, the shooter killed seven people and wounded five, four seriously. -
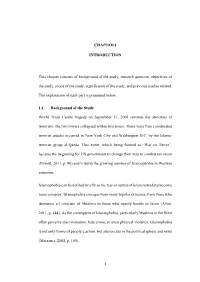
CHAPTER I INTRODUCTION This Chapter Consists of Background Of
CHAPTER I INTRODUCTION This chapter consists of background of the study, research question, objectives of the study, scope of the study, significance of the study, and previous studies related. The explanation of each part is presented below. 1.1. Background of the Study World Trade Centre tragedy on September 11, 2001 reminds the atrocities of terrorism, the two towers collapsed within two hours. There were four coordinated terrorist attacks occurred in New York City and Washington D.C. by the Islamic terrorist group al-Qaeda. This event, which being framed as “War on Terror”, became the beginning for US government to change their way to combat terrorism (Powell, 2011, p. 90) and it led to the growing number of Islamophobia in Western countries. Islamophobia can be defined briefly as the fear or hatred of Islam nowadays become more complex. Islamophobia emerges from many bipolar extremes, from those who denounce all criticism of Muslims to those who openly hostile to Islam (Allen, 2011, p. 144). As the consequent of Islamophobia, particularly Muslims in the West often perceive discrimination, hate crime, or even physical violence. Islamophobia is not only forms of people’s action, but also occurs in the political sphere and news (Marranci, 2004, p. 105). 1 Various forms of Islamophobia are also found in European countries. Muslims often get extra tight examination on immigrations and they are often get complaints about parking during Friday prayers. In German, Muslims are regarded rejecting norms and values and wanting to stay apart from the majority population by their way of life, so that they were called as the “Other” (Congressional Research Service, 2011, p. -

Europa Jagt Die Drahtzieher Des Terrors Mit Deren Hilfe Man Kirchtürme, Rathäu- Klimaschützer Ser Oder Bergwände in Den Farben Der Tri- Kolore Anstrahlen Kann
Unsere Art zu leben – der Kampf um die Werte Feuilleton NEUESTE NACHRICHTEN AUS POLITIK, KULTUR, WIRTSCHAFT UND SPORT WWW.SÜDDEUTSCHE.DE HF2 MÜNCHEN, DIENSTAG, 17. NOVEMBER 2015 71. JAHRGANG / 47. WOCHE / NR. 265 / 2,50 EURO (SZ) Satire darf alles, und darum darf der Charlie-Hebdo-Zeichner Joann Sfar selbst- verständlich auch den Leidtragenden in al- ler Welt sagen, sie sollten sich ihre Gebete für Paris nun bitte wieder an den Hut ste- cken: Man brauche das nicht. Sein Appell erinnert wenn schon nicht stilistisch, so doch in der Sache an das Kleingedruckte in Todesanzeigen, in denen darum gebeten wird, von Beileidsbezeigungen beziehungs- weise -bekundungen am Grab Abstand zu nehmen. Diese mittlerweile fast schon no- torische Klausel gilt als derart distinguiert, dass niemand mehr auf die Idee kommt, Terror in Paris sie als das aufzufassen, was sie im Kern ist, nämlich ein gezierter, ja gestelzter Affront. In bürokratischer Umständlichkeit sagt sie Die Opfer: Ihre Geschichten entlarven nichts anderes, als dass die Trauergäste die Lügen der Täter Seite 2 zwar zur Beerdigung kommen dürfen, da- bei aber tunlichst niemanden mit ihrer Die Täter: Wie junge Männer zu Mör- wohl für scheinheilig gehaltenen Trauer dern wurden Seite 3 behelligen sollen. Nun kann Trauer freilich auch fürchter- Ja zum Einsatz: Ohne Militär ist der Ter- lich nerven, besonders wenn sie wie eine ror nicht zu besiegen Seite 4 Woge über die ganze Welt geht und sich al- lein durch dieses Lawinenartige dem Ver- Lösegeld und Öl: Der IS hat eine solide dacht aussetzt, dass sie, bei aller Echtheit Einnahmebasis Seite 5 im Detail, aufs Ganze gesehen das Ergeb- nis einer großmächtigen Organisation ist. -

Issn 2421-4442
ISSN 2421-4442 La Rivista semestrale Sicurezza, Terrorismo e Società intende la Sicurezza come una 7 condizione che risulta dallo stabilizzarsi e dal mantenersi di misure proattive capaci di promuovere il benessere e la qualità della vita dei cittadini e la vitalità democratica delle istituzioni; affronta il fenomeno del Terrorismo come un processo complesso, di lungo periodo, che affonda le sue radici nelle dimensioni culturale, religiosa, politica ed economica che caratterizzano i sistemi sociali; propone alla Società – quella degli studiosi e degli operatori e quella ampia di cittadini e istituzioni – strumenti di com- prensione, analisi e scenari di tali fenomeni e indirizzi di gestione delle crisi. Sicurezza, Terrorismo e Società si avvale dei contributi di studiosi, policy maker, analisti, operatori della sicurezza e dei media interessati all’ambito della sicurezza, del terrorismo e del crisis management. Essa si rivolge a tutti coloro che operano in tali settori, volendo rappresentare un momento di confronto partecipativo e aperto al dibattito. La rivista ospita contributi in più lingue, preferendo l’italiano e l’inglese, per ciascuno dei quali è pubblicato un Executive Summary in entrambe le lingue. La redazione solle- cita particolarmente contributi interdisciplinari, commenti, analisi e ricerche attenti alle principali tendenze provenienti dal mondo delle pratiche. Sicurezza, Terrorismo e Società è un semestrale che pubblica 2 numeri all’anno. Oltre ai due numeri programmati possono essere previsti e pubblicati numeri speciali. -

Issn 2421-4442
ISSN 2421-4442 La Rivista semestrale Sicurezza, Terrorismo e Società intende la Sicurezza come una 7 condizione che risulta dallo stabilizzarsi e dal mantenersi di misure proattive capaci di promuovere il benessere e la qualità della vita dei cittadini e la vitalità democratica delle istituzioni; affronta il fenomeno del Terrorismo come un processo complesso, di lungo periodo, che affonda le sue radici nelle dimensioni culturale, religiosa, politica ed economica che caratterizzano i sistemi sociali; propone alla Società – quella degli studiosi e degli operatori e quella ampia di cittadini e istituzioni – strumenti di com- prensione, analisi e scenari di tali fenomeni e indirizzi di gestione delle crisi. Sicurezza, Terrorismo e Società si avvale dei contributi di studiosi, policy maker, analisti, operatori della sicurezza e dei media interessati all’ambito della sicurezza, del terrorismo e del crisis management. Essa si rivolge a tutti coloro che operano in tali settori, volendo rappresentare un momento di confronto partecipativo e aperto al dibattito. La rivista ospita contributi in più lingue, preferendo l’italiano e l’inglese, per ciascuno dei quali è pubblicato un Executive Summary in entrambe le lingue. La redazione solle- cita particolarmente contributi interdisciplinari, commenti, analisi e ricerche attenti alle principali tendenze provenienti dal mondo delle pratiche. Sicurezza, Terrorismo e Società è un semestrale che pubblica 2 numeri all’anno. Oltre ai due numeri programmati possono essere previsti e pubblicati numeri speciali. -
Ukázka Závěrečné Práce
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vliv bezpečnosti vybraných regionů na cestovní ruch Bakalářská práce 2021 Kateřina Šmahová PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Práci s názvem Vliv bezpečnosti vybraných regionů na cestovní ruch jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. Beru na vědomí, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a směrnicí Univerzity Pardubice č. 7/2019 Pravidla pro odevzdávání, zveřejňování a formální úpravu závěrečných prací, ve znění pozdějších dodatků, bude práce zveřejněna prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice. V Pardubicích dne 29. 4. 2021 Kateřina Šmahová v. r. PODĚKOVÁNÍ: Touto cestou bych ráda poděkovala svému vedoucímu Ing. Martinu Maštálkovi, Ph.D. za jeho neustálý dohled, připomínky a strávený čas, který mi při psaní bakalářské práce věnoval. Dále bych chtěla poděkovat své rodině a přátelům za podporu a pomoc, kterou mi během studia poskytli. -

Bakalářská Práce Analýza Teroristických Útoků
VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Studijní program: Bezpečnostní management v regionech BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ANALÝZA TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ PROVEDENÝCH VE 21. STOLETÍ NA ÚZEMÍ EU Autor: Denisa Kaššayová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Káčer, Ph.D. 2017 P r o h l a š u j i, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil v textu. Veškerou použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. Současně souhlasím s tím, aby tato práce byla zpřístupněna v knihovně VŠRR a používána ke studijním účelům v souladu s autorským právem. V Praze dne 28.4. 2017 Denisa Kaššayová Poděkování Ráda bych zde věnovala poděkování svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Jánu Káčerovi, Ph.D., za připomínky a náměty v průběhu tvorby BP, za profesionální vedení konzultací a za doporučení odborné literatury. Poděkování patří i panu Lumíru Němcovi, z oboru speciálních sil PČR a AČR, za odbornou konzultaci a doporučení zdrojů. Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou teroristických útoků a jejím cílem je analyzovat útoky, které byly spáchány na území států Evropské unie za posledních 16 let. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětlena základní teoretická východiska, jež napomáhají k vypracování části praktické. V první kapitole popisuje terorismus samotný, jeho definici a formy. Ve druhé kapitole pak nalezneme popis teroristických útoků z hlediska jejich formy, motivu a budou zde popsány fáze útoků. Ve třetí kapitole teoretické části je nastíněn boj proti terorismu na území EU. V závěru teoretické části jsou popsány cíle a metodika pro vypracování praktické části. Praktickou část bakalářské práce tvoří analýza šesti největších teroristických útoků, jimž čelila Evropská unie od počátku 21. -

IS Jihadists Claim Paris Attacks That Killed
SUBSCRIPTION SUNDAY, NOVEMBER 15, 2015 SAFAR 2, 1437 AH www.kuwaittimes.net Arabic Israel razes Egypt’s woes Russia pays threatened by homes of four erode Sisi’s doping dominance Palestinians image of price with of English5 in West8 Bank invincibility IAAF ban IS jihadists 15claim Paris18 Min 11º Max 25º attacks that killed 128 High Tide 00:18 & 14:14 France vows ‘merciless’ response • Concert hall, stadium, cafes targeted Low Tide 07:40 & 19:33 40 PAGES NO: 16698 150 FILS PARIS: Islamic State jihadists yesterday claimed a series of coordinated attacks by gunmen and suicide bombers in Paris that killed at least 128 people in scenes of car- nage at a concert hall, restaurants and the national stadi- um. French President Francois Hollande also blamed the Islamist extremist group for the bloodshed and called the coordinated assault on Friday night at six different sites an “act of war”. Authorities identified the body of a French national known to the intelligence services near the Bataclan con- cert hall, where 82 people were killed by armed men who had shouted “Allahu akbar” (“God is greatest!”) before gunning down concert-goers. Police sources said he was probably one of those who stormed the building as around 1,500 people were watching a Californian rock band. The discovery of Syrian and Egyptian passports near the body of other of assailants appeared to justify fears over the threat posed to Europe by extremism in the Middle East. SEE PAGES 10, 11, 14, 20 & 40 The attacks, which saw the first-ever suicide bombings on French soil, were “prepared, organized and planned overseas, with help from inside (France) which the inves- tigation will establish,” Hollande said. -

N° 3922 Assemblée Nationale
N° 3922 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juillet 2016 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE (1) relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 M. GEORGES FENECH Président M. SÉBASTIEN PIETRASANTA Rapporteur Députés —— (1) La composition de cette commission d’enquête figure au verso de la présente page. La commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme est composée de : M. Georges Fenech, président ; M. Sébastien Pietrasanta, rapporteur ; MM. Jacques Cresta, Meyer Habib, Guillaume Larrivé, Mme Anne-Yvonne Le Dain, vice-présidents ; M. Christophe Cavard, Mme Françoise Dumas, MM. Olivier Falorni, Serge Grouard, secrétaires ; MM. Pierre Aylagas, David Comet, Jean-Jacques Cottel, Marc Dolez, Mme Marianne Dubois, MM. Philippe Goujon, Henri Guaino, François Lamy, Jean-Luc Laurent, Michel Lefait, Pierre Lellouche, Mme Lucette Lousteau, MM. Olivier Marleix, Jean-René Marsac, Alain Marsaud, Pascal Popelin, Mmes Maina Sage, Julie Sommaruga, MM. Patrice Verchère, Jean-Michel Villaumé. — 3 — SOMMAIRE ___ Pages AVANT-PROPOS DE M. GEORGES FENECH, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE ..................................................................................... 11 INTRODUCTION ........................................................................................................... 27 PREMIÈRE PARTIE – EN 2015 : DES ATTENTATS D’UNE AMPLEUR INÉDITE ..................................................................................................... 31 I. LA CHRONOLOGIE DES ATTAQUES DES 7, 8 ET 9 JANVIER 2015 .............. 32 A. L’ATTAQUE DE CHARLIE HEBDO LE 7 JANVIER 2015 ................................. 32 1. De l’attaque de Charlie Hebdo à la disparition des frères Kouachi ....................... 32 2. L’organisation de l’enquête et de la traque le 7 janvier après 12h00 ....................