Proquest Dissertations
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature
A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor RESEARCH IN MEDIEVAL CULTURE Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Medieval Institute Publications is a program of The Medieval Institute, College of Arts and Sciences Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor MEDIEVAL INSTITUTE PUBLICATIONS Western Michigan University Kalamazoo Copyright © 2015 by the Board of Trustees of Western Michigan University All rights reserved Manufactured in the United States of America This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Taylor, Robert A. (Robert Allen), 1937- Bibliographical guide to the study of the troubadours and old Occitan literature / Robert A. Taylor. pages cm Includes index. Summary: "This volume provides offers an annotated listing of over two thousand recent books and articles that treat all categories of Occitan literature from the earli- est enigmatic texts to the works of Jordi de Sant Jordi, an Occitano-Catalan poet who died young in 1424. The works chosen for inclusion are intended to provide a rational introduction to the many thousands of studies that have appeared over the last thirty-five years. The listings provide descriptive comments about each contri- bution, with occasional remarks on striking or controversial content and numerous cross-references to identify complementary studies or differing opinions" -- Pro- vided by publisher. ISBN 978-1-58044-207-7 (Paperback : alk. paper) 1. Provençal literature--Bibliography. 2. Occitan literature--Bibliography. 3. Troubadours--Bibliography. 4. Civilization, Medieval, in literature--Bibliography. -

Commercial Release Sheet (PDF)
GCD P32103 Poissance d’amours New release information February 2008 Graindelavoix “Le grain, c’est le corps dans la voix qui chante, dans la main qui écrit, dans le membre qui exécute...” (Roland Barthes) NOTES (ENG) NOTES (FRA) Little attention has been given on record so far La discographie avait jusqu’à présent négligé to the music and writings emanating from the la musique et les écrits extraordinaires dus à flourishing economic and cultural environs of la floraison économique et culturelle du Brabant 13th-century Brabant but it is from the au XIIIe ; et c’est à cette source prodigieuse remarkable outpouring associated with this ayant surgi dans ce duché médiéval que Björn medieval duchy – covering the areas of Brussels, Schmelzer et Graindelavoix ont puisé pour créer Antwerp and the present day Belgian provinces leur troisième volume chez Glossa. Au cours of Vlaams and Walloon Brabant as well as des deux précédents, Caput (GCD P32101) et Noord-Brabant in The Netherlands – that Björn Joye (GCD P32102), Schmelzer et son ensemble Schmelzer and Graindelavoix have created their résident à Anvers ont exploré, dans la musique third recording for Glossa. In Caput (GCD médiévale tardive de Johannes Ockeghem et P32101) and Joye (GCD P32102) Schmelzer de Gilles Binchois, des courants et des tendances and his Antwerp-based ensemble explored in qui illuminent notre temps. Graindelavoix, en the late medieval music of Johannes Ockeghem effet, s’intéresse principalement, dans le cadre Poissance d’amours and Gilles Binchois undercurrents that illuminate de la musique ancienne, à la relation entre la Mystics, monks and minstrels our own times. -

Bibliographie Des Chansonniers Franã§Ais Des Xiiie Et Xive Siãšcles
BIBLIOGRAPHIE CHANSONNIEH RANÇAI LE PU "t'. - 1~1PHBl1:HJ E MA HG!ŒSSOU FILS BIBLIOGRAPHIE DES CHANSONNIERS FRANCAIS. .. DES XIIIe ET XIVe SIÈCLES COMPRENANT LA DESCRIPTION DE TOUS LES MANUSCRITS LA TABLE DES CHANSONS CLASSÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DE RIMES ET LA LISTE DES TROUVÈRES PAR GASTON RA YN A UD TOME PREMIER DESCRIPTION DES MANUSCRITS PARIS F. VIEWEG, LIBRAIRE- ÉDI TEUR 67, RUE RlCHELlllU. 67 1884 INTRODUCTION Les travaux préliminalres de l'édition des œuvres de Tiébaut de Champagne, que je prépare depuis plusieurs années et qui verra bientôt le jour, m'ont conduit à étu dier de près tous les manuscrits de chansons françaises du moyen âge; j'ai dû, à cette occasion, parcourir ces manuscrits, les dépouiller complètement et dresser pour mon usage une table générale, d'où je pusse extraire, dans son intégrité, la bibliographie des chansons du Roi de Navarre, qui trop souvent, dans certains manuscrits, sont anonymes ou ont de fausses attributions. C'est ce travail, complété et augmenté, que je présente aujour d'hui au public; il sera, je l'espère, utile, et évitera aux travailleurs bien des recherches et des tâtonnements, en leur permettant de prendre connaissance, à l'aide du premier vers d'une chanson, des manuscrits qui la con tiennent et des éditeurs qui l'ont publiée, et, d'autre part, de retrouver, sous le nom de chaque trouvère, les pièces qui lui sont attribuées, à tort ou à raison. L'idée, du reste, n'est pas absolument nouvelle: déjà, J:\ITnODUC'j au XVIIie siècle, La Borde, dans son Essai sur la musique (t. -
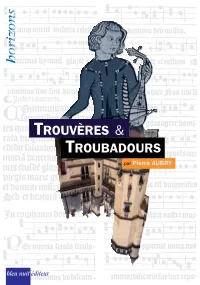
Trouvères & Troubadours
TROUVÈRES & TROUBADOURS par Pierre AUBRY bleu nuit éditeur Trouvères & Troubadours dans la même collection: 1. Alexandre BORODINE par André Lischké 32. César FRANCK par Eric Lebrun 2. Le Clavecin des Lumières par Jean-Patrice Brosse 33. Giuseppe VERDI par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin 3. Leos JANACEK par Patrice Royer 34. Charles-Valentin ALKAN par B. François-Sappey & F. Luguenot 4. Jean SIBELIUS par Pierre Vidal 35. Francis POULENC par Isabelle Werck 5. Etienne Nicolas MÉHUL par Adélaïde de Place 36. Edvard GRIEG par Isabelle Werck 6. Gaston LITAIZE par Sébastien Durand 37. Wolgang Amadeus MOZART par Yves Jaffrès 7. Dietrich BUXTEHUDE par Eric Lebrun 38. Camille SAINT-SAËNS par Jean-Luc Caron & Gérard Denizeau 8. Guillaume LEKEU par Gilles Thieblot 39. Antonio SALIERI par Marc Vignal 9. Jan Dismas ZELENKA par Stéphan Perreau 40. Anton BRUCKNER par Jean Gallois 10. Maurice EMMANUEL par Christophe Corbier 41. Jean-Philippe RAMEAU par Jean Malignon & J.-Philippe Biojout 11. André JOLIVET par Jean-Claire Vançon 42. Christoph Willibald GLUCK par Julien Tiersot 12. Richard STRAUSS par Christian Goubault 43. Carl NIELSEN par Jean-Luc Caron 13. Alexandre P. F.BOËLY par B. François-Sappey & E. Lebrun 44. Ludwig van BEETHOVEN par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin 14. Gaetano DONIZETTI par Gilles de Van 45. Charles GOUNOD par Yves Bruley 15. Gioachino ROSSINI par Gérard Denizeau 46. Manuel de FALLA par Gilles Thieblot 16. Antonio VIVALDI par Adélaïde de Place & Fabio Biondi 47. Charles-Marie WIDOR par Anne-Isabelle de Parcevaux 17. Edouard LALO par Gilles Thieblot 48. Ralph VAUGHAN WILLIAMS par Marc Vignal 18. -

Œuvres Complètes De Rutebeuf, Trouvère Du Xiiie Siècle, Recueillies Et Mises Au Jour Pour La Première Fois Par Achille Jubinal
Œuvres complètes de Rutebeuf, trouvère du XIIIe siècle, recueillies et mises au jour pour la première fois par Achille Jubinal. Nouvelle édition revue et corrigée. Achille JUBINAL Paris : 1874, Paul Daffis. Œuvres complètes de Rutebeuf, trouvère du XIIIe siècle, recueillies et mises au jour pour la première fois par Achille Jubinal, Nouvelle édition revue et corrigée, A. JUBINAL, 1874 : Paris, Paul Daffis, vol. 1, pp. 1-4. C’est de la Povretei Rutebuef1 Ms. 7633. Je ne ſai par où je coumance Tant ai de matyere abondance Por parleir de ma povretei. Por Dieu vos pri, frans Rois de France, 5 Que me doneiz queilque chevance2 Si fereiz trop grant charitei. J’ai veſcu de l’autrui chatei3 Que hon m’a créu4 & preſtei ; Or me faut chacuns de créance, 10 C’om me ſeit povre & endetei : Vos r’aveiz hors dou reigne eſtei Où toute avoie m’atendance. Entre chier tens & ma mainie5 Qui n’eſt malade ni fainie, 15 Ne m’ont laiſſié deniers ne gage. Gent truis d’eſcondire6 arainie7 Et de doneir mal enseignie8 : 1 L’ensemble de cette pièce, son quatrième et surtout son onzième vers indiquent que la composition en remonte au temps très-court qui s’écoula entre le commencement et la fin de la seconde croisade, et qu’elle fut écrite pendant que Louis IX était occupé à combattre les infidèles. Le saint roi dut donc la rece- voir, si elle parvint jusqu’à lui, sur la plage de Tunis. 2 Chevance : voyez, pour ce mot, une des notes de la fin de la Paiz de Rutebueſ. -

The Troubadours
The Troubadours H.J. Chaytor The Project Gutenberg EBook of The Troubadours, by H.J. Chaytor This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net Title: The Troubadours Author: H.J. Chaytor Release Date: May 27, 2004 [EBook #12456] Language: English and French Character set encoding: ASCII *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK THE TROUBADOURS *** Produced by Ted Garvin, Renald Levesque and the Online Distributed Proofreading Team. THE TROUBADOURS BY REV. H.J. CHAYTOR, M.A. AUTHOR OF "THE TROUBADOURS OF DANTE" ETC. Cambridge: at the University Press 1912 _With the exception of the coat of arms at the foot, the design on the title page is a reproduction of one used by the earliest known Cambridge printer, John Siberch, 1521_ PREFACE This book, it is hoped, may serve as an introduction to the literature of the Troubadours for readers who have no detailed or scientific knowledge of the subject. I have, therefore, chosen for treatment the Troubadours who are most famous or who display characteristics useful for the purpose of this book. Students who desire to pursue the subject will find further help in the works mentioned in the bibliography. The latter does not profess to be exhaustive, but I hope nothing of real importance has been omitted. H.J. CHAYTOR. THE COLLEGE, PLYMOUTH, March 1912. CONTENTS PREFACE CHAP. I. INTRODUCTORY II. -

Guillaume IX, Le Gap Et La Psychologie Évolutionniste
Guillaume IX, le Gap et la Psychologie évolutionniste Si l’on s’accorde pour attribuer le titre de premier troubadour à Guillaume de Poitiers (1071-1126), septième comte de ce nom et neuvième duc d’Aquitaine, ce n’est pas seulement à cause de l’igno- rance où nous sommes de tout ce qui a pu le précéder; cela reflète aus- si l’exceptionnelle diversité de la mince œuvre qu’il nous a léguée, indice d’un tâtonnement typique des débuts. A une exception près, contestée d’ailleurs, les pièces conservées sont toutes désignées par l’appellation passe-partout vers (autre signe d’un art qui se cherche), et pourtant le prince-poète n’a jamais cessé d’explorer les diverses possibilités métriques et thématiques qu’offrait cette forme. Dès avant la fameuse étiquette «trovatore bifronte» dont Pio Rajna a doté Guillaume, Friedrich Diez, qui ne connaissait que neuf sur onze de ses poésies, avait partagé son œuvre en trois catégories en fonction de leur contenu sensuel (sinnlich), tendre (zärtlich) ou sérieux (ernst), réparti- tion reprise dans l’édition Jeanroy 1. Les recherches les plus récentes raffinent encore l’analyse, distinguant non moins de cinq «registres» (Bec), voire six groupes ou sous-groupes (Lafont) dans l’œuvre de notre poète 2. L’hétérogénéité de la production poétique de Guillaume, sur- tout son ‘bifrontisme’, l’écart entre ses poèmes ‘courtois’ et ‘non-cour- tois’, a toujours posé un problème pour les études occitanes, susci- tant de nombreuses tentatives d’explication, dont on ne peut citer que quelques-unes des plus saillantes. -

1 the Middle Ages
THE MIDDLE AGES 1 1 The Middle Ages Introduction The Middle Ages lasted a thousand years, from the break-up of the Roman Empire in the fifth century to the end of the fifteenth, when there was an awareness that a ‘dark time’ (Rabelais dismissively called it ‘gothic’) separated the present from the classical world. During this medium aevum or ‘Middle Age’, situated between classical antiquity and modern times, the centre of the world moved north as the civil- ization of the Mediterranean joined forces with the vigorous culture of temperate Europe. Rather than an Age, however, it is more appropriate to speak of Ages, for surges of decay and renewal over ten centuries redrew the political, social and cultural map of Europe, by war, marriage and treaty. By the sixth century, Christianity was replacing older gods and the organized fabric of the Roman Empire had been eroded and trading patterns disrupted. Although the Church kept administrative structures and learning alive, barbarian encroachments from the north and Saracen invasions from the south posed a continuing threat. The work of undoing the fragmentation of Rome’s imperial domain was undertaken by Charlemagne (742–814), who created a Holy Roman Empire, and subsequently by his successors over many centuries who, in bursts of military and administrative activity, bought, earned or coerced the loyalty of the rulers of the many duchies and comtés which formed the patchwork of feudal territories that was France. This process of centralization proceeded at variable speeds. After the break-up of Charlemagne’s empire at the end of the tenth century, ‘France’ was a kingdom which occupied the region now known as 2 THE MIDDLE AGES the Île de France. -

Lo Chansonnier Du Roi Luoghi E Autori Della Lirica E Della Musica Europee Del Duecento
Lo Chansonnier du Roi Luoghi e autori della lirica e della musica europee del Duecento Facoltà di Lettere e Filosofia Dottorato in Musica e Spettacolo Curriculum di Storia e Analisi delle Culture Musicali Candidato Alexandros Maria Hatzikiriakos Tutor Co-Tutor Prof. Emanuele Giuseppe Senici Prof. Davide Daolmi a Niccolò Ringraziamenti Seppur licenziata sotto il nome di un solo autore, questa tesi ha raccolto una considerevole quantità di debiti, nel corso dei suoi tre anni di gestazione, che mi è impossibile ignorare. Agli studi e al prezioso aiuto di Stefano Asperti devo non solo il fondamento di questo lavoro, ma anche un supporto indispensabile. Parimenti ad Anna Radaelli, sono grato per un sostegno costante, non solo scientifico ma anche morale ed emotivo. Non di meno, i numerosi consigli di Emma Dillon, spesso accompagnati da confortanti tazze di caffè nero e bollente, mi hanno permesso di (ri-)trovare ordine nel coacervo di dati, intuizioni e deduzioni che ho dovuto affrontare giorno dopo giorno. A Simon Gaunt devo un prezioso aiuto nella prima e confusa fase della mia ricerca. A Marco Cursi e Stefano Palmieri devo una paziente consulenza paleografica e a Francesca Manzari un’indispensabile expertise sulle decorazioni del Roi. Ringrazio inoltre Davide Daolmi per la guida, il paziente aiuto e le numerose “pulci”; Maria Teresa Rachetta, filologa romanza, per aver lavorato e presentato con me i primi frutti di questa ricerca, lo Chansonnier du Roi per avermi dato l’opportunità di conoscere Maria Teresa Rachetta, l’amica; Livio Giuliano per ragionamenti improbabili ad ore altrettanto improbabili, sulla sociologia arrageois; Cecilia Malatesta e Ortensia Giovannini perché … il resto nol dico, già ognuno lo sa. -

Chapter 2: Secular and Cathedral Music in the High Middle Ages I
Chapter 2: Secular and Cathedral Music in the High Middle Ages I. Introduction – Chapter 1 dealt primarily with sacred music, influenced by the fact that initially only sacred music was available for observation. Chapter 2 turns to secular music. II. Troubadours and Trouvères A.Troubadours 1. The first European vernacular poet whose work survives was William IX (7th count of Poitiers and 9th duke of Aquitaine). b. The tradition of these poets is known as the troubadour. c. The troubadour tradition was a “top down” as those of the highest social ranks were the main participants. Their poetry celebrated feudal ideals. d. Different types of troubadour verse dealt with various aspects of the feudal system, including songs of alliance, knightly decorum, exploits, challenges, and death. 2. Courtly love lay at the heart of the troubadour tradition. a. The canso was a song about love. b. Courtly love songs celebrated the same high ideals as other types of songs. c. The lady about whom a poet wrote usually outranked him, making her theoretically unattainable. d. Courtly love was generally more about veneration than physical love. e. The poetic style matches the lofty ideals of courtly love, as demonstrated in Can vei la lauzeta mover. B. Performance and Oral Culture 1. We do not know the rhythm of troubadour songs, but most likely the loftier style of the troubadour songs approximated that of contemporary chant. 2. Some troubadour songs matched a lower-class style; these were not based on chant style. a. Pastorela is one such genre. b. L’autrier jost’ una sebissa by Marcabru is an example. -

Key Colour Author(S): Franz Grœnings Source: the Musical Times and Singing Class Circular, Vol
Key Colour Author(s): Franz Grœnings Source: The Musical Times and Singing Class Circular, Vol. 27, No. 525 (Nov. 1, 1886), pp. 651-653 Published by: Musical Times Publications Ltd. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3363186 Accessed: 04-11-2015 14:37 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Musical Times Publications Ltd. is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Musical Times and Singing Class Circular. http://www.jstor.org This content downloaded from 146.201.208.22 on Wed, 04 Nov 2015 14:37:19 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions THE MUSICAL TIMES.-NOVEMBER I, 1886. 651 figurationwhich, in commonwith other things,was on keycolour generally go in a circleand leave things due to easternexample and influences. But theyare as they were before, because opponents argue from the moreremarkable when we considerhow scanty and differentinstruments or combinations (voices included) limitedwere the means at thedisposal of the trouvbres, without sometimes even mentioning their respective and thatthey were composedat a timewhen music, basis or ignoring their difference,and then they both no less than poetry,had just emerged from six generalise the observations or impressions received centuriesof utterdarkness; nay,it maybe doubted froma certainsound producer. -

Troubadours NEW GROVE
Troubadours, trouvères. Lyric poets or poet-musicians of France in the 12th and 13th centuries. It is customary to describe as troubadours those poets who worked in the south of France and wrote in Provençal, the langue d’oc , whereas the trouvères worked in the north of France and wrote in French, the langue d’oil . I. Troubadour poetry 1. Introduction. The troubadours were the earliest and most significant exponents of the arts of music and poetry in medieval Western vernacular culture. Their influence spread throughout the Middle Ages and beyond into French (the trouvères, see §II below), German, Italian, Spanish, English and other European languages. The first centre of troubadour song seems to have been Poitiers, but the main area extended from the Atlantic coast south of Bordeaux in the west, to the Alps bordering on Italy in the east. There were also ‘schools’ of troubadours in northern Italy itself and in Catalonia. Their influence, of course, spread much more widely. Pillet and Carstens (1933) named 460 troubadours; about 2600 of their poems survive, with melodies for roughly one in ten. The principal troubadours include AIMERIC DE PEGUILHAN ( c1190–c1221), ARNAUT DANIEL ( fl c1180–95), ARNAUT DE MAREUIL ( fl c1195), BERNART DE VENTADORN ( fl c1147–70), BERTRAN DE BORN ( fl c1159–95; d 1215), Cerveri de Girona ( fl c1259–85), FOLQUET DE MARSEILLE ( fl c1178–95; d 1231), GAUCELM FAIDIT ( fl c1172–1203), GUILLAUME IX , Duke of Aquitaine (1071–1126), GIRAUT DE BORNELH ( fl c1162–99), GUIRAUT RIQUIER ( fl c1254–92), JAUFRE RUDEL ( fl c1125–48), MARCABRU ( fl c1130–49), PEIRE D ’ALVERNHE ( fl c1149–68; d 1215), PEIRE CARDENAL ( fl c1205–72), PEIRE VIDAL ( fl c1183–c1204), PEIROL ( c1188–c1222), RAIMBAUT D ’AURENGA ( c1147–73), RAIMBAUT DE VAQEIRAS ( fl c1180–1205), RAIMON DE MIRAVAL ( fl c1191–c1229) and Sordello ( fl c1220–69; d 1269).