Cahier Actes De Colloque SHGHD.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cross-Currents in French Defense and U.S. Interests by Leo G
STRATEGIC PERSPECTIVES 10 Cross-currents in French Defense and U.S. Interests by Leo G. Michel Center for Strategic Research Institute for National Strategic Studies National Defense University Institute for National Strategic Studies National Defense University The Institute for National Strategic Studies (INSS) is National Defense University’s (NDU’s) dedicated research arm. INSS includes the Center for Strategic Research, Center for Complex Operations, Center for the Study of Chinese Military Affairs, Center for Technology and National Security Policy, Center for Transatlantic Security Studies, and Conflict Records Research Center. The military and civilian analysts and staff who comprise INSS and its subcomponents execute their mission by conducting research and analysis, publishing, and participating in conferences, policy support, and outreach. The mission of INSS is to conduct strategic studies for the Secretary of Defense, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, and the Unified Combatant Commands in support of the academic programs at NDU and to perform outreach to other U.S. Government agencies and the broader national security community. Cover: French Army Colonel Eric Bellot des Minières, right, briefs General Stanley A. McChrystal, USA, at Combat Outpost 42 in Tagab Valley, Afghanistan, March 30, 2010. General McChrystal was commander of the North Atlantic Treaty Organization International Security Assistance Force and U.S. Forces Afghanistan. Photo by Mark O’Donald Cross-currents in French Defense and U.S. Interests Cross-currents in French Defense and U.S. Interests By Leo G. Michel Institute for National Strategic Studies Strategic Perspectives, No. 10 Series Editor: Nicholas Rostow National Defense University Press Washington, D.C. -
Navy Accepts Delivery of Future USS Gravely
® Serving the Hampton Roads Navy Family Vol. 18, No. 30, Norfolk, VA FLAGSHIPNEWS.COM July 29, 2010 Navy accepts delivery of future USS Gravely BY CHRIS JOHNSON Team Ships Public Affairs WASHINGTON — The Navy offi cially ac- cepted delivery of the future USS Gravely from Northrop Grumman Shipbuilding during a ceremony, July 26, in Pascagoula, Miss. Desig- nated DDG 107, Gravely is the 57th ship of the Arleigh Burke class. The ship successfully completed acceptance trials, June 28. Due to the oil spill currently affecting the Gulf of Mexico, the trials were slightly modifi ed, with the ship conducting pierside tests and inspections by the Navy’s Board of Inspection and Survey (INSURV), fol- lowed by a 36-hour underway period to assess the ship’s main propulsion, auxiliary, steering, damage control equipment, navigation sys- tems and deck equipment as well as overall completeness. “Though the oil spill forced us to modify our normal trial schedule, we were still able to de- liver Gravely as originally scheduled,” said Capt. Pete Lyle, DDG 51 class program man- ager in the Navy’s Program Executive Offi ce (PEO) Ships. “That is really a testament to the maturity of the class and the program’s suc- cessful history of delivering ships on time and on schedule.” Gravely is a multi-mission guided-missile Photo by MC2 Corey Truax destroyer designed to operate in multi-threat The Arleigh Burke class guided-missile destroyer USS Gravely (DDG 107) is surrounded by oil containment booms to prevent oil from the air, surface and subsurface environments. The Deepwater Horizon oil spill from reaching it’s hull while pierside in Pascagoula, Miss. -

French Defence Policy in a Time of Uncertainties Yves Boyer
FOKUS | 5/2012 French defence policy in a time of uncertainties Yves Boyer Besides the United States the EU is the reasons (historical, societal, diplomatic, In the military domains the French only grouping of nations able to project etc.) explain the many difficulties met by defence organisation, whatever its limits, its influence worldwide. Despite the the Europeans to further their cooperation has been organised to be efficient and current crisis, the EU remains a global in that field and the various ambiguities in to maintain the coherence of the French economic superpower with the highest the conduct of each EU country’s defence defence posture. The Executive (the Pre- GNP worldwide when the various GNP affairs. sident of the Republic) is the head of the of its members are combined. In the armed forces according to the constitu- foreseeable future this situation will be France shares with her EU’s partners, tion. He provides guidance (subsequently preserved, allowing the Union to generate and notably those members of the agreed on by the Parliament) on the financial surpluses which can be used to Eurozone, the dire effects of the financial overall strategy and military organisati- back its policy of global influence based and economic crisis. The debt issue, in on. He carefully controlls their execution on diverse forms of “civilian” power with conjunction with economic stagnation, through his military staff at the Elysée a central position in various international will affect public spending and, notably, palace and directs their implementation networks and a significant role in interna- defence expenditure. However, France through the chairing of the high council tional institutions. -

Mali: Vive La Coloniale?
This is a repository copy of Mali: vive la Coloniale?. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/100199/ Version: Accepted Version Article: Utley, RE (2016) Mali: vive la Coloniale? International Journal of Francophone Studies, 19 (2). pp. 143-172. ISSN 1368-2679 https://doi.org/10.1386/ijfs.19.2.143_1 © 2016 Intellect Ltd. This is an author produced version of a paper published in International Journal of Francophone Studies. Uploaded in accordance with the publisher's self-archiving policy. Reuse Unless indicated otherwise, fulltext items are protected by copyright with all rights reserved. The copyright exception in section 29 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 allows the making of a single copy solely for the purpose of non-commercial research or private study within the limits of fair dealing. The publisher or other rights-holder may allow further reproduction and re-use of this version - refer to the White Rose Research Online record for this item. Where records identify the publisher as the copyright holder, users can verify any specific terms of use on the publisher’s website. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. [email protected] https://eprints.whiterose.ac.uk/ 1 Mali: vive la Coloniale? Rachel E. Utley, University of Leeds School of History, University of Leeds, Leeds, LS2 9JT. [email protected] Rachel Utley is a Lecturer in International History in the School of History, University of Leeds (UK). -

Forces Spéciales : Opérations Selon Le Droit De La Guerre
Forces spéciales : opérations selon le droit de la guerre Les forces spéciales remplissent, en uniforme, des missions que l’Etat peut revendiquer. Effectuées en toute discrétion pour des raisons opérationnelles et de sécurité, ces dernières ne sont pas « secrètes ». Leur commandant, le vice-amiral Laurent Isnard, l’a souligné devant la presse, le 22 juin 2017 à Paris, à l’occasion de leur 25ème anniversaire. Evolution des missions. Intégrateur de forces, le Commandement des opérations spéciales (COS) compte une centaine de personnes. Mais son vivier totalise près de 4.000 opérateurs et 400 réservistes, répartis dans 13 unités spéciales dépendant des armées (Terre, Air et Marine nationale), directions et services. Ces composantes se chargent du recrutement, de la formation et de la mise à disposition du matériel adapté. Le COS y prélève des effectifs en fonction de la mission et des objectifs à atteindre. Des actions commandos dans les Balkans au début, le COS est passé aux opérations plus longues, en interarmées et interalliées, en Afghanistan. Puis, dans les pays d’Afrique, il lui a fallu comprendre la situation sur place, en vue d’une appréciation nationale, lancer un engagement avec un partenaire local et l’accompagner jusqu’à ce qu’il puisse réaliser la mission seul. Pendant l’opération « Barkhane » (Sahel), le COS lutte contre le terrorisme et partage les moyens (hélicoptères notamment) avec les troupes conventionnelles, dans le cadre d’un dialogue permanent avec le Centre de planification et de conduite des opérations à Paris. Pour l’opération « Chammal » (Irak), les forces spéciales françaises ne pratiquent pas le « ciblage » de combattants, précise l’amiral Isnard. -

Note N°04/13
note n°04/13 Yves Boyer Deputy Director, Fondation pour la Recherche Stratégique and Professor, Ecole polytechnique French defence policy in a time of uncertainties (January 2013) This note was originally published in Fokus, Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik, 5/2012 Besides the United States the EU is the only of the UN’s regular budget, for a significant grouping of nations able to project its influence amount of UN peacekeeping operations, and one worldwide. Despite the current crisis, the EU -half of all UN member states’ contributions to remains a global economic superpower with the UN funds and programs. EU member states are highest GNP worldwide when the various GNP also signatories to almost all international trea- of its members are combined. In the foreseeable ties currently in force. In the last two decades, future this situation will be preserved, allowing the EU has finalized the single market; estab- the Union to generate financial surpluses which lished a single currency; created a zone without can be used to back its policy of global influence internal frontiers (“Schengen”); launched com- based on diverse forms of “civilian” power with a mon defense, foreign and internal security poli- central position in various international net- cies; and expanded from twelve to 27 members. works and a significant role in international These are very positive developments in a global- institutions. Indeed, the EU is the single largest ised world where cooperation in trade, social de- financial contributor to the UN system: at the velopment, environment preservation, etc. are end of the 2010 decade the EU provided for 38% the dominant value. -

Humanitarian Diplomacy and International Crisis Management
PROGRAM Humanitarian Diplomacy and International Crisis Management INTERNATIONAL CONFERENCE ORDER OF MALTA UNESCO - 27TH – 28TH JANUARY 2011 PARTNER HUMANITARIAN DIPLOMACY AND INTERNATIONAL CRISIS MANAGEMENT Even if the development of relationships between NGOs, diplomats, civilians and military forces is not new, the recent concepts of “duty to interfere” and “responsibility to protect” have paved the way for what is now called “humanitarian diplomacy”. Since military operations took place in Iraq, Afghanistan, Darfur and Sahel, crisis resolution has been constantly evolving and now largely affects the relationships between military forces, diplomats and non- governmental organizations on the scene of action. As a matter of fact, the involvement of humanitarian organizations, medias, large multinational companies, private security fi rms and non-state actors on a regular basis raises the issue of having the various, State and non-State actors cohabitate, co-operate and integrate in the theatre, often with incompatible objectives. Many tasks assigned to military forces, peace enforcement tasks, humanitarian assistance, and “nation building” are now increasingly contradictory and civil populations living in affected countries are the fi rst victims of such situations, along with humanitarian workers. The challenges our world is facing, local and international armed confl icts, major pandemics, violations of human rights, major migratory movements, corruption fi ghting, terrorism and the various forms of criminality, as well as natural and man-made disasters, can no longer be met at diplomatic level only. This is why a number of Western countries have been trying to fi nd solutions implementing political, military and humanitarian strategies and increasingly delegating their powers, together with signifi cant fi nancial assets, to multilateral organizations and international NGOs, thus actually tasking humanitarian actors. -

Crossing the Wilderness
REPORT — SPRING 2021 Crossing the wilderness Europe and the Sahel This report is part of Friends of Europe’s Peace, Security and Defence programme. Written by Paul Taylor, it brings together the views of scholars, policymakers and senior defence and security stakeholders. Unless otherwise indicated, this report reflects the writer’s understanding of the views expressed by the interviewees and participants of survey. The author and the participants contributed in their personal capacities, and their views do not necessarily reflect those of the institutions they represent, or of Friends of Europe and its board of trustees, members or partners. Reproduction in whole or in part is permitted, provided that full credit is given to Friends of Europe and that any such reproduction, whether in whole or in part, is not sold unless incorporated in other works. The Peace, Security and Defence programme is supported by the United States government. This report is produced in partnership with Publisher: Geert Cami Author: Paul Taylor Publication Director: Dharmendra Kanani Programme Manager: Elena Saenz-Feehan Programme Executive: Alex O’Mahony Programme Assistant: Krystal Gaillard Editors: Anna Muizniece, Angela Pauly, Teresa Carvalho & Daniel Pietikainen Design: Matjaž Krmelj © Friends of Europe - April 2021 Table of contents Foreword 6 Methodology and Acknowledgments 10 Executive summary 14 No promised land 14 Crisis of legitimacy 16 Instability and intervention 17 Containment, not victory 18 No proxy war, french lead 20 Widening coalitions, endless -
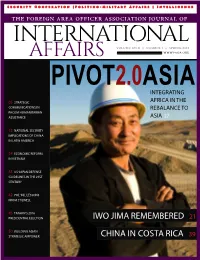
International VOLUME XVIII // NUMBER 1 // SPRING 2015 Affairs PIVOT2.0ASIA INTEGRATING
Security Cooperation |Politico-Military Affairs | Intelligence the foreign area officer association journal of INTERNATIONAL VOLUME XVIII // NUMBER 1 // SPRING 2015 AFFAIRS WWW.FAOA.ORG PIVOT2.0ASIA INTEGRATING 05 STRATEGIC AFRICA IN THE COMMUNICATIONS IN REBALANCE TO PACOM HUMANITARIAN ASSISTANCE ASIA 27 12 NATIONAL SECURITY IMPLICATIONS OF CHINA IN LATIN AMERICA 24 ECONOMIC REFORM IN VIETNAM 35 US-JAPAN DEFENSE GUIDELINES IN THE 21ST CENTURY 42 POL-MIL LESSONS FROM STILWELL 45 TAIWAN’S 2016 PRESIDENTIAL ELECTION IWO JIMA REMEMBERED 21 50 BUILDING ASIAN STRATEGIC AIRPOWER CHINA IN COSTA RICA 39 ISSN 1551-8094 The Foreign Area Officer Association Journal of SAVE THE DATE International Affairs is a non-profit publication for Regional and International Affairs professionals. 15-30 August | Election for the 2015-2018 FAO Association Board of Gov- The views expressed are those of the authors, not ernors - 12 members have been self-nominated for 9 positions, including of the Department of Defense, the Armed services 6 current Board members. A list of nominees, with short bio sketches for or any DoD agency, and are intended to advance each, will be published online and by email. Watch for email and website the profession through professional and academic dialog. announcements for voting procedures. SUBSCRIPTIONS & MEMBERSHIPS 22 October | FAOA Black Tie Dinner, featuring Lt. Gen. (ret.) Keith W. Subscription to the journal comes with member- Dayton, Director, George C. Marshall European Center for Security Stud- ship in the association. Membership information ies - Registration will be made available through FAOA.org and email an- may be obtained online at FAOA.org noucements will be sent with details. -

DFT 3.2 ANG Tome 1
DFT 3.2 Tome 1 ANG (FT-03) Employment of Land Forces in Joint Operations Edition 2015 2 3 DFT 3.2 TOME 1 ANG (FT-03) Employment of Land Forces in Joint Operations “Ground action will remain the decisive factor, and the role of the Army of the utmost importance: in future, as now, wars will be won on the ground. Operation Serval underscored the need to be prepared to act immediately and fight during our very deployment. Our action on the ground will aim to achieve an optimal footprint, in terms of both size and time-scale. Responsiveness, versatility and mobility will be the key assets of our land forces.” Admiral Edouard Guillaud, Joint Chief of Staff At the National Assembly Symposium of the Forces Employment Doctrine Center (CDEF) 4 December, 2013 2 DFT 3.2 TOME 1 ANG (FT- 03) - EMPLOYMENT OF LAND FORCES IN JOINT OPERATIONS SUMMARY OF AMENDMENTS 1. This table lists all of the amendments readers have suggested and sent to the CDEF, regardless of their location or ranking. 2. Amendments validated by the CDEF are written in red in the table below, in chronological order of when they were taken into account. 3. Those amendments taken into account appear in purple in the new version. 4. The serial number at the bottom of the cover page of the original is corrected (in bold, red Roman letters) and “amended day/month/ year” is added. 5. The digital copy of the amended text replaces the previous version in all databases. N° Amendment Author Last updated 1 Update of joint doctrine references CDEF 01/08/2014 2 Update of joint doctrine references CDEF 01/07/2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 DFT 3.2 TOME 1 ANG (FT- 03) - EMPLOYMENT OF LAND FORCES IN JOINT OPERATIONS FOREWORD Approved by the Army Chief of Staff1 on March 31, 2014, FT-03 is a “Capstone doctrine document” for the employment of land forces. -

Meridian Annual Report 2009
1 BOARD OF Chairman Governor James J. Blanchard Hon. James R. Jones TRUSTEES Partner and Chair Chief Executive Officer Government Affairs Practice Group Manatt Jones Global Strategies, LLC DLA Piper US, LLP Hon. Tom C. Korologos Ms. Sarah Alexander Strategic Advisor President DLA Piper US, LLP Emerging Markets Private Equity Association Mr. Philip C. Lauinger, Jr. Ms. Lisa Barry Chairman and CEO Vice President, Government Affairs Lauinger Publishing Co. Chevron Corporation Hon. Charles T. Manatt Mrs. Robert Bennett Co-Chairman U.S. Senate Spouse (R-UT) Manatt Jones Global Strategies, LLC Hon. Julia Chang Bloch Mrs. Howard “Buck” McKeon President U.S. Congressional Spouse (R-CA) US-China Education Trust Governor James J. Blanchard Mr. Tobia Mercuro Susan Blumenthal Markey, M.D. Former President Fmr. U.S. Assistant Surgeon General Riverton Investment Corporation Rear Admiral, USPHS (ret.) Mr. David Metzner Hon. Christopher Burnham Managing Partner Vice Chairman & Managing Director American Continental Group Deutsche Bank Asset Management Mr. F. Joseph Moravec Charles H. Camp, Esquire Principal Law Offices of Charles H. Camp F. Joseph Moravec, LLC Mr. Oliver Chanler Mr. Evan Morris Board of Directors Member VP, Federal Government Affairs and Genesee Valley Conservancy Public Policy Roche Pharmaceuticals Mrs. Meryl Chertoff Co-Director Ms. Lisa Nelson Justice & Society Program Head of Global Government Relations Aspen Institute Visa Inc. Mr. Jim Clifton Ms. Mary O’Connor Chairman & CEO Director of Outreach Gallup Center for the Study of the Presidency and Congress Ms. Josephine Cooper Group VP, Government & Industry Mr. Nels Olson Toyota Motor North America Managing Director, Eastern Region Korn/Ferry International Mrs. -

2011 Honorary Awards
Honorary awards The Queen has been graciously pleased to approve the following honorary British awards in 2014: THE MOST DISTINGUISHED ORDER OF ST MICHAEL AND ST GEORGE DCMG Ms Angelina JOLIE For services to UK foreign policy and the campaign to end warzone sexual violence CMG Mrs Despina ZERNIOTI For services to UK/Greek relations and to the Order of St Michael and St George THE MOST EXCELLENT ORDER OF THE BRITISH EMPIRE (Civil Division) GBE Mr Ratan Naval TATA, KBE For services to UK/India relations, inward investment to the UK and philanthropy KBE Mr Michael Rubens BLOOMBERG For services to UK/US relations and to philanthropic causes Mr Mohammed Abdullatif JAMEEL For services to philanthropy in the UK Mr John Franklyn MARS For services to British business and the economy Mr Haruo NAITO For services to Japanese investment in the UK and to Anglo-Japanese relations CBE Professor Heesun CHUNG For services to promoting British education in South Korea Mr Michael Ilan Yoel FEDERMANN For services to UK/Israel business cooperation and UK prosperity Mr Tadakazu KIMURA For services to international sponsorship and Anglo-Japanese cultural understanding Mr Alain Jacques Richard MINC For services UK/French relations Mrs Dervilla Mary MITCHELL For services to engineering Mr Yahya Mohammed NASIB For services to UK commercial interests in Oman Mr Eli PAPOUCHADO For services to UK/Israel business cooperation and British prosperity Mr Gennady Nikolayevitch ROZHDESTVENSKY For services to music Mr Jose Ignacio SANCHEZ GALAN For services to the UK energy sector and UK/Spain trade and investment links Mr Dong-bin SHIN For services to British prosperity OBE Professor Mohammad Kazem M.