Programme De Salle
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Virtual Edition in Honor of the 74Th Festival
ARA GUZELIMIAN artistic director 0611-142020* Save-the-Dates 75th Festival June 10-13, 2021 JOHN ADAMS music director “Ojai, 76th Festival June 9-12, 2022 a Musical AMOC music director Virtual Edition th Utopia. – New York Times *in honor of the 74 Festival OjaiFestival.org 805 646 2053 @ojaifestivals Welcome to the To mark the 74th Festival and honor its spirit, we bring to you this keepsake program book as our thanks for your steadfast support, a gift from the Ojai Music Festival Board of Directors. Contents Thursday, June 11 PAGE PAGE 2 Message from the Chairman 8 Concert 4 Virtual Festival Schedule 5 Matthias Pintscher, Music Director Bio Friday, June 12 Music Director Roster PAGE 12 Ojai Dawns 6 The Art of Transitions by Thomas May 16 Concert 47 Festival: Future Forward by Ara Guzelimian 20 Concert 48 2019-20 Annual Giving Contributors 51 BRAVO Education & Community Programs Saturday, June 13 52 Staff & Production PAGE 24 Ojai Dawns 28 Concert 32 Concert Sunday, June 14 PAGE 36 Concert 40 Concert 44 Concert for Ojai Cover art: Mimi Archie 74 TH OJAI MUSIC FESTIVAL | VIRTUAL EDITION PROGRAM 2020 | 1 A Message from the Chairman of the Board VISION STATEMENT Transcendent and immersive musical experiences that spark joy, challenge the mind, and ignite the spirit. Welcome to the 74th Ojai Music Festival, virtual edition. Never could we daily playlists that highlight the 2020 repertoire. Our hope is, in this very modest way, to honor the spirit of the 74th have predicted how altered this moment would be for each and every MISSION STATEMENT Ojai Music Festival, to pay tribute to those who imagined what might have been, and to thank you for being unwavering one of us. -

Machine Musicianship This Page Intentionally Left Blank Machine Musicianship Robert Rowe
Machine Musicianship This Page Intentionally Left Blank Machine Musicianship Robert Rowe The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England 2001 Massachusetts Institute of Technology All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and re- trieval) without permission in writing from the publisher. This book was set in Melior by Achorn Graphic Services, Inc., and was printed and bound in the United States of America. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Rowe, Robert. Machine musicianship / Robert Rowe. p. cm. Includes bibliographical references and index. Contents: Machine musicianshipÐSymbolic processesÐSub-symbolic processesÐ Segments and patternsÐCompositional techniquesÐAlgorithmic expression and music cognitionÐInteractive improvisationÐInteractive multimediaÐInstallationsÐDirec- tions. ISBN 0-262-18206-8 (hc. : alk. paper) 1. Arti®cial intelligenceÐMusical applications. 2. MusicÐComputer programs. 3. Real-time programming. 4. Computer composition. I. Title. ML74.R68 2001 780′.285Ðdc21 00-038699 Contents Acknowledgments ix 1 Machine Musicianship 1 1.1 The Motivation for Machine Musicianship 3 1.2 Algorithmic Composition 6 1.3 Algorithmic Analysis 8 1.4 Structure of the Text 12 1.5 Machine Musicianship Library 14 2 Symbolic Processes 17 2.1 Chord Theory 18 2.1.1 Triad Classi®er 19 2.1.2 Representations 28 2.1.3 MIDI Chord Recognizer 33 2.1.4 Chord Spelling 42 2.2 Context Sensitivity 46 2.2.1 Virtual -

Machine Musicianship This Page Intentionally Left Blank Machine Musicianship Robert Rowe
Machine Musicianship This Page Intentionally Left Blank Machine Musicianship Robert Rowe The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England 2001 Massachusetts Institute of Technology All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and re- trieval) without permission in writing from the publisher. This book was set in Melior by Achorn Graphic Services, Inc., and was printed and bound in the United States of America. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Rowe, Robert. Machine musicianship / Robert Rowe. p. cm. Includes bibliographical references and index. Contents: Machine musicianshipÐSymbolic processesÐSub-symbolic processesÐ Segments and patternsÐCompositional techniquesÐAlgorithmic expression and music cognitionÐInteractive improvisationÐInteractive multimediaÐInstallationsÐDirec- tions. ISBN 0-262-18206-8 (hc. : alk. paper) 1. Arti®cial intelligenceÐMusical applications. 2. MusicÐComputer programs. 3. Real-time programming. 4. Computer composition. I. Title. ML74.R68 2001 780′.285Ðdc21 00-038699 Contents Acknowledgments ix 1 Machine Musicianship 1 1.1 The Motivation for Machine Musicianship 3 1.2 Algorithmic Composition 6 1.3 Algorithmic Analysis 8 1.4 Structure of the Text 12 1.5 Machine Musicianship Library 14 2 Symbolic Processes 17 2.1 Chord Theory 18 2.1.1 Triad Classi®er 19 2.1.2 Representations 28 2.1.3 MIDI Chord Recognizer 33 2.1.4 Chord Spelling 42 2.2 Context Sensitivity 46 2.2.1 Virtual -
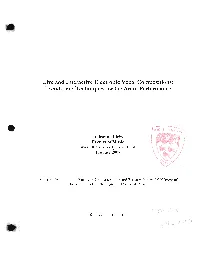
Live and Interactive Electronic Vocal Compositions: Trends and Techniques for the Art of Performance
Live and Interactive Electronic Vocal Compositions: Trends and Techniques for the Art of Performance • Julieanne Klein F acuIty of Music McGill University, Montreal January 2007 A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Music. r © Julieanne Klein 2007 • Abstract This thesis deals with technological, compositional and performance-practice aspects of computer-based live and interactive electronic vocal music. Live performance-based electronic music indicates a composition by which the vocal, instrumental and/or electronic sounds are processed in real time. By surveying historical developments, technological advances, aesthetics, and important figures, this document intends to assist singers in gaining a global perspective of the field in hopes of facilitating interest in the performing and commissioning of live electronic vocal compositions. An important element of this thesis is an annotated appendix of computer-based live and interactive electronic vocal music detailing instrumentation, technical requirements, texts, performance notes and publisher contact information. In order to assist in the study and performance of these works, relevant performance issues are explored, and a methodology and step-by-step checklist for learning contemporary and electronic vocal music is included. An analysis of three vocal works in this genre is presented: En Écho by Philippe Manoury, Erba nera che cresci segno nero tu l!il!i by Mauro Lanza, and a new work commissioned especially for this study, Avant la lawe by David Adamcyk. Cette thèse traite des aspects technologiques et compositionnels ainsi que de l'interprétation d'oeuvres pour voix et traitement électronique interactif en temps réel. -

Ambient Music the Complete Guide
Ambient music The Complete Guide PDF generated using the open source mwlib toolkit. See http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Mon, 05 Dec 2011 00:43:32 UTC Contents Articles Ambient music 1 Stylistic origins 9 20th-century classical music 9 Electronic music 17 Minimal music 39 Psychedelic rock 48 Krautrock 59 Space rock 64 New Age music 67 Typical instruments 71 Electronic musical instrument 71 Electroacoustic music 84 Folk instrument 90 Derivative forms 93 Ambient house 93 Lounge music 96 Chill-out music 99 Downtempo 101 Subgenres 103 Dark ambient 103 Drone music 105 Lowercase 115 Detroit techno 116 Fusion genres 122 Illbient 122 Psybient 124 Space music 128 Related topics and lists 138 List of ambient artists 138 List of electronic music genres 147 Furniture music 153 References Article Sources and Contributors 156 Image Sources, Licenses and Contributors 160 Article Licenses License 162 Ambient music 1 Ambient music Ambient music Stylistic origins Electronic art music Minimalist music [1] Drone music Psychedelic rock Krautrock Space rock Frippertronics Cultural origins Early 1970s, United Kingdom Typical instruments Electronic musical instruments, electroacoustic music instruments, and any other instruments or sounds (including world instruments) with electronic processing Mainstream Low popularity Derivative forms Ambient house – Ambient techno – Chillout – Downtempo – Trance – Intelligent dance Subgenres [1] Dark ambient – Drone music – Lowercase – Black ambient – Detroit techno – Shoegaze Fusion genres Ambient dub – Illbient – Psybient – Ambient industrial – Ambient house – Space music – Post-rock Other topics Ambient music artists – List of electronic music genres – Furniture music Ambient music is a musical genre that focuses largely on the timbral characteristics of sounds, often organized or performed to evoke an "atmospheric",[2] "visual"[3] or "unobtrusive" quality. -

Staatskapelle Berlin Daniel Barenboim Anne-Sophie Mutter
GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE Mardi 29 juin 2021 – 20h 2e Biennale Pierre Boulez Staatskapelle Berlin Daniel Barenboim Anne-Sophie Mutter Programme Pierre Boulez Initiale Ludwig van Beethoven Concerto pour violon Pierre Boulez Mémoriale Ludwig van Beethoven Symphonie no 5 Staatskapelle Berlin Daniel Barenboim, direction Anne-Sophie Mutter, violon Coproduction Piano****, Phiharmonie de Paris Dans le cadre de la 2e Biennale Pierre Boulez, en partenariat avec la Pierre Boulez Saal Berlin FIN DU CONCERT (SANS ENTRACTE) VERS 22H00. Les œuvres Pierre Boulez (1925-2016) Initiale pour septuor de cuivres Composition : 1987, révision en 2010. Commande de Dominique de Menil pour l’inauguration du musée de la Menil Collection à Houston Création : le 30 novembre 1986 au musée de la Menil Collection à Houston. Effectif : 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, tuba. Durée : environ 5 minutes. Parallèlement à ses œuvres les plus ambitieuses, Pierre Boulez a composé plusieurs pièces brèves pour répondre à des commandes : Pour le Dr Kalmus pour cinq instruments (1969), Initiale pour sept cuivres (1987), Incises pour piano (1995), Une page d’éphéméride pour piano (2005). Le cadre de la création d’Initiale (le musée de la Menil Collection à Houston tout juste inauguré) ne pouvait que séduire le compositeur : Renzo Piano était l’architecte de ce musée d’art contemporain, situé près de la Rothko Chapel commandée également par les collectionneurs Dominique et John de Menil. La division de l’effectif en deux groupes instrumentaux se prête à la spatialisation, bien qu’elle ne soit pas spécifiée dans la partition. La figure mélodique de la première page – un motif d’arpège ascendant, typiquement boulézien – sert de matrice à toute l’œuvre, où se succèdent de brèves sections différenciées par leur tempo, leur rythme, leur phrasé et leur écriture. -

Le Son Numérique: Une Acoustique Affranchie De
LE SON NUMÉRIQUE : UNE ACOUSTIQUE AFFRANCHIE DE LA MÉCANIQUE ? J. Risset To cite this version: J. Risset. LE SON NUMÉRIQUE : UNE ACOUSTIQUE AFFRANCHIE DE LA MÉ- CANIQUE ?. Journal de Physique IV Proceedings, EDP Sciences, 1992, 02 (C1), pp.C1-3-C1-11. 10.1051/jp4:1992101. jpa-00251043 HAL Id: jpa-00251043 https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00251043 Submitted on 1 Jan 1992 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. JOURNAL DE PHYSIQUE IV Colloque Cl, supplément au Journal de Physique III, Volume 2, avril 1992 LE SON NUM~QUE:UNE ACOUSTIQUE AFFRANCHIE DE LA MÉCANIQUE ? J.C.RISSET Laboratoire de Mécanique et d>Acoustique,31 Chemin Joseph Aiguier; F-13000 Marseille, France Abstract. Since 1875, there have been radical innovations in Our ways to deal with sound. Sounds could be recorded and converted into electrical vibrations and vice-versa. Electronics made radio and sound recording practical. A new era came about with the advent of digital recording, synthesis and processing of sound, pioneered in 1957 by Mathews. Sounds can now be coded arbitrarily and elaborated with unprecedented precision and flexibility, which seems to free acoustics from the constraints of mechanics. -
Copie De CC 18 Intérieur + P88 Modif.Indd
champs culturels virtualite art & culture n 12.2004 18 Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité Direction générale de l’enseignement et de la recherche J’ai repris, à la rentrée de septembre, l’animation du champs n 12.2004 18 réseau action culturelle du Ministère de l’Agriculture et la responsabilité de la rédaction de Champs < Culturels, revue semestrielle qui en est l’émanation. culturels Ce numéro intitulé « Virtualité, art et culture » s’appuie sur une session de formation organisée en janvier 2004 en partenariat avec l’ENESAD (Ecole "virtualité, art & culture" Nationale d’Enseignement Supérieur Agronomique p01 - EDITORIAL - La Villette numérique - Frédéric MAZELLI de Dijon) à la demande d’enseignants désireux d’approfondir leur réflexion sur ce sujet. La plupart des contributions ont été proposées par les interve- regards croisÇs nants et participants du stage et ce dossier tente de faire résonner en échos les analyses de chercheurs, p02 - La question du virtuel - Paul MATHIAS d’artistes, de pédagogues, d’acteurs culturels sur la problématique de la virtualité. p08 - Entre présence et absence - Jean-Louis WEISSBERG Oscillant entre fascination et inquiétude face à ces mondes virtuels qui nous échappent, nous sommes p14 - La pratique du jeu vidéo : expériences de à la recherche de propos rationnels pouvant éclairer «réalité virtuelle» - Mélanie ROUSTAN notre point de vue. Bouleversant notre relation au temps et à l’espace, p18 - Feux croisés sur la pratique des jeux vidéo notre perception du réel, ouvrant des perspectives Vincent LEPLEY nouvelles à la création (composition musicale, arts visuels, théâtre, danse…), focalisant les jeunes de p21 - Une critique à inventer - Olivier SEGURET plus en plus tôt devant les consoles de jeux et les écrans d’ordinateurs, les outils virtuels nous plon- p25 - Des souris et des jeunes - Manuel COLOMBAT gent dans un abîme vertigineux et nous renvoient le reflet de notre propre perplexité. -

JP Thesis September 09
The Extended Flautist: Techniques, Technologies and Performer Perceptions in Music for Flute and Electronics Author Penny, Margaret Jean Published 2009 Thesis Type Thesis (Professional Doctorate) School Queensland Conservatorium of Music DOI https://doi.org/10.25904/1912/3188 Copyright Statement The author owns the copyright in this thesis, unless stated otherwise. Downloaded from http://hdl.handle.net/10072/366551 Griffith Research Online https://research-repository.griffith.edu.au THE EXTENDED FLAUTIST: Techniques, technologies and performer perceptions in music for flute and electronics Jean Penny Bachelor of Music (Instrumental performance, Honours), University of Melbourne Queensland Conservatorium Griffith University A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Musical Arts (Performance) May 2009 The Extended Flautist KEYWORDS Breath tone, Burt, electronics, contemporary music performance, extended techniques, flute, Hajdu, identity, interactive live electronics, Lavista, meta- instrument, micro-sounds, Musgrave, performance, performance analysis, performance practice, performance space, physicality, Pinkston, Risset, Saariaho, Stroppa, self-perception, sonority, sound technologist, spatialisation, technology. i The Extended Flautist ABSTRACT As musical and performance practices have evolved over the last half-century, the realm of the solo flautist has expanded to encompass an extensive array of emerging techniques and technologies. This research examines the impact -

Transcript (PDF)
Music at MIT Oral History Project Barry Vercoe Interviewed by Forrest Larson with Mark Ethier August 19, 2011 Interview no. 1 Massachusetts Institute of Technology Lewis Music Library Transcribed by MIT Academic Media Services and 3Play Media. Cambridge, MA Transcript Proof Reader: Lois Beattie, Jennifer Peterson Transcript Editor: Forrest Larson ©2013 Massachusetts Institute of Technology Lewis Music Library, Cambridge, MA ii Table of Contents 1. Family and early musical background (00:16) ..............................................1 Father, jazz musician—playing saxophone –playing cornet in brass band—dance band at university—early composing and arranging— family musicians—Elizabeth Vercoe, composer & pianist— Andrea Vercoe, violinist— Scott Vercoe, jazz pianist and film score composer. 2. Formative Musical Experiences (10:46) ........................................................4 singing in church choirs—cathedral choir while at university—interest in Renaissance choral music—Vercoe’s“On Eastnor Knoll”—University of Aukland—mathematics and music degrees—Peter Godfrey—Roger Tremain 3. Graduate study in composition at University of Michigan (18:48) ...............7 teaching fellowship—notable qualities of the music department—studies with Ross Lee Finney—George Wilson—Leslie Bassett--Alban Berg and Arnold Schoenberg— chromaticism and 12-tonetechnique—Anton Webern 4. Encountering analog electronic music (24:40) ..............................................9 Beginnings of the University of Michigan electronic music studio--Mario Davidovsky— disillusionment with analog sound synthesis —Davidovsky’s Synchronisms—music and mathematics--serialism—Anton Webern 5. Early years of computer music research and development (34:38) .............12 Initial work with computer music --Oberlin Conservatory—post doctoral studies at Princeton University— John Clough—Max Mathews—Bell Telephone Laboratories, acoustics research-- MUSIC IV —Milton Babbitt—Godfrey Winham—Ken Stieglitz— digital filter design--MUSIC 360—GROOVE 6. -

Table of Contents
Town The copyright of this thesis rests with the University of Cape Town. No quotation from it or information derivedCape from it is to be published without full acknowledgement of theof source. The thesis is to be used for private study or non-commercial research purposes only. University A STUDY AND CATALOGUE OF FRENCH FLUTE MUSIC WRITTEN BETWEEN 1945 AND 2008 Town LIESL STOLTZ SUPERVISOR: PROF.Cape JAMES MAY of University Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctorate in Music by performance and thesis in the faculty of humanities, University of Cape Town February 2010 DECLARATION I, the understated, hereby declare that this dissertation is my own work. It is being submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctorate of Music at the University of Cape Town and has not been previously submitted for a degree at any other institution. Town Cape of University Liesl Stoltz Cape Town, 2 February, 2010 i TO MY GRANNY Town OUMA JACOBA JANSE VAN RENSBURG Cape of University ii ACKNOWLEDGEMENTS Upon completion of this work, I would like to thank the following people and institutions: Prof. James May, my supervisor, for his patience, time, guidance and the sharing of his incredible knowledge; My parents and sister, Christélle, who is always there for me and without whom this thesis would not have been completed; Wilhelm, my husband, for his love and support and for accepting the inevitable; Eva Tamassy, my first flute teacher, for always believing in me; Pierre-Yves Artaud, for his role -

Jean-Claude Risset Laboratoire De Mécanique Et D'acoustique, CNRS, Marseille [email protected]
Jean-Claude Risset Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, CNRS, Marseille [email protected] COMPUTER MUSIC: WHY? Introduction One of my early desires as a musician was to sculpt and organize directly the sound material, so as to extend compositional control to the sonic level - to compose the sound itself, instead of merely composing with sounds. My use of the computer has focused mostly on this goal. I have been able to fullfill this desire to some extent by resorting to digital synthesis and also digital processing of sound. As I shall explain, I had to perform exploration and research to use the computer musically. The computer: why and how? My first pieces did not involve the electronic technology, and today I still compose works for the voice, the instruments and the orchestra: but I have spent much time exploring the possibilities of the computer for musical creation, mostly for the compositional elaboration of sound material. I had an early and vivid interest for timbre. However, in the early sixties, I was not attracted to either musique concrète - based on the editing of recorded sound objects - or electronic music - built up from electronically produced sound material. To put things simply, I found that although musique concrète was opening the scope of musical sounds, it did not provide to the composer with the refined compositional control he could exert when writing instrumental music. Musique concrète offers a rich variety of powerful sounds: however the possibilities of transforming those sounds are rudimentary in comparison, so that it is hard to avoid an aesthetics of collage.