Ladjal These
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Journal Officiel Algérie
N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets
No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

Chronologie Des Massacres En Algérie (1994 - 2004)
Chronologie des massacres en Algérie (1994 - 2004) Salah-Eddine Sidhoum, Algeria-Watch, 2005 Cette chronologie a été réalisée sur la base d'informations rapportées par la presse nationale et internationale, des agences de presse internationales et de témoignages recueillis par l'auteur. Les informations contenues dans cette liste ne sont ni complètes ni prouvées étant donné que les sources elles-mêmes ne sont pas infaillibles. Les médias algériens sont soumis à un contrôle strict, ce qui était particulièrement contraignant entre 1994 et 1999. Nous lançons un appel pour compléter ou corriger ces données et rappelons que seules des enquêtes impartiales et indépendantes permettront d'établir ces faits particulièrement douloureux. 1994 15 janvier : Ratissage à l'Arbaa (Blida). 11 citoyens sont arrêtés. Leurs cadavres criblés de balles seront retrouvés le lendemain, à proximité de leurs domiciles. Du 18 au 22 mars : 25 cadavres de citoyens arrêtés lors de ratissages sont retrouvés à Médéa et Berrouaghia et 19 autres à Cherarba et les Eucalyptus. 19 mars : Les cadavres de 20 citoyens sont retrouvés dans les rues de Ouled El Fodda. Selon le témoignage de leurs familles aux organisations internationales des droits de l'homme, ils auraient été arrêtés lors de rafles militaires. 20 mars 1994. 14 cadavres sont retrouvés dans les rues de Blida. Ils avaient été arrêtés la veille, selon le témoignage de leurs familles par des parachutistes, en représailles à la mort de six policiers. 29 avril : 65 fidèles sont enlevés de la Mosquée de Taoughrit (Ténès) par des hommes en tenue militaire et circulant à bord de véhicules militaires selon le témoignage de leurs familles. -

Aba Nombre Circonscriptions Électoralcs Et Composition En Communes De Siéges & Pourvoir
25ame ANNEE. — N° 44 Mercredi 29 octobre 1986 Ay\j SI AS gal ABAN bic SeMo, ObVel , - TUNIGIE ABONNEMENT ANNUEL ‘ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL Abonnements et publicité : Edition originale .. .. .. .. .. 100 D.A. 150 DA. Edition originale IMPRIMERIE OFFICIELLE et satraduction........ .. 200 D.A. 300 DA. 7 9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER (frais d'expédition | tg}, ; 65-18-15 a 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER en sus) Edition originale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années antérleures : suivant baréme. Les tables sont fourntes gratul »ment aux abonnés. Priére dé joindre les derniéres bandes . pour renouveliement et réclamation. Changement d'adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANGAISE) SOMMAIRE DECRETS des ceuvres sociales au ministére de fa protection sociale, p. 1230. Décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux siéges & pourvoir pour l’élection a l’Assemblée fonctions du directeur des constructions au populaire nationale, p. 1217. , ministére de la formation professionnelle et du travail, p. 1230. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général da la planification Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux et de. la gestion industrielle au ministére de fonctions du directeur de la sécurité sociale et lindustrie lourde,.p. -

Les Massacres En Algérie, 1992-2004
Comité Justice pour l'Algérie Les massacres en Algérie, 1992-2004 Dossier n° 2 Salima Mellah Mai 2004 1 Table Résumé.......................................................................................................................................4 Introduction ..............................................................................................................................6 II. Les massacres dans le temps...............................................................................................9 1992-1993 : violences ciblées................................................................................................9 1994-1995 : la terreur et l’horreur s’installent.....................................................................11 Forces régulières ............................................................................................................12 Escadrons de la mort ......................................................................................................13 Les groupes armés islamistes..........................................................................................14 Les milices anti-islamistes ..............................................................................................16 1995-1996 : l’armée prend le dessus, avec l’aide des GIA, et les massacres s’intensifient..................................................................................................................................18 Les « grands massacres » de l’été 1997...............................................................................20 -

BERROUAGHIA « NON Au 19 Mars »
INFO 755 BERROUAGHIA « NON au 19 mars » BERROUAGHIA Cette commune est située dans la région du Tell, au Nord-ouest de MEDEA, et à environ 95 km au Sud-ouest d'ALGER. Climat méditerranéen avec été chaud. Culminant à 930 mètres d’altitude, sur la chaine de l’Atlas Tellien, dans une cuvette bordée à l’Est par la chaîne des Bibans et à l’Ouest par l’Ouarsenis, BERROUAGHIA est alimentée par deux importants oueds, le CHELIF à l’Ouest et l’Oued ISSER à l’Est, située sur la route d’ALGER à LAGHOUAT, à 32 km au Sud de MEDEA, dont elle est séparée par le col de BEN-CHICAO, et à 44 km au Nord de BOGHARI. -BERROUAGHIA battue par les vents, subit le Siroco du Sud toute l’année, les assauts du froid et de la neige en hiver, et reçoit une brise légèrement iodée en été. -BERROUAGHIA est un nom arabe désignant l'asphodèle (berrouagh). -BERROUAGHIA est donc le village des asphodèles. HISTOIRE A l'époque Romaine, BERROUAGHIA était un petit bourg berbère du nom de THANARAMUSA. Ce bourg se trouvait sur une double situation stratégique Route/Frontière (Limes). Cette double situation amena les Empereurs romains à s'intéresser de plus près à ces bourgs. C'est ainsi, qu'entre l'an 122 et 124, l'un d'entre eux renforça le bourg de THANARAMUSA par un camp de soldats vétérans. Celle-ci prit le nom de THANARAMUSA-CASTRA. Présence turque 1515 - 1830 En 1517, AROUDJ BARBEROUSSE s'empare de la ville, de la vallée du Chelif et de MEDEA. -

Travel Narratives and Life-Writing Travel Narratives and Life-Writing
LHJ 2020 Travel Narratives and Life-Writing and Travel Narratives Travel Narratives and Life-Writing LINCOLN U N I V E R S I T Y Fall 2020 | Volume 8 LHJ LHJ V The Lincoln Humanities Journal olume 8 The Lincoln Humanities Journal Abbes Maazaoui, Editor Fall 2020 Volume 8 LHJ The Lincoln Humanities Journal Fall 2020 | Volume 8 Travel Narratives and Life-Writing Abbes Maazaoui, Editor Annual publication of Lincoln University of Pennsylvania All rights reserved ISSN 2474-7726 Copyright © 2020 by the Lincoln Humanities Journal The Lincoln Humanities Journal (LHJ) The Lincoln Humanities Journal, ISSN 2474-7726 (print), ISSN 2474-7726 (online), is an interdisciplinary double blind peer-reviewed journal published once a year by Lincoln University of Pennsylvania. Its main objective is to promote interdisciplinary studies by providing an intellectual platform for international scholars to exchange ideas and perspectives. Each volume is focused on a pre-selected theme in the fields of arts, humanities, the social sciences, and contemporary culture. Preference is given to topics of general interest that lend themselves to an interdisciplinary approach. Manuscripts should conform to the MLA style. Submissions may be made by e-mail to the editor at [email protected]. The preferred language is English. The journal is published both online and in print, in November-December of each year. The Lincoln Humanities Journal Fall 2020 | Volume 8 Editor ABBES MAAZAOUI Lincoln University Editorial Board J. KENNETH VAN DOVER Fulbright Scholar ERIK LIDDELL Eastern Kentucky University KIRSTEN C. KUNKLE Co-Founder and Artistic Director, Wilmington Concert Opera HÉDI JAOUAD Professor Emeritus, Skidmore College EZRA S. -

Décret Exécutif N° 12-428 Du 16 Décembre 2012 Portant Déclaration
9 Safar 1434 7 23 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 DECRETS Décret exécutif n° 12-428 du 2 Safar 1434 Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 16 décembre 2012 portant correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; déclaration d’utilité publique les opérations de réalisation des projets entrant dans le cadre de la Vu le décret présidentiel n°12-325 du 16 Chaoual 1433 production, du transport et de la distribution de correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du l’électricité et du gaz. Premier ministre ; ———— Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 Le Premier ministre, correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret exécutif n°93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 n°91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles (alinéa 2) ; relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Après approbation du Président de la République ; complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Décrète : les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Article 1er. – En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°91-11du 27 avril 1991, et conformément Vu la loi n°98-04 du 20 Safar 1419 correspondant -
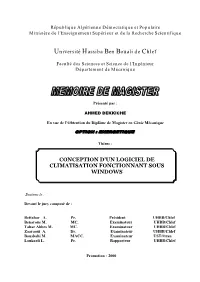
Université Hassiba Ben Bouali De Chlef CONCEPTION D'un
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Hassiba Ben Bouali de Chlef Faculté des Sciences et Science de l’Ingénieur Département de Mécanique Présenté par : AHMED DEKKICHE En vue de l’Obtention du Diplôme de Magister en Génie Mécanique Thème : CONCEPTION D’UN LOGICIEL DE CLIMATISATION FONCTIONNANT SOUS WINDOWS Soutenu le : Devant le jury composé de : Bettahar A. Pr. Président UHBB/Chlef Benarous M. MC. Examinateur UHBB/Chlef Tahar Abbes M. MC. Examinateur UHBB/Chlef Zaaraoui A. Dr. Examinateur UHBB/Chlef Bousbahi M. MACC. Examinateur UST/Oran Loukarfi L. Pr. Rapporteur UHBB/Chlef Promotion : 2000 :ǎƼǴǷ ƨȇȂƬnjdzơƨȇǁơǂūơƨǴȈǐūơƣƢLjŞƶǸLjȇȅǀdzơƔơȂŮơǦȈǰƬdzļƢǷȂǴǠǷƲǷƢǻǂƥǃƢųƛĿƨLJơǁƾdzơǽǀǿDzưǸƬƫ ,ƤƫƢǰǷ ,ňƢǰLJ )ŘƦǷǦȈǰƬdzƨȇǁȁǂǔdzơƔơȂŮơƩƢǬǧƾƫǦǴƬűƾȇƾƸƬƥǵȂǬȇƢǸǯƢȀǨȈǰƫƽơǂŭơǥǂǤǴdzƨȈǨȈǐdzơȁ ǦǴƬƼŭƨȈǻƢȈƦdzơƩƢǘǘƼŭơǶLJǂƥƶǸLjȇƢǸǯ .řǗȂdzơ ƣơǂƬdzơǺǷƨǘǬǻȅƗĿǞǫơȁ ( . .ƾƴLjǷ ,ǁƢǘǷ ,ȄǨnjƬLjǷ .ǹƢǰŭơơǀđƨǏƢŬơƩƢǷȂǴǠŭơǞȈŦǁƢƦƬǟȏơśǠƥƢǼȇǀƻƗǦȈǰŭơDŽȈƸǴdzƨȇǁơǂūơƩƢƥƢLjƬǯȋơ Résumé : Dans cette étude nous avons essayé de développer un logiciel de climatisation qui permettra de calculer les bilans thermiques hivernal et estival pour les locaux à climatiser et de déterminer les différents débits d'air qui entrent en jeu dans l'installation de climatisation d'un bâtiment (habitation, bureaux, hôpital, aéroport, mosquée…) à n'importe quel endroit de notre pays et de tracer l'évolution des différents apports thermiques des locaux climatisés en fonction de toutes les informations dont on dispose concernant ce lieu. Abstract -

Journal Officiel
N° 47 Mercredi 19 Dhou El Kaada 1434 52ème ANNEE Correspondant au 25 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION Algérie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL Tunisie (Pays autres DU GOUVERNEMENT ABONNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye WWW. JORADP. DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale….........….........…… 1070,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d'expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG sus) ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 Dhou El Kaada 1434 2 25 septembre 2013 S O M M A I R E DECRETS Décret exécutif n° 13-319 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l'agriculture et du développement rural...................................................... -

Actions Climatiques (Neige Et Vent) Et Des Surcharges De Sable En Zones Sahariennes
Chapitre 1 : Généralité et nécessité de la réglementation CHAPITRE 1 : Généralité et nécessité de la réglementation 1. Définitions 1.1.Normalisation Établissement et mise en application d’un ensemble de règles et de spécifications visant à simplifier, unifier et rationaliser les produits industriels, les activités d’un secteur, les unités de mesure, les symboles,… Processus animé dans un organisme national ou international indépendant des industriels. 1.2.Certification Procédure volontaire par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit ou un service est conforme à des exigences spécifiées dans un référentiel. • Certification de systèmes • Certification de produits • Certification d’essai Enjeu de la certification • Garantir : la qualité, la sécurité, l’aptitude a l’usage et la conformité aux normes, à des critères écologiques et à des critères d’origine géographique. • Permettre l’identification fiable du produit, des services, des personnes,… • Instaurer un lien de confiance entre fournisseur et utilisateur. 1.3.Accréditation Procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu'un organisme ou un individu est compétente pour effectuer des tâches spécifiques 1.4.Norme Une spécification technique établi par consensus et approuvé par un organisme de normalisation reconnu pour des usages communs et répétés. C’est un document qui donne des 1 Chapitre 1 : Généralité et nécessité de la réglementation règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Les normes permettent un langage commun dans un secteur ou un domaine précis. Leur but est de faciliter les échanges commerciaux, développer de nouveaux marchés, améliorer la compétitivité des entreprises, assurer la sécurité et la satisfaction des usagers. -
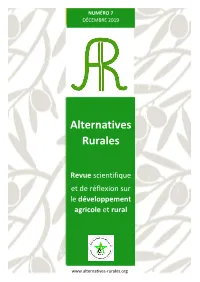
Pdf Du Numéro 7 Complet
NUMÉRO 7 SOMMAIRE DÉCEMBRE 2019 Alternatives Rurales Revue scientifique et de réflexion sur le développement agricole et rural 1 www.alternatives-rurales.org Alternatives Rurales SOMMAIRE Edito………….………………………………………………………………………………………………..........................................3 ETUDES ET RECHERCHES Système participatif de garantie pour un label agro-écologique au Maroc. Sylvaine Lemeilleur, Juliette Sermage, Annie Mellouki…………………………………………………………………………………………………...................6 Plateformes d’innovation pour une production durable du palmier dattier dans le Tafilalet (Maroc). Larbi Aziz, Stella Matutina Kpoton, Rachid Bouamri……………..…………….................................................24 Le contrat de gestion participative pourrait-il résoudre la crise de gouvernance des eaux souterraines ? Cas de la nappe de Berrechid au Maroc. Romaïssa Ouassissou, Marcel Kuper, Ali Hammani, Mohamed El Amrani……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..39 A la recherche de la réutilisation des eaux urbaines en agriculture : rationalité technicienne et impensés institutionnels dans le projet d’irrigation de Settat-Sidi El Aidi. Pierre-Louis Mayaux, Abderrahim Bensmaïl………........................................................................................................................................52 Transfert de gestion dans la petite et moyenne hydraulique en Algérie entre politiques publiques et réalités du terrain. Yasmina Yakoubi, Chérif Aoudjit..............................................................................70 La gestion