La Paix Du Haut D'une Guérite
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Journal Officiel Algérie
N° 64 Dimanche 19 Safar 1440 57ème ANNEE Correspondant au 28 octobre 2018 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale.................................. 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction...... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 19 Safar 1440 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 28 octobre 2018 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 18-262 du 6 Safar 1440 correspondant au 15 octobre 2018 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger, le 15 mai 2017............... -

BENI SLIMANE « Non Au 19 Mars »
INFO 588 BENI SLIMANE « Non au 19 mars » BENI SLIMANE Dans le centre algérien et culminant à 584 mètres d’altitude le village de BENI SLIMANE est situé à 21 km au Sud- ouest de TABLAT ; à 40 km à l’Ouest de BIR RABALOU sur la RN 18 et à 70 Km de MEDEA. Nous donnerons à l'ensemble des montagnes au Nord et au Sud de la vallée de BERROUAGHIA, le nom de monts du TITTERI du nom de l'ancien beylick, dont MEDEA était le chef-lieu. Ce nom que l'historien arabe Ibn-KHALDOUN donne au KEF LAKHDAR, situé à moitié distance de BOGHAR et d'AUMALE, n'est plus guère usité; mais il nous a paru d'autant préférable au point de vue synthétique, qu'entre les termes locaux le choix est singulièrement embarrassant. Au-delà des montagnes abruptes et ravinées qui dominent au Sud la plaine de la MITIDJA, le plateau argileux et nu, de MEDEA, au relief tourmenté, découpé par les profonds sillons des rivières qui s’éloignent vers l’Ouest, le Nord et l’Est, a de nombreuses sources et qui n’est pas dépourvu de terres propices aux céréales. Il forme un passage, d’ailleurs assez difficile, entre la vallée du CHELIFF et les trois plaines des BENI SLIMANE, des ARIB et de BOUIRA, qui se suivent de l’Ouest à l’Est, représentant une ancienne vallée, à une altitude de 600-500 mètres. La première, qui nous concerne BENI SLIMANE, souffre de la sécheresse. On traverse ensuite la plaine des ARIB, très bonnes terres, mais peu cultivées; la route passe par les Frênes, BIR RABALOU, LES TREMBLES, petits villages de colonisation, pour pénétrer dans la cuvette dont AUMALE occupe le centre. -

Journal Officiel N°2020-59
N° 59 Dimanche 16 Safar 1442 59ème ANNEE Correspondant au 4 octobre 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: 1 An 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A Tél : 021.54.35..06 à 09 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d'expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 16 Safar 1442 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 4 octobre 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 20-274 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux -

Journal Officiel N°2020-5
N° 05 Mercredi 4 Joumada Ethania 1441 59ème ANNEE Correspondant au 29 janvier 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Joumada Ethania 1441 29 janvier 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République............................................................................................................................. 4 Décret exécutif n° 19-391 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019........................................................................................................................................ -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets
No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

Brèves Du Centre
L’Algérie profonde / Actualités L’Algérie profonde Brèves du centre M’SILA TROIS MORTS ET UN BLESSÉ GRAVE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION Trois personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu hier à 6h10 à 17 km de la ville de M’Sila. Selon la Protection civile de M’Sila, cet accident s’est produit lorsqu’un camion Renault 340 a heurté de plein fouet une voiture Peugeot 305 sur le RN60, reliant Hammam Dalaâ à M’Sila, au lieu dit Loukmane dans la commune d’Ouled Mansor. Cet accident a fait 3 morts sur le coup et un blessé grave. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances et les causes exactes du drame. Chabane BOUARISSA Médéa création de nouveaux pôles urbains Une opération de création de nouveaux pôles urbains, lancée il y a quelques mois, a été accréditée par les autorités de la wilaya en vue d'asseoir une nouvelle vision qui tienne compte des contraintes particulières liées à la gestion du foncier. C’est dans cette optique que s’inscrit la mise en œuvre, l’année écoulée, d’une dizaine de pôles urbains, expérience qui sera encore consolidée au cours de cet exercice par l’aménagement de huit nouveaux pôles qui concerneront toutes les agglomérations à grande concentration de populations. Cette démarche, est-il indiqué, est dictée par le souci d’harmoniser la croissance des villes touchées et partant d’arriver à une utilisation parcimonieuse des espaces dans l’objectif de mettre en valeur les équipements publics en adéquation avec l’environnement et les besoins d’extension urbaine. -
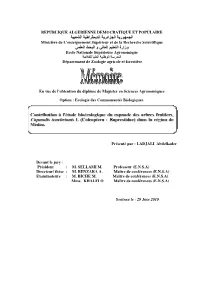
Ladjal These
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ار اا اا ط ا Ministère de L'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique وزارة ا ا و ا ا Ecole Nationale Supérieure Agronomique ار اط ا #"ﺣ Département de Zoologie agricole et forestière En vue de l'obtention du diplôme de Magister en Sciences Agronomiques Option : Ecologie des Communautés Biologiques. Présenté par : LADJALI Abdelkader Devant le jury : Président : M. SELLAMI M. Professeur (E.N.S.A) Directeur/ thèse : M. BENZARA A. Maître de conférences (E.N.S.A) Examinateurs : M. BICHE M. Maître de conférences (E.N.S.A) Mme. KHALFI O Maître de conférences (E.N.S.A) Soutenu le : 29 Juin 2010 SOMMAIRE INTRODUCTION…………………………………………………… 1 CHAPITRE I CARACTERISTIQUES SYSTEMATIQUES ET MORPHOLOGIQUES DES COLEOPTERES I - CLASSIFICATION DES COLEOPTERES……………………… 3 A - SOUS ORDRE DES ADEPHAGA...................................................... 3 1 - Cicindelidae ................................................................................... 4 2 - Carabidae ...................................................................................... 4 3 - Dytiscidae ...................................................................................... 4 4 - Gyrinidae........................................................................................ 4 5 - Paussidae........................................................................................ 4 6 - Haliphidae..................................................................................... 5 7 - Hygrobiidae ................................................................................. -

Page 8 Regions 23 Avril
Le Soir d’Algérie Régions Mercredi 23 avril 2008 - PAGE 8 SIDI-BEL-ABBéS TLEMCEN AlgŽrie TŽlŽcom, Sidi-Ali Benyoub crie Expo grand public La direction territoriale des télécommunications à Tlemcen a organisé une exposition grand public sur les ˆ la catastrophe Žcologique différents secteurs des télécoms. C’était l’occasion pour le public de découvrir des stands sur l’internet et ses Les habitants de la daïra de Sidi-Ali Benyoub de leurs enfants se sont des murs et plafonds qu’il est réseaux, la téléphonie ainsi que le stand commercial. (Sidi-Bel-Abbès) crient à la catastrophe écolo- organisés à travers des impossible de réparer à Des explications étaient fournies aux visiteurs par des associations et comités de cause de la répétitions des gique qui les menace chaque jour. professionnels par le biais d’une projection. A la fin de quartier, pour tirer la sonnet- explosions. cette journée, il y a eu une conférence où deux communi- «Il y va de notre santé rique, dégâts sur leurs te d’alarme et crier à l’insup- D’ailleurs, le wali avait cations ont été faites, l’une sur «histoire de l’internet et son physique et morale et celle demeures, maladies de leurs portable, pointant du doigt demandé à son exécutif l’en- évolution en Algérie» et l’autre «internet, la solution des de nos enfants», s’insurgent enfants, telles sont les les exploitants des carrières voi d’une commission d’en- entreprises économiques». les habitants des localités de conséquences engendrées qui «continuent à nuire indi- quête pour vérifier les décla- Sidi-Ali Benyoub, Bordj par l’exploitation de ces car- rectement à notre vie quoti- rations des habitants. -

Journal Officiel
N° 70 Dimanche 9 Safar 1434 51ème ANNEE correspondant au 23 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION Algérie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL Tunisie (Pays autres DU GOUVERNEMENT ABONNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye WWW. JORADP. DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale….........….........…… 1070,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d'expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG sus) ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 2 9 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 23 décembre 2012 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n°12-419 du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012 portant ratification de la convention sur l'exemption des ressortissants des deux Etats détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux et de service de l'obligation d'obtenir un visa d'entrée entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 janvier 2010...................................................................................... -

Chronologie Des Massacres En Algérie (1994 - 2004)
Chronologie des massacres en Algérie (1994 - 2004) Salah-Eddine Sidhoum, Algeria-Watch, 2005 Cette chronologie a été réalisée sur la base d'informations rapportées par la presse nationale et internationale, des agences de presse internationales et de témoignages recueillis par l'auteur. Les informations contenues dans cette liste ne sont ni complètes ni prouvées étant donné que les sources elles-mêmes ne sont pas infaillibles. Les médias algériens sont soumis à un contrôle strict, ce qui était particulièrement contraignant entre 1994 et 1999. Nous lançons un appel pour compléter ou corriger ces données et rappelons que seules des enquêtes impartiales et indépendantes permettront d'établir ces faits particulièrement douloureux. 1994 15 janvier : Ratissage à l'Arbaa (Blida). 11 citoyens sont arrêtés. Leurs cadavres criblés de balles seront retrouvés le lendemain, à proximité de leurs domiciles. Du 18 au 22 mars : 25 cadavres de citoyens arrêtés lors de ratissages sont retrouvés à Médéa et Berrouaghia et 19 autres à Cherarba et les Eucalyptus. 19 mars : Les cadavres de 20 citoyens sont retrouvés dans les rues de Ouled El Fodda. Selon le témoignage de leurs familles aux organisations internationales des droits de l'homme, ils auraient été arrêtés lors de rafles militaires. 20 mars 1994. 14 cadavres sont retrouvés dans les rues de Blida. Ils avaient été arrêtés la veille, selon le témoignage de leurs familles par des parachutistes, en représailles à la mort de six policiers. 29 avril : 65 fidèles sont enlevés de la Mosquée de Taoughrit (Ténès) par des hommes en tenue militaire et circulant à bord de véhicules militaires selon le témoignage de leurs familles. -

Liste Des Tableaux
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DE BLIDA 1 Faculté des sciences de la nature et de la vie Département des biotechnologies MEMOIRE DE FIN D’ETUDE En vue de l’obtention du diplôme de master En sciences Agronomiques Option : Sciences Forestières THEME Application du SIG dans la cartographie des formations végétales de la région deTamezguida, Wilaya de Médéa. Présenté par : HALFAOUI Fethia Devant le jury : Président Mr Nebri R. MCB Univ. Blida 1 Promoteur Mme Touahria S. MCB Univ. Blida 1 Examinateur Mr Akli A. MAA Univ. Blida 1 Invitée Mme Benrima A. Professeur Univ. Blida 1 Année universitaire : 2016/2017 Utilité et utilisation des arbres Les arbres sont utiles à bien des égards, pour la construction, pour la médecine, pour les métiers traditionnels, pour l'urbanisme, et plus généralement pour leur contribution à l'équilibre des écosystèmes. Aimer les arbres, c'est les protéger. Les connaître, c'est les apprécier au quotidien, en ville, en forêt, dans les parcs ou dans votre jardin. (Anonyme) Remerciements A l’issue de ce modeste travail de recherche, je tiens tout particulièrement à remercier Tout d’abord Allah le tout puissant qui m’a aidé à réaliser ce travail. Je tiens à remercier Docteur Touahria Safia (Maitre de conférences à l’université Saad Dahleb de Blida), pour avoir accepté de diriger avec beaucoup d’attention et de soin ce mémoire. Je lui suis très reconnaissante pour sa disponibilité, sa bienveillance et son soutien permanent, et d’avoir prêté un intérêt constant au sujet du mémoire. -

Aba Nombre Circonscriptions Électoralcs Et Composition En Communes De Siéges & Pourvoir
25ame ANNEE. — N° 44 Mercredi 29 octobre 1986 Ay\j SI AS gal ABAN bic SeMo, ObVel , - TUNIGIE ABONNEMENT ANNUEL ‘ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL Abonnements et publicité : Edition originale .. .. .. .. .. 100 D.A. 150 DA. Edition originale IMPRIMERIE OFFICIELLE et satraduction........ .. 200 D.A. 300 DA. 7 9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER (frais d'expédition | tg}, ; 65-18-15 a 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER en sus) Edition originale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années antérleures : suivant baréme. Les tables sont fourntes gratul »ment aux abonnés. Priére dé joindre les derniéres bandes . pour renouveliement et réclamation. Changement d'adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANGAISE) SOMMAIRE DECRETS des ceuvres sociales au ministére de fa protection sociale, p. 1230. Décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux siéges & pourvoir pour l’élection a l’Assemblée fonctions du directeur des constructions au populaire nationale, p. 1217. , ministére de la formation professionnelle et du travail, p. 1230. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général da la planification Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux et de. la gestion industrielle au ministére de fonctions du directeur de la sécurité sociale et lindustrie lourde,.p.