Article SHAF, Juillet 2015
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download PDF Datastream
“Le Premier Cadre”: Theatre Architecture and Objects of Knowledge in Eighteenth- Century France by Pannill Camp B.A., University of Puget Sound, 1999 A.M., Brown University, 2001 A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Theatre, Speech and Dance at Brown University Providence, Rhode Island May 2009 ii © Copyright 2009 by Pannill Camp iii This dissertation by Pannill Camp is accepted in its present form by the Department of Theatre, Speech, and Dance as satisfying the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Theatre and Performance Studies. _______________ ______________________ Date Spencer Golub, Advisor Recommended to the Graduate Council ________________ ______________________ Date Rebecca Schneider, Reader ________________ ______________________ Date Jeffrey Ravel, Reader Approved by the Graduate Council ________________ ______________________ Date Sheila Bonde, Dean of the Graduate School iv VITA Pannill Camp was born in Austin, Texas in 1977 and grew up in Aurora, Colorado, where he graduated from Overland High School in 1995. He studied English and Theatre at the University of Puget Sound, graduating with a B.A. degree in English Writing, Rhetoric, and Culture in 1999. Pannill began pursuing a master’s degree that year in theatre studies at Brown University, which he completed in 2001. During the course of his studies for this degree he directed The Wild Duck by Henrik Ibsen at Brown’s Production Workshop and Mac Wellman’s Dracula on the theatre department’s mainstage, for which productions he was awarded the Weston Award for Theatre Directing in 2001. After spending a year living and working in New York City and a year creating English language instruction materials for the Spanish Army in Madrid, Pannill returned to Providence in 2003 to begin work on his doctorate in theatre and performance studies in the Ph.D. -

Enlightenment Walking Tour 4
France and Paris were changed dramatically by the Enlightenment and ensuing French Revolution. Likewise, many of the monuments and buildings you’ll see on this walk were “reinvented” during the 18th century. The Panthéon, where this walk starts, began as a church sponsored by an absolute monarch and ended the century as a monument to the country’s most famous Enlightenment figures. The place de la Concorde, where the walk ends, saw one monarch celebrated with a statue and another executed on the same site. Saint-Sulpice and Saint- Thomas-d’Aquin were transformed from churches to secular “temples” and back to churches again. And the Palais du Luxembourg, Hôtel de Salm, and Palais Bourbon, homes at the beginning of the century to royalty and aristocrats, ended the century as homes to the country’s newly created democratic institutions. In addition to showcasing neoclassical buildings and monuments, the walk also provides an opportunity to wander through part of the Saint-Germain des Prés quarter, one of the city’s most lively and interesting neighborhoods. Start: Panthéon (Métro: Maubert Mutualité) Finish: Place de la Concorde (Métro: Concorde) Distance: 3 miles Time: 3 - 4 hours Best Days: Any day Copyright © Ann Branston 2011 HISTORY Religion and Philosophy Politics and Economics The political and economic situation in 18th-century France provided fertile As the 18th century began, France’s monarchy and the Catholic church ground for Enlightenment philosophers (know as “philosophes”) who (known later collectively as the “ancien régime”) were at the apex of their believed that natural “scientific” laws could be applied to social, economic power and glory. -

Dossier De Presse
Rebirth of a masterpiece Renaissance d’un chef-d’œuvre Une réalisation he Chancellerie d’Orléans... a chancellerie d’Orléans… Peu d’hô- or hôtels particuliers have tels particuliers parisiens ont fait collective T century jewel, dismantled stone by couler autant d’encre que ce joyau du XVIIIe siècle, déconstruit pierre par L Over the past century, the demoli- pierre en 1923 pour permettre l’agran- tion itself, followed by successive des mécènes américains regroupés failed attempts to reassemble it, has inspired criticism or simple nos- dissement de la Banque de France. au sein du World Monuments Fundd ont talgia, from lovers of Vieux Paris and !- apporté à ce projet leur concours géné- time, the Chancellerie d’Orléans, La démolition elle-même, puis l’échec stored in pieces in the warehouses reux : la Fondation Florence Gould, "- des projets de remontage successifs, ting its hour. la Fondation Samuel Kress, le Robert ont alimenté depuis un siècle la plume, W. Wilson Challenge to conserve our A personal initiative acerbe ou simplement nostalgique, !#"$%& Heritage et la Fondation Selz. Wailly, Bertrand de Vignaud, a lover des amoureux du Vieux Paris et de l’art of art and architecture, learned of the hôtel’s existence, and began working français. Entre-temps, la Chancellerie En juillet 2015, une convention signée on a strategy to get it rebuilt. With the support of the governors of the d’Orléans, conservée en pièces déta- "()% entre la Banque de France et le minis- Trichet and then Christian Noyer, he chées dans des entrepôts de la Banque began implementing his strategy, tère de la Culture a entériné le choix $*"$++/0 de France, attendait son heure. -

Full Text (PDF)
Document generated on 09/27/2021 11:49 p.m. Man and Nature L'homme et la nature Planning Space for the Masses in France 1789-1799 James A. Leith Volume 6, 1987 URI: https://id.erudit.org/iderudit/1011919ar DOI: https://doi.org/10.7202/1011919ar See table of contents Publisher(s) Canadian Society for Eighteenth-Century Studies / Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle ISSN 0824-3298 (print) 1927-8810 (digital) Explore this journal Cite this article Leith, J. A. (1987). Planning Space for the Masses in France 1789-1799. Man and Nature / L'homme et la nature, 6, 225–267. https://doi.org/10.7202/1011919ar Copyright © Canadian Society for Eighteenth-Century Studies / Société This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit canadienne d'étude du dix-huitième siècle, 1987 (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ PLANNING SPACE FOR THE MASSES IN FRANCE 1789-1799 Since this is an after-dinner talk rather than a formal lecture, I am go• ing to be more personal (although in case anyone wants to publish my talk, I have put in footnotes). I have been working for five or six years on a work entitled Space and Revolution: Projects for Monuments, Squares and Public Buildings in France 1789-1789. -
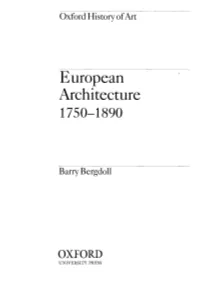
European Architecture 1750-1890
Oxford History of Art European Architecture 1750-1890 Barry Bergdoll O X fO R D UNIVERSITY PRESS OXFORD UNIVERSITY PRESS Great Clarendon Street, Oxford 0 x2 6 d p Oxford New York Athens Auckland Bangkok Bombay Calcutta Cape Town Dares Salaam Delhi Florence Hong Kong Istanbul Karachi Kuala Lumpur Madras Madrid Melbourne Mexico City Mumbai Nairobi Paris Sao Paulo Singapore Taipei Tokyo Toronto Warsaw and associated companies in Berlin Ibadan Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the U K and in certain other countries © Barry Bergdoll 2000 First published 2000 by Oxford University Press All rights reserved. No part of this publication maybe reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the proper permission in writing o f Oxford University Press. Within the U K, exceptions are allowed in respect of any fair dealing for the purpose of research or private study, or criticism or review, as permitted under the Copyright, Design and Patents Act, 1988, or in the case of reprographic reproduction in accordance with the terms of the licences issued by the Copyright Licensing Agency. Enquiries concerning reproduction outside these terms and in other countries should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above. This book is sold subject to the condition that it shall not, byway o f trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the publisher’s prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser. -

Wildenstein Magnificent French Furniture, Objets D
For Immediate Release Friday 30 September 2005 Contact: Catherine Manson (London) 44 207 389 2664 [email protected] Capucine Milliot (Paris) 33 140 76 84 08 [email protected] Andrée Corroon (New York) 212 636 2679 [email protected] WILDENSTEIN MAGNIFICENT FRENCH FURNITURE, OBJETS D’ART & TAPESTRIES Unseen for Decades and In Pure, Untouched and Unrestored Condition, The Superb Wildenstein Collection Will Be Revealed at Christie’s The Wildenstein Collection of Magnificent French Furniture and Objets d’Art Christie’s King Street 14 & 15 December 2005 London – Christie’s announces the sale of the Wildenstein Collection of Magnificent French Furniture, Objets d’Art and Tapestries will take place in London on 14 and 15 December 2005. The sale of this vast collection, started at the turn of the century by Nathan and Laure Wildenstein and comprising more than 250 works of art, including an unprecedented dispersal of magnificent Boulle furniture, is estimated to realise over £14 million ($25 million). The depth and range of the collection is as extraordinary as its impeccable, untouched condition. The majority of the works have remained undisturbed since their acquisition up to one hundred years ago at the turn of the 20th century and the collection has not been available, even to the cognoscenti, for either viewing or acquisition. Its appearance on the market is a true landmark event in the annals of French furniture collecting. “After careful thought, Wildenstein has decided to sell the contents of the Hôtel de Wailly at 57, rue de la Boétie in Paris to create new facilities for housing the archives and research workrooms of the Wildenstein Institute, the world’s leading publisher of catalogues raisonnés. -

Les Décors De L'hotel De Voyer D'argenson, Dit Chancellerie D'orléans (1765-1772)
1 LES DÉCORS DE L’HOTEL DE VOYER D’ARGENSON, DIT CHANCELLERIE D’ORLÉANS (1765-1772) Recherches et analyse des trois pièces sur le jardin du Palais-Royal. Philippe Cachau, Docteur en histoire de l’art Chercheur, conseiller et chargé de communication du Patrimoine Novembre 2013 2 PLAN Introduction 3 I. Marc-René de Voyer de Paulmy d’Argenson, marquis de Voyer : portrait d’un mécène éclairé. 5 II. Les artistes 1. Charles De Wailly (1730-1798) 16 2. Augustin Pajou (1730-1809) 21 3. Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) 24 4. Jean-Jacques Lagrenée, dit le Jeune (1724-1805) 28 5. Louis-Jacques Durameau (1733-1796) 30 6. Charles Monnet (1732- après 1808) 33 III. Les artisans 35 IV. L’hôtel. 1. Aperçu historique 37 2. Les pièces sur le Palais-Royal. Décor et ameublement a) La petite salle à manger (1767-1769 et 1772) 44 b) Le grand salon (1765-1769 et 1771) 55 c) La chambre de la marquise de Voyer (1767-1770 et 1771-1772) 69 Conclusion 79 Sources 82 Bibliographie 84 Illustrations Pièces annexes 3 Introduction Depuis 1997, le World Monuments Fund France, devenu le World Monument Europe, a engagé sous la houlette de son président M. Bertrand du Vignaud, le remontage et la restauration des décors de l’hôtel de Voyer d’Argenson à Paris, autrefois sur le Palais-Royal, à savoir ceux de la petite salle à manger, du grand salon et de la chambre de la marquise de Voyer. Opération réalisée par délégation de maîtrise d’ouvrage convenue avec le ministère de la Culture et la Banque de France, le 12 juillet 2011, et qui prendra place au rez-de-chaussée de l’hôtel de Rohan-Strasbourg. -

Rome Vaut Bien Un Prix. an Artistic Elite in the Service of the State
Artl@s Bulletin Volume 8 Article 9 Issue 2 The Challenge of Caliban 2019 Rome vaut bien un prix. An Artistic Elite in the Service of the State: the Pensionnaires of the Académie de France in Rome, 1666-1968 Annie Verger Artl@s, [email protected] Follow this and additional works at: https://docs.lib.purdue.edu/artlas Part of the History of Art, Architecture, and Archaeology Commons, and the Music Commons Recommended Citation Verger, Annie. "Rome vaut bien un prix. An Artistic Elite in the Service of the State: the Pensionnaires of the Académie de France in Rome, 1666-1968." Artl@s Bulletin 8, no. 2 (2019): Article 9. This document has been made available through Purdue e-Pubs, a service of the Purdue University Libraries. Please contact [email protected] for additional information. This is an Open Access journal. This means that it uses a funding model that does not charge readers or their institutions for access. Readers may freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles. This journal is covered under the CC BY-NC-ND license. Artl@s At Work Rome vaut bien un prix. An Artistic Elite in the Service of the State: the Pensionnaires of the Académie de France in Rome, 1666-1968 Annie Verger* Résumé The Dictionnaire biographique des pensionnaires de l’Académie de France à Rome serves as a register for the artists sent to Italy by the French state from the time of Louis XIV in 1666 up until the abolition of the Prix de Rome concours in 1968. -

Archives Du Théâtre De L'odéon
ARCHIVES DU THÉÂTRE DE L’ODÉON 1809-1983 Répertoire numérique détaillé de la sous-série 55 AJ (1ère de couverture). ¢ Gravure du Théâtre de l’Odéon. Extrait d’un programme imprimé du Théâtre de l’Odéon de 1903 (55 AJ 126/2). (4e de couverture). ¢ Affiche pour Oh ! les beaux jours !, de Samuel Beckett, saison 1966-1967. Signé Roland Deville (55 AJ 342). ARCHIVES NATIONALES ARCHIVES DU THÉÂTRE DE L’ODÉON 1809-1983 55 AJ 1 à 430 Répertoire numérique détaillé par Élisabeth GAUTIER-DESVAUX, Yvette ISSELIN, Odile KRAKOVITCH, Brigitte LABAT-POUSSIN (†) et Sylvie NICOLAS Revu et complété par Yvette ISSELIN et Brigitte LABAT-POUSSIN (†) Annexe par Juliette CARON Ouvrage publié avec le visa de la direction des Archives de France PARIS 2009 © Archives nationales, 2009 ISBN : 978-2-86000-329-2 INTRODUCTION GÉNÉRALE INTRODUCTION Les archives du théâtre de l’Odéon, rassemblées dans le fonds 55 AJ, par la diversité de leurs versements aussi bien que par leur réunion finale aux Archives nationales (Paris), sont le reflet de l’histoire et de la destinée mouvementée de l’établissement aux xixe et xxe siècles ainsi que de la constitution souvent complexe des ensembles documentaires. Les péripéties du théâtre sont en effet aisément discernables dans 55 AJ, composé de six versements distincts, dont les trois premiers correspondent à des moments de rupture de la vie du Théâtre : les archives dites « anciennes » tout d’abord, datées de la première moitié du xixe siècle à 1959 (55 AJ 1-127), celles ensuite du Théâtre de France et du Théâtre national de l’Odéon, de 1959 à 1973 (55 AJ 128-207)1, celles enfin du Théâtre des Nations pour les années 1954 à 1971 (55 AJ 221-335)2, durant lesquelles l’Odéon hébergea les troupes du monde entier. -

Hadrian's Villa: a Source of Inspiration for Neoclassical Russia?
280 C. Ruggero УДК: 72.032; 72.035; 725.17 ББК: 85.113 А43 DOI: 10.18688/aa200-2-25 C. Ruggero Hadrian’s Villa: A Source of Inspiration for Neoclassical Russia? The project Hadrian’s Villa as a Microcosm. A Space of Artistic Interaction in 18th- and 19th- Century Europe1 closely investigates and outlines the different approaches of viewers towards this ancient Roman site in light of the visitor’s respective culture of origin2. French pension- naires were mostly involved in exactly measuring and surveying the structures in their single parts extracting details from the general context, and then using these architectural solutions for majestic public buildings, symbols of innovation and transformation. British artists fa- voured an approach that considers the ‘environment’ of architecture; however, they were also more interested in collecting the finds that came to light during several excavations to be dis- played in their country houses or private collections. Germans had a controversial approach toward the imperial site and Roman antiquity in general: on the one hand, a romantic attitude due to its surroundings in a partially overgrown landscape, and on the other an extremely methodical and also critical stance (Winckelmann advocated Greek antiquity rather than Ro- man). Italians, with their home-field advantage, assumed the role of mediators and were also involved in excavation campaigns and in the trade of antiquities. In the case of Hadrian’s Villa we are not dealing with a single edifice or with a built area of manageable size, but with a site extending around 120 hectares with more than thirty com- plexes located in Tivoli (about 20 miles northeast of Rome), which was inscribed a world cultural heritage by UNESCO in 1999. -

Bibliothèque Et Archives Canada
• Une Architecture Murmurante: An Expression of Freemasonry in Claude-Nicolas Ledoux's Propylaea for Paris? Martha Langford Department of Art History • McGill University, Montreal '. Ju1y, 1991 A Thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts (c) Martha Langford 1991 Table of Contents: i. Abstract ii. Résumé Hi. Acknow1edgements iv. List of I11ustratione 1. Introduction. Sources and Precedents for this Investigation: The Scope of Previous Research 8. Chapter 1. French Freemasonry of the Neoc1assical Period: History and Iconography 30. Chapter II. Masonic Imagery in the Art and Architecture of the Neoclassica1 Period: The Evolving Image of the Temple 50. Chapter III. Manifestations of Freemasonry in the Architecture of Claude-Nicolas Ledoux: Masonic Motifs, Patterns and Traits in Projects Predating the Propylaea; the Saline de Chaux (1773 - 1778) and the Ideal City of Chaux (1780 - 1804); Evidence of Ledoux's Connection to the Order 78. Chapter IV. The Masonic Symbolism of the Propylaea: History, Programme and Description of the Project; Ledoux's Decorative Scheme; the Ceremonial Entrances of the East-West Axis 104. Conclusion. Neoclassical Architecture and the Migration of Masonic Symbols 107. Bibliography 112. Illustrations 1 i 1 Abstract Anthony Vid1er's recent monograph on the eighteenth-century French architect Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) cha~acterizes certain aspects of Ledoux's work as Masonic. Vidler defines Freemasonry primarily as an instrument of sociability. His recognition of Masonic imageryand intent, especially in Ledoux's Ideal City, combines with certain details of Ledoux's life to convince Vidler of Ledoux's adherence to a Masonic or quasi-Masonic lodge. -

Dossier De Presse-Marigny-2.Indd
Le Conseil général de Loir-et-Cher présente © RMN (Château de Versailles) / Gérard Blot © RMN (Château de Versailles) du 30 juin au 16 septembre 2012 Dossier de presse Contact presse : Guillaume Néron Bancel : 06 47 44 81 98 - 02 54 58 41 11 - [email protected] Communiqué de presse Ambitieux, fier, ombrageux : les qualificatifs ne manquent pas pour définir Abel-François Poisson de Vandières, marquis de Marigny et seigneur de Menars (1727-1781). Son destin, tracé à la plume de l’exception, en fait foi. Il eut la chance d’être le frère cadet de la maîtresse de Louis XV, titrée marquise de Pompadour, qui l’introduisit dès son adolescence à la cour du roi. À vingt-quatre ans, il est nommé directeur général des Bâtiments du roi, arts et manufactures. Un voyage en Italie en compagnie d’artistes et d’architectes engagés dans les débats esthé- tiques contemporains fut le déclic vers l’émancipation : Marigny commença alors à se constituer une collection d’exception. Sa galerie de statues était la 1ère de France après celle de Louis XV. Il dirigea surtout la politique des arts du royaume pendant 30 ans, laissant à l’humanité des chefs-d’œuvre tels que la place de la Concorde, l’École Militaire, les jardins des Champs- Élysées ou le Panthéon de Paris. L’exposition Le naturel exalté. Marigny, ministre des arts au château de Menars, qui sera présentée à Expo 41, du 30 juin au 16 septembre 2012, est la 1ère rétrospective mondiale consacrée au frère de la Pompadour et ministre de Louis XV.