Fort Chambly Chambly - Québec
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fortifier La Vallée Du Richelieu Pierre Cloutier Et Maggy Bernier
Document généré le 23 sept. 2021 21:05 Cap-aux-Diamants La revue d’histoire du Québec Fortifier la vallée du Richelieu Pierre Cloutier et Maggy Bernier Les 350 ans du régiment de Carignan-Salières Numéro 122, 2015 URI : https://id.erudit.org/iderudit/79289ac Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Les Éditions Cap-aux-Diamants inc. ISSN 0829-7983 (imprimé) 1923-0923 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Cloutier, P. & Bernier, M. (2015). Fortifier la vallée du Richelieu. Cap-aux-Diamants, (122), 21–23. Tous droits réservés © Les Éditions Cap-aux-Diamants inc., 2015 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ FORTIFIER LA VALLÉE DU RICHELIEU par Pierre Cloutier et Maggy Bernier lors que l’his- toriographie, la A généalogie, la toponymie et les an- ciens chemins militaires de Chambly et Sainte- Thérèse témoignent du passage du régiment Carignan-Salières en Nouvelle-France, que reste-t-il des cinq forts construits pour les campagnes de 1665 et 1666? Tous disparus depuis longtemps, l’ar- chéologie en a retrouvé et documenté trois dans les dernières décen- nies. -

Fur Trade in New France
THE FUR TRADE IN NEW FRANCE * Descriptions From frontispiece of Lahontan, New Voyages to North-America, 1703 1685, 1697 “these Merchants have a more beneficial Trade than a great many other Tradesmen in the World” Fur Trading with the Indians at Fort Chambly near Montreal 1685 In Louis Armand de Lom d'Arce, Baron de Lahontan, Nouveaux voyages dans l'Amérique septentrionale (New Voyages to North-America), 1703 [The Ottawas and Hurons] come down every Year to the Colony in order to make a better Market than they can do in their own Country of Michilimackinac, which lies on the Banks of the Lake of Hurons, at the Mouth of the Lake of the Illinese [Lake Michigan]. Their way of Trading is as follows: Upon their first Arrival, they encamp at the distance of five or six hundred Paces from the Town. The next day is spent in [ar]ranging their Canoes, unloading their Goods and pitching their Tents, which are made of Birch Bark. The next day after, they demand Audience of the Governor General, which is granted ’em that same day in a public place. Upon this Occasion, each Nation makes a Ring for itself; the Savages sit upon the Ground with their Pipes in their Mouths, and the Governor is seated in an armed Chair; after which, there starts up an Orator or Speaker from one of these Nations, who makes an Harangue, importing, “That his ‘Brethren are come to visit the Governor general, and to renew with him their wonted Friendship: That their chief View is to promote the Interest of the French, some of whom being unacquainted with the way of Traffic, -

La Rivière Richelieu André Charbonneau
Document generated on 10/02/2021 4:20 p.m. Cap-aux-Diamants La revue d'histoire du Québec Une voie stratégique bien gardée La rivière Richelieu André Charbonneau Des lieux chargés d’histoire Number 37, Spring 1994 URI: https://id.erudit.org/iderudit/8583ac See table of contents Publisher(s) Les Éditions Cap-aux-Diamants inc. ISSN 0829-7983 (print) 1923-0923 (digital) Explore this journal Cite this article Charbonneau, A. (1994). Une voie stratégique bien gardée : la rivière Richelieu. Cap-aux-Diamants, (37), 20–24. Tous droits réservés © Les Éditions Cap-aux-Diamants inc., 1994 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ k Une voie stratégique bien gardée La rivière Richelieu ''••'• Voie commerciale de première importance la France et l'Angleterre sur le continent nord- dont il fallait protéger l'accès, le Richelieu américain, ou encore durant les luttes armées se raconte à travers ses nombreux lieux entre le Canada et les États-Unis, le Richelieu et historiques à caractère militaire. le lac Champlain sont constamment le théâtre d'opérations militaires de premier plan. Par conséquent, de nombreuses installations mili f I i par André Charbonneau taires y ont été aménagées; plusieurs de ces ouvrages témoignent encore aujourd'hui d'un passé riche en événements. -

Britain's Magnificent “Forts”
Britain’s Magnificent “Forts” The Freedom Freighters of WW 2 By Geoff Walker For our non-seafaring friends, many would associate the word “Fort” with some kind of medieval bastion or land based strong hold, but in the case to hand, nothing could be further from reality. Fort was the name given to a class of Cargo Ship built in Canada during WW2, for the British government (MOWT), under the Lend Lease scheme. All Fort ships, except two which were paid for outright, were transferred on bareboat charter, on Lend - lease terms, from the Canadian Government or the U.S. War Shipping Administration who bought ninety of the 'Forts' built in Canada. The construction of this type of ship commenced in 1942, and by war’s end well over 230 of these vessels had been delivered to the MOWT, (including all “Fort” variants and those built as Tankers) each at an average cost of $1,856,500. Often, confusion persists between “Fort” and “Park” class ships that were built in Canada. To clarify, “Fort” ships were ships transferred to the British Government and the “Park” ships were those employed by the Canadian Government, both types had similar design specifications. All Fort ships were given names prefixed by the word “Fort”, whilst “Park” ships all had names ending or suffixed with “Park” at the time of their launching, although names were frequently changed later during their working life. These ships were built across eighteen different Canadian shipyards. Their triple expansion steam engines were built by seven different manufacturers. There were 3 sub-classes of the type, namely, “North Sands” type which were mainly of riveted construction, and the “Canadian” and “Victory” types, which were of welded construction. -

Art Militaire Et Technique De Guerre : Le Fort De Chambly De 1710-1711 Marc Lafrance
Document généré le 2 oct. 2021 10:58 Revue d'histoire de l'Amérique française Art militaire et technique de guerre : le fort de Chambly de 1710-1711 Marc Lafrance Volume 37, numéro 1, juin 1983 URI : https://id.erudit.org/iderudit/304123ar DOI : https://doi.org/10.7202/304123ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Institut d'histoire de l'Amérique française ISSN 0035-2357 (imprimé) 1492-1383 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Lafrance, M. (1983). Art militaire et technique de guerre : le fort de Chambly de 1710-1711. Revue d'histoire de l'Amérique française, 37(1), 21–49. https://doi.org/10.7202/304123ar Tous droits réservés © Institut d'histoire de l'Amérique française, 1983 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ ART MILITAIRE ET TECHNIQUE DE GUERRE: LE FORT DE CHAMBLY DE 1710-1711 MARC LAFRANCE Parcs Canada, Québec Introduction* En moins de cinquante ans, le fort de Chambly, considéré en 1712 comme «le rempart du Canada du costé d'en haut», devient, à l'époque de la guerre de Sept Ans, «un mauvais fort», une «misérable bicoque»1. -
Montréal-Est 40 15 Saint-Hyacinthe 640 138 440 25 223 Sainte-Julie 20 344 229 40 Boucherville Beloeil
Western New England Greenway Upper Housatonic Valley National Heritage Area & Champlain Valley National Heritage Partnership Long Island Sound to Montreal Quebec - Route Map 6 of 6: North Hero, Vermont to Montreal, Quebec National Park Service/U.S. Department of the Interior rom North Hero, VT to Montreal it is flat so it is F the wind to be aware of not the hills. A short 10 mile loop around Isle La Motte will take you past Quebec City quarries with the oldest known fossils in the world and the site of Samuel de Champlain’s landing in QUEBEC 40 173 Vermont. Have your passport ready when you get to 20 the border follow the directions to meet Route Verte Montreal 55 in Lacoile, QC. Halfway to St. Jean sur Richelieu are 201 10 Sherbrooke signs Route de Forts which will lead you Ft. Lennox. 15 St. Jean sur Richelieu A short boat ride to the island fort is both fun and 89 ME educational. In St. Jean sur Richelieu the bike path 91 Burlington along the Chambly Canal starts at Pont Gouin and Augusta Montpelier 95 ends near Ft. Chambly. 87 VT 93 Portland Chambly to Montreal becomes more urban the farther 89 NH you go but it is all on bike paths or bike lanes. Once NY Concord you enter the Montreal area you are in a complex with Manchester hundreds of miles of bike paths and lanes and unless Albany 91 93 90 it’s race time you can ride the Formula One track. MA 90 Boston Springeld Providence Hartford RI 87 CT 95 84 New York City Western New England Greenway Section 6: North Hero, Vermont to Montreal, Quebec Cue Sheet VT 211.7 NORTH HERO - Continue on Rt. -

Fort Chambly 2018 National Historic Site of Canada Ii
Management Plan Fort Chambly 2018 National Historic Site of Canada ii © Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the Chief Executive Officer of Parks Canada, 2018. FORT CHAMBLY NATIONAL HISTORIC SITE OF CANADA MANAGEMENT PLAN, 2018. Paper: R64-105/53-2018E 978-0-660-27924-4 PDF: R64-105/53-2018E-PDF 978-0-660-27923-7 Cette publication est aussi disponible en français. For more information about the management plan or about FORT CHAMBLY NATIONAL HISTORIC SITE: 2 De Richelieu Street, Chambly, Quebec, Canada J3L 2B9 Tel: 450-658-1585, fax: 450-658-7216 Email: [email protected] http://www.pc.gc.ca/fortchambly Front cover image credits top from left to right: Parks Canada bottom: Parks Canada Fort Chambly National Historic Site iii Management Plan Foreword Canada’s national parks, national historic sites and national marine conservation areas belong to all Canadians and offer truly Canadian experiences. These special places make up one of the finest and most extensive systems of protected natural and cultural heritage areas in the world. The Government is committed to preserving our natural and cultural heritage, expanding the system of protected places and contributing to the recovery of species-at-risk. At the same time, we must continue to offer new and innovative visitor and outreach programs and activities so that more Canadians can experience Parks Canada places and learn about our environment, history and culture. This new management plan for Fort Chambly National Historic Site of Canada supports this vision. Management plans are developed through extensive consultation and input from various people and organizations, including Indigenous peoples, local and regional residents, visitors and the dedicated team at Parks Canada. -
Archaeology, History and Memory at Fort St Anne, Isle La Motte, Vermont
W&M ScholarWorks Dissertations, Theses, and Masters Projects Theses, Dissertations, & Master Projects 2006 Enshrining the Past: Archaeology, History and Memory at Fort St Anne, Isle La Motte, Vermont Jessica Rose Desany College of William & Mary - Arts & Sciences Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/etd Part of the History of Art, Architecture, and Archaeology Commons, and the United States History Commons Recommended Citation Desany, Jessica Rose, "Enshrining the Past: Archaeology, History and Memory at Fort St Anne, Isle La Motte, Vermont" (2006). Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1539626510. https://dx.doi.org/doi:10.21220/s2-5rdk-4r65 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Dissertations, Theses, and Masters Projects by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. ENSHRINING THE PAST ARCHAEOLOGY, HISTORY AND MEMORY AT FORT ST. ANNE, ISLE LA MOTTE, VERMONT A Thesis Presented to the Faculty of the Department of Anthropology The College of William and Mary in Virginia In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree of Master of Arts By Jessica Rose Desany 2006 APPROVAL SHEET This thesis is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Jessica Rose Desany Approved by the Committee, May 2006 -fcmmeiLr 8<(iqd — Dr. Kathleen Bragdon, Chair Dr. Martin Gallivan For my Parents, Without whose love and support I could never have accomplished this And to Dr. Marjory Power. -

National Historic Sites of Canada System Plan Will Provide Even Greater Opportunities for Canadians to Understand and Celebrate Our National Heritage
PROUDLY BRINGING YOU CANADA AT ITS BEST National Historic Sites of Canada S YSTEM P LAN Parks Parcs Canada Canada 2 6 5 Identification of images on the front cover photo montage: 1 1. Lower Fort Garry 4 2. Inuksuk 3. Portia White 3 4. John McCrae 5. Jeanne Mance 6. Old Town Lunenburg © Her Majesty the Queen in Right of Canada, (2000) ISBN: 0-662-29189-1 Cat: R64-234/2000E Cette publication est aussi disponible en français www.parkscanada.pch.gc.ca National Historic Sites of Canada S YSTEM P LAN Foreword Canadians take great pride in the people, places and events that shape our history and identify our country. We are inspired by the bravery of our soldiers at Normandy and moved by the words of John McCrae’s "In Flanders Fields." We are amazed at the vision of Louis-Joseph Papineau and Sir Wilfrid Laurier. We are enchanted by the paintings of Emily Carr and the writings of Lucy Maud Montgomery. We look back in awe at the wisdom of Sir John A. Macdonald and Sir George-Étienne Cartier. We are moved to tears of joy by the humour of Stephen Leacock and tears of gratitude for the courage of Tecumseh. We hold in high regard the determination of Emily Murphy and Rev. Josiah Henson to overcome obstacles which stood in the way of their dreams. We give thanks for the work of the Victorian Order of Nurses and those who organ- ized the Underground Railroad. We think of those who suffered and died at Grosse Île in the dream of reaching a new home. -

Marine News - Cont'd
Marine News - cont'd. One of the last lake fleets with any large amount of excess tonnage has been Canada Steamship Lines, but it now has rid itself of most of its unwanted vessels. Scrap bids were called for June 2nd, and subsequently four obsolete ships were sold to the Ziff (Corostel Trading) interests of Montreal for dismantling overseas. First to move was NIPIGON BAY, (a) IMPERIAL LEDUC (55), which had been built at Collingwood in 1951, was acquired by C. S.L. in 1955, was converted to a straight-decker at Port Arthur in 1958, and later had her deck raised five feet. She last ran in 1982 and since had been laid up at Montreal, at Kingston, and finally at Toronto. She cleared port on July 7, 1989, and was downbound at the Snell Lock on July 10 in tow of GLENBROOK, LAC COMO, GLENEVIS and STORMONT, bound for Sorel, where she arrived on the 12th and was moored in the Richelieu River. The next to get underway was GEORGIAN BAY, which had been built by Colling wood Shipyards in 1954 and was designed as a sister to IMPERIAL LEDUC, IM PERIAL REDWATER, IMPERIAL WOODBEND and B. A. PEERLESS. She was, however, completed as a bulk carrier, not a tanker, and thus was always an unusual ship. She had been idle at Thunder Bay since December 9, 1982, and she had deteriorated remarkably, with her cabins vandalized and much of her paint peeled off. She was towed from Thunder Bay on July 11 and was downbound at the Soo on July 13 in tow of AVENGER IV, with ANGLIAN LADY assisting as far as DeTour. -
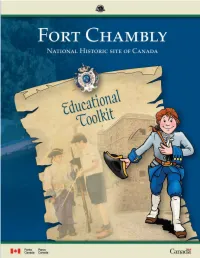
Guide2007 E.Pdf
o help you get the most out of your field trip, we have prepared this instructional toolkit for you to use in the classroom. The toolkit cov- ers several activities serving to acquaint Elementary Cycle Two and Three pupils with Canadian Society in New France around 1745. These activities, which can be used to prepare pupils ahead of their visit or as part of projects once they are back in the classroom, bring into play various competencies such as observation, logical inference, argumentation, analysis and reflective thinking. We hope these activities will provide your students with a series of learning opportunities that are as fun as they are rewarding. The Guide-Interpreter Team Illustration : C. Courcy Table of Contents: Timeline ...................................................................................................... 2 Workshop 1 The Grand Boulevards of New France ............................................... Exercise 1 Navigating French America 3 Workshop 2 Private Jean-Baptiste Lefort dit Laforest writes to his Mother ....... Exercise 2 Questions about Jean-Baptiste’s letter 5 Workshop 3 Archaeologists: Detectives who investigate times gone by.............. Exercise 3 Would you make a good archaeologist? 7 Workshop 4 Settling the huge land known as Canada............................................ Exercise 4 Living on a seigneury 9 Workshop 5 Fort Chambly comes to the defence of Montreal! ........................... Exercise 5 Circle-the-word game 11 Illustration : C. Courcy Suggestions for activities once you’re -
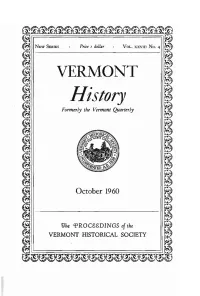
The Lake Champlain Army and the Fall of Montreal
~~~~~~~~~~~~~m~~~ ~ .~ ~ NEw SERIES : Price 1 dollar : VOL. XXVIII No. 4 ~ ~ ~ ~ VERMONT ~ ~ History ~ ~ Form",ly tm Vermont QfJarterly ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ October 1960 ~ ~ ~ @ ~he GFROCf,f,DINGS of the ~ (:A VERMONT HISTORICAL SOCIETY b) ~ @ ~ ~ ~®~~~®~®~®~~®~® THE LAKE CHAMPLAIN ARMY AND THE FALL OF MONTREAL By THOMAS M. CHARLAND OMMANDER~IN-CHIEF Amherst might have captured Montreal C as early as 1759.ln accord with his character, he did not want to act in haste; but the precautions he took were termed as excessive by his opponents. He spent the most precious time of the season in prepa(atory works which were not imperative. When he was ready to launch the attack, the season appeared too advanced, and he had to postpone the attempt. He had JUSt the time to sound the outworks of lsle-aux-Noix, up St. Johns on the Richelieu River.* Along the road leading from Fort Edward to the head of Lake George he managed to have opened a wide gap on each side, so that his army might travel in. open field without the slightest danger of ambush, and to have fortified posts at intervals of three or four miles. His move was delayed by the completion of these works. It was July 2. I before his flotilla of barges could enter Lake George. The anny he was proceeding with outnumbered four to one the forcf;s headed by his opponent Bourlamaque. The latter had been given orders to blow up Fans Carillon and St. Frederic, if they were to, be besieged by too far superior forces. This he did in the night July 2.6 for Carillon, and in the morning July 31 for St.