Download Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Le Traitement Du Passé Dans Trois Romans Québécois Contemporains
Université de Montréal En marge de l’histoire : le traitement du passé dans trois romans québécois contemporains par Stéphanie Paradis Département des littératures de langue française Faculté des arts et des sciences Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de M. A. en Littératures de langue française Janvier 2018 © Stéphanie Paradis, 2018 Résumé Ce mémoire porte sur le traitement du passé dans trois romans québécois contemporains, La constellation du lynx de Louis Hamelin, Pourquoi Bologne d’Alain Farah et Jonas de mémoire d’Anne Élaine Cliche. Ces trois récits partagent une obsession pour le passé qui pousse les narrateurs à enquêter sur des épisodes problématiques et méconnus que les textes explorent tout en les tenant à distance. Plusieurs procédés formels contribuent à créer cet écart et à maintenir un décalage avec le passé dont l’accès est toujours indirect. L’analyse de la construction de la narration et des narrateurs montre comment ces divers degrés d’éloignement demeurent dynamiques. Les textes installent également une distance dans leurs usages du passé par le recul qu’ils prennent par rapport aux faits établis et aux idées préconçues. Les passés explorés sont interprétés, transformés par la fiction qui en propose une relecture. L’hypothèse de ce mémoire, nourrie par la sociocritique, concerne le rôle de la fiction et sa capacité à éclairer des aspects du passé qui restent inaccessibles à d’autres discours, notamment à l’Histoire qui cherche à éliminer la subjectivité. Mots-clés : passé, histoire, sociocritique, littérature québécoise contemporaine, La constellation du lynx, Pourquoi Bologne, Jonas de mémoire i Abstract This thesis focuses on the representation of the « past tense » in three contemporary Quebec novels, La constellation du lynx by Louis Hamelin, Pourquoi Bologne by Alain Farah and Jonas de mémoire by Anne Élaine Cliche. -

Free Catalog
Featured New Items DC COLLECTING THE MULTIVERSE On our Cover The Art of Sideshow By Andrew Farago. Recommended. MASTERPIECES OF FANTASY ART Delve into DC Comics figures and Our Highest Recom- sculptures with this deluxe book, mendation. By Dian which features insights from legendary Hanson. Art by Frazetta, artists and eye-popping photography. Boris, Whelan, Jones, Sideshow is world famous for bringing Hildebrandt, Giger, DC Comics characters to life through Whelan, Matthews et remarkably realistic figures and highly al. This monster-sized expressive sculptures. From Batman and Wonder Woman to The tome features original Joker and Harley Quinn...key artists tell the story behind each paintings, contextualized extraordinary piece, revealing the design decisions and expert by preparatory sketches, sculpting required to make the DC multiverse--from comics, film, sculptures, calen- television, video games, and beyond--into a reality. dars, magazines, and Insight Editions, 2020. paperback books for an DCCOLMSH. HC, 10x12, 296pg, FC $75.00 $65.00 immersive dive into this SIDESHOW FINE ART PRINTS Vol 1 dynamic, fanciful genre. Highly Recommened. By Matthew K. Insightful bios go beyond Manning. Afterword by Tom Gilliland. Wikipedia to give a more Working with top artists such as Alex Ross, accurate and eye-opening Olivia, Paolo Rivera, Adi Granov, Stanley look into the life of each “Artgerm” Lau, and four others, Sideshow artist. Complete with fold- has developed a series of beautifully crafted outs and tipped-in chapter prints based on films, comics, TV, and ani- openers, this collection will mation. These officially licensed illustrations reign as the most exquisite are inspired by countless fan-favorite prop- and informative guide to erties, including everything from Marvel and this popular subject for DC heroes and heroines and Star Wars, to iconic classics like years to come. -

Societas Criticus Revue De Critique Sociale Et Politique on N'est Pas Vache…On Est Critique! & D.I
1 Version archive pour bibliothèques de Societas Criticus et DI Revues Internet en ligne Societas Criticus Revue de critique sociale et politique On n'est pas vache…on est critique! & D.I. revue d’actualité et de culture Où la culture nous émeut! www.societascriticus.com Vol. 9 no. 3 Cette revue est éditée à compte d'auteurs. (28 mars – 18 mai 2007) Pour nous rejoindre: [email protected] Societas Criticus C.P. 182, Succ. St-Michel Montréal (Québec) Canada H2A 3L9 Les co-éditeurs: Michel Handfield, M.Sc. Sociologie et Délinquant Intellectuel pour penser autrement! Gaétan Chênevert, M.Sc. Adm. et Diogénien Soumission de texte: 2 Les envoyer par courriel. Si votre texte est en fichier attaché, si possible le sauvegarder en format "rtf" (rich text format) sans notes automatiques. Index de ce numéro : Édito Questions de presse Pas de scandale? Et si c’était encore plus scandaleux… Médias pour la démocratie Sur l’élection québécoise, voir l’essai Bamako, Mali /Québec /Canada! Essais Bamako, Mali /Québec /Canada! Le Journal/Fil de presse Tous et toutes ensemble pour le FSQ! Bolivie : La coca est là pour rester La partie D.I.,Delinkan Intellectuel, revue d’actualité et de culture Commentaires livresques : Sous la jaquette! Finkielkraut, Alain, Baconnet, Marc, et Grange, Mireille, 2003, Enseigner les lettres aujourd'hui, Genève : éditions du tricorne Nouveaux livres reçus Regard sur... la jeunesse en Afrique subsaharienne; La raison démasquée. Sociologie de l’acteur et recherche sociale en Afrique; Métamorphoses de la culture libérale, Éthique, médias, entreprises; Une pensée libérale, critique ou conservatrice ? Actualité de Hannah Arendt, d'Emmanuel Mounier et de George Grant pour le Québec d’aujourd’hui; La vie (presque) sans pétrole; Le nazisme comme religion. -

Heather O'neill
HEATHER O’NEILL Écrire en anglais au Québec HIVER | PRINTEMPS 2019 Deni ELLIS BÉCHARD Blanc Heather O’NEILL Mademoiselle Samedi soir Patrick deWITT Sortie côté tour David MITCHELL Slade House C DA Thomas WHARTON Un jardin de papier suivi de Logogryphe (édition spéciale) David MITCHELL Les mille automnes de Jacob de Zoet Emma HOOPER Etta et Otto (et Russell et James) Nick CUTTER Troupe 52 © Nadia Morin editionsalto.com | aparte.info HIVER | PRINTEMPS 2019 Édito Deni ELLIS BÉCHARD Yes sir ! Madame…* Blanc Je n’avais jamais entendu prononcer le nom de Linda Leith avant de me porter volontaire comme bénévole à Heather O’NEILL Metropolis bleu. Je m’engageais certes pour la Littérature, pour baigner dans le chaos d’un festival (et assister à des évènements gratuitement), mais j’y allais surtout pour échanger avec des auteurs et des autrices autrement que par Mademoiselle Samedi soir livre ou professeur interposé. Et pour cela, j’étais prête à me rendre dans un hôtel impersonnel du centre-ville de Montréal où se tenait alors la manifestation. La jeune vingtaine, je poursuivais alors avec une ardeur non feinte et une inspiration emballée un baccalauréat en Patrick deWITT études anglaises et littérature comparée à l’Université de Montréal. J’avais très peu ou alors vaguement conscience que des anglophones écrivaient aussi au Québec. Dans mes cours, nous lisions dans le texte original Emily Dickinson, Sortie côté tour Cormac McCarthy, Don DeLillo, Jean Rhys ou Joseph Conrad, mais très peu d’œuvres québécoises — en français ou en anglais —, à l’exception de Cohen dont les romans The Favorite Game et Beautiful Losers m’avaient laissée mystifiée David MITCHELL et confuse par le talent de leur auteur. -

Université De Montréal SQUEEZE Représentations Du Baseball Dans L
Université de Montréal SQUEEZE Représentations du baseball dans l’imaginaire social au Québec : 1994-2014 Francis Mineau Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de M.A. en Littératures de langue française Avril 2017 ©Francis Mineau, 2017 Résumé Le baseball occupe une place atypique dans les discours publics au Québec. Ses multiples représentations, teintées d’une exubérante ferveur ou d’un désintérêt des plus opiniâtres, l’attestent sans équivoque. Outre l’unicité de la langue française (qui est déjà beaucoup en soi), on se doute que des particularismes québécois existent et qu’ils prennent forme dans les diverses manifestations culturelles écrites, chantées, dessinées ou publicisées de ce sport. Le baseball a influencé les cultures savante et populaire d’ici et il continue à faire couler de l’encre, à pénétrer et à structurer des discours de natures diverses et à marquer l’imaginaire et l’imagination. Il s’agit dans la présente recherche d’arriver à une lecture spécifiquement québécoise des représentations du baseball dans l’imaginaire (social, collectif et culturel) entre 1994 et 2014, grâce à l’examen de quatre thématiques principales, soit l’écriture, l’espace, le temps et la sexualité. Mots-clés : baseball, Expos de Montréal, littérature québécoise, culture populaire, imaginaire social, sociocritique, histoire culturelle. II Abstract Baseball holds a special place in Quebec’s public discourse. Its multiple representations, stuck between heartfelt passion and a stubborn disinterest, are proof of this. Besides the uniqueness of the French language (which is already significant in itself), we can suspect that a Quebec distinctiveness exists through the various cultural expressions of this sport, whether they be written, sung, drawn or publicized. -

Pierre Falardeau : Un Cinéaste Trop Engagé Pour Les Organismes Subventionnaires Fédéraux Du Canada
The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law / Le Royaume paisible? Relations entre les communautés culturelles et linguistiques du Canada et l’application de la loi TransCanadiana Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d’Études Canadiennes The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law / Le Royaume paisible? Relations entre les communautés culturelles et linguistiques du Canada et l’application de la loi 6. 2013 Poznań 2013 Rada Wydawnicza / Advisory Board / Comité de Rédaction Maciej Abramowicz (Université Marie Curie-Skłodowska, Lublin) Klaus-Dieter Ertler (Université de Graz) Yannick Gasquy-Resch (Université Aix-Marseille) Jan Grabowski (University of Ottawa) Sherrill Grace (University of British Columbia) Thomson Highway (Writer, Distinguished Visiting Professor at Brandon University) Serge Jaumain (Université Libre de Bruxelles) Smaro Kambourelli (University of Guelph) Józef Kwaterko (Université de Varsovie) Peter Kyloušek (Université Masaryk, Brno) Larissa Lai (University of British Columbia) Norman Ravvin (Concordia University; Concordia Institute for Canadian Jewish Studies, Montreal) Anna Reczyńska (Jagiellonian University, Kraków) Radosław Rybkowski (Jagiellonian University, Kraków) Eugenia Sojka (University of Silesia, Katowice) Teresa Tomaszkiewicz (Université Adam Mickiewicz, Poznań) Recenzenci naukowi / Reviewers / Rapporteurs Jacek Fabiszak (Adam Mickiewicz University in Poznań), Sherrill Grace (University of British Columbia), -

Fall 2017 Conundrum Press
Conundrum Press Fall 2017 art by Geneviève Elverum THE CASE OF THE MISSING MEN Kris Bertin and Alexander Forbes ISBN 978-1-77262-016-0 5.5 x 8.5 inches, 224 pages black and white, trade paperback $20 November The Case of the Missing Men is a mystery The Case of The Missing Men is at turns thriller set in a strange and remote east- funny, intriguing, eerie and endear- coast village called Hobtown. The story ing, and is beautifully illustrated in follows a gang of young teens who have a style reminiscent of children’s pulp made it their business to investigate classics like Nancy Drew and the each and every one of their town’s bi- Hardy Boys. zarre occurrences as The Teen Detective Club (a registered afterschool program). Their small world of missing pets and shed-fires is turned upside down when real-life kid adventurer and globetrotter “Kris Bertin’s stories are a Sam Finch comes to town and enlists revelation, a triumph — each them in their first real case—the search stamped with the mark of a for his missing father. In doing so, he new and rising genius” and the teens stumble upon a terrifying — David Adams Richards world of rural secret societies, weird- but-true folk mythology, subterranean lairs, and an occultist who can turn men into dogs. Kris Bertin and Alexander Forbes are childhood friends who trained in separate disciplines in order to reunite as adults and make comic books. Alexander Forbes is an artist and graduate of NSCAD, and Kris Bertin is the author of the acclaimed short story collection BAD THINGS HAPPEN (Biblioasis 2016). -

Madame La Ministre De La Culture
Madame Christine St-Pierre, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 225, Grande Allée Est Québec (Québec) G1R 5G5 Madame la ministre, C’est avec grand désarroi que nous avons pris connaissance des propos que vous avez prononcés ce vendredi 8 juin, propos selon lesquels « nous, on sait ce que ça veut dire le carré rouge, ça veut dire l’intimidation, la violence, ça veut dire aussi le fait qu’on empêche des gens d’aller étudier »1. Nous nous trouvons aujourd’hui dans l’obligation de vous demander de présenter des excuses publiques pour ces propos démagogiques qui tentent de discréditer la légitimité du port du carré rouge et de réduire malhonnêtement le sens qui lui est attaché, méprisant du coup le choix réfléchi et affirmé de très nombreux membres de la communauté artistique québécoise. Que la ligne de parti vous oblige à une certaine réserve, nous le comprenons, mais que vous prêtiez si facilement votre ministère comme tribune à ce type de propagande alors qu’il est chargé d'administrer et de représenter les intérêts du milieu culturel québécois, nous indigne profondément: vous n’êtes pas sans savoir que la grande majorité des acteurs de ce milieu arborent fièrement le carré rouge. Tout comme le Premier ministre se doit d'être le représentant des intérêts de tout un peuple (chose qui, malheureusement, est actuellement mise en doute au Québec), une ministre de la Culture ne peut se permettre de mépriser les artistes et les travailleu(rs)ses culturel(le)s qui fondent les raisons d'être de son ministère. -
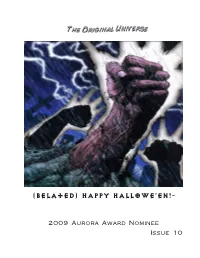
The Original Universe Is Published 6 Times a Contact: My E-Mail for This Zine Is Year on a Bi-Monthly Schedule
(Belated) Happy Hallowe’en!~ 2009 Aurora Award Nominee Issue 10 Table of Contents v) Zine trades: If you produce a zine, I’ll be glad to exchange a copy of this Editor’s Corner ………………………….. 3 one for yours. Ramblings of a Comic Collector by Gregory Woronchak .……….. 4 To remain on the mailing list you have to Blackest Night is Here ...................… 7 contribute The Usual at least once every 2 issues. Blast From the Past: The Kree/Skrull War Failure to do so gets you bumped from mailings. by Justin Mohareb ....................................... 11 You’ll be reminded if you’re close to that point. My Two Sides ......................... 12 Movie Views .............................................. 13 Rights: all articles, art and letters are © to you. Montreal Comic Con Report ..................... 15 In the case of characters and concepts belonging Comic Thoughts …………………….. .. .... 16 to others, rights revert to them and their Hey Kids, Letters! .........................................18 copyrights should be mentioned. The Original Universe is published 6 times a Contact: My e-mail for this zine is year on a bi-monthly schedule. Sample issues are [email protected] available for $3 Canadian, about the same cost as many comics. You can also subscribe at a cost My Snail-Mail address is of $12 per year. Jeff Boman The zine is also available free for The Usual. The 6900 Cote St-Luc Road #708 Usual consists of several options: Montreal, QC H4V 2Y9 CANADA i) LOC (Letter of Comment): This is the most common method, and Next Deadline: January 12. recommended even if you use the other methods as well. This is simply a letter to the editor giving feedback on the issue itself, maybe feedback to other contributors as well. -

The Rip Off Press Mail Order Catalog
Time to knuckle down and study... comix & collectibles from The Rip Off Press Mail Order Catalog No-Pictures Edition Stuff for sale September 2013 THE NO PICTURES VERSION OF THE RIP OFF PRESS MAIL ORDER CATALOG Need to see pictures of the items we sell? Visit our website! If you don't own a com- If phoning in your order (Charged to one of the aforementioned cards only): Call 530 puter, go to your public library and somebody will be happy to help you log on: www. 885-8183. Have your want list and your charge card handy. We’ll take it from there. ripoffpress.com. After our previous website’s hosting company vanished without a trace We are usually available to answer the phone in person from 7 to 1 and 5 p.m. to 10 in August of 2012, we have not yet gotten online ordering enabled. But you can get a p.m. Pacific time, Monday through Friday. Weekend hours vary. better idea of what you want, then place a mail order from this product listing or from the Adobe PDF format order form available as a download on our home page. Ordering for Delivery Outside the U.S. Payment must be made in US Dollars. Checks or money orders must be payable through a U.S. bank, so charge cards or Paypal are the preferred payment method. We PLACING YOUR ORDER ship via International Priority Mail (First Class on posters), which generally takes a week Sorry, we do not ship C.O.D.! or two to arrive. -

ANANSI FALL 2014 / WINTER 2015 TITLES SCOTT GRIFFIN Chair
Anansi Publishes Very Good Fiction LYNN COADY Scotiabank Giller Prize ANANSI Winner Granta • Portobello KATHLEEN WINTER CBC Canada Reads Finalist RAWI HAGE CBC Canada Reads Finalist Fall 2014/Winter 2015 HOUSE OF ANANSI FALL 2014 / WINTER 2015 TITLES SCOTT GRIFFIN Chair NONFICTION ... 1 SARAH MACLACHLAN President & Publisher FICTION ... 13 ALLAN IBARRA VP Finance ASTORIA (SHORT FICTION) ... 23 MATT WILLIAMS VP Publishing Operations ARACHNIDE (FRENCH TRANSLATION) ... 29 JANIE YOON Senior Editor ANANSI INTERNATIONAL ... 33 JANICE ZAWERBNY Senior Editor, Canadian Fiction SPIDERLINE ... 47 DAMIAN ROGERS Poetry Editor A LIST ... 55 KELLY JOSEPH Managing Editor POETRY ... 59 MEREDITH DEES Editor ERIN MALLORY Manager, Cross-Media Group GRANTA & PORTOBELLO ... 63 ALYSIA SHEWCHUK Designer LONNY KNAPP Print Production Manager SALES INFORMATION ... 76 ERIC JENSEN VP Marketing WWW.HOUSEOFANANSI.COM LAURA REPAS Publicity Director LAURA MEYER Senior Publicist AT WWW.HOUSEOFANANSI.COM YOU CAN: FRED HORLER Marketing Manager • Find books by interest, genre, curriculum, • Read bios, watch videos, and see links to popularity, age, and audience author websites, blogs, and Twitter feeds CAROLYN McNEILLIE Digital Marketing Manager • Preview sample chapters and sample spreads • Access teaching guides, curriculum links, BARBARA HOWSON VP Sales & Rights for illustrated works key industry reviews, and award details ALLISON STEELE Account Manager, International Digital and Print Sales • Take advantage of our one-click shopping • Download reading guides JENNA SIMPSON -
Author List for Advertisers This Is the Master Set of Authors Currently Available to Be Used As Target Values for Your Ads on Goodreads
Author List for Advertisers This is the master set of authors currently available to be used as target values for your ads on Goodreads. Use CTRL-F to search for your author by name. Please work with your Account Manager to ensure that your campaign has a sufficient set of targets to achieve desired reach. Contact your account manager, or [email protected] with any questions. 'Aidh bin Abdullah Al-Qarni A.G. Lafley A.O. Peart 029 (Oniku) A.G. Riddle A.O. Scott 37 Signals A.H. Tammsaare A.P.J. Abdul Kalam 50 Cent A.H.T. Levi A.R. Braunmuller A&E Kirk A.J. Church A.R. Kahler A. American A.J. Rose A.R. Morlan A. Elizabeth Delany A.J. Thomas A.R. Torre A. Igoni Barrett A.J. Aalto A.R. Von A. Lee Martinez A.J. Ayer A.R. Winters A. Manette Ansay A.J. Banner A.R. Wise A. Meredith Walters A.J. Bennett A.S. Byatt A. Merritt A.J. Betts A.S. King A. Michael Matin A.J. Butcher A.S. Oren A. Roger Merrill A.J. Carella A.S.A. Harrison A. Scott Berg A.J. Cronin A.T. Hatto A. Walton Litz A.J. Downey A.V. Miller A. Zavarelli A.J. Harmon A.W. Exley A.A. Aguirre A.J. Hartley A.W. Hartoin A.A. Attanasio A.J. Jacobs A.W. Tozer A.A. Milne A.J. Jarrett A.W. Wheen A.A. Navis A.J. Krailsheimer Aaron Alexovich A.B. Guthrie Jr. A.J.