Arthur Rimbaud
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
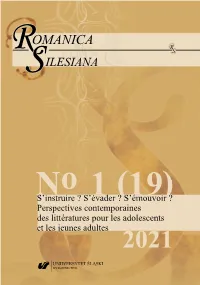
Hunger Games De Suzanne Collins 32
Redaktor naczelny / Rédacteur en chef Andrzej Rabsztyn Recenzenci / Évaluateurs Gerardo Acerenza (Università degli Studi di Trento), Sylvie Brodziak (Université Cergy-Pontoise), Maria Centrella (Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”), Hélène Charderon (Mary Imma- culate College, Limerick), Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński), José Domingues de Almeida (Université de Porto), Youcef Immoune (Université Alger 2), Anna Kaczmarek-Wiśniewska (Uniwersytet Opolski), Ewa Kalinowska (Uniwersytet Warszawski), Dariya Khokhel (Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University), Nawel Krim (Université Alger 2), Olga Kulagina (Université pédagogique d’État de Moscou), Esther Laso y León (Université d’Alcalá, Madrid), Anna Maziarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Svetlana Mikhailova (Moscow City University), Krystyna Modrze- jewska (Uniwersytet Opolski), Isabelle Moreels (Universidad de Extremadura, Cáceres), Adrian Radu (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca), Martine Renouprez (Universidad de Cádiz), Odile Richard- Pauchet (Université de Limoges), Anne Schneider (INSPE Université de Caen-Normandie), Claudia Sousa Pereira (University of Évora), Anita Staroń (Uniwersytet Łódzki), Magdalena Wandzioch (Uniwersytet Śląski, Katowice) Komitet Redakcyjny / Comité de Rédaction Marie-Andrée Beaudet (Université Laval), José Luis Bernal Salgado (Universidad de Extremadura), TÚa Blesa (Universidad de Zaragoza), Philippe Bonolas (Universidade Católica Portuguesa), Manuel Broncano (Universidad de León), Jean-François Durand (Université -

Arthur Rimbaud
PASSION RIMBAUD BIBLIOTHÈQUE DE CLAUDE JEANCOLAS EXPERT EMMANUEL LHERMITTE 7 NOVEMBRE 2016 Préparez-vous à l’inattendu ENCHÉRIR SUR INTERNET Drouot Live www.drouotlive.com ACHETER SUR INTERNET Drouot Online www.drouotonline.com FACILITER VOS ACHATS Drouot Card www.drouot.com/card S’INFORMER La Gazette Drouot www.gazette-drouot.com EXPÉDIER VOS ACHATS Drouot Transport www.drouot-transport.com Hôtel Drouot 9, rue drouot 75009 Paris +33 (0)1 48 00 20 20 [email protected] www.drouot.com © photos Bruno SIMON +33 1 48 00 00 50 [email protected] Ventes aux enchères publiques Drouot richelieu - 9, rue Drouot - 75009 Paris Parking sous l’hôtel des Ventes Drouot-richeLieu Le LuNDi 7 NoVeMBre 2016 SaLLe 11 à 14h PASSION RIMBAUD BIBLIOTHÈQUE DE CLAUDE JEANCOLAS EXPERT Emmanuel LHERMITTE Membre de la Compagnie Nationale des Experts Assisté de Stéphanie MARTIN Expositions publiques Exposition à la librairie Responsable de la vente Samedi 5 novembre de 11h à 18h uniquement sur rendez-vous Géraldine JOST Dimanche 6 novembre de 11h à 18h [email protected] [email protected] Lundi 7 novembre de 11h à 12h 01.40.65.91.11 01 47 70 50 94 Catalogue et photographies en ligne sur ENCHÉRISSEZ SUR Ordres d'achat : www.pescheteau-badin.com Romain CERVELLO www.drouot.com 01 47 70 50 90 - [email protected] PESCHETEAU-BADIN Commissaires-Priseurs OVV n° 2002-312 16, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS Tél. 01 47 70 50 90 - [email protected] Veuillez consulter attentivement les conditions de vente à la fin du catalogue 14 7 novembre 2016 2 Pescheteau-Badin ARTHUR RIMBAUD En début de vacation sera dispersé un ensemble de documents et d'ouvrages sur la vie et l'oeuvre d’Arthur Rimbaud 1. -

Management Et Représentation Enquête Sur Les Représentations Du Management Dans Le Cinéma Français, 1895-2005
UNIVERSITE DE NANTES Institut d’Economie et de Management de Nantes – IAE 2008 THESE pour l’obtention du grade de docteur en sciences de gestion présentée et soutenue publiquement par Eve LAMENDOUR le 8 septembre 2008 Management et représentation Enquête sur les représentations du management dans le cinéma français, 1895-2005 Volume 1 JURY DIRECTEURS DE RECHERCHE Yannick LEMARCHAND , Professeur à l’Université de Nantes, directeur de la thèse Patrick FRIDENSON , Directeur d'études à l’EHESS, co-directeur de la thèse RAPPORTEURS Anne PEZET , Professeur à l’Université Paris-Dauphine Pierre SORLIN , Professeur émérite à l’Université Paris III SUFFRAGANTS Mathieu DETCHESSAHAR , Professeur à l’Université de Nantes Hervé LAROCHE , Professeur à l’ESCP-EAP Béatrice de PASTRE , Directrice des collections aux Archives Françaises du Film, CNC Remerciements Quand arrive le moment d'écrire les remerciements, cela signifie que le travail est fait, que la thèse est écrite. Au moment du bilan, le geste de se tourner en arrière montre à quel point le travail solitaire de recherche et d'écriture exige paradoxalement un engagement collectif en ce sens que cette thèse n'a été possible que grâce à l'aide de nombreuses personnes. Qu'il me soit donné ici le privilège de remercier tous ceux qui ont permis, encouragé, facilité la recherche et l’écriture de ma thèse. Pour leur encadrement avisé, je sais grée à Yannick Lemarchand et à Patrick Fridenson, mes directeurs de thèse. L'enthousiasme originel, la profonde bienveillance, les conseils et relectures attentives de Yannick Lemarchand ont éclairé ce parcours. La présence constructive et la pertinente efficacité de Patrick Fridenson, sa vision pragmatique ont nourri la dynamique de la recherche. -

Neotipografia Material Poetics In
NEO-TIPO-GRAFÍA: MATERIAL POETICS IN THE SPANISH HISTORICAL AVANT-GARDE Zachary Rockwell Ludington Severna Park, Maryland Master of Arts, University of Virginia, 2009 Bachelor of Arts, University of North Carolina at Chapel Hill, 2007 A Dissertation presented to the Graduate Faculty of the University of Virginia in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Spanish, Italian & Portuguese University of Virginia August, 2014 © 2014 Zachary Rockwell Ludington 2 ACKNOWLEDGEMENTS AND DEDICATION I must first extend my warmest thanks to my advisor, Andrew A. Anderson, for his scholarship and for his sharp and supportive critical eye. My work in this dissertation owes a great deal not only to his previous research but also to his helpful comments and his guidance throughout the course of the project. I would also like to thank every member of the Department of Spanish, Italian & Portuguese at the University of Virginia, past and present. I owe specific debts of gratitude to a few friends in the department who have especially enriched my experience during my time at the University, both academically and personally. They are Fernando Operé, David T. Gies, Gustavo Pellón, Randolph Pope, Mané Lagos, Daniel Chávez, Eli Carter, Omar Velázquez Mendoza, Tally Sanford, Shawn Harris, Julia Garner, Luca Prazeres, Diana Arbaiza, Stephen Silverstein, Jülide Etem, Sarah Bogard, Alejandra Gutiérrez, Keith Howard, Tim McAllister, Adriana Rojas Campbell, Gabrielle Miller, Gillian Price, Melissa Frost, and Diana Galarreta. Friends and colleagues outside the department but ever present and interested in my work are Ana Elia García Pérez, Nathan Brown, John Lyons, Paul A. Cantor, Shaun Cullen, Chicho Lorenzo, Tico Braun, Antonio Reyes, Manuela Jiménez, Brian Carr, and Erik J. -

Mise En Page 1
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris Dossier de presse - Avril 2010 SOMMAIRE Informations pratiques p. 2 Communiqué de presse p. 3 Arthur Rimbaud : repères biographiques p. 4 Parcours de l’exposition p. 5 Les origines et l’œuvre p. 5 L’icône p. 7 Les arts vivants, littérature et cinéma p. 9 Dévotions p. 11 L’explosion multimédia et art de la rue p. 12 Le livre p. 13 Autour de l’exposition p. 14 Les images qui ponctuent ce dossier sont disponibles et libres de droits pour la presse dans le cadre de la promotion de cette exposition. Contact : [email protected] 01 44 78 80 46/58 Body rose pour bébé Zazzle (USA), collection Tee-shirt rouge du Parti communiste, cellule particulière, DR, cliché Youngtae. de Charleville, 2007, collection Jean-Charles Bervesseles, cliché Studio Carl Gustin. INFORMATIONS PRATIQUES RIMBAUDMANIA. L’éternité d’une icône 7 mai - 1er août 2010 Du mardi au dimanche, de 13h à 19h Nocturne les jeudis jusqu’à 21h Fermeture les 8, 13 mai et 14 juillet > Galerie des bibliothèques / Ville de Paris 22, rue Malher Paris 4e Métro : Saint-Paul Entrée 4 €. Tarif réduit : 2 € Réservation pour les groupes, scolaires et centres de loisirs : Galerie des bibliothèques : 01 44 59 29 60 [email protected] > Visites commentées par le commissaire de l’exposition : Samedi 22 mai - 14h30 Vendredi 11 juin - 15h30 Samedi 26 juin - 14h30 > Commissaire de l’exposition : Claude Jeancolas Scénographie : Gaëlle Seltzer Graphisme : Christophe Billoret > Contacts presse / Paris bibliothèques Annabelle Allain 01 44 78 80 46 Gérald Ciolkowski 01 44 78 80 58 Visuels sur demande : [email protected] > Coproduction Paris bibliothèques / www.paris-bibliotheques.org Ville de Charleville-Mézières 2 COMMUNIQUÉ DE PRESSE En un siècle, Arthur Rimbaud s’est imposé comme l’un des mythes fondateurs de la culture moderne. -

Bad Blood Ancestry: from Barbarian to Christian
2017 HAWAII UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCES ARTS, HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES & EDUCATION JANUARY 3 - 6, 2017 ALA MOANA HOTEL, HONOLULU, HAWAII BAD BLOOD ANCESTRY: FROM BARBARIAN TO CHRISTIAN KREPPS, MYRIAM PITTSBURG STATE UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGLISH AND MODERN LANGUAGES Dr. Myriam Krepps Department of English and Modern Languages Pittsburg State University Bad Blood Ancestry: From Barbarian to Christian Synopsis: Should we assume that in “Bad Blood” Rimbaud is asserting the Gaul as his authentic historical ancestors? He is not the only Frenchman to have elected the barbarians as his distant relatives, so has the French Republic and its people; for France, the Gaul represent a common chosen ancestry, a unifying symbol. My study concentrates on how Rimbaud, through his narrator’s claim to ancestry, whether singular or plural, barbarian or Christian, shapes his identity, and the identity of his readers. Dr. Myriam Krepps Associate Professor of French Modern Languages Program Coordinator Department of English and Modern Languages Pittsburg State University Bad Blood Ancestry: From Barbarian to Christian When the narrator of Une saison en enfer (A Season in Hell) claims in “Mauvais sang:” “J’ai de mes ancêtres gaulois l’œil bleu blanc, la cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte,”1 should we assume that Rimbaud is asserting the Gaul as his authentic ancestors? Rimbaud is not the only Frenchman to have elected the Gallic barbarians as his distant relatives, so has the French Republic and its people; for 19th-century France, the Gaul represent a common chosen ancestry, a unifying symbol. The French did not always claim the Gaul as their ancestors, and until the nineteenth century, the Francs were the recognized ancestors by the French nobility of the Ancient Régime, while the Gallic ancestry could only be claimed by commoners. -

Les Illuminations D'arthur Rimbaud : Reflexions Sur Neuf Traductions En Anglais (1946-2002)
Edith Cowan University Research Online Theses : Honours Theses 2003 Les Illuminations d'Arthur Rimbaud : Reflexions sur Neuf Traductions en Anglais (1946-2002) Brian R. Rundgren Edith Cowan University Follow this and additional works at: https://ro.ecu.edu.au/theses_hons Part of the French and Francophone Literature Commons Abstract in English, Text in French Recommended Citation Rundgren, B. R. (2003). Les Illuminations d'Arthur Rimbaud : Reflexions sur Neuf rT aductions en Anglais (1946-2002). https://ro.ecu.edu.au/theses_hons/944 This Thesis is posted at Research Online. https://ro.ecu.edu.au/theses_hons/944 Edith Cowan University Copyright Warning You may print or download ONE copy of this document for the purpose of your own research or study. The University does not authorize you to copy, communicate or otherwise make available electronically to any other person any copyright material contained on this site. You are reminded of the following: Copyright owners are entitled to take legal action against persons who infringe their copyright. A reproduction of material that is protected by copyright may be a copyright infringement. Where the reproduction of such material is done without attribution of authorship, with false attribution of authorship or the authorship is treated in a derogatory manner, this may be a breach of the author’s moral rights contained in Part IX of the Copyright Act 1968 (Cth). Courts have the power to impose a wide range of civil and criminal sanctions for infringement of copyright, infringement of moral rights and other offences under the Copyright Act 1968 (Cth). Higher penalties may apply, and higher damages may be awarded, for offences and infringements involving the conversion of material into digital or electronic form. -

GÉRARD LÉVY 17, Rue De Beaune - Paris
GÉRARD LÉVY 17, rue de Beaune - Paris PREMIÈRES ET DERNIÈRES COLLECTIONS ÉVENTAILS • ASIE • PHOTOGRAPHIES Ventes les 1& 2 Juin 2021 PREMIÈRES ET DERNIÈRES COLLECTIONS ÉVENTAILS • ASIE • PHOTOGRAPHIES Mardi 1 Juin 2021 & Mercredi 2 juin 2021 Paris — e Salle VV • 3 rue Rossini – Paris IX — Mardi 1er juin — Éventails – Asie 14h Mercredi 2 juin — Photographie 11h : Livres spécialisés 14h : Photographies — Expositions Vendredi 28 mai de 11h à 18h Samedi 29 mai de 11h à 18h Lundi 31 mai de 11h à 18h Mardi 1er Juin de 11h à 12h — Intégralité des lots sur www.millon.com Département Experts Sommaire ADMINISTRATRICE DE VENTE ÉVENTAILS VENTE DU MARDI 1ER JUIN VENTE DU MARDI 1ER JUIN — — Georgina LETOURMY-BORDIER Aurélie van SAENE Expert SFEP-CEDEA Partie 1 : Eventails Partie 1 : Eventails +33 (0)1 48 00 98 85 Expert près de la Cour d’Appel de Versailles +33 ()6 14 67 60 35 e e [email protected] [email protected] 8 Europe du XVII au XX siècles ASIE ASIE 34 Livres et documentations spécialisées — — Anna KERVIEL Jean GAUCHET [email protected] [email protected] 36 Extrême-Orient TaHsi CHANG +33 (0)1 47 27 93 29 [email protected] Partie 2 : Asie Partie 2 : Asie PHOTOGRAPHIE PHOTOGRAPHIE 47 Asie — — Joséphine BOYER Christophe GŒURY +33 (0)1 87 03 04 70 + 33 (0)6 16 02 64 91 68 Livres et documentations spécialisés [email protected] [email protected] assisté de Nathalie SICLIS COMMISSAIRE-PRISEUR +33(0)6 60 39 61 62 VENTE DU MERCREDI 2 JUIN VENTE DU MERCREDI 2 JUIN — [email protected] Alexandre Millon Photographies Photographies -

La Commission Attire Encore L'attention De L'honorable
C 58 E/8 Journal officiel de l’Union européenne FR 6.3.2004 La Commission attire encore l’attention de l’Honorable Parlementaire sur le fait que les projets financés dans le cadre des Fonds structurels (1) ont souvent une dimension culturelle, y compris la restauration et la mise en œuvre du patrimoine architectural et culturel, la construction d’équipements culturels, la mise en place de services culturels et touristiques et des actions de formation artistiques ou liées à la gestion des activités culturelles. (1) Plus précisément, le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). (2004/C 58 E/008) QUESTION ÉCRITE P-2712/02 posée par María Izquierdo Rojo (PSE) à la Commission (20 septembre 2002) Objet: Prestations sociales en faveur des vendangeurs émigrants espagnols Le nombre de journaliers espagnols qui travaillent actuellement en France pour les vendanges dépasse les quinze mille. En ce qui concerne leurs droits au titre de la législation sociale et de la législation du travail, la campagne actuelle 2002 se caractérise par le fait que «les vendangeurs seront exonérés des cotisations à la caisse de maladie et de vieillesse de la sécurité sociale française»; d’autre part, il est dit clairement dans le feuillet d’information que le ministère du travail espagnol a distribué à ces vendangeurs que «le travailleur doit demander à l’employeur, à la fin du contrat, de lui remettre ses feuilles de paie sur lesquelles doivent figurer les montants des versements de cotisations à la sécurité sociale effectués en sa faveur», ce qui, étant donné les circonstances, sera difficile à réaliser. -

IGNACIO ZULOAGA and the PROBLEM of SPAIN Dena
ABSTRACT Title of dissertation: IGNACIO ZULOAGA AND THE PROBLEM OF SPAIN Dena Crosson, Doctor of Philosophy, 2009 Dissertation directed by: Professor June Hargrove Department of Art History and Archeology This dissertation examines the career of Ignacio Zuloaga (1870-1945), a highly successful and influential artist during his lifetime, in the context of nationalism and the political and cultural conditions that informed his artistic persona. Positioning himself to both Spanish and foreign audiences as the “painter of Spain,” his style and subject matter simultaneously exploited foreign preconceptions about Spain while serving as a lightning rod for the critical nationalist discourse preoccupying Spanish political and cultural leaders during the first decades of the twentieth century. In the 1910s and 1920s the vernacular nationalism he practiced was not opposed to modernism. But by the 1930s, nationalism had become associated with rising fascist movements both in Europe and in Spain. Through a series of case studies this dissertation problematizes the issue of modernism in art and fills an important gap in the study of the critical role of nationalism for the struggle between tradition and modernity in the arts in early twentieth-century Spain. Chapter One examines Zuloaga’s influence in France through his affiliation with a group of French artists known as La Bande Noire and describes his important contribution to the rediscovery of El Greco in the last years of the nineteenth century. Chapter Two explores Zuloaga’s discovery of the province of Castilla in 1898 as a subject for his work. It charts the significance of Castilla for the nationalist project of the Generation of 98 as well as for the regenerationist Institución Libre de Enseñanza (Free Institute of Learning). -

Rimbaud, Vallès, Literary Politics, and the Legacy of the Commune
L’EnfantPeuple: Rimbaud,Vallès,LiteraryPolitics,andtheLegacyoftheCommune = = ATHESISSUBMITTEDTOTHEFACULTYOFTHEGRADUATESCHOOLOF THEUNIVERSITYOFMINNESOTA = BY = RobertA.St.Clair = = = INPARTIALFULFILLMENTOFTHEREQUIREMENTS FORTHEDEGREEOF DOCTOROFPHILOSOPHY = = MáriaMinichBrewer,Advisor BrunoChaouat,CoAdvisor = June2011 Copyright © Robert A. St. Clair, 2011 i Acknowledgements As no order could ever adequately express the importance of their contributions or the extent of my gratitude for their collaboration and support, the following friends, mentors, and family are listed here in no particular order at all. My parents, for making sure I went to college and not out west in a box-car, as initially planned (there are of course more things to thank them for than there are footnotes in the present work, but I’d like to single out this one in the hopes that it will bring a smile to their faces). Judith Preckshot, for her tireless and assiduous efforts when she was the DGS in 2006 to help make sure my dossier d’admission to the University of Minnesota’s French Department was a successful one. I’d like to recognize Judith Preckshot and Eileen Sivert, too, for helping me prepare for the job market by giving me a chance to teach the 3101 course – it was a thrill from start to finish, one that provided invaluable professional experience to a young academic, and the even greater privilege of sharing my work on Rimbaud with the students at the University of Minnesota. Thanks to Dan Brewer for reading a very early version of the work on David’s Bara that figures in chapter 2, and to Dana Lindaman for inviting me to Harvard in the spring of 2010 to share my work on Rimbaud with his poetry class – it proved to be a trip that was both delightful and immensely productive (extra thanks for sharing Charles Marville’s photos of pre-Haussmann Paris). -

Sur Les Oeuvres Complètes De Rimbaud Dans La Pléiade, 2015
Sur les OEuvres complètes de Rimbaud dans la Pléiade, 2015. Des retouches superficielles ou une immense révision ? Takeshi Matsumura To cite this version: Takeshi Matsumura. Sur les OEuvres complètes de Rimbaud dans la Pléiade, 2015. Des retouches superficielles ou une immense révision ?. FRACAS, Groupe de recherche sur la langue et la littérature françaises du centre et d’ailleurs (Tokyo), 2016, 46, pp.1-46. halshs-01379300 HAL Id: halshs-01379300 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01379300 Submitted on 11 Oct 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. F R A C A S numéro 46 le 11 octobre 2016 Groupe de recherche sur la langue et la littérature françaises du centre et d’ailleurs (Tokyo) contact : [email protected] 1 Sur les Œuvres complètes de Rimbaud dans la Pléiade, 2015. Des retouches superficielles ou une immense révision ? Takeshi MATSUMURA Depuis sa première publication en 2009, l’édition des Œuvres complètes de Rimbaud dans la Bibliothèque de la Pléiade1 connaît un succès constant. Elle a été réimprimée trois fois : en 2011, en 2013 et en 2015. Dans l’entretien qu’André Guyaux a accordé le 1er mars 2015 sur le site internet de Jacques Bienvenu (Rimbaud Ivre), il parle brièvement de ces réimpressions.