Accéder Au Livret D'accompagnement
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

In Der Berichterstattung Über Die Anschläge
EINE KONTRASTIVE BEGRIFFSANALYSE DES SPRACHGEBRAUCHS (DEUTSCH UND NIEDERLÄNDISCH) IN DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE ANSCHLÄGE VON BRÜSSEL MIXED METHODS STUDIE AUF BASIS EINES SELBST ERSTELLTEN KORPUS VON DEUTSCHEN UND FLÄMISCHEN ZEITUNGS- UND ZEITSCHRIFTARTIKELN Aantal woorden: 16.706 Lisa De Brabant Studentennummer: 01306076 Promotor: Prof. dr. Carola Strobl Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in het Vertalen Academiejaar: 2017 – 2018 Verklaring i.v.m. auteursrecht De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor(en). Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren. DANKESWORT Diese Masterarbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die Hilfe einiger wichtiger Personen, denen ich hier meinen Dank aussprechen möchte. In erster Linie möchte ich meiner Betreuerin Prof. dr. Carola Strobl herzlich für die wertvolle Hilfe und die unerschöpfliche Geduld danken, denn ohne sie hätte ich es einfach nicht schaffen können. Als ich über bestimmte Sachen zweifelte oder während des Prozesses auf Schwierigkeiten stieß, konnte ich sie immer einfach um Rat beten und mit einer schnellen Antwort rechnen. Auch die Termine im Laufe des Jahres habe ich als sehr angenehm und motivierend erfahren. -

School of Journalism and Mass Communications, Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism
ISIS & NEW MEDIA SCHOOL OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIONS, MASTER OF ARTS IN DIGITAL MEDIA, COMMUNICATION AND JOURNALISM DISSERTATION Modern Terrorism: The Media Representation of ISIS’s Terrorist Activity within 2015- 2016 Papaioakeim Marianthi Supervisor: VamvakasVassilis Assistant Professor Aristotle University of Thessaloniki, 2017 1 ISIS & NEW MEDIA Table of contents Introduction ................................................................................................................................................ 4 Chapter 1. Retrospection of Terrorism ...................................................................................................... 6 1.1 Definitions of Terrorism .................................................................................................................. 6 1.2 A historical Overview ...................................................................................................................... 8 1.2.1 Origins of Terrorism ..................................................................................................................... 8 1.2.2 Waves of Modern Terrorism ........................................................................................................ 9 1.3 Influential Terrorist Groups ............................................................................................................ 9 Chapter 2. The Predominant Terrorist Group ISIS: The activity of ISIS within 2015-2016 ................... 13 2.1 Paris Attacks ................................................................................................................................. -

Open Yazujian Mastersthesis Finaldraft.Pdf
The Pennsylvania State University The Graduate School The College of Information Sciences and Technology A COMPARATIVE SOCIAL NETWORK ANALYSIS OF THE 2008 MUMBAI, 2015 PARIS, and 2016 BRUSSELS TERRORIST NETWORKS A Thesis in Information Sciences and Technology by Tyler J. Yazujian 2017 Tyler J. Yazujian Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science May 2017 The thesis of Tyler J. Yazujian was reviewed and approved* by the following: Peter Forster Senior Lecturer of Information Sciences and Technology Thesis Adviser Jessica Kropczynski Lecturer of Information Sciences and Technology T { Donald Shemanski Professor of Practice of Information Sciences and Technology Andrea H. Tapia Associate Professor of Information Sciences and Technology Head of the Graduate Department in the College of IST *Signatures are on file in the Graduate School ii ABSTRACT This research builds a further understanding about analyses to characterize networks with limited data available. It uses social network analysis to retrospectively compare the networks of the terrorist attacks in Mumbai 2008, Paris November 2015, and Brussels March 2016, to better recognize the roles and positions of the networks’ actors. Expanding on previous analysis of the Mumbai terrorist network, this paper identifies new methods to study dark networks by applying social network analysis to the Mumbai, Paris, and Brussels networks. Three levels of analysis are conducted: (1) an attribute-level correlation to examine correlation between age and organizational role across cells; (2) key player analysis to investigate whether key players share similar roles; and (3) application of structural block models to the networks to identify cellular combat teams. -

Defence Review Was Printed in the Company Printshop
Defence VOLUME 145 Review SPECIAL ISSUE 2017/2 THE CENTRAL JOURNAL OF THE HUNGARIAN DEFENCE FORCES Issued by the HDF Defence Staff HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofi t Közhasznú Társaság takes part in publishing Responsible for the publishing: and distributing the journal. Major General István Szabó Responsible manager: Editorial board Managing director Zoltán Benkóczy Chairman (Editor in Chief): Branch manager: Mihály Vigh Lieutenant General Zoltán Orosz (PhD) Acting Head of editorial staff : Members of the Board: Maj. Gen. (Ret.) János Isaszegi (PhD) Col. Tamás Bali (PhD) Editor of the special issue: Col. János Besenyő (PhD) Col. János Besenyő (PhD) Secretary of the Editorial Board: CPT Róbert Stohl (PhD) Col. (Ret.) Ferenc Földesi (PhD) Language revision: Kosztasz Panajotu (PhD) Col. (Ret.) Dénes Harai (PhD) Brig. Gen. József Koller (PhD) Editorial staff Col. Péter Lippai (PhD) Responsible editor: Zoltán Kiss Col. (Ret) László Nagy (CSc) Proofreading: Boldizsár Eszes Brig. Gen. Romulusz Ruszin (PhD) Design editor: Katalin Dancs Col. Siposné Kecskeméthy Klára (CSc) Editorial Secretary: Anita Szabó Sándor Szakály (DSc ) Telephone: +36 1 459-5355 Rudolf Urban (CSc) (Brno University) e-mail: [email protected] Péter Wagner (PhD) Postal address: 1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b Advisory Board: Defence Review was printed in the company printshop. Ágota Fóris (PhD) The entire content of the journal is accessible on Brig. Gen. Gábor Horváth www. honvedelem.hu Zoltán Kalmár (PhD) Head of Printing offi ce: director Zoltán Pásztor Maj. Gen. Ferenc Korom HU ISSN 2060-1506 Brig. Gen. Imre Lamos Brig. Gen. Imre Pogácsás (Phd) Defence Review is recognised by the Hungarian Academy of István Szilágyi (DSc) Sciences as a category „A” benchmark publication. -

Ein ‚Failed State'?
BELGIEN IN DER DEUTSCHEN PRESSE: EIN ‚FAILED STATE’? EINE FRAMING-STUDIE VON BELGIEN IN DER BERICHTERSTATTUNG NACH DEN TERRORISTISCHEN ANSCHLÄGEN IN PARIS UND BRÜSSEL Aantal woorden: 26 089 Tim Buckens Studentennummer: 01270652 Promotor: Prof. Dr. Ine Van linthout Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in de richting meertalige communicatie Academiejaar: 2016 - 2017 VERKLARING AUTEURSRECHT De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor(en). Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn. VORWORT Bevor ich mit dem Inhalt meiner Masterarbeit anfange, möchte ich einige Leute bedanken, die für das Zustandekommen dieser Studie von wichtiger Bedeutung gewesen sind. Zuerst möchte ich Prof. Dr. Ine Van linthout herzlich für das interessante Thema und die ständige Hilfe und Rat danken, denn ohne sie war diese Studie nicht möglich gewesen. Sie war immer erreichbar, wenn ich bei meiner Forschung Schwierigkeiten begegnete, wodurch meine Fragen jederzeit schnell beantwortet wurden. Das habe ich im vergangenen Jahr immer sehr geschätzt. -

Information Flows of Reporting on Terrorism Attack by Online News Portals
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2017, Vol. 7, Special Issue – Islam and Contemporary Issues) ISSN: 2222-6990 Information Flows of Reporting on Terrorism Attack by Online News Portals Sofia Hayati Yusoffab, Fauziah Hassana, Ainul Azmin Mohd Zaminc aCommunication Program, Faculty of Leadership and Management, Universiti Sains Islam Malaysia bIslamic Science Institute, Universiti Sains Islam Malaysia cKuliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences International Islamic University, Malaysia DOI: 10.6007/IJARBSS/v7-i13/3186 URL: http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i13/3186 ABSTRACT Issues related to terrorism have been reported excessively by the media in order to tell public by giving recent and significant information. Currently, online media are known to be a major source of news as they can provide information without any delayed to ensure the society stay connected with and being informed on the latest issues. Therefore, this article is specially designed to explore on how the main online news portals in Europe (http://www.euronews.com/) and Africa (http://allafrica.com/) report issues on recent attacks in Paris and Mali. The objectives in this article are threefold: to compare the coverage of news reporting; to identify the news sources used and lastly to identify the news themes that emerged in news reporting. To perform this, a qualitative content analysis approach on two different case studies have been employed and all the news samples were analysed using qualitative software namely QSR NVivo 11. The results indicated that Paris attack issues received 25 news coverage compared to Mali attack issues at 19 news coverage. -

Myanmar Holds Election
Page 8 • Terror strike in Paris • COM: Tonga is cool El Gato • Friday,World December 4, 2015 • Los Gatos High School • www.elgatonews.com Tragedy spreads throughout Paris after series of attacks by Jessica Blough and Rowyn Van Miltenburg band Eagles of Death Metal was playing a sold out Hollande has since called a three-month state world have reached out to France, offering their Center Editor and News Editor show when three attackers stormed into the hall of emergency for France. The day after the attacks, support. Monuments ranging from the Sydney Opera On Nov. 13, Paris fell victim to a series of coor- and opened fire on the crowd. Eighty-nine people he deployed ten thousand soldiers throughout Paris House to the Empire State Building temporarily lit dinated terrorist attacks that took the lives of 130 died immediately and ninety-nine were critically and other cities. Hollande also announced that the up their exteriors in red, white, and blue, mimicking people. The attacks occurred at six separate loca- injured. The attackers shouted “Allahu akbar” army, police force, and gendarmerie will all expand the Tricolore to show solidarity with Paris. tions in the city and a suburb, Saint Denis. These and referenced Iraq and Syria, the first evidence in the upcoming year. The European Union has After the attacks, Obama spoke of the attacks attacks come less than a year after two masked that the Islamic State might have a role in the also instituted stricter border controls. The United saying, “Our hearts broke too.” He added, “Nous gunmen targeted Charlie attacks. -
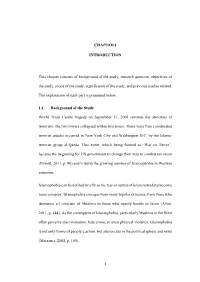
CHAPTER I INTRODUCTION This Chapter Consists of Background Of
CHAPTER I INTRODUCTION This chapter consists of background of the study, research question, objectives of the study, scope of the study, significance of the study, and previous studies related. The explanation of each part is presented below. 1.1. Background of the Study World Trade Centre tragedy on September 11, 2001 reminds the atrocities of terrorism, the two towers collapsed within two hours. There were four coordinated terrorist attacks occurred in New York City and Washington D.C. by the Islamic terrorist group al-Qaeda. This event, which being framed as “War on Terror”, became the beginning for US government to change their way to combat terrorism (Powell, 2011, p. 90) and it led to the growing number of Islamophobia in Western countries. Islamophobia can be defined briefly as the fear or hatred of Islam nowadays become more complex. Islamophobia emerges from many bipolar extremes, from those who denounce all criticism of Muslims to those who openly hostile to Islam (Allen, 2011, p. 144). As the consequent of Islamophobia, particularly Muslims in the West often perceive discrimination, hate crime, or even physical violence. Islamophobia is not only forms of people’s action, but also occurs in the political sphere and news (Marranci, 2004, p. 105). 1 Various forms of Islamophobia are also found in European countries. Muslims often get extra tight examination on immigrations and they are often get complaints about parking during Friday prayers. In German, Muslims are regarded rejecting norms and values and wanting to stay apart from the majority population by their way of life, so that they were called as the “Other” (Congressional Research Service, 2011, p. -

Radicalization Into Salafi Jihadism: Some Patterns and Profiles in Europe 2015–20171
26 Terrorism and Counterterrorism DR 2017/2 Hanga Horváth-Sántha: RADICALIZATION INTO SALAFI JIHADISM: SOME 1 PATTERNS AND PROFILES IN EUROPE 2015–2017 ABSTRACT: Understanding the dynamics, trigger factors and root causes of violent extremism leading to acts of terrorism has been subjected to vast research for the past decade. In this regard, the notion of radicalisation has been especially debated and contested by various researchers, leaving one sole ground to base all other theories upon: there is not one single pathway to terrorism, but there are many and the root causes vary heavily. Whilst radicali- sation may occur among various ethnic and religious groups, this article will specifically focus on radicalisation processes leading to violence-promoting Islamist extremism (Salafi- Jihadism) in the European context and will be delimited to the examination of persons who have committed crimes of terrorism in Europe during the past two years. The reason for this rather slim scope is to examine whether the different types of acts of terrorism and the radicalisation processes behind (as far as they are known) differ from earlier experience with this type of violent extremism in European states with regard to the significantly shrunken time of the radicalisation process, the modus operandi, the selection of targets and the po- tentially different motives. The fact that some of the perpetrators entered Europe as asylum seekers and supposedly became radicalised on their way or upon arrival to the host society makes the issue even more delicate, however, so far they constitute a group neither to be underestimated, nor overestimated. The article attempts to increase the understanding of the phenomenon of violent radicalisation in the light of the recent Jihadist-inspired attacks. -

IS Jihadists Claim Paris Attacks That Killed
SUBSCRIPTION SUNDAY, NOVEMBER 15, 2015 SAFAR 2, 1437 AH www.kuwaittimes.net Arabic Israel razes Egypt’s woes Russia pays threatened by homes of four erode Sisi’s doping dominance Palestinians image of price with of English5 in West8 Bank invincibility IAAF ban IS jihadists 15claim Paris18 Min 11º Max 25º attacks that killed 128 High Tide 00:18 & 14:14 France vows ‘merciless’ response • Concert hall, stadium, cafes targeted Low Tide 07:40 & 19:33 40 PAGES NO: 16698 150 FILS PARIS: Islamic State jihadists yesterday claimed a series of coordinated attacks by gunmen and suicide bombers in Paris that killed at least 128 people in scenes of car- nage at a concert hall, restaurants and the national stadi- um. French President Francois Hollande also blamed the Islamist extremist group for the bloodshed and called the coordinated assault on Friday night at six different sites an “act of war”. Authorities identified the body of a French national known to the intelligence services near the Bataclan con- cert hall, where 82 people were killed by armed men who had shouted “Allahu akbar” (“God is greatest!”) before gunning down concert-goers. Police sources said he was probably one of those who stormed the building as around 1,500 people were watching a Californian rock band. The discovery of Syrian and Egyptian passports near the body of other of assailants appeared to justify fears over the threat posed to Europe by extremism in the Middle East. SEE PAGES 10, 11, 14, 20 & 40 The attacks, which saw the first-ever suicide bombings on French soil, were “prepared, organized and planned overseas, with help from inside (France) which the inves- tigation will establish,” Hollande said. -

Leseprobe Aus
Leseprobe aus: ISBN: 978-3-644-90416-3 Mehr Informationen zum Buch finden Sie auf www.rowohlt.de. Inhalt Motto Personen, Ort und Zeit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. «Furcht ist durchaus nicht die Furcht, welche uns das bevorstehende Übel eines andern, für diesen andern, er- weckt, sondern es ist die Furcht, welche aus unserer Ähn- lichkeit mit der leidenden Person für uns selbst entspringt; es ist die Furcht, dass die Unglücksfälle, die wir über diese verhänget sehen, uns selbst treffen können.» (Gotthold Ephraim Lessing, Hamburger Dramaturgie) 4 ARMIN EVA GÖTTINGER MICHAILOV TARTINI ORT, eine Stadt. Verregnete Gassen, finstere Ecken, damp- fende Bars. Dazwischen Lagerhallen, billige Hotels, alte Keller, die Kanalisation darunter. Durchzogen von Bahn- trassen, Autotunnels, Frachthäfen. Im Zentrum grelles Licht, Promenaden der Sichtbarkeit. Am Rande, abgehängt, ein Haus. ZEIT, eine Silvesternacht. Und in Rückblenden die letzten zweieinhalb Jahre. 5 1. DICH ZU VERLIEREN. AN EINEM ABEND, WO ICH WART, UND DU KOMMST NICHT. DIE ZEIT, DIE ZU LANG WIRD. ALLEIN. DIESE ZEIT IST NICHTS FÜR ASTHMA- TIKER. DIESE ZEIT IST NICHTS FÜR HERZ-KREISLAUF- SCHWÄCHEN. BRAUCHST DIE LUFT, SONST KOLLA- BIERST, IN ALLEN BEREICHEN. BIS REIN INS EIGENE FLEISCH, WER WEISS DENN SCHON , WIE LANG SEIN KÖRPER? DER KOLLAPS. UND DIE ARBEIT ZU VERLIE- REN. WENN MAN DAVON AUSGEHT, DASS ÜBERALL , DER ABBAU, DIE KONKURRENZ, DEIN BILDUNGSNI- VEAU, WAS, WENN DIE ABTEILUNGSLEITUNG DICH ZUM GESPRÄCH. -

Qui Est Vraiment Salah Abdeslam
L’ANALYSE DE SA CAVALE ET LA LECTURE DES LETTRES qu’il envOIE QUI EST DE PRISON RÉVÈLENT LE VRAI VISAGE DU TERRORISTE Du 13 NOVEMBRE Au lendemain de son arrestation, il s’était engagé à livrer les secrets de la préparation des attentats. Puis il a changé d’avis. L’homme, VRAIMENT scruté 24 heures sur 24 par des caméras dans sa cellule de Fleury- Mérogis, garde obstinément le silence. Pourtant l’enquête avance. Les policiers peuvent aujourd’hui reconstituer précisément le parcours et le rôle de celui qui a été bien plus qu’un simple logis- SALAH ticien. Délinquant au casier judiciaire chargé de 12 infractions, trafiquant de haschisch, amateur de boîtes de nuit autant que de cercles de jeu, et finalement terroriste censé se faire exploser. Si le détenu le plus surveillé de France se tait, cela ne l’empêche pas ABDESLAM d’écrire. Et de livrer de lui-même le portrait d’un homme fanatisé. Le 18 mars 2016, une heure et demie après son arrestation, Salah Abdeslam (en médaillon), blessé au genou, a été transporté dans une école de Molenbeek pour recevoir les premiers soins. Le 15 mars 2016, Salah Abdeslam (en médaillon), traqué par la police, s’enfuit à travers les jardins en franchissant une palissade. Il est photographié par une voisine. Une lettre qui vaut profession de foi. Cet écrit non daté, versé au dossier d’instruction « cceptez-vous aujourd’hui de répondre aux questions ? le 11 octobre 2016, – Non, je désire garder le silence. est la réponse de Salah IL REFUSE DE PARLER – Encore une fois, pouvez-vous dire pour quelles rai- Abdeslam à Aline C.