Il Était Une Gare… »
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

De Saint Charles À L'estaque, Marseille Ferroviaire »
Alterrandonnée n°25 23 Septembre 2018 « De Saint Charles à L’Estaque, Marseille ferroviaire ». par Pierre Lémery-Peissik DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 RENDEZ-VOUS À 9H00 Alterrandonnée Attac Marseille n°25 : « De Saint Charles à L’Estaque, Marseille ferroviaire » L’Alterrando qui vous est proposée vous emmènera de Marseille St Charles à Marseille Blancarde, La Joliette, L’Estaque et La Nerthe, pour vous donner un aperçu de l’histoire ferroviaire de Marseille. Quelques mots d’introduction Les chemins de fer ont commencé à susciter l’intérêt de l’Etat, des commerçants, industriels à partir des années 1820 avec l’apparition de premières lignes en Angleterre, à traction hippomobile au départ. En France, les premières lignes ouvrent en 1827, et la première ligne exploitée à l’aide de machines à vapeur est inaugurée en 1837 (Paris – St Germain en Laye). La loi Legrand du 11 juin 1842 relative à l’établissement de grandes lignes de chemin de fer dresse la liste des lignes à construire dont une ligne se dirigeant de Paris « Sur la Méditerranée, par Lyon, Marseille et Cette ». est approuvé par le Conseil général des Ponts et Chaussées le 12 décembre de la même année. Plusieurs tracés étaient en concurrence ; pour faire simple un tracé par Salon de Provence, un passant par la Côte Bleue pour éviter un tunnel trop long et le projet porté par Paulin Talabot, passant par Tarascon et Arles. Le projet via Salon était quant à lui porté notamment par un ingénieur suisse, Franz Mayor de Montricher, surtout connu à Marseille pour la réalisation du Canal de Marseille. -

Paulin TALABOT
Cet ingénieur participe à l’essor du chemin de fer français et dirige la prestigieuse compagnie P.L.M. S’intéressant à la finance, il contribue à fonder le Crédit Lyonnais et la Société Générale. Paulin TALABOT (François Paulin Talabot) Né le 18 août 1799 (1er fructidor an VII de la République) À six heures du matin à Limoges 87 Haute-Vienne Selon acte n°323 source : Archives municipales de Limoges Décédé le 21 mars 1885 à Paris Polytechnicien à l’étroit, dans l’administration A sa naissance, François dit Paulin est le quatrième des huit enfants de François Talabot qui est un bourgeois et un notable de Limoges. En effet, il est avocat au parlement de la ville avant de devenir président de son tribunal civil pendant vingt ans. Ingénieur polytechnicien à 20 a ns, (5e sur 82), Paulin opte pour l’école d’application des Ponts et Chaussées où il restera jusqu’en 1931, dans des postes divers dont le dernier lié à la construction du canal latéral à la Loire. Mais ces missions impatientent sans doute ce talentueux polytechnicien qui dira plus tard : l'Etat m'a fait compter et mesurer des pavés ou des tas de cailloux sur les routes... Les enjeux économiques de l’époque, révèlent ses talents de capitaine d’industrie En 1831, il quitte définitivement l’Administration pour entrer à la Compagnie du Canal de Beaucaire (Beaucaire- Aigues-Mortes) afin de développer les houillères d’Alès. Trois ans plus tard, Paulin Talabot devient le gérant de la Société des Mines de la Grand-Combe et des Chemins de Fer du Gard qu’il a contribué à mettre en place. -

Bulletin De La Sabix, 42 | 2008 Les Polytechniciens Et L’Aventure Saint-Simonienne 2
Bulletin de la Sabix Société des amis de la Bibliothèque et de l'Histoire de l'École polytechnique 42 | 2008 Regards sur l'École polytechnique au XIXe siècle Les polytechniciens et l’aventure saint-simonienne Jean-Pierre Callot Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/sabix/131 DOI : 10.4000/sabix.131 ISSN : 2114-2130 Éditeur Société des amis de la bibliothèque et de l’histoire de l’École polytechnique (SABIX) Édition imprimée Date de publication : 1 avril 2008 Pagination : 40-51 ISBN : ISSN N° 2114-2130 ISSN : 0989-30-59 Référence électronique Jean-Pierre Callot, « Les polytechniciens et l’aventure saint-simonienne », Bulletin de la Sabix [En ligne], 42 | 2008, mis en ligne le 31 août 2009, consulté le 08 septembre 2020. URL : http:// journals.openedition.org/sabix/131 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sabix.131 Ce document a été généré automatiquement le 8 septembre 2020. © SABIX Les polytechniciens et l’aventure saint-simonienne 1 Les polytechniciens et l’aventure saint-simonienne Jean-Pierre Callot NOTE DE L’ÉDITEUR Publié dans La Jaune et la Rouge (la revue des anciens élèves de l’Ecole polytechnique), septembre et octobre 1964. 1 Evoquer le rôle des polytechniciens dans la grande aventure saint-simonienne, animer un moment les silhouettes d’antiques qu’estompe un oubli immérité, tel est le but que je me suis proposé dans les quelques pages qui suivent. 2 Lorsque mourut le comte de Saint-Simon, le 19 mai 1825, après une vie traversée d’aventures et terminée dans la misère, c’est un groupe de disciples bien clairsemé qui suivit son corps jusqu’au cimetière du Père-Lachaise. -

Rapport Général Tome III Annexe 20
N° 101 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1993 - 1994 Annexe au procès-verbal de la séance du 22 novembre 1993 . RAPPORT GÉNÉRAL <0 FAIT au. nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1 ) sur le projet de loi de finances pour 1994 ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, Par M. Jean ARTHUIS , j ■ Sénateur , Rapporteur général. 1 TOME in LES MOYENS DES SERVICES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES (Deuxième partie de la loi de finances) il } ANNEXE N° 20 ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET TOURISME II. Transports : 2. Routes 3. Sécurité routière Rapporteur spécial : M. Paul LORIDANT (1 ) Cette commission est composée de : MM . Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel , Paul Girod, Jean Clouet, Jean - Pierre Masseret, vice-présidents ; Jacques Oudin , Louis Perrein, François Trucy , Robert Vizet, secrétaires ; Jean Arthuis , rapporteur général ; Philippe Adnot, René Ballayer, Bernard Barbier, Claude Belot, Mme* Maryse Bergé-Lavigne , MM. Maurice Blin , Camille Cabana , Ernest Cartigny , Auguste Cazalet, Michel Charasse , Jacques Chaumont, Henri Collard, Maurice Couve de Murville, Pierre Croze, Jacques Delong, Mme Paulette Fost, MM . Henri Goetschy , Emmanuel Hamel, Alain Lambert, Tony Larue, Paul Loridant, Roland du Luart, Michel Manet , Philippe Marini , Michel Moreigne, Jacques Mossion, Bernard Pellarin, René Régnault, Michel Sergent , Jacques Sourdille , Henri Torre, René Trégouët, Jacques Valade. Voir les numéros : Assemblée nationale ( 10e législ.) : 536, 580, 585 et T.A.66 . Sénat : 100(1993-1994). Lois de finances . -2- SOMMAIRE Pages PRINCIPALES OBSERVATIONS -T. .... : 5 i CHAPITRE PREMIER : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES CRÉDITS il 1 . Les changements de structure 12 /> . " 2 . Le développement du réseau routier 13 3 . -

L'étude Des Ateliers Sncf D'arles Par L'inventaire
L’ÉTUDE DES ATELIERS SNCF D’ARLES PAR L’INVENTAIRE GÉNÉRAL En 2005, alors que s’engageaient les projets de reconversion sur la partie ouest des Ateliers SNCF à Arles, le service de l’Inventaire général a conduit une opération d’urgence pour constituer une documentation la plus complète possible sur l’état des Ateliers avant les premières transformations. Ce site méritait à plus d’un titre une enquête de ce type. Les Ateliers SNCF d’Arles occupent en effet une place importante dans l’histoire du chemin de fer français. Site ancien, remontant aux premières années du développement du rail en France ; site important, illustrant les installations d’une des plus emblématiques compagnies ferroviaires, celle du Paris-Lyon-Méditerranée, il offre un témoignage passionnant de la constitution de cette compagnie puisque chaque fusion des compagnies précédentes a laissé sa trace dans l’aménagement des onze hectares qui lui ont été consacrés. Vue aérienne des Ateliers peu avant leur fermeture Les Ateliers SNCF méritent en outre de figurer en bonne place dans une présentation du patrimoine de la ville d’Arles. Connue pour ses monuments représentatifs de presque toutes les périodes de son histoire, la ville peut aussi s’enorgueillir de posséder, avec ces ateliers, un exemple très intéressant d’architecture industrielle du XIX e siècle. Il faut également rappeler que ce site est aujourd’hui la trace, ô combien visible dans le tissus urbain, d’une histoire, celle du chemin de fer, qui a contribué à façonner le visage actuel de toute l’agglomération, et qu’il fut son poumon économique pendant plus de cent ans, favorisant l’émergence d’une mémoire ouvrière encore vive aujourd’hui. -

3.6.6 Schéma Directeur Cyclable De Valence-Romans Déplacements
3.6.6 Schéma Directeur Cyclable de Valence-Romans Déplacements Priorité 1 : Les itinéraires prioritaires, objectifs : la continuité cyclables inter et intra pôles centraux La liaison Valence-Romans (itinéraire n°1) est un axe majeur dans l’organisation du territoire. Elle répond aux déplacements Valence-Romans Déplacement réalise des préconisations techniques pour l’aménagement des voies cyclables et définit en effectués quotidiennement entre les deux principaux espaces urbains et les différentes zones d’activités avec notamment la étroite collaboration avec l’ensemble de ces partenaires des orientations et objectifs à atteindre. gare TGV sur la zone de Rovaltain. Afin d’obtenir un réseau cyclable continu et homogène sur l’ensemble du territoire, Valence Romans Déplacements a défini des itinéraires cyclables à aménager en priorité. Ces priorités pourront être affinées dans le cadre de la mise en œuvre du Priorité 2 : les itinéraires secondaires, objectifs : les continuités cyclables intra pôles secondaires Schéma, notamment en fonction des opportunités d’aménagements. Ces itinéraires ont pour vocation de relier les pôles secondaires (communes périurbaines). La majorité de ces itinéraires sont dédiés aux déplacements domicile/loisir avec notamment les itinéraires en projet de la Véloroute et voie verte (VVV) Vallée de l’Isère (itinéraire n°7), la VVV du Piedmont (itinéraire n°8) et la VVV de la vallée de l’Herbasse (itinéraire n°9). Priorité 3 : les itinéraires complémentaires, objectifs : les continuités cyclables inter pôles complémentaires Ces itinéraires sont complémentaires aux itinéraires cyclables secondaires. La majorité de ces itinéraires sont dédiés aux déplacements de loisirs Zone d’étude Zone d’étude Figure 75 : Schéma de principe des itinéraires cyclables (source : VRD) La liaison Valence-Romans (itinéraire n°1) concerne le carrefour des Couleures. -

Acteurs Et Effets Gastronomiques Sur La Route Nationale 7 Kilien Stengel
Acteurs et effets gastronomiques sur la Route Nationale 7 Kilien Stengel To cite this version: Kilien Stengel. Acteurs et effets gastronomiques sur la Route Nationale 7. Actes du colloque Nationale 7 ! De la route antique à la route du futur, t.88, 2019, Mémoires de la Société académique du Nivernais. hal-02124033 HAL Id: hal-02124033 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02124033 Submitted on 20 May 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU NIVERNAIS Actes du colloque Nationale 7 ! De la route antique à la route du futur TOME LXXXVIII 2019 MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU NIVERNAIS TOME LXXXVIII 2019 Actes du colloque Nationale 7 ! De la route antique à la route du futur Tenu à Nevers au Palais ducal les 25 et 26 mai 2018 Société académique du Nivernais 11 bis, rue Gresset 58000 NEVERS Adresse électronique : [email protected] Association reconnue d'utilité publique1 par décret du 21 août 1911 Éditeur Directeur de la publication Société académique du Nivernais 11 bis rue Gresset, 58000 Nevers Maquette Anne-Marie Chagny-Sève avec le concours d’Élisabeth Barreau Impression Bernard-Noël Chagny Dépôt légal : ISSN 0181-0561 Imprimerie Saviard, 58660er Coulanges-lès-Nevers 1 trimestre 2019 Mémoires La publication de ce tome des a été rendue possible grâce à l'aide du ministère de la culture (Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté), de la Ville de Nevers et du Conseil départemental de la Nièvre que nous remercions très vivement. -

150 Éve Adták Át a Szuezi-Csatornát Az Ókori Csatorna
150 éve adták át a Szuezi-csatornát Dr. Nagy László BME 2019. november 17-én 150 éves a Szuezi-csatorna. Csaknem négyezer év jelenti a Földközi- és Vörös-tenger összekapcsolásának a történelmét. A csatorna terve már az ókorban foglalkoztatta az uralkodókat. Az ókor tudós mérnökei azonban nem egy észak–déli csatorna tervét készítették el, hanem egy nyugat–keleti irányban húzódó csatornáét, amely a Nílus egy új mellékága lett a delta keleti részén, a Vádi Tumiláton keresztül. Bár jó néhány kísérlet történt a helyreállítására, az ókori csatorna azonban többször eliszaposodott, tönkrement. A források szerint i.e. 767-ig többé-kevésbé használatban volt. Az 1840-es években egy észak-déli csatorna megépítésével javasolták a víziút kialakítását. A technikai fejlődés, a politikai lehetőség és nem kis részben a személyes kapcsolatok jelentették ennek a műszaki „csodának“ a megvalósíthatóságát. Talán kevés olyan műszaki létesítmény van, amelyik ilyen nagy hatással lett volna a Földi viszonyokra, és ilyen sok „törődést” igényelt volna. Fitzgerald 1876-ban megjelent könyvében azt írta, hogy a Szuezi nagy csatorna politikai, mérnöki és pénzügyi történet. Ez a megállapítás több, mint száz évvel később is igaz, ennek a hármas tagozódásnak a kialakulását szeretném bemutatni jelen tanulmányban. A szuezi földszoroson át a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő csatorna gondolata már az ókorban felmerült. A Szuezi-csatorna1 a Sínai-félsziget nyugati részén2 épült tengeri csatorna. Hossza 193,3 km, a legkeskenyebb részén 300 m széles. Ez a mesterséges vízi út Egyiptomban a Földközi-tengeri Port Said és a Vörös-tengeri Szuez városokat köti össze. A csatorna észak-déli irányú vízi szállítást tesz lehetővé Európa és Ázsia között Afrika megkerülése nélkül. -
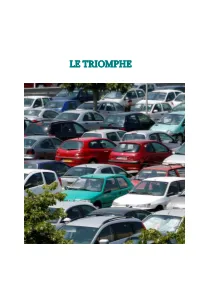
LE TRIOMPHE Table Des Matières
LE TRIOMPHE Table des matières Le triomphe - La démocratisation de l’automobile - L’automobile métamorphose le réseau routier - L’autoroute - La circulation urbaine - Le stationnement - L’automobile remodèle la ville - L’automobile à l’origine de la ville polycentrée - L’automobile au secours du haut-pays L’autoroute A8 dans la plaine du Var, 2008 La démocratisation de l’automobile le trafic des voitures à traction animale Très tôt, un des objectifs des s’effondrait pour les marchandises (130, 99 constructeurs automobiles fut la recherche et 48) et tendait à disparaître pour les d’une réduction du prix pour s’assurer une voyageurs (177, 137 et 5). plus large clientèle. L’Américain Ford initia le mouvement en construisant à partir de 1908, à grande échelle, une voiture simple de conception et légère mais confortable, la Ford T, abandonnant le concept initial de la voiturette dont le châssis non carrossé, restait d’un prix élevé. En France, c’est André Citroën qui le premier en 1919 reprit le système de fabrication américain à la chaîne réduisant le coût de production grâce à la rapidité et à l’efficacité d’un travail répétitif ininterrompu imposé par la cadence du défilement du tapis. On pouvait ainsi livrer 2 CV Citroën sur une publicité Castrol, 1957 au client un modèle unique de voiture, prête à rouler, avec châssis, carrosserie et L’influence de l’automobile sur tous les perfectionnements tels l’évolution de la société et des mentalités qu’éclairage et démarreur électriques. avait déjà été ressentie par Ernest Laut en Les délivrances des certificats de 1924(17). -

Chronologie Détaillée, Expliquée Et Extensive Du Saint-Simonisme
Chronologie détaillée, expliquée et extensive du saint-simonisme Nature et origine du fichier La version qu’on va consulter ici de la chronologie du saint-simonisme est une version d’essai. Elle est destinée à être, dans quelques années, remplacée par une version expurgée de ses probables erreurs et, surtout, enrichie de nouveaux dépouillements. Ce document prend place dans le volet éditorial du projet SAINT-SIMONISME18-21 soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Il est mis à la libre disposition de tous, sous la seule condition, pour tout usage public, d’une mention de son origine. Son auteur scientifique est Philippe Régnier, directeur de recherche émérite à l’IHRIM, qui l’a conçu et réalisé dans le cadre du volet éditorial du projet de recherche ANR SAINT- SIMONISME 18-21. La mise en forme et la table interactives ont été réalisées par Isabelle Treff, ingénieure à l’IHRIM. Les sources Il n’est fort heureusement pas toujours nécessaire de recourir aux sources primaires, que constituent, en l’occurrence, pour l’essentiel, les originaux des correspondances conservées. De nombreuses dates proviennent du corpus historique élaboré par Enfantin et les siens, forts de leur accaparement du nom de Saint-Simon, soit le Calendrier saint-simonien, les Archives copiées et annotées sous la direction d’Enfantin en 1832 et 1833, les Notices historiques (en fait, les biographies respectives de Saint-Simon et d’Enfantin) écrites par ses exécuteurs testamentaires (Fournel et Laurent principalement) en accompagnement de leur édition des Œuvres de Saint-Simon et d’Enfantin, de la Correspondance inédite d’Enfantin, les rapports ou récits d’acteurs et de témoins, comme les Souvenirs d’une fille du peuple, ou la saint-simonienne en Égypte, de Suzanne Voilquin, sans oublier les maîtres ouvrages écrits par Charléty et d’Allemagne, dans la large mesure où ils sont eux aussi centrés sur la personne du « Père ». -

Informations & Réflexes
c d e INFORMATIONS f g h & RÉFLEXES i k l PRÉVENTION : QUE FAIRE FACE AUX m n o RISQUES MAJEURS ? p q r t à con n s e e r s t u m v u e DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL c r o SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM) D v a w édition 2016 Madame, Monsieur, P4 Entre le fleuve et le bois de Saint-Eutrope, chargée notamment de : l’alerte à la po- Panorama des risques majeurs à Ris-Orangis sur les flancs de la vallée de la Seine et au pulation, la mise à l’abri et l’hébergement cœur du sud du Grand Paris, notre ville d’urgence, ainsi que la communication de P5 bénéficie d’une situation géographique crise jusqu’au retour à la normale. exceptionnelle qui font son identité et Comment êtes-vous alerté en cas de danger ? son attractivité. Une localisation qui nous Pour cette raison, Ris-Orangis a élaboré oblige cependant à anticiper les risques un Plan communal de sauvegarde (PCS). P6 naturels et industriels pouvant exception- Ce document fait un diagnostic complet Les inondations nellement nous impacter. des risques et établit des procédures adap- tées à un grand nombre de scénarios. Ce Si ces événements restent rares, nous document est consultable en mairie et sur SOMMAIRE P8 savons que le risque zéro n’existe pas. Il le site internet de la ville. Les risques industriels nous faut donc, sans céder à la panique, anticiper leurs conséquences par des me- Afin d’informer avec précision les Ris- P10 sures préventives (règles d’urbanisme, mo- sois-es des mesures de prévention et des Les mouvements de terrain dernisation de nos réseaux, exercices,…) gestes à adopter, j’ai souhaité, avec mon et la définition de procédures adaptées adjoint chargé de l’Environnement, du en cas d’incident. -

Extrait De L'histoire DE NÎMES D'adolphe Pieyre, 1886 Urbanisme, Voirie, Évènements
Extrait de l'HISTOIRE DE NÎMES d'Adolphe Pieyre, 1886 Urbanisme, voirie, évènements PRÉFACE DE L'ÉDITION, NEMAUSENSIS L'historien Adolphe Pieyre a fait un incroyable travail de collecte historique sur une période allant de 1831 à 1885. Avec cette édition de l'Histoire de Nîmes en 3 volumes, il nous a transmis le fruit de ses recherches. Il est bien dommage qu'il ait noyé les renseignements collectés en y ajoutant des pages entières concernant l'histoire de France. Autre fausse note, avec ses longs et lourds commentaires engagés, il a détourné de nombreux lecteurs de l'intérêt qu'ils auraient pu avoir sur son véritable travail de recherche. Tout cela a contribué à dénaturer l'image d'un travail méticuleux et très bien référencé. De nombreux chercheurs et amoureux de l'histoire de Nîmes se sont détournés de ses écrits, ces derniers étant considérés comme œuvres mineures. Par la force des choses, au cours de nos travaux de documentation, les 3 volumes de l'Histoire de Nîmes d'Adolphe Pieyre sont devenus pour nous une référence incontournable. Lors de nos recherches aux Archives Municipales nous avons découvert, à la lecture des Délibérations du Conseil Municipal, l'essentiel de la documentation source de cet historien. Ses écrits, tirés de sources méticuleusement relevées, enrichis par des articles de presse d'époque ainsi que par des témoignages de personnes ayant vécu ces événements, n'ont fait que renforcer notre conviction sur la qualité cachée de son travail. Par cette présente édition, expurgée de tout ce qui est hors sujet local, et commentaires politiques, nous avons voulu vous faire partager, de façon plus digeste, l'œuvre d'Adolphe Pieyre.