Environnement Projet Tram Mostaganem
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Du Corps Electoral
éflexionSi vous aimez la liberté Payez-en le prix QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION Lundi 16 Septembre 2019 N° 3370 12ème année Prix 20 DA www.reflexiondz.net AUTORITE INDEPENDANTE DES ELECTIONS APRES UNE LONGUE HIBERNATION L’ex-ministre de Belkhadem, la justice Chorfi candidat du FLN à élu président P 4 la présidentielle ?! P 2 BENSALAH SIGNE LES LOIS RELATIVES A LA TENUE DE CONVOCATIONL’ELECTION PRESIDENTIELLE DU CORPS ELECTORAL Tout est fin prêt pour l’élection présidentielle, Bensalah a signé les deux lois organiques relatives à la création de l’autorité de surveillance et d’organisation de la présidentielle, avec comme couronnement la convocation du corps électoral. P 3 RENTREE UNIVERSITAIRE 2019-2020 A MOSTAGANEM L’UNIVERSITE RENFORCE SES CAPACITES D’ACCUEIL Le recteur de l’Université ‘’Abdelhamid Benbadis’’, le professeur Mustapha Belhakem, a révélé récemment que, pour l’année universitaire 2019-2020, l’université s’apprête à accueillir près de 4940 nouveaux étudiants en « Master »se sont présentés dont 4543 viennent ont été confirmés, a-t-il précisé. Lire page 7 éflexionSi vous aimez la liberté Payez-en le prix dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION NNoonn Lundi 16 Septembre 2019 2 BELKHADEM, CANDIDAT DU Moul FLN À LA PRÉSIDENTIELLE ?! Firma Selon le site ‘’El Massar news’’, le retour d’Abdelaziz Bel- khadem s’annonce en grandes pompes, ce dernier est proposé comme candidat pour la prochaine élection présidentielle. Toujours selon le site, M. Mohamed Dje- mai, l’actuel secrétaire général remue ciel et terre pour le soutenir et le propulser en tant qu’unique candidat du parti. Notons que M.Belkha- dem s’est éclipsé de la scène politique depuis le 26 août 2014 où l’ex- président Abde- laziz Bouteflika a mis fin par décret à ses fonctions en qualité de ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République ainsi qu'à toutes ses activités en re- lation avec l'ensemble des structures de l'État. -

Cap Sur La Préservation De L'environnement: Toute L'actualité
L’Algérie profonde / Actualités Secteur des travaux publics à Mostaganem Cap sur la préservation de l’environnement Les pneus usagés au lieu de s’en débarrasser à tort et à travers dans la nature sont récupérés pour soigner les accotements des routes. L’initiative louable, baptisée opération pneus-sol, revient aux services du département de Amar Ghoul qui a effectué, mercredi passé, une visite de travail et d’inspection à travers la wilaya de Mostaganem. L’expérience a été tentée dans un premier temps à Tipasa, et les services en question viennent de la rééditer à Mostaganem où une “montagne” de pas moins de six mille pneus usagés ont été utilisés pour “soigner” les accotements en pente de la déviation desservant la localité de Benabdelmalek Ramdane. Le ministre des Travaux publics a manifesté sa pleine satisfaction quant à l’efficacité du projet. La technique, qui n’a rien d’extraordinaire, contribue à améliorer l’entretien des routes, tout en participant à la préservation de l’environnement. Elle est destinée à renforcer, consolider et stabiliser les talus et les remblais le long des nouveaux tronçons routiers réalisés. Pour le ministre des Travaux publics, qui s’est déclaré particulièrement attache au volet esthétique et à la préservation de l’environnement, la technique pneus/sol, appelée à la généralisation, s’inscrit dans le cadre de la vision futuriste du secteur, en plus du “simple” développement du réseau routier et de l’amélioration de la qualité des routes et de la signalisation routière allant de pair. Tout au long des dix haltes qu’il a marquées au cours de son périple à travers la wilaya de Mostaganem, le représentant du gouvernement n’a pas cessé d’insister sur les travaux d’accompagnement devant sous-tendre les projets de réalisation d’infrastructures par les aménagements des “des abords des routes et autres ouvrages d’art, notamment par la plantation d’arbres et la mise en place de canaux pour l’acheminement des eaux pluviales. -

Consolidation “Avant Fin Août” De Tronçons De 3 Routes Nationales
TRIDesB ULecteursNE TRDesIB LecteursUNE Contribution Quotidien national d’information Lundi 10 juin 2019 Régions Quotidien national d’information Lundi 10 juin 2019 MILA KHENCHELA FACE À L’IMPASSE POLITIQUE 2,75 milliards DA Consolidation “avant fin août” de pour les POS Sept scénarios possibles Une enveloppe financière de 2,75 milliards DA a été octroyée Professeur des universités, du Sénat étant intérimaire, selon chistes , des gauchistes, des ultra mique et sociale et la réforme de de transition que certains propo- pour les plans d’occupation du sol expert international la constitution , serait ipso facto le droitistes, des libéraux modérés Sonatrach lieu de production de la sent, le temps ne se rattrapant tronçons de 3 routes nationales (POS) dans la wilaya de Dr Abderrahmane MEBTOUL nouveau chef de l’Etat qui dès lors , des sociaux-démocrates, des rente, et le système financier lieu jamais en économie, conduira à la Khenchela, a indiqué dimanche le les intempéries sur 7 sites de nommerait un nouveau gouver- islamistes et de ceux qui se pro- de distribution de la rente, les ban- régression économique et sociale Les travaux de wali Kamel Nouicer. e temps ne se rattrape nement « de compétences natio- clament démocrates ? En ques publiques (plus de 85% des avec des réserves de change ten- chemins de wilaya et commu- Dégagé du programme d’urgence jamais en économie, nales « neutres » chargé de fonction des expériences histori- crédits octroyés) étant au cœur consolidation de tronçons dant vers zéro et le retour au FMI naux ainsi que -
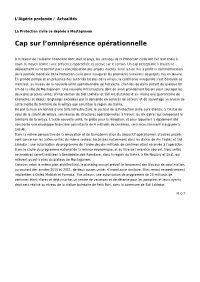
Cap Sur L'omniprésence Opérationnelle
L’Algérie profonde / Actualités La Protection civile se déploie à Mostaganem Cap sur l’omniprésence opérationnelle À la faveur de l’aubaine financière dont jouit le pays, les services de la Protection civile ont fait leur choix à court et moyen terme : une présence rapprochée et accrue sur le terrain. Un cap perceptible à travers le déploiement sur le terrain par la concrétisation des projets inscrits. Ainsi a-t-on mis à profit la commémoration de la journée mondiale de la Protection civile pour inaugurer les premières livraisons de projets mis en œuvre. En grande pompe et en présence des autorités locales de la wilaya, la cérémonie inaugurale s’est déroulée ce mercredi, au niveau de la nouvelle unité opérationnelle de Achaâcha, chef-lieu de daïra distant de quelque 80 km de la ville de Mostaganem. Une nouvelle infrastructure dont on avait grandement besoin pour soulager les deux plus proches unités d’intervention de Sidi Lakhdar et Sidi Ali, distantes d’au- moins une quarantaine de kilomètres et depuis longtemps excédées par la demande en services de secours et de sauvetage au niveau de cette moitié du territoire de la wilaya que constitue la région du Dahra. De par la mise en service d’une telle infrastructure, le secteur de la Protection civile aura étendu, à l’instar de celui de la sûreté de wilaya, son réseau de structures opérationnelles à travers les dix daïras qui composent le territoire de la wilaya. L’autre nouvelle unité, fin prête pour la réception, et pour laquelle il a également été consacrée une enveloppe financière consistante de 4 milliards de centimes, sera incessamment inaugurée à Sidi Ali. -

Cinq Forêts Récréatives Seront Aménagées
L’Algérie profonde / Ouest Investissement à Mostaganem Cinq forêts récréatives seront aménagées La forêt de Sidi Manso ur surplo mbant le littoral qui court le long du littoral mosta gané mois. © M. Salah / Libert é La forêt de Sidi Mansour est très prisée par les investisseurs, de par sa position géographique stratégique, surplombant la mer. L’autorisation et la délimitation des forêts récréatives se feront en application du décret 06-368 du 19 octobre 2006, qui fixe le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les modalités de son octroi. Au sens du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 publié au Journal officiel, fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, il est entendu par forêt récréative, toute forêt, section de forêt, ou toute formation forestière, naturelle ou plantée, aménagée ou à aménager, relevant du domaine forestier national et destinée à la récréation, à la détente, aux loisirs et à l’écotourisme. Au sens de l’article 4 fixant les modalités de la conformité des installations, il est clairement stipulé que l’usage de la forêt devra être compatible avec le cadre naturel du lieu d’implantation et ne devra en aucune manière constituer une source de nuisance, de maladie ou de dégradation du milieu naturel. Toutes les infrastructures doivent être légères, démontables et/ou transportables, et s’intégrer avec le paysage de la forêt. L’administration des forêts -

Hommage Aux Sacrifices D'un Peuple Héros
éflexionSi vous aimez la liberté Payez-en le prix QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION Jeudi 31 Octobre 2019 N° 3409 12ème année Prix 20 DA www.reflexiondz.net ECOLES PRIMAIRES A MOSTAGANEM RELIZANE Des dizaines de Le maire d’Oued cas de pédiculose Djemaa suspendu recensées P 7 de ses fonctions P 4 LE GENERAL GAID SALAH ASSURE : ‘’La présidentielle aura bien lieu le 12 décembre’’ En visite, mercredi à la première région militaire, le chef d’Etat-major de l’Armée, Ahmed Gaid Salah a évoqué encore la situation politique du pays, en affirmant que « les élections présidentielles auront bien lieu à la date prévue, c'est à dire le 12 décembre. Lire page 4 65EME ANNIVERSAIRE DE LA GLORIEUSE REVOLUTION TEMOIGNAGES DE FEU MOUDJAHID, SAÏD NAIT SI ALI La maison Berber, HOMMAGE AUX SACRIFICES le ‘’Merkez’’ de Mostaganem D’UN PEUPLE HÉROS P 3 La maison Berber, construite sur une colline surplombant la plage de Kharouba Mostaganem, est une vrai forteresse dans la mesure où elle a été bâtie presque en béton armé et à partir de laquelle on peut superviser, de n’importe quel côté, tout mouvement allant ou venant vers la plage. P 6 ACCIDENT DE LA ROUTE 3 MORTS ET 4 BLESSES A ADRAR P 4 éflexionSi vous aimez la liberté Payez-en le prix dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION NNoonn Jeudi 31 Octobre 2019 2 UN CHAMPION ACCUSE DES PARTIES DE TRAVAILLER ‘’Gonfler’’ le compte pour CONTRE L’ALGÉRIE ! avoir le visa, c’est fini ! Le champion olympique 2012 du 1500 mètres, l’Algé- rien Taoufik Makhloufi, a lancé de graves accusations contre ce qu’il appelle certaines parties occupant des postes. -

L'ancien Et L'actuel Maire Sous Enquete
éflexionSi vous aimez la liberté Payez-en le prix QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION Mercredi 11 Septembre 2019 N° 3366 12ème année Prix 20 DA www.reflexiondz.net GROUPE CEVITAL POUR FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DE BOUTEFLIKA Les fils de Rebrab Le député milliardaire dans le viseur de Tliba sera poursuivi la justice P 2 en justice P 4 L’ALGERIE A LA CROISEE DES CHEMINS LA REVUE EL-DJEICH Résoudre rapidement par L’ère de la fabrication une élection présidentielle transparente des présidents est Par Dr Abderrahmane Mebtoul Le Conseil des Ministres en date du 09 septembre 2019 définitivement révolue a adopté une série de résolutions suite au rapport du Panel, qui malgré d’importantes pressions a réalisé un La revue El-Djech a dénoncé, dans son semer le doute sur ses intentions et ses important travail, une conjoncture très difficile où les édition de septembre, certains médias efforts, à travers certaines plumes mer- pratiques politiques du passé et récentes ont produit douteux et des plumes mercenaires qui cenaires, certaines chaînes douteuses et une méfiance généralisé faute de morale : pour preuve, conspirent contre l’institution militaire partis rejetés par le peuple, n’ont d’autre la délinquance des plus hauts responsables du pays. pour semer le doute sur les intentions argument que la critique et le dénigre- L’Algérie traverse une crise politique sans précédent de- et les efforts de l’ANP. « Ces parties et ment dans le seul souci de concrétiser puis l’indépendance avec les risques d’aller vers une leurs acolytes qui conspirent contre des intérêts étroits au détriment des in- cessation de paiement fin 2021 début 2022. -

Journal Officiel Algérie
N° 68 Dimanche 15 Rabie El Aouel 1437 54ème ANNEE Correspondant au 27 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ABONNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye WWW. JORADP. DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale….........…........…… 1070,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction..... 2140,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d'expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 15 Rabie El Aouel 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 décembre 2015 S O M M A I R E DECRETS Décret présidentiel n° 15-313 du 27 Safar 1437 correspondant au 9 décembre 2015 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 1ère région militaire............................................................................................................................................ 5 Décret présidentiel n° 15-314 du 27 Safar 1437 correspondant au 9 décembre 2015 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 2ème région militaire......................................................................................................................................... -

Communes of Algeria
S.No. Commune HASC Population 1 Abadla DZ.BC.AB 10,845 2 Abalissa DZ.TM.AB 6,484 3 Abi Youcef DZ.TO.AU 7,743 4 Abou El Hassen DZ.CH.AH 20,164 5 Achaacha DZ.MG.AC 31,360 6 Adekar DZ.BJ.AD 13,495 7 Adrar DZ.AR.AD 43,903 8 Afir DZ.BM.AF 12,613 9 Aflou DZ.LG.AF 53,260 10 Aghbal DZ.TP.AG 6,606 11 Aghbalou DZ.BU.AG 19,530 12 Aghlal DZ.AT.AG 6,841 13 Aghni-Goughrane DZ.TO.AG 10,833 14 Aghrib DZ.TO.AR 13,408 15 Ahl El Ksar DZ.BU.AK 12,315 16 Ahmed Rachedi DZ.ML.AR 14,489 17 Ahmer El Ain DZ.TP.AA 25,633 18 Ahnif DZ.BU.AF 10,268 19 Ain Abessa DZ.SF.AB 15,058 20 Ain Abid DZ.CO.AA 25,958 21 Ain Adden DZ.SB.AA 2,319 22 Ain Arnat DZ.SF.AA 30,129 23 Ain Azel DZ.SF.AZ 41,073 24 Ain Bebouche DZ.OB.AC 14,597 25 Ain Beida DZ.OB.AB 92,197 26 Ain Beida DZ.OG.AB 14,500 27 Ain Beida Harriche DZ.ML.AB 18,513 28 Ain Ben Beida DZ.GL.AB 8,269 29 Ain Benian DZ.AD.AN 4,677 30 Ain Benian DZ.AL.AB 52,343 31 Ain Ben Khelil DZ.NA.AB 3,776 32 Ain-Bessem DZ.BU.AB 36,830 33 Ain Biya DZ.OR.AB 26,253 34 Ain Bouchekif DZ.TR.AB 12,386 35 Ain Boucif DZ.MD.AB 24,434 36 Ain Boudinar DZ.MG.AB 5,241 37 Ain Bouihi DZ.AD.AB 13,920 38 Ain Bouziane DZ.SK.AB 8,381 39 Ain Charchar DZ.SK.AC 13,717 40 Ain Chouhada DZ.DJ.AC 8,337 41 Ain Defla DZ.AD.AD 52,276 42 Ain Deheb DZ.TR.AD 25,366 43 Aïn Djasser DZ.BT.AD 13,232 44 Aïn El Arbaa DZ.AT.AA 12,443 45 Ain El Assel DZ.ET.AA 12,482 www.downloadexcelfiles.com 46 Ain El Berd DZ.SB.AB 13,779 47 Ain El Berda DZ.AN.AB 17,446 48 Ain El Diss DZ.OB.AD 2,741 49 Ain El Fakroun DZ.OB.AF 47,237 50 Ain El Hadid DZ.TR.AH 13,358 51 Ain El Hadjar DZ.BU.AH -

L'activité De La Pêche Et Le Développement Local : Étude De Cas
République Algérienne Démocratique Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique UNIVERSITE D’ORAN Faculté des Sciences Economiques Sciences de Gestion et Sciences Commerciales MEMOIRE de Magister Pour l’obtention de diplôme de Magister en Sciences Economiques Option : Economie Régionale Urbaine Appliquée L’activité de la pêche et le développement local : étude de cas sur la wilaya de Mostaganem Présenté par : Encadré par : Mr HANSAL Aboubakr Dr AIT HABOUCHE/MIHOUB Ouahiba Membre de jury : soutenue le30/06/2013 Mr.MEBTOUL Abderrahmane président Professeur université d’Oran Mme.Ait Habouche Ouahiba rapporteur Maître de conférences A université d’Oran Mr.FEKIH Abdelhamid examinateur Maître de conférences A université d’Oran Mr.DAOUDI Salah examinateur Maître de conférences A université d’Oran Année Universitaire 2012-2013 REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS En préambule à ce mémoire, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui m'ont apporté leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce travail ainsi qu’à la réussite de cette période de formation. Toutes ma reconnaissance va d’abord à monsieur AIT HABOUCHE Abdelmadjide pour m’avoir permis de poursuivre ma poste graduation dans les meilleures conditions et en toute sérénité de la confiance et l’intérêt qui a porte pour cette étude ainsi que pour ces précieux conseils. Je tiens à remercier particulièrement Madame AIT HABOUCH /MIHOUB Ouahiba, qui m’a accompagnée tout au long de la réalisation de ce mémoire. Je tiens à exprimer mes vifs remerciements à toutes personnes et organismes ayant contribués à ce travail, particulièrement : La direction de la pêche et des ressources halieutique de la wilaya de Mostaganem La direction de planification et d’aménagement de territoire de cette wilaya Aussi plus la direction d’emploi et des PME/PMI S.P.A DELPHINE (complexe pêcherie à l’intérieur du port de Mostaganem) De m’avoir accepté spontanément et sans aucune difficulté au sein de son établissement. -

List of Refugee Deaths
List of 36 570 documented deaths of refugees and migrants due to the restrictive policies of "Fortress Europe" Documentation by UNITED as of 1 April 2019 Death by Policy - Time for Change! Campaign information: Facebook - UNITED Against Refugee Deaths, UnitedAgainstRefugeeDeaths.eu, [email protected], Twitter: @UNITED__Network #AgainstRefugeeDeaths UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees Amsterdam secretariat: Postbus 413, NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands, tel +31-6-48808808, [email protected], www.unitedagainstracism.org The UNITED List of Deaths can be freely re-used, translated and re-distributed, provided UNITED is informed in advance and source (UnitedAgainstRefugeeDeaths.eu) is mentioned. Researchers can obtain this list with more data in xls format from UNITED. found name, gender, age region of origin cause of death source dead number 28/03/19 2 N.N. (men) unknown drowned, bodies recovered off coast of Chios (GR), 36 rescued HelCoastG/IOM 27/03/19 1 Ali (boy, 18) Afghanistan suicide in shelter for unaccompanied minor asylum seekers in Geneva (CH), bad housing conditions Vivre/RTS/Le Courrier/TribuneGeneve 26/03/19 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, found in advanced state of decomposition on beach near Tetouan, south of the Strait of Gibraltar (MA) El Pueblo de Ceuta/IOM 26/03/19 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, found dead on beach in Azla (MA), presumably while trying to reach Spain FaroCeuta 26/03/19 1 N.N. Sub-Saharan Africa drowned, found floating in advanced state of decomposition in sea in Tarajal area of Ceuta (ES) FaroCeuta/Ceutaaldia/El Pueblo de Ceuta/IOM 26/03/19 4 N.N. -

En Dépit D'une Recrudescence De La Covid-19
En dépit d’unE rEcrudEscEncE dE la covid-19 LES SPÉCIALISTES PRÔNENT LA VIPGageI 2LANCE N° 6877 -MARDI 29 DÉCEMBRE 2020 cOrOnavirus en algérie 382 nouveaux cas et 9 décès en 24 heures www.jeune-independant.net [email protected] Page 2 MOhaMed chOrfi : Le code éLectoraL bientôt prêt La commission des experts, chargée de la révision du régime électoral présidée par Ahmed Laaraba, dévoilera bientôt la première mouture du projet d’amendement de ce texte de loi. C’est ce qu’a affirmé hier le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Chorfi, lors de son passage au forum de la Radio nationale, annonçant que l'ANIE s’échine à la préparation d’une «plate-forme appropriée pour le contrôle des scrutins afin de les débarrasser de toute forme de fraude». Page 3 e PhiliP MOrris internatiOnal Mis en cause 5 , beM et bac 2021 Ouverture du caPital Vaste trafic La date des entrePrises Publiques de cigarettes du début des Le gouvernement temporise vers l’AlgérPiaege 4 inscriptions fixéPaeges 3 Page 4 quOtidien natiOnal d’infOrMatiOn fOndé le 28 Mars 1990 – issn 1111-0115. Prix : algérie 20 da, france 1 eurO 2 nATIONALE ALors qu’uNe troisième VAgue de coVid-19 N’est PAs écArtée Les spécialistes prônent la vigilance La baisse du nombre des personnes contaminées à la Covid-19 enregistrée ces derniers jours, conjuguée avec l’espoir d’un vaccin, peuvent donner lieu à un relâchement dans le respect des gestes barrière. C’est la raison pour laquelle les spécialistes prônent toujours la vigilance et la prévention pour éviter l’arrivée d’une nouvelle vague de contamination.