Archéo 66 N° 33 (2018)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Les Fusiliers De Montagne Du Roussillon Au Xviiie Siècle : Des Troupes Légères Roussillonnaises Parmi Les Roussillonnais Nicolas L’Hénaff
Les fusiliers de montagne du Roussillon au XVIIIe siècle : des troupes légères roussillonnaises parmi les Roussillonnais Nicolas l’Hénaff To cite this version: Nicolas l’Hénaff. Les fusiliers de montagne du Roussillon au XVIIIe siècle : des troupes légèresrous- sillonnaises parmi les Roussillonnais. Histoire. 2019. dumas-02462054 HAL Id: dumas-02462054 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02462054 Submitted on 31 Jan 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA Année universitaire 2018-2019 MASTER II Recherche HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE Histoire, arts et archéologie méditerranéenne Mémoire de recherche présenté par Nicolas L’Hénaff sous la direction de Monsieur Patrice Poujade, professeur des universités en histoire moderne LES FUSILIERS DE MONTAGNE DU ROUSSILLON AU XVIIIE SIÈCLE Des troupes légères roussillonnaises parmi les Roussillonnais Soutenu le 26 septembre 2019 devant un jury composé de Julien LUGAND, maître de conférences HDR en histoire de l’art moderne, Université de Perpignan Via Domitia, président Patrice POUJADE, professeur des universités en histoire moderne, Université de Perpignan Via Domitia Illustration n° 1 : Les Fusiliers de montagne d’après Eugène Leliepvre, peintre officiel de l’Armée. Série Ancien Régime (XI), Paris, Le Cimier, 2000 REMERCIEMENTS a rédaction de ce mémoire, aboutissement d’une année entière d’investigations sur les L Fusiliers de montagne du Roussillon, n’aurait été possible sans l’appui de Monsieur Patrice Poujade, mon directeur de recherches et professeur d’histoire moderne. -

Pass IT P TU ASS GRA Découvertes EN PAYS CATALAN Les Plus Beaux Sites Des Pyrénées-Orientales Vous Attendent
RÉDU FS ITS RI A T 20 65 20 Pass IT P TU ASS GRA découvertes EN PAYS CATALAN Les plus beaux sites des Pyrénées-Orientales vous attendent leDépartement66.fr L’Accent Catalan de la République Française Benvinguts/ Benvingudes a Catalunya Nord! El Departament té el plaer de presentar-vos l’edició del 2020 del Pass découvertes a Catalunya Nord, nova fórmula. Mitjançant aquest Pass, vos convidem a venir a descobrir alguns dels llocs més bonics dels Pirineus Orientals. Tant si viviu al territori com si esteu visitant, vos permetrà de gaudir de tarifes reduïdes durant tot l’any. En aquestes pàgines, s’han destacat 65 llocs associats, repartits pel territori. Patrimoni històric (castells, abadies, museus...), patrimoni natural (Polilles), llocs culturals o espais de lleure, tots vos obren les portes per a visites o animacions. Aquesta guia pràctica també vol valorar els actors turístic locals, a qui el Departament i la seua Agència de desenvolupament de turisme i de lleure donen suport i que acompanyen. És gràcies a la feina i l’energia d’aqueixos actors que el nostre patrimoni històric, natural i cultural pot continuar vivint i acollint-vos. Bones visites i boniques trobades a totes i a tots! Hermeline MALHERBE Presidenta del Departament dels Pirineus Orientals Welcome to the Catalan Country! The Department is pleased to present the 2020 edition of the Catalan Country Discoveries Pass, a new formula. This Pass is an invitation to come and discover some of the most beautiful sites in the Pyrénées-Orientales. Whether you live in the region or you are visiting, it will allow you to benefit from reduced rates all year round. -
Les Remparts
Parc del Pirineu català VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT, LES REMPARTS VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT, FORT LIBERIA VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT, LA COVA BASTERA VAUBAN EN ROUSSILLON Mont-Louis et Villefranche-de-Confl ent font partie du territoire du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. PERPIGNAN VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT COLLIOURE MONT-LOUIS LE PERTHUS AMÉLIE-LES-BAINS BELLEGARDE PORT-VENDRES PRATS-DE-MOLLO Parc del Pirineu català Plan de Montlouis - 1739. Plan de Villefranche-de-Confl ent - 1703. Plan de Perpignan. Plan du Fort de Bellegarde - Le Perthus. Plan du fort de Prats-de-Mollo. Plan du fort d’Amélie-les-Bains. Plan de Collioure. LE TRAIN JAUNE TRAIN LE • Villefranche-de-Confl ent Villefranche-de-Confl • Saint-Vaast-La-Hougue • Saint-Martin de Ré de Saint-Martin • Neuf-Brisach • Mont-Louis • Mont-Dauphin • Longwy • Camaret-sur-Mer • Briançon • Blaye-Cussac - Fort Médoc Fort - Blaye-Cussac • Besançon • Arras LE RÉSEAU DES SITES MAJEURS VAUBAN MAJEURS SITES DES RÉSEAU LE LA VILLE LA MONT-LOUIS, MONT-LOUIS, LE FOUR SOLAIRE FOUR LE MONT-LOUIS, MONT-LOUIS, LA CITADELLE LA MONT-LOUIS, MONT-LOUIS, Parc del Pirineu català Pirineu del Parc MONT-LOUIS, PLACE FORTE DE MONTAGNE ituée à 1600 m d’altitude, aux portes de la Cerdagne, du Confl ent et du Capcir, Mont-Louis, la ville fortifi ée la plus haute de France, a, depuis sa création, constamment gardé sa vocation première de ville de garnison. SToujours domaine militaire, notre citadelle est aujourd’hui occupée par le Centre National d’Entraînement Com- mando (CNEC). Malgré sa petite superfi cie (39 ha) qui fait d’elle la plus petite commune des Pyrénées-Orientales, notre ville, chef-lieu de canton, a aussi conservé le dynamisme économique et administratif souhaité par Vauban. -

65 Découvertes
RÉDU FS ITS RI A T 20 65 20 Pass IT P TU ASS GRA découvertes EN PAYS CATALAN Les plus beaux sites des Pyrénées-Orientales vous attendent leDépartement66.fr L’Accent Catalan de la République Française Benvinguts/ Benvingudes a Catalunya Nord! El Departament té el plaer de presentar-vos l’edició del 2020 del Pass découvertes a Catalunya Nord, nova fórmula. Mitjançant aquest Pass, vos convidem a venir a descobrir alguns dels llocs més bonics dels Pirineus Orientals. Tant si viviu al territori com si esteu visitant, vos permetrà de gaudir de tarifes reduïdes durant tot l’any. En aquestes pàgines, s’han destacat 65 llocs associats, repartits pel territori. Patrimoni històric (castells, abadies, museus...), patrimoni natural (Polilles), llocs culturals o espais de lleure, tots vos obren les portes per a visites o animacions. Aquesta guia pràctica també vol valorar els actors turístic locals, a qui el Departament i la seua Agència de desenvolupament de turisme i de lleure donen suport i que acompanyen. És gràcies a la feina i l’energia d’aqueixos actors que el nostre patrimoni històric, natural i cultural pot continuar vivint i acollint-vos. Bones visites i boniques trobades a totes i a tots! Hermeline MALHERBE Presidenta del Departament dels Pirineus Orientals Welcome to the Catalan Country! The Department is pleased to present the 2020 edition of the Catalan Country Discoveries Pass, a new formula. This Pass is an invitation to come and discover some of the most beautiful sites in the Pyrénées-Orientales. Whether you live in the region or you are visiting, it will allow you to benefit from reduced rates all year round. -
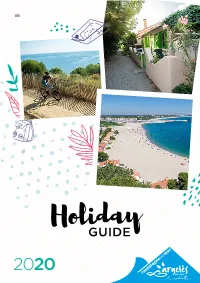
Argelès-Sur-Mer ! Welcome To
2020 Welcome to Argelès-sur-Mer ! Contents Municipal Tourist Office Place de l’Europe Discovering Argelès-sur-Mer ...................................... p. 4-6 66700 Argelès-sur-Mer Markets Argelès-sur-Mer & Around .............................. p. 7 Local Products ............................................................. p. 8-9 Tel. + 33 (0)4 68 81 15 85 Entertainment Events 2020 ........................................ p. 10 www.argeles-sur-mer.com Transport Services ........................................................ p. 11 [email protected] Beach Information – Beach Clubs .......................... p. 12-14 Water-based Activities ........................................... p. 15-17 Leisure Activities .................................................... p. 18-23 Leisure Area ............................................................ p. 23-24 Eating out - Bars ..................................................... p. 25-33 Shopping ................................................................ p. 34-48 Banks - ATMs - Bureau de change .............................. p. 36 Hotels ........................................................................... p. 49 Tourist & Holiday Residences ....................................... p. 49 Camping Sites ........................................................ p. 50-51 Holiday Villages ............................................................ p. 51 This guide is a non-contract guide. Holiday Guide produced by: Stratèges Estate Agencies ........................................................... -
Life in the Pyrénées-Orientales Nº 62 FREE / GRATUIT
2018 /19 Winter P-O Life Life in the Pyrénées-Orientales Nº 62 FREE / GRATUIT www.anglophone-direct.com Le Racou. © Simon Brown OUT for FOOD & TEST your THE DAY FRENCH FRENCH In Narbonne DRINK Ideas for Eating LIFE out in Winter When Urine Paris… AMÉLIOREZ votre ANGLAIS we create relaxing, outside space for you :) Edito Hola amics meus t will probably be well into 2019 by the time you read this but I Bon Any Nou - Happy New Year in Catalan of course - with warmest wishes for a Happy, Healthy and Lucky New Year! As usual, autumn and early winter have been magnificent, with daily generous doses of that magnificentP-O light, the perfect antidote to the winter blues, and bold splashes of mimo- sa, almond blossom and early flowers already tempted out by the winter sun. I feel so lucky to be a part of it all! In this edition, we bring you readers' winter restaurant recom- DREAMING OF A mendations (say that 3 times quickly!) for all pockets, walks CONSERVATORY? and days out, great local theatre, wine reviews, airport news, language exercises, a local nature quiz …..and some really PERGOLAS · CONSERVATORIES · PORCHES bad jokes! P-O Life has now been around for 14 years! Phew! A big Magazine gratuit. Tout Droits réservés, Reproduction interdite Droits réservés, Tout Magazine gratuit. THANK YOU to our advertisers who keep this ship afloat. and an even bigger THANK YOU to the many amazing people who graciously and generously contribute material to P-O Life – it just wouldn’t be the same without you. -

Patrimoine66
pPatrimoineass66 Le patrimoine en terre catalane PRÉHISTOIRE BAROQUE PATRIMOINE CLOÎTRE ROMAN CHÂTEAU FORTIFICATIONS ART MODERNE ETHNOLOGIE NATURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MÉMOIRE PEINTURE 2018 pass patrimoine 66 Visitez malin ! Comment utiliser votre Pass Patrimoine 66 ? Avec le Pass Patrimoine 66, vous bénéficiez d’un tarif réduit dès votre 2ème visite dans l’ensemble des 61 sites et monuments présents dans ce support. N’oubliez pas de le faire tamponner à chaque visite pour bénéficier directement d’une réduction. La personne qui vous accompagne peut également profiter de cette offre. Vous trouverez le Pass Patrimoine 66 gratuitement dans les 61 sites et monuments partenaires ainsi que dans les offices de tourisme, les structures d’hébergement ou vous pouvez aussi en faire la demande auprès de l’Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales au +33 (0)4 68 51 52 53. 1ère visite à plein tarif puis réductions. Valable jusqu’à l’édition 2019, une seule fois pour un même site ou monument. Offre non cumulable avec d’autres formes de promotion. Amb el Pass Patrimoni 66, beneficieu d’una tarifa reduïda a partir de la vostra segona visita en el conjunt dels 61 llocs i monuments presents en aquest suport. No descuideu fer-ho segellar a cada visita per beneficiar directament d’una reducció. La persona que us acompanya pot igualment gaudir d’aquesta oferta.Trobareu el Pass Patrimoni 66 gratuïtament en els 61 llocs i monuments socis així com en les oficines de turisme, les estructures d’allotjamet o podeu també fer-ne la demanda a prop del Turisme 66 al +33 (0)4 68 51 52 53. -

Nº 56 FREE / GRATUIT François Desnoyer François
2017 1 Summer P-O Life Life in the Pyrénées-Orientales Nº 56 FREE / GRATUIT François Desnoyer www.anglophone-direct.com OUT for FOOD TEST your THE DAY & DRINK LET’S Get FRENCH Dali & Pablo Casals Restaurant PHYSICAL Reviews Sea, Sport, Sail AMÉLIOREZ votre ANGLAIS 2 3 For your next conservatory, GUARANTEE15 EDITO:-) YEARS look no further than TRYBA! GUARANTEEDINSURANCE BY With TRYBA – LE VERANDIER, benefit from the very latest TRIPLE-GLAZING technology Hola nois Please support Elections, politics, falling pound, terror and our advertisers. Without them, tragedy, doom and gloom.... Whilst we can’t we would change the world, we can offer a temporary quite simply antidote – the Pyrénées-Orientales. not exist rab yourself a glass of something cool, drink in the sparkling Med, the mystic Canigou, that intoxicating odour of pine, lavenderG and herbs. Elle n’est pas belle la vie? And if you’re worried about your waistline faced with a summer of cold beer, BBQs and dinners beneath the stars, buy jeans or a skirt at least one size too big and pull nonchalantly at the waistline during the evening apero. Or a better option might be to try some of the fabulous sporting activities that we have put together to burn off the calories... For quality and reliability I Made in France I Established 35 years followed by the interesting selection of restaurants to put them back on again! • Let our professional, English-speaking consultants bring your project to life. Our days out in this edition are full of art and music: Dali in Céret, Reproduction interdite Droits réservés, Tout Magazine gratuit. -

Nº 64 Free / Gratuit
2019 summer P-O Life Life in the Pyrénées-Orientales Nº 64 FREE / GRATUIT www.anglophone-direct.com © Barry Blend FOOD OUT for P-O TEST your &DRINK THE DAY NATURALLY FRENCH Restaurant ….In Collioure, Biters and Stingers Reviews Palau Del Vidre and Elne AMÉLIOREZ votre ANGLAIS :) we create relaxing, outside space for you Edito Summer’s here and the time is right... for dancing in the streets...and oh boy, are our P-O streets a-boppin’ and a-poppin’ with live music, festivals, Catalan tradition..... Join us for a day out in Collioure on the coast, Palau and Elne, and up into the Conflent in search of cooler air and some fabulous concerts in amazing venues. We have loads of restaurant ideas...and Faisons la course check out the Yellow Pages at the back pour rentrer à for a butcher, a baker, a candlestick maker la maison DREAMING OF A (or even a builder, plumber, electrician..). CONSERVATORY? Thanks to our advertisers who keep us afloat - and tothousands of loyal readers. PERGOLAS · CONSERVATORIES · PORCHES We wouldn’t exist without you! Wishing you sunshine, laughter, cold beer and plenty of shade this summer! D’ACCORD- mais je vais facilement gagner For quality and reliability I Made in France I Established 35 years • Let our professional, English-speaking consultants bring your project to life. ABRUTI! • You could extend your home by up to 4Om2 without planning permission.* • Call 04 68 55 05 05 now to get a free, no-obligation quote or simply scan here: Faisons la course - let’s have a race The name you can trust. -

Holiday Residences
GB HolidGUIaDEy 2019 Welcome to Argelès-sur-Mer ! Contents Municipal Tourist Office Place de l’Europe Discovering Argelès-sur-Mer ....................................... p. 4-6 66700 Argelès-sur-Mer Markets Argelès-sur-Mer & Around ................................p. 7 Local Products .............................................................. p. 8-9 Tel. 04 68 81 15 85 Entertainment Events 2018 ..........................................p. 10 www.argeles-sur-mer.com Transport Services .........................................................p. 11 [email protected] Beach Information - Beach Clubs ............................p. 12-14 Water-based Activities .............................................p. 15-17 Leisure Activities ......................................................p. 18-23 Leisure Area ...................................................................p. 24 Eating out - Bars ...................................................... p. 25-33 Shopping .................................................................. p. 34-48 Banks - ATMs - Bureau de change ...............................p. 36 Hotels .............................................................................p. 49 Tourist & Holiday Residences ........................................p. 49 Camping Sites ..........................................................p. 50-51 Holiday Villages .............................................................p. 51 This guide is a non-contract guide. Estate Agencies .............................................................p. -

RS+20170308-01.Pdf
SOMMAIRE PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES CABINET SIDPC . Arrêté PREF/SIDPC/2017066-0001 du 7 mars 2017 relatif à la liste des établissements recevant du public du département des Pyrénées-Orientales SOUS-PREFECTURE DE PRADES . Arrêté SPPRADES 2017/ 067-0001 du 8 mars 2017 portant autorisation d’organiser le dimanche 26 mars 2017 une épreuve sportive automobile dénommée "15 ème MOTO KID'S MILLASSOIS" sur le circuit homologué de Millas . Arrêté SPPRADES 2017/ 067-0002 du 8 mars 2017 portant autorisation d’organiser le dimanche 19 mars 2017, une manifestation de TRIAL MOTO dénommée « CHALLENGE GILBERT GRANDO » à Corbère . Arrêté SPPRADES 2017/ 067-0002 portant autorisation d’organiser le dimanche 19 mars 2017, une manifestation de TRIAL MOTO dénommée « CHALLENGE GILBERT GRANDO » à Corbère DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE Decision du 6 mars 2017 portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention constitutive du GCSMS Présence S Service : Offre de soins et autonomie . Décision du 3 mars 2017 relative à la composition du Conseil Territorial de Santé du territoire de démo- cratie sanitaire des Pyrénées-Orientales DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT OCCITANIE Direction Écologie . Arrêté DREAL/DE/2017065-001 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation loi sur l’eau – Commune du Barcarès, dragage décennal du port de Barcarès DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS OCCITANIE . Décision du 7 mars 2017 de délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux dans le domaine des contributions indirectes AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE . Arrêté du 01 février 017 portant nomination des membres CCI des accidents médicaux de l’Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées Orientales . -

Cahier Départemental Des Pyrénées-Orientales
Modernisation de l’inventaire ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique Région Languedoc-Roussillon Édition 2008-2010 validée par le MNHN en avril 2011 Département des Pyrénées-Orientales Mai 2012 Maîtrise d’ouvrage Secrétariat Scientifique et Coordination des données Technique et Coordination « Flore et Habitats Naturels » des données « Faune » Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique – Deuxième Génération Région Languedoc-Roussillon Cahier départemental des Pyrénées-Orientales 2/17 Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique – Deuxième Génération Région Languedoc-Roussillon Cahier départemental des Pyrénées-Orientales 3/17 Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique – Deuxième Génération Région Languedoc-Roussillon 1- Données statistiques des ZNIEFF dans le département des Pyrénées- Orientales 1.1- Les périmètres ZNIEFF dans les Pyrénées-Orientales ZNIEFF I et II ZNIEFF I ZNIEFF II confondues Nombre 163 31 194 Surface minimale (ha) 1 260 Surface maximale (ha) 5 469 68 968 Surface totale du département concerné 112 194 302 952 314 766 par les ZNIEFF (ha) Emprise de l’inventaire (par rapport à la 27% 73% 76%* superficie du département) * : Les ZNIEFF I incluses dans des ZNIEFF II ne sont pas recomptées. 1.2- Représentativité des Pyrénées-Orientales par rapport à l’inventaire en région ZNIEFF I ZNIEFF II ZNIEFF I et II En nombre de ZNIEFF (par rapport au nombre 19% 22% 19% total de ZNIEFF en Languedoc-Roussillon) En surface en ZNIEFF (par rapport à la surface 24% 19% 19% en ZNIEFF en Languedoc-Roussillon) Pour information, la région Languedoc-Roussillon est concernée par 997 ZNIEFF (855 de type I et 142 de type II) représentant une surface d’environ 1 694 630 hectares.