Diagnostic Du Sous-Bassin D'assif Al
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chapitre VI La Ville Et Ses Équipements Collectifs
Chapitre VI La ville et ses équipements collectifs Introduction L'intérêt accordé à la connaissance du milieu urbain et de ses équipements collectifs suscite un intérêt croissant, en raison de l’urbanisation accélérée que connaît le pays, et de son effet sur les équipements et les dysfonctionnements liés à la répartition des infrastructures. Pour résorber ce déséquilibre et assurer la satisfaction des besoins, le développement d'un réseau d'équipements collectifs appropriés s'impose. Tant que ce déséquilibre persiste, le problème de la marginalisation sociale, qui s’intensifie avec le chômage et la pauvreté va continuer à se poser La politique des équipements collectifs doit donc occuper une place centrale dans la stratégie de développement, particulièrement dans le cadre de l’aménagement du territoire. La distribution spatiale de la population et par conséquent des activités économiques, est certes liée aux conditions naturelles, difficiles à modifier. Néanmoins, l'aménagement de l'espace par le biais d'une politique active peut constituer un outil efficace pour mettre en place des conditions favorables à la réduction des disparités. Cette politique requiert des informations fiables à un niveau fin sur l'espace à aménager. La présente étude se réfère à la Base de données communales en milieu urbain (BA.DO.C) de 1997, élaborée par la Direction de la Statistique et concerne le niveau géographique le plus fin à savoir les communes urbaines, qui constituent l'élément de base de la décentralisation et le cadre d'application de la démocratie locale. Au recensement de 1982, était considéré comme espace urbain toute agglomération ayant un minimum de 1 500 habitants et qui présentait au moins quatre des sept conditions énumérées en infra1. -

Elaboration D'une Convention Pour La Gestion Intégrée Des Ressources En Eau Dans Le Bassin Du Haouz-Mejjate Au Maroc
Elaboration de la convention GIRE du Bassin Haouz-Mejjate « contrat de nappe » Abdessamad Hadri – RESING Atelier stratégie de communication GIRE – 24.03.2016 Atelier d’élaboration d’une stratégie de communication 24.03.2016 Plan de la présentation Objectifs et Consistance Aperçu des principaux résultats Options d’amélioration Atelier d’élaboration d’une stratégie de communication 24.03.2016 Objectifs et consistance Atelier d’élaboration d’une stratégie de communication 24.03.2016 3 Cadrage global: rappel du contexte de l’étude Projet lancé au niveau du Bassin Haouz-Mejjate, avec l’appui technique de la GIZ portant sur « l’Elaboration d’une convention GIRE (Contrat de nappe) au niveau du Bassin Haouz-Mejjate »: L’étude s’inscrit dans le cadre : . de la mobilisation nationale de mise en œuvre de contrats de nappes, et . des efforts entrepris par l’ABHT et l’ABHOER destinés à promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau au niveau du Bassin Haouz- Mejjate, Atelier d’élaboration d’une stratégie de communication 24.03.2016 4 Cadrage global: rappel du contexte de l’étude Atelier d’élaboration d’une stratégie de communication 24.03.2016 5 Approche méthodologique Mission 1: Diagnostic et identification Mission 2: Elaboration préliminaire des mesures d’amélioration participative de la « Convention Eau » Comité Pilotage Participatif Secrétariat Audits Pilotage ABH-T publics mise en oeuvre CN Comité Groupes Suivi de Travail Processus Atelier d’ Ateliers Validation Ateliers Atelier émergence régionaux Mission 1 régionaux clôture Recueil et -

Pauvrete, Developpement Humain
ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISSARIAT AU PLAN PAUVRETE, DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC Données cartographiques et statistiques Septembre 2004 Remerciements La présente cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social est le résultat d’un travail d’équipe. Elle a été élaborée par un groupe de spécialistes du Haut Commissariat au Plan (Observatoire des conditions de vie de la population), formé de Mme Ikira D . (Statisticienne) et MM. Douidich M. (Statisticien-économiste), Ezzrari J. (Economiste), Nekrache H. (Statisticien- démographe) et Soudi K. (Statisticien-démographe). Qu’ils en soient vivement remerciés. Mes remerciements vont aussi à MM. Benkasmi M. et Teto A. d’avoir participé aux travaux préparatoires de cette étude, et à Mr Peter Lanjouw, fondateur de la cartographie de la pauvreté, d’avoir été en contact permanent avec l’ensemble de ces spécialistes. SOMMAIRE Ahmed LAHLIMI ALAMI Haut Commissaire au Plan 2 SOMMAIRE Page Partie I : PRESENTATION GENERALE I. Approche de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l’inégalité 1.1. Concepts et mesures 1.2. Indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité au Maroc II. Objectifs et consistance des indices communaux de développement humain et de développement social 2.1. Objectifs 2.2. Consistance et mesure de l’indice communal de développement humain 2.3. Consistance et mesure de l’indice communal de développement social III. Cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social IV. Niveaux et évolution de la pauvreté, du développement humain et du développement social 4.1. Niveaux et évolution de la pauvreté 4.2. -

Monograpphie De La Region De Marrakech Safi(1)
ROYAUME DU MAROC Ministère de l’Intérieur Direction Générale des Collectivités Locales La Région de Marrakech-Safi MONOGRAPHIE GENERALE 2015 SOMMAIRE I. PREAMBULE .............................................................................................................................................. 1 II. PRESENTATION GENERALE DE L'ESPACE REGIONAL ................................................................................... 2 1. CADRE ADMINISTRATIF ....................................................................................................................................... 2 2. CADRE GEOGRAPHIQUE ...................................................................................................................................... 5 III. CONDITIONS ET RESSOURCES NATURELLES ............................................................................................... 7 1. CLIMAT ET PRECIPITATIONS ................................................................................................................................. 7 2. RESSOURCES HYDROGRAPHIQUES ......................................................................................................................... 8 a) Les eaux de surface ................................................................................................................................. 8 b) Les eaux souterraines .............................................................................................................................. 9 3. LA FORET ..................................................................................................................................................... -

Télécharger Le Document
CARTOGRAPHIE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL MULTIDIMENSIONNEL NIVEAU ET DÉFICITS www.ondh.ma SOMMAIRE Résumé 6 Présentation 7 1. Approche méthodologique 8 1.1. Portée et lecture de l’IDLM 8 1.2. Fiabilité de l’IDLM 9 2. Développement, niveaux et sources de déficit 10 2.1. Cartographie du développement régional 11 2.2. Cartographie du développement provincial 13 2.3. Développement communal, état de lieux et disparité 16 3. L’IDLM, un outil de ciblage des programmes sociaux 19 3.1 Causes du déficit en développement, l’éducation et le niveau de vie en tête 20 3.2. Profil des communes à développement local faible 24 Conclusion 26 Annexes 27 Annexe 1 : Fiabilité de l’indice de développement local multidimensionnel (IDLM) 29 Annexe 2 : Consistance et méthode de calcul de l’indice de développement local 30 multidimensionnel Annexe 3 : Cartographie des niveaux de développement local 35 Annexes Communal 38 Cartographie du développement communal-2014 41 5 RÉSUMÉ La résorption ciblée des déficits socio-économiques à l’échelle locale (province et commune) requiert, à l’instar de l’intégration et la cohésion des territoires, le recours à une cartographie du développement au sens multidimensionnel du terme, conjuguée à celle des causes structurelles de son éventuel retard. Cette étude livre à cet effet une cartographie communale du développement et de ses sources assimilées à l’éducation, la santé, le niveau de vie, l’activité économique, l’habitat et les services sociaux, à partir de la base de données «Indicateurs du RGPH 2014» (HCP, 2017). Cette cartographie du développement et de ses dimensions montre clairement que : - La pauvreté matérielle voire monétaire est certes associée au développement humain, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’identifier les communes sous l’emprise d’autres facettes de pauvreté. -

MPLS VPN Service
MPLS VPN Service PCCW Global’s MPLS VPN Service provides reliable and secure access to your network from anywhere in the world. This technology-independent solution enables you to handle a multitude of tasks ranging from mission-critical Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), quality videoconferencing and Voice-over-IP (VoIP) to convenient email and web-based applications while addressing traditional network problems relating to speed, scalability, Quality of Service (QoS) management and traffic engineering. MPLS VPN enables routers to tag and forward incoming packets based on their class of service specification and allows you to run voice communications, video, and IT applications separately via a single connection and create faster and smoother pathways by simplifying traffic flow. Independent of other VPNs, your network enjoys a level of security equivalent to that provided by frame relay and ATM. Network diagram Database Customer Portal 24/7 online customer portal CE Router Voice Voice Regional LAN Headquarters Headquarters Data LAN Data LAN Country A LAN Country B PE CE Customer Router Service Portal PE Router Router • Router report IPSec • Traffic report Backup • QoS report PCCW Global • Application report MPLS Core Network Internet IPSec MPLS Gateway Partner Network PE Router CE Remote Router Site Access PE Router Voice CE Voice LAN Router Branch Office CE Data Branch Router Office LAN Country D Data LAN Country C Key benefits to your business n A fully-scalable solution requiring minimal investment -

11892452 02.Pdf
Table of Contents A: SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS B: WATER LEVEL FLUCTUATION AND GEOLOGICAL CROSS SECTION IN THE HAOUZ PLAIN C: CLIMATE, HYDROLOGY AND SURFACE WATER RESOURCES D: IRRIGATION E: SEWERAGE AND WATER QUALITY F: WATER USERS ASSOCIATIONS AND FARM HOUSEHOLD SURVEY G: GROUNDWATER MODELLING H: STAKEHOLDER MEETINGS - i - A: SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS Table of Contents A: SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS A.1 Social and Economic Conditions of the Country ------------------------------------------ A - 1 A.1.1 Administration------------------------------------------------------------------------- A - 1 A.1.2 Social Conditions ------------------------------------------------------------------------ A - 1 A.1.3 Economic Conditions----------------------------------------------------------------- A - 2 A.1.4 National Development Plan ------------------------------------------------------------ A - 3 A.1.5 Privatization and Restructuring of Public Utilities ------------------------------- A - 5 A.1.6 Environmental Policies--------------------------------------------------------------- A - 6 A.2 Socio-Economic Conditions in the Study Area -------------------------------------------- A - 8 A.2.1 Social and Economic Situations----------------------------------------------------- A - 8 A.2.2 Agriculture ----------------------------------------------------------------------------- A - 9 A.2.3 Tourism--------------------------------------------------------------------------------- A - 11 A.2.4 Other Industries----------------------------------------------------------------------- -

Pris En Application Du Dahir Portant Loi N° 1-74-338 Du 24 Joumada II 1394 (15 Juillet 1974) Relatif À L’Organisation Judiciaire (B.O
Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire (B.O. 17 juillet 1974) Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire (B.O. 17 juillet 1974) Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire Bulletin Officiel du 17 juillet 1974 Vu le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume ; Après examen par le Conseil des ministres réuni le 11 joumada II 1394 (2 juillet et 1974). Article Premier : L’organisation judiciaire comporte un certain nombre de juridictions dont le siège et le ressort sont fixés conformément au tableau annexé (1). Cours d’appel et tribunaux de première instance Tableau annexé au décret 2-74-498 tel qu’abrog. et rempl. par le n° 2-96-467 20 nov. 1996- 8 rejeb 1417 : BO 2 janv. 1997, p 3 tel que mod. par le décret 2-99-832 du 28 septembre 1999-17 joumada II 1420 ; par le Décret n° 2-00-732 du 2 novembre 2000 – 5 chaabane 1421- B.O du 16 novembre 2000 et par le décret n° 2-02-6 du 17 juillet 2002-6 joumada I 1423 (B.O du 15 août 2002, décret n° 2-03-884 du 4 mai 2004 – 14 rabii I 1425 ; B.O. -
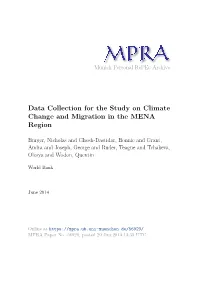
Data Collection for the Study on Climate Change and Migration in the MENA Region
Munich Personal RePEc Archive Data Collection for the Study on Climate Change and Migration in the MENA Region Burger, Nicholas and Ghosh-Dastidar, Bonnie and Grant, Audra and Joseph, George and Ruder, Teague and Tchakeva, Olesya and Wodon, Quentin World Bank June 2014 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56929/ MPRA Paper No. 56929, posted 29 Jun 2014 13:35 UTC Data Collection for the Study on Climate Change and Migration in the MENA Region Nicholas Burger, Bonnie Ghosh-Dastidar, Audra Grant, George Joseph, Teague Ruder, Olesya Tchakeva, and Quentin Wodon June 2014 This paper is forthcoming in: Wodon, Q., A. Liverani, G. Joseph and N. Bougnoux, 2014 editors, Climate Change and Migration: Evidence from the Middle East and North Africa, Washington, DC: The World Bank. Abstract A large part of this study is based on data collected in 2011 in five focus countries of the MENA region. In addition, other existing data sources were used as well, as documented in the various chapters that follow, but this need not be discussed in this chapter. This chapter documents the process followed and some of the choices made for new data collection, both quantitative and qualitative, for the study on climate change and migration in the MENA region. After a brief introduction, we explain the nature of the household survey questionnaire, what it enables us to document, as well as some of its limits. Next, we explain how the household survey sites were selected and how the samples were constructed in each of the five focus countries. We also provide a few comments on the challenges encountered during survey implementation. -

Maroc Bulletin Officiel
Cent-neuvième année – N° 6854 11 joumada II 1441 (6 février 2020) ISSN 0851 - 1217 ROYAUME DU MAROC BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE TARIFS D’ABONNEMENT ABONNEMENT EDITIONS AU MAROC IMPRIMERIE OFFICIELLE { A L’ETRANGER RABAT - CHELLAH 6 mois 1 an Tél. : 05.37.76.50.24 ‑ 05.37.76.50.25 A destination de l’étranger, 05.37.76.54.13 par voies ordinaire, aérienne 250 DH 400 DH Compte n° : Edition générale................................................................... ou de la poste rapide interna‑ Edition de traduction officielle............................................. 150 DH 200 DH tionale, les tarifs prévus ci‑ 310 810 1014029004423101 33 Edition des conventions internationales................................ 150 DH 200 DH contre sont majorés des frais ouvert à la Trésorerie Préfectorale de Rabat d’envoi, tels qu’ils sont fixés 250 DH 300 DH Edition des annonces légales, judiciaires et administratives... par la réglementation postale au nom du régisseur des recettes Edition des annonces relatives à l’immatriculation foncière.. 250 DH 300 DH en vigueur. de l’Imprimerie officielle Cette édition contient la traduction officielle des lois et règlements ainsi que tous autres décisions ou documents dont la publication au Bulletin officiel est prévue par les lois ou les réglements en vigueur Pages Pages SOMMAIRE fonds fiduciaire du Fonds pour les technologies propres (FTP), pour la garantie du prêt de vingt TEXTES GENERAUX millions de dollars américains (20.000.000,00 $), consenti par ledit Fonds à Moroccan Agency Secrétaire d’Etat auprès du ministre de for Sustainable Energy (MASEN), pour le l’agriculture, de la pêche maritime, du financement du projet de Complexe solaire Noor développement rural et des eaux et forêts Midelt - Première phase - Centrale Noor I. -

Synthèse)Groupes)3)Et)4
Synthèse Compte Rendu d’Atelier Groupes 3 et 4 – V2 Objet Atelier d’information et de consultation (Etude pour un systèmpe de GIRE dans le sous-bassin de Chichaoua) Date et Lieu 22 Décembre - Chichaoua Participants Acteurs du sous-bassin des ressources en eau ((liste ci-jointe) Thème Eau potable et assainissement Groupe 3 4 Animateur M. KAMIL M. HADRI Rapporteur M. GHAZOUANI M. AACHRINE Constats, dysfonctionnement et causes Propositions et recommandations A-! AEP A4- Propositions et recommandations AEP A1- Constats Face à ces contraintes plusieurs solutions ont été trouvées. Elles sont jugées comme •! Taux de desserte dans les communes varie entre 30% (cas de la commune provisoires, car elles émanent de la volonté de quelques individus ou des structures, d’Irohalen) et 100% (cas de la commune de Sidi Bouzid) ne permettent pas, en raison de leur coût de toucher toute la population, ont un •! Les gestionnaires de l’AEP rurale sont : l’ONEE, les associations et les caractère volontariste et sont justifiées par l'urgence des besoins et par la nécessité communes de satisfaire une catégorie de population exclue de l'accès à la ressource : Les changements climatiques et en particulier l'aridification du climat sont de l'avis de tous les participants la première cause de pénurie généralisée d'eau, ‒! Les communes ont pris en charge l'approvisionnement en eau via un que ce soit au niveau des zones de montagne ou dans les communes de plaine. camion citerne des foyers qui n'y ont pas accès. C'est le cas de la CR de Quatre aspects ont été mis en exergue : Lamzoudia. -

(AUEA) / Farm Household Survey 3.6.1 Problems
3.6 Issues Relating to Water Resources Management and Water Users Association (AUEA) / Farm Household Survey 3.6.1 Problems and Constraints of Water Sector of the State The World Bank issued the Country Assistance Strategy (CAS) for Morocco in 2005. For the formulation of strategy of water sector assistance to the government, they analyzed the present constraints for the long-term development program for the water sector on 1) Ensure better governance of the water sector, 2) Ensure that the population and economic sector’s water demands are met in a sustainable manner. They are summarized in Table 3.6.1. Based on the CAS, presently Water Sector Reform Project (DPL) is under operation 3.6.2 Problems and Constraints on Water Resources in the Study Area (1) Present water supply and demands The water source of the Study Area relies on rainfall and snow in the Tensift River Basin and they are used as river water, dam water and recharged groundwater. The water transferred from the Oum Er Rbia River Basin, which is located neighboring to the Tensift River Basin, as to cover the deficit as well. The amounts of water use by source types are: 336 Mm3/year (36%) by surface water including river water and dam water, 505 Mm3/year (54%) by groundwater, and 101 Mm3/year (11%) by transferred water in the average of 1993/94-2003/04. The amount of available water is limited in whole sources, so that the water demand is not fully satisfied at present. This water deficit causes limitation of economic activity especially in the agricultural sector in the Area.