Saint-Laurent· Vision
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annexes Du Rapport Principal
Nature et tourisme : L’écotourisme au Québec en 2002 Annexes du rapport principal Rapport produit par Éco Tour Conseils Etc. Maurice Couture, Adm. A. avec la collaboration de Sébastien Cloutier Tourisme Québec Table de concertation sur l’écotourisme au Québec Octobre 2002 Octobre 2002/ Nature et tourisme : L’écotourisme au Québec en 2002 Liste des annexes Annexe « A » : Fiches descriptives des principales ressources écotouristiques par région administrative Annexe « B » : Information sur l’offre d’une sélection de producteurs « spécialisés » en écotourisme du Québec Annexe « C » : Sélection de membres d’Aventure et Écotourisme Québec offrant des produits d’écotourisme Annexe « D » : Villages présentant des potentiels comme étape d’un circuit d’écotourisme ou comme lieu de séjour à proximité de milieux naturels Annexe E : Description des 150 produits offerts à destination du Canada à partir du site Web iExplore Annexe « F » : Exemples de produits concurrents au niveau international Annexe « G » : Exemples de produits offerts par des organismes internationaux de conservation Annexe « H » : Exemples de produits concurrents ailleurs au Canada Annexe « I » : Produits touristiques autochtones liés à de l’écotourisme ou du tourisme de nature Annexe « J » : Contenus descriptifs des guides touristiques 2001-2002 des ATR du Québec liés aux produits de tourisme de nature et d’écotourisme du Québec Annexe « K » : Contenus promotionnels des guides touristiques 2001- 2002 des ATR du Québec concernant les produits de tourisme de nature et -

Santa Claus Comes to Cascapedia-St-Jules
lt is Season’s Greetings! beginning 20 Adams, Gaspé, Quebec G4X 2R8 Tel.: (418) 368-2244 to look a lot Fax: (418) 368-6963 like our favourite time of year, ÉGIDE DUPUIS ET FILS INC. and we’d like to share well 300 boul. York South Gaspé, Quebec G4X 2L6 wishes with the friends Tel.: 418-368-5778 / 4124 we hold so dear: Fax: 418-368-7202 May your Christmas be merry, happy, healthy and bright, and may your New Year deliver continued delight! Thank you for shopping locally and making 2016 a great year for all of us. We appreciate your support, and we look forward 398, boulevard York South. Gaspé, Québec to serving you again soon. Tel.: 418-368-5055 / Fax: 418-368-2345 Martin Gagnon et Vicky Fournier Uniprix Desneiges Plourde Carrefour Gaspé: 80, boul. Renard Est 39, montée Sandy Beach, Gaspé Rivière-au-Renard Tel : 418-368-3341 Tel : 418-269-3351 Uniprix Martin Gagnon et Vicky Fournier 400, boulevard York South, Gaspé, Québec Place Jacques Cartier 167, rue de la Reine, Gaspé Tel.: 418-368-1575 / Fax 418-368-2345 Tel : 418-368-5595 Page 19, December 21, 2016 - Spec Photo: Courtesy of Philmcreations Santa Claus comes to Cascapedia-St-Jules Elaine Sexton here after arriving from the North Pole. CASCAPEDIA-ST-JULES: - Pictured above are the children and parents Thank you to the Eagles Club who provided the treats for all the chil- who enjoyed a visit from Santa Claus recently at the municipal hall in Cas- dren. A big thanks to those who made the gingerbread men for the kids to capedia-St-Jules. -
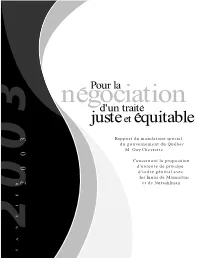
Justeet Equitable
Pour la negociationd'un traite juste et equitable Rapport du mandataire spécial du gouvernement du Québec M. Guy Chevrette Concernant la proposition d'entente de principe d'ordre général avec les Innus de Mamuitun 2003 et de Nutashkuan JANVIER Pour la négociation d'un traité juste et équitable Table des matières 1. PRÉAMBULE. 5 2. LES GRANDS CONSTATS . 7 3. LES TERRITOIRES EN CAUSE ET LES PRINCIPES ET MODALITÉS QUI S’Y APPLIQUERAIENT. 11 3.1 Le Nitassinan. 11 3.1.1 La propriété . 11 3.1.2 L’étendue. 11 3.1.3 Les activités traditionnelles de chasse, de pêche, de trappe et de cueillette (Innu Aitun) . 12 3.1.4 La participation au développement. 14 a) Forêt, mines et pourvoiries. 14 b) Parcs, réserve faunique et aires d’aménagement et de développement. 15 3.1.5 La participation aux processus gouvernementaux de la gestion du territoire . 16 3.1.6 Les redevances. 16 3.2 L’Innu Assi . 16 3.2.1 L’autonomie gouvernementale. 17 3.2.2 L’autonomie financière. 17 3.2.3 Les droits des tiers sur l’Innu Assi . 18 3.2.4 Les cas particuliers de Nutashkuan et d’Essipit . 19 4. LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION ET AUTRES CONSIDÉRATIONS . 21 4.1 La participation au processus de négociation et d’information. 21 4.2 La participation aux processus postnégociation . 22 4.3 Le cas de Sept-Îles et de Uashat-Maliotenam . 22 4.4 La clause concernant la Constitution de 1982 . 22 4.5 Référendum ou consultation . 23 CONCLUSION . 25 RECOMMANDATIONS . 27 ANNEXES A. -

The Fishing Industry in Quebec Socio-Economic Profile Gaspé Area 2004
The Fishing Industry in Quebec Socio-Economic Profile Gaspé Area 2004 Prepared by Policy and Economic Branch Quebec Region THE FISHING INDUSTRY IN QUEBEC SOCIO-ECONOMIC PROFILE GASPÉ AREA May 2004 FISHERIES AND OCEANS CANADA QUEBEC REGION Policy and Economics Branch Fisheries and Oceans Canada, Quebec Region Published by: Policy and Economics Branch Fisheries and Oceans Canada Quebec, QC G1K 7Y7 ©Her Majesty the Queen in Right of Canada Catalogue Number Fs 66-5/173F ISSN 0847-1185 May 2004 Cette publication est également disponible en français. The Fishing Industry in the Gaspé Area Socio-Economic Profile 2004 PRODUCTION TEAM Editorial Staff Élisabeth Koulouris, DRPE, DFO, Quebec Region Julie Lavallée, DRPE, DFO, Quebec Region Frédéric Lessard, DRPE, DFO, Quebec Region Ali Magassouba, DRPE, DFO, Quebec Region Contributors Chantal Bernier, DRPE, DFO, Quebec Region David Courtemanche, DRPE, DFO, Quebec Region Claude Arseneault, HRSDC Gérald Dubé, HRSDC Sylvain Labbé, HRSDC Text Editing and Layout Francine Dufour, DRPE, DFO, Quebec Region Cathy Rioux, DRPE, DFO, Quebec Region Model Design Thomas Larouche, DRPE, DFO, Quebec Region COVER PHOTOS Harrington Harbour: Fisheries and Oceans Canada At Work on the Boat: Fisheries and Oceans Canada, V. Haeberlé Shrimp Processing (Eastern Quebec Seafoods Ltd. (1998): Fisheries and Oceans Canada, J. Lavallée ACRONYMS BAPAP: Bureau d’accréditation des pêcheurs et aides-pêcheurs du Québec CRIQ: Centre de recherche industriel du Québec DFO: Fisheries and Oceans Canada DRPE: Policy and economics Branch HRSDC: Human Resources and Skills Development Canada MAPAQ: Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ABBREVIATIONS SYMBOLS $M: millions of dollars p: preliminary $B: billions of dollars no: number $K: thousands of dollars Policy and Economics Branch Fisheries and Oceans Canada, Quebec Region ACKNOWLEDGEMENTS A great amount of statistical data from the Fisheries Management Branch’s Statistical Services was required to complete this study. -

| 1 Portrait De La Communauté De New Carlisle
| 1 Portrait de la communauté de New Carlisle « Sortir du cadre du gouvernement pour impliquer la société civile, le secteur du bénévolat et le secteur privé est un pas essentiel vers l’action pour l’équité en santé. Une plus grande participation communautaire et sociale au processus d’élaboration des politi- ques aide à prendre des décisions justes sur les questions d’équité en santé. » (Organisation Mondiale de la Santé). AUTEURES Mary Richardson, Ph.D., anthropologue, Direction du développement des individus et des communautés, Institut national de santé publique du Québec Joëlle Gauvin-Racine, M.A., anthropologiste CONCEPTION ET MISE EN PAGE CMA Medeiros, Réseau communautaire de la santé et des services sociaux TRADUCTION Anne Rogier, interprète et traductrice accréditée REMERCIEMENTS Nous tenons à remercier CASA pour leur collaboration exceptionnelle, en particulier Cathy Brown (directrice), Maria Chatterton (coordonnatrice) et Fay Gallon (agente administrative). Nous remercions également Denise Dallain et la municipalité de New Carlisle, David Felker de CASA, Valerie Gilker de CEDEC et le CSSS Baie-des-Cha- leurs. Nous désirons aussi remercier Denis Hamel et Mélanie Tessier de l’Institut national de santé publique du Québec pour leur aide précieuse avec les données statistiques. 2 | Table des matières Un projet de développement des communautés 4 Bâtir des communautés en santé 4 Accès aux soins de santé parmi les groupes linguistiques minoritaires 6 Des réalités changeantes au sein des populations d’expression anglaise au Québec 7 -

Compensation Policy Issue
United Nations Environment Programme Dams and Development Project Compendium on Relevant Practices - 2nd Stage Compensation Policy Issue Monetary compensation for lost assets and loss of access to resources Livelihood restoration and enhancement Community development Catchment development Final Report Prepared by: Mr. Vincent ROQUET, Sociologist and Planner, Lead Consultant with Ms. Carine DUROCHER, Anthropologist Vincent Roquet & Associates Inc. 560 Sainte-Croix Avenue, suite 101, Montreal (Quebec) Canada, H4L 3X5 Tel: +1 (514) 849-3030; Fax: +1 (514) 849-3322 Email: [email protected] September 15th, 2006 Table of Contents Page EXECUTIVE SUMMARY....................................................................................................................... vi 1 – INTRODUCTION ................................................................................................................................ 1 1.1 Context........................................................................................................................................ 1 1.2 Study Objective........................................................................................................................... 1 1.3 Study Process.............................................................................................................................. 2 1.4 Contents of Final Report............................................................................................................. 2 2 – METHODOLOGY.............................................................................................................................. -

Genealogy and Historical Societies in Québec
Genealogical Collections preserved at various Genealogy and Historical Societies in Québec * original pioneer papers, original manuscripts, family papers, township papers, towns and villages papers, indexed church records of births, marriages, deaths, indexed cemetery listings, indexed land grants, local census records, forgotten villages and old place names, church history, history books, publications for sale which can be found at various societies across this province and surrounding regions. 1 Table of Contents Ascott Heritage ........................................................................................................................................... 5 Aylmer Heritage Association ....................................................................................................................... 5 Beaurepaire-Beaconsfield Historical Society............................................................................................... 5 Brome County Historical Society ................................................................................................................. 5 Cascapedia Bay Heritage - Cacapedia River Museum ................................................................................. 5 Chateauguay Valley Historical Society ........................................................................................................ 6 Coasters Association Inc ............................................................................................................................. 6 -

Notaries of the Gaspé Peninsula Guide
Some Tips for Researching Gaspé Ancestors The Loyalist Families of the Bay of Chaleur http://gogaspe.com/host/annett/volume1/10 Claims of The Loyalists Bay Chaleur.pdf http://gogaspe.com/host/annett/volume5/179 Applications for Gaspe Lands from 1764.pdf http://gogaspe.com/host/annett/volume2/33 New Carlisle in Infancy.pdf http://gogaspe.com/host/annett/volume2/36 The Great Famines of Gaspe.pdf http://gogaspe.com/host/annett/volume2/48 Land Patents in Gaspesia.pdf http://qahn.org/awardrecipient/kenneth-hugh-annett http://gogaspe.com/host/annett/volume2/37 Edward Issac Mann.pdf The Loyalist Churches of the Gaspé Peninsula https://genealogyensemble.files.wordpress.com/2014/11/gaspe-loyalist- churches.pdf Online database at Library Archives Canada (LAC/BAC) under the general heading of Gaspe Land Commission Documents: http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genite m.displayItem&rec_nbr=204972&lang=fre&rec_nbr_list=3837858,3837842,4 125828,204972,4195175,3813470,1370088,749242,3747372,1684305 Database you can research by name: http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/terres/gaspe-land-commission- demandeurs/Pages/liste-noms-demandeurs.aspx Database with research option by family name: In regard to the Loyalist families of Chaleur Bay, among the collections at the BAnQ Gaspé are original documents addressing food distribution to needy Loyalist families during the famine period of 1816. These documents were previously held by the Provincial Court of the District of Gaspé - Dossiers #2002- 02-016/1, cote TL26,S2,SSS777 (Cote stands for shelf item #) Description of these documents: 1816-1918 – December 14th 1816 – January 3rd 1817, written correspondence between François Demers, priest, and William Crawford, judge of the Provincial Court for the District of Gaspé, addressing the citizens of Chaleur Bay in regard to a famine that affected the Bay of Chaleur from December 14th 1816 to March 22nd 1817. -

Mine Arnaud Project
m ine Arnaud Project Environmental Impact Statement Summary DEc EmbER 2012 PROJEcT NO.: 121-17926-00 ARNAUD MINE PROJECT ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT SUMMARY Prepared for Mine Arnaud inc. By GENIVAR inc. Approved by : Bernard Massicotte, M.Sc. Biologist DECEMBER 2012 121-17926-00 WORK TEAM GENIVAR Project Manager : Bernard Massicotte, Biol., M.Sc. Assistant Project Manager : Mathieu Cyr, Geogr., M.Env. Activity Manager : Hélène Desnoyers, Geogr., MA Collaborator : Marie-Hélène Brisson, Biol., B.Sc. Geomatics : Ludovic Deschênes, Cartogr. Edition : Linette Poulin Recommended citation: GENIVAR, 2012. Arnaud Mine Project. Environmental Impact Statement - Summary. Filed with the Canadian Environmental Assessment Agency. Report to Mine Arnaud by GENIVAR inc. 107 p. Mine Arnaud – Environmental Impact Statement Summary GENIVAR 121-17926-00 December 2012 i TABLE OF CONTENTS Page Work team ................................................................................................................................. i Table of contents ...................................................................................................................... iii List of tables ............................................................................................................................. vii List of maps ............................................................................................................................. vii List of figures .......................................................................................................................... -

The Loyalist Churches of the Gaspé Peninsula
The Loyalist Churches of the Gaspé Peninsula Compiled by: Jacques Gagné - [email protected] Last up-date: June 24th 2014 1 The Loyalists Churches of the Gaspé Peninsula Contents Those who served 4 Towns & Villages 5 Bonaventure County 6 2 Cox Township 6 Gaspé County 6 Matapédia County 6 Towns and villages 8 Anse-à-Brillant 8 Baie de Gaspé Sud 9 Cap-au-Renard 13 Douglastown - 19 Entry Island 20 Flatlands 22 Gascons 24 Haldimand - 29 Indian Cove 29 Jersey Cove 30 Kaskibijack 30 L’Anse à Beaufils 31 Magdalen Isles 33 New Carlisle 38 Old Harry 43 Pabos 43 Restigouche ( 49 Sandy Beach 54 Tracadiac 57 Wakeham - 57 York Centre 58 Regional Genealogical Repositorie 59 Online Sources 59 Contributors or source material 62 3 Dr. Kenneth Hugh Annett - Ken Annett deserves a special place in the hearts of many He is perhaps best known to the readers of SPEC for his countless hours of research which produced the series Gaspé of Yesterday. Composed of over 400 articles on aspects of Gaspesian Heritage, Gaspé of Yesterday reflects the historic time-frame of Anglophone Gaspesian History. SPEC received a copy of each article and has published some 190 of them The bound volumes can be consulted at the Gaspesian British Heritage Centre, the Gaspé Community Library, the Literary and Historical Society of Québec, the Bishop's University Library, the Archives of the Anglican Diocese of Quebec and the Archives nationales du Québec in Québec City - A few articles of Ken Annett, published by SPEC can be found among the David McDougall Collection at the QFHS library. -

Patient Refused at the Paspebiac CLSC Was Already Dead Geneviève Gélinas a 74-Year-Old Man, from Duguay Remained Vague About Vestigation
Contract 400119680 ESTABLISHED • MAY 1975 VOLUME 43 / NO 49 / DECEMBER 13, 2017 $1.50 (Tax included) Patient refused at the Paspebiac CLSC was already dead Geneviève Gélinas A 74-year-old man, from Duguay remained vague about vestigation. from 10 p.m., the paramedics Bonaventure suffered from what could be done to reduce “The real issue remains. have to drive the patient to the GASPÉ: – The death of a man cardiac arrest at 11:13 p.m. The those delays. “The analysis has Will we have, yes or no, a doc- closest hospital emergency, refused at the Paspebiac CLSC paramedics initiated cardiopul- to be made with the para- tor on duty 24 hours a day, Maria or Chandler. But the the night of November 23 has monary resuscitation when medics. Then if there are re- seven days a week, in the fu- guidelines provided by the nothing to do with the absence they arrived at 11:25 pm. When quests to be made at the ture? If somebody has a heart CISSS to the paramedics men- of a doctor on duty during that they called the CLSC at 11:45 ministry, that’s our responsibil- attack and is driven (to the tion some exceptions, includ- night, an internal inquiry made p.m., the team of one doctor ity.” CLSC) by his wife, he won’t ing a cardiac arrest. In such a by the Gaspésie Integrated and five nurses directed them The report was completed be received?,” reacted the Parti case, they must go to the Health and Social Service Cen- to the Maria hospital, 57 kilo- on November 29 but wasn’t québécois Bonaventure MNA Paspebiac CLSC. -

Investigation Into Possible Connection Between Patient Death and Doctor Shortage Gilles Gagné
Inside this week QUIZ Only one coroner Exceptional year Christmas Quiz - page 16 on the Gaspé Peninsula for tourism on the Gaspé Contract 400119680 VOLUME 43 / NO 47 / NOVEMBER 29, 2017 $1.50 (Tax included) PASPEBIAC CLSC: Investigation into possible connection between patient death and doctor shortage Gilles Gagné PASPEBIAC: - The Ministry of Health and the Gaspé Peninsula Health Agency are conducting an investigation in an attempt to determine the circumstances surrounding the death of a patient during a transfer between his Bonaventure home, the Paspebiac CLSC and the Maria Hospital on November 23. He was suffering from cardiac arrest. The patient was brought to the Paspebiac CLSC at 11:45 p.m. but there was no doctor on duty between mid- night and the following morning, November 24 at 8 a.m. The nurse on duty al- legedly informed the para- medics who had driven the patient to the Paspebiac CLSC that there was no gen- eral practitioner at the emer- gency at the time. A day later, Photo: J. Imhoff she was suspended until fur- Between June 1 and mid-November, the Paspebiac CLSC was unable to fill 28 general practitioner shifts at the emergency. ther notice. The paramedics conse- quently drove the patient to Highway 132 bridge closure coming is unacceptable (…) patients. saved, had a general practi- Maria hospital, where he was between New Richmond and It is bad decision-making.” The Paspebiac CLSC has tioner been on duty in Paspe- pronounced dead. One of the Gesgapegiag. He also added that “medi- been plagued with holes in its biac.