PLU Angervilliers
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
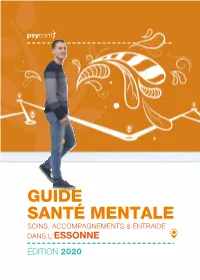
Guide Santé Mentale Soins, Accompagnements & Entraide Dans L’Essonne Édition 2020 2 Édito
GUIDE SANTÉ MENTALE SOINS, ACCOMPAGNEMENTS & ENTRAIDE DANS L’ESSONNE ÉDITION 2020 2 ÉDITO a publication d’un guide santé mentale pour chaque dépar- L tement francilien est une des actions majeures du Psycom, soute- nue par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France. Psycom est un groupement de coopération sanitaire à vocation régionale. Il a pour principales missions d’informer le public et les professionnels sur la santé mentale, ainsi que d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie et l’inclusion sociale et citoyenne des personnes vivant avec un trouble psychique. Chaque guide contribue à la mise en œuvre d’un des objectifs du projet régional de santé : assurer une meilleure lisibilité de l’offre de prise en charge et d’accompagnement, qu’elle soit sanitaire, médico-sociale et sociale. Ce travail est le fruit de la collaboration quotidienne avec l’ensemble des acteurs de la santé mentale du territoire. Je tiens à remercier, chaleureusement, toutes les personnes qui se sont engagées au service de ce projet. Psycom développe d’autres actions en matière de com- munication, d’information, de formation et de conseils en santé mentale. Je vous invite à consulter son site Internet, www.psycom.org, pour en prendre connaissance et partager autour de vous ces initiatives en faveur de la promotion de la santé mentale et de l’accès aux soins. Lazare Reyes, Administrateur du Psycom 3 4 INTRODUCTION u cours des 40 dernières années, l’organisation des soins psychiatriques a beaucoup évolué, passant des soins A hospitaliers aux soins dans la Cité, au plus près des lieux de vie des personnes et de leur entourage. -

1. Rapport De Présentation Suite Contrôle De Légalité
PLU du VAL-SAINT-GERMAIN– Rapport de présentation 93 bis Rue Village 91530 Le Val-Saint-Germain P.L.U. Révision du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation 1 Document approuvé en Conseil Municipal du 16 octobre 2018, complété SOMMAIREsuite au contrôle de légalité 0 Document arrêté par le Conseil Municipal du 20 décembre 2017 PLU du VAL-SAINT-GERMAIN– Rapport de présentation 1 Document approuvé par le Conseil Municipal du 16 octobre 2018, complété suite au contrôle de légalité PLU du VAL-SAINT-GERMAIN– Rapport de présentation SOMMAIRE : PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC ET FONCTIONNEMENT TERRITORIAL 8 Chapitre 1.1. – Eléments de cadrage .................................................................................................................... 9 1.1.1. Situation générale .................................................................................................................................. 9 1.1.2. Contexte intercommunal ........................................................................................................................ 9 1.1.3. Présentation du territoire communal .................................................................................................... 10 Chapitre 1.2. – Données démographiques ......................................................................................................... 11 1.2.1. La population communale et ses évolutions ........................................................................................ 11 1.2.2. Les caractéristiques de la population.................................................................................................. -

La Validation, La
pour COMMENT RÉSERVER ? Forfaits & tickets La validation, à valider à chaque voyage sur le réseau c’est obligatoire ! Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités dédiée au transport à la demande et sur laquelle Avant de monter dans le bus, préparez votre passe Navigo Réservez vous pouvez : Les forfaits Navigo ou votre ticket. 1. créer votre compte Pour tous Navigo annuel validez-les VOYAGEZ Navigo mois 2. réserver votre trajet* systématiquement Navigo semaine RÉSERVEZ pour éviter 3. suivre votre TàD en temps réel Navigo jour CONSULTEZ une amende. 4. évaluer votre trajet Jeunes Imagine R Étudiant LA DEMANDE LA À T R TRANSPO Imagine R Scolaire Gratuité Jeunes en insertion PAYS DE LIMOURS DE PAYS Rendez-vous sur le TàD Tarifs réduits et gratuité Navigo gratuité VALABLE À PARTIR DU 31 AOÛT 2020 AOÛT 31 DU PARTIR À VALABLE Pays de Navigo Solidarité mois Limours Navigo Solidarité semaine Navigo Tarification Senior Limours Améthyste Pays de Pays U A E V NOU * à partir de 30 jours à l’avance et jusqu’à 20 Commandez et rechargez votre passe Navigo minutes avant le départ selon vos besoins et votre profil sur iledefrance-mobilites.fr, aux guichets et dans les agences des transporteurs (RATP, SNCF, Optile). RENDEZ-VOUS SUR : Les tickets Disponibles en gares, stations et agences 93100 (au format papier ou rechargeables SAVAC Appli TàD sur votre passe Navigo Easy) : SAVAC Île-de-France Ticket t+ Mobilités À l’unité ou en carnet de 10 tickets, tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans, les titulaires de la carte Famille tad.idfmobilites.fr Nombreuse -

Saint -Jean -De -Beauregard De L’Agitation Urbaine
Saisissant contraste entre le monde rural et l’urbanisation galopante, entre hier et aujourd’hui, Saint-Jean-de-Beauregard se compose d’un chef-lieu de commune et de deux hameaux, Villeziers et La Gâtine. En 1610, le seigneur du lieu, François DUPOUX obtint, par lettres patentes, de changer le nom d’origine, Montfaucon, en Beauregard. 300 Belliregardinois vivent dans ce village au milieu de 390 hectares de terres agricoles et de bois. Comme les champs de céréales et les collines boisées qui l’entourent, il offre une oasis de calme à un jet de pierre Saint -Jean -de -Beauregard de l’agitation urbaine. PATRIMOINE A NE PAS MANQUER... Le château Harmonie de trois couleurs, celles de la brique, l’ardoise et la pierre, dans une architecture classique du 17ème siècle. Habité en permanence et entretenu avec amour. Outre la curiosité de visiter une demeure habitée - beau mobilier rassemblé par la famille de Caraman - s’ajoute ici l’attrait du potager. Entièrement clos de murs, il mêle, sur deux hectares, les carrés de légumes oubliés, les pivoines et les roses anciennes. Les amateurs s’y retrouvent deux fois l’an pour des manifestations réputées (voir agenda). Le pigeonnier Lavoir de Villeziers Contemporain du château, c’est le plus important de la région. Ses 4 500 cases ou boulins, témoignent de l’importance du domaine. Une curieuse échelle tournante (restaurée) permet d’accéder aux cases les plus élevées. Autour du château, quelques maisons constituent le cœur du village. Fin 19ème siècle, avant la «Laïque», une petite école privée accueillait les fillettes de la commune, dirigées avec fermeté par les demoiselles Tabouriècle. -

Retour Sur Deux Sites Qui Méritent Toute Notre Attention
Bulletin de NaturEssonne Association d'Étude et de Protection La Lettre de de la Nature en Essonne Siège social : 10, place Beaumarchais 91600 SAVIGNY -SUR-ORGE tel : 01 69 45 54 47 [email protected] www.naturessonne.fr Octobre 2014 - N°64 "...il comprit que les associations renforcent l'homme, mettent en relief les dons de chacun, et donnent une joie qu'on éprouve rarement à vivre pour son propre compte…" Italo Calvino Le Baron perché Retour sur deux sites qui méritent toute notre attention Depuis sa création, NaturEssonne regroupe tous ceux qui caractéristiques, suivant la définition de l'annexe 1 de la veulent s’investir, conformément aux statuts, dans : l’étude, Directive Habitats. le porter à connaissance, la protection et la gestion du patrimoine naturel du département de l’Essonne. NaturEssonne est alors représentée par Serge Urbano au sein de cette instance. Il va faire appel à Alain Fontaine et Parmi toutes les actions entreprises par l’association, deux Gérard Luquet pour peaufiner les inventaires écologiques actions de protection ont été évoquées au cours de sorties des sites Essonniens et permettre, suite à la décision du organisées au printemps dernier : CSRPN et des institutions européennes, la création du site Natura 2000 "IDF 08", "Pelouses calcaires du Gâtinais". - le 18 mai sur la "Pelouse à Maïté" Le but est de préserver ces milieux naturels fortement - le 7 juin sur le site des étangs de "Baleine et Brûle Doux". menacés et de maintenir leur richesse floristique ou de la Il nous a semblé intéressant d’évoquer l’histoire de ces sites faire renaître dans les zones potentielles. -

PLU Angervilliers
DEPARTEMENT DE l’ESSONNE PLU Vaugrigneuse PLU approuvé par le Conseil Municipal en date du 29 novembre 2013 Maire de Vaugrigneuse 1 rue Héroard 91640 Vaugrigneuse 01 64 58 90 59 2. Rapport de présentation Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme [RAPPORT DE PRESENTATION] Commune de VAUGRIGNEUSE Plan Local d’Urbanisme [RAPPORT DE PRESENTATION] SOMMAIRE AVANT Le PLU – Aspects généraux PROPOS Le rapport de présentation 6 DIAGNOSTIC ET FONCTIONNEMENT 1ère partie 9 TERRITORIAL Chapitre 1 Elément de cadrage 10 1.1- Situation générale 10 1.2- Les structures intercommunales 1 2 1.3- Le territoire communal 13 Chapitre 2 Données démographiques 14 2.1- La population communale et ses évolutions 14 2.2- Caractéristiques des ménages et des habitants 18 Chapitre 3 Données générales sur l’habitat 22 3.1- Evolution du parc de logements 22 3.2- Caractéristiques des résidences principales 24 3.3- Les besoins et perspectives d’évolution 26 3.4- Evaluation du potentiel d’urbanisation résidentielle 30 Chapitre 4 Equipements et services à la population 35 4.1- Le niveau d’équipements général 35 4.2- Les équipements de la commune 36 Chapitre 5 Données socio-économiques 40 5.1- La population active 40 5.2- Les activités dans le secteur 45 5.3- Les activités à Vaugrigneuse 46 Chapitre 6 Diagnostic agricole et forestier 48 6.1- Etat des lieux des activités agricoles 48 6.2- Etat des lieux des activités forestières 52 Chapitre 7 Circulations et déplacements 54 7.1- Les moyens de transports et de déplacements 54 7.2- Les grands flux 59 7.3- -

Prefecture De L'essonne
PREFECTURE DE L’ESSONNE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Service environnement ______ ARRETE n° 2011 - DDT – SE – 97 du 27 avril 2011 relatif à la délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau destinés à la consommation humaine Crèvecoeur et Pihale 2 situés sur la commune de SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE LE PREFET DE L’ESSONNE, Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite VU la directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; VU la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 211-3 et R. 211-110 ; VU le code rural et notamment ses articles R.114-1 à R.114-10 ; VU le code de la santé publique, et notamment les article R. 1321-6 et suivants et R.1321-42 ; VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et notamment son article 27 ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret du 16 mai 2008 portant nomination de M. Jacques REILLER, préfet, en qualité de Préfet de l’Essonne ; VU l’arrêté du 11 janvier 2007 du ministère de la santé et de la solidarité, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées -

Plan Local D’Urbanisme
Plan local d’Urbanisme RÈGLEMENT PLU de VAL-SAINT-GERMAIN – Projet d’Aménagement et de Développement Durables 93 bis Rue Village 91530 Le Val-Saint-Germain P.L.U. Révision du Plan Local d’Urbanisme Annexes Sanitaires 7.1 Pièces Écrites Document approuvé en Conseil Municipal du 16 Octobre 2018 REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME PRÉAMBULE Dans le cadre de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, les communes ou leurs groupements doivent délimiter : - les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; - les zones d’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident leur entretien, afin de protéger la salubrité publique ; - Ainsi que les zones où il est nécessaire de prévoir des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. - Et des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. Les obligations des communes vis à vis de ces types de zones sont définies par l’article L2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales et par l’article L 35.1 du Code de la Santé Publique, complété par l’article 36 de la Loi sur l’Eau. -

Sommaire Mairie Travaux & Urbanisme Enfance Et Éducation
Sommaire Mairie Environnement Budget Communal - 5 Sictom du Hurepoix - 16 Cérémonie des vœux - 6 Déchèteries - 17 Remise des médailles Route de Dourdan - Rue de la Tuilerie - 18 Élections municipales ONF Cérémonie du 11 novembre - 7 Entretien du pont de l’autoroute A10 Départ à la retraite Jeu SICTOM Une année, un arbre, des enfants Syndicat Intercommunal pour l’Adduction Nouveaux habitants de l’Eau Potable - 19 Les jeunes majeurs Communauté de Communes du Pays de Limours - 8 Culture Travaux & La flûte de Luna - Tailleurs pour Dames - 20 Audition festival du Méli Mélo Fête de la peinture - Fête du village Urbanisme Concert de Harpe - Tour de France Colombophile Forum des associations Travaux d’entretien - 9 Journée du patrimoine - 22 Mesures de prévention - Actions de sécurisation - 10 Exposition 14/18 - Le Colombier Sécurité routière - 11 Travaux de voirie - Assainissement aire de jeux Square des Coudrettes Projet Parc du Château - Cabinet médical Sports & loisirs A.D.Y.G - B.O.A. - 23 Comité des fêtes - CIA - 24 Enfance Club des Séniors - AS Angervilliers Football - 25 Les Foulées d’Angervilliers - 26 Judo Club d’Angervilliers - 27 et éducation Loisirs Arts et Culture - (L.A.C.) - 28 École maternelle - 12 Chasse Communale École élémentaire - 13 La Caisse des Écoles - 13 État civil Cohésion sociale Mariages - Naissances - Décès - 29 C.C.A.S. - 14 Galette des rois - Sortie de printemps Vie pratique Le diner voisins-voisines - Sortie d’automne Repas de fin d’année - 15 Récompenses de nos commerçants - 30 Colis de noël - Visites à nos ainés Coordonnées commerces Carrefour des Solidarités Les pharmacies - 31 La santé - Les médecins - 32 Site Internet : http ://www.ville-angervilliers.fr Courriel : [email protected] 5, rue de Voisins - B.P. -

Bulletin Municipal 2018 3 SOMMAIRE MUNICIPALITÉ
2018 leBULLETINmag MUNICIPAL République Française MAIRIE D’ANGERVILLIERS Rue du Château - 91470 Angervilliers - 01 64 59 02 06 ville-angervilliers.fr ÉDITO Chères angervilliéroises, Chers angervilliérois, Que retenir de cette année 2018 ? Le blocage par les travaux de voirie de la Départementale, le CD 132 qui traverse le village ? Effectivement, vous avez tous subi des nuisances, plus ou moins lourdes, mais ces travaux étaient obligatoires, voire urgents, car les canalisations d’eau potable étaient vieillissantes. Visite d’un RMO à Maisse, avec Patrick IMBERT Vice-Président du SMO Essonne Numérique et Les rue du Marais, Grande rue et François DUROVRAY Président du Département. rue de l’Église sont des axes très dangereux, au vu du nombre de camions et de véhicules qui y passent et la présence de trottoirs étroits. Huit mois plus tard, les canalisations d’eau potable ont été changées par le Syndicat Eaux Ouest Essonne et les compteurs en plomb supprimés sur cet axe. Les réseaux secs ont été enfouis, des solutions ont été apportées pour améliorer l’écoulement des eaux pluviales et usées, le passage de la fibre a été également pris Avant en compte. La création des stationnements, un passage surélevé, la signalisation horizontale et verticale est finalisée et la zone 30 à l’entrée de la commune par la rue du Marais jusqu’au rond point de la Place des Copains d’Abord est désormais opérationnelle. La réféction de la bande de roulement, financée par le Département, a parachevé l’ensemble des travaux. Esthétiquement, personne ne peut nier l’embellissement du village. Sécuritairement, après un rappel des règles du bien vivre ensemble, adressé à tous, j’émets le souhait que nos automobilistes responsables respecteront le code de la route, et ainsi, ne seront pas verbalisés. -

Les Maires Essonniens Mis À Jour 08/04/2021
Les maires essonniens Communes Nom Prénom Adresse Mairie CP Adresses mail Téléphone ABBEVILLE-LA-RIVIERE MEYER Eric Place de la Mairie 91150 [email protected] 01.64.95.67.37 ANGERVILLE MITTELHAUSSER Johann 34. rue Nationale 91670 [email protected] 01.64.95.20.14 ANGERVILLIERS BOYER Danny 1. rue du Château 91470 [email protected] 01.64.59.02.06 ARPAJON BÉRAUD Christian 70. Grande Rue 91290 [email protected] 01.69.26.15.05 ARRANCOURT YANNOU Denis 3. place de la Mairie 91690 [email protected] 01.69.58.80.81 ATHIS-MONS GROUSSEAU Jean-Jacques Place du Général de Gaulle 91200 [email protected] 01.69.54.54.54 AUTHON-LA-PLAINE ANDRE Nicolas 5. place de l’Eglise 91410 [email protected] 01.64.95.51.07 AUVERNAUX HILGENGA Wilfrid 5. place de la Maire 91830 [email protected] 01.64.93.80.16 AUVERS-SAINT-GEORGES MEUNIER Denis Place du Général Leclerc 91580 [email protected] 01.60.80.34.01 AVRAINVILLE LE FOL Philippe 1. rue du Parc 91630 [email protected] 01.64.91.30.08 BALLAINVILLIERS GUEU-VIGUIER Stéphanie 1. rue de Longjumeau 91160 [email protected] 01.64.48.83.34 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE MIONE Jacques 2. rue de la Mairie 91610 [email protected] 01.64.93.73.73 BAULNE BERNARD Jacques 102. route de Corbeil 91590 [email protected] 01.64.57.60.71 BIEVRES PELLETIER-LE-BARBIER Anne Place de la Mairie 91570 [email protected] 01.69.35.15.50 BLANDY ROSSELL Cyril 2 . -

Aucun Titre De Diapositive
Coordonnées des secrétariats MAIA ESSONNE Nord Est BIEVRES VERRIERES- LE-BUISSON 01 69 63 29 70 [email protected] IGNY MAIA ESSONNE Nord SACLAY VILLIERS- VAUHALLAN WISSOUS PARAY- LE-BACLE MASSY VIEILLE- POSTE Christine MIMARD YERRES SAINT- CHILLY- CROSNES AUBIN PALAISEAU MAZARIN ATHIS- MONS VIGNEUX- 01 69 80 46 98 SUR-SEINE CHAMPLAN GIF-SUR- YVETTE ORSAY MORANGIS secretariat.maia91@ VILLEBON-SUR- BRUNOY BURES- YVETTE JUVISY- MONTGERON SUR- SUR-ORGE BOUSSY- YVETTE SAVIGNY- SAINT- hpgm.fr SAULX- LONGJUMEAU SUR- ANTOINE VARENNES- VILLEJUST LES- ORGE EPINAY- JARCY BOULLAY- CHARH TREUX SOUS- LES- VIRY- DRAVEIL SENART GOMETZ-LE- LES ULIS BALLAINVILLIERSEPINAY-SUR- TROUX CHATILLON QUINCY- LES CHATEL ORGE GOMETZ-LA- SOUS- SAINT-JEAN- SENART MOLIERES VILLE SAINT-JEAN- LA VILLE- DE-BEAUREGARD DU-BOIS VILLIERS- VILLEMOISSON- SUR- SUR- NOZAY ORGE MORSANG- ORGE SUR-ORGE GRIGNY JANVRY SOISY-SUR- PECQUEUSE MARCOUSSIS SAINTE- SEINE ETIOLLES LIMOURS LONGPONT- GENEVIEVE- RIS-ORANGIS TIGERY MONTLHERY SUR- DES-BOIS ORGE BRIIS-SOUS- SAINT-MICHEL- FORGES SUR-ORGE FLEURY-MEROGIS MAIA ESSONNE EVRY SAINT-GERMAIN- LINAS LES-CORBEIL FORGES-LES-BAINS FONTENAY- LES-BRIIS LEUVILLE- COURCOURONNES Sud - Brigitte SUR-ORGE LE PLESSIS- BONDOUFLE CORBEIL- BRETIGNY- PATE ESSONNES BRUYERES- SAINT-PIERRE- BODEREAU LE-CHATEL SUR-ORGE DU-PERRAY VAUGRIGNEUSE COURSON- SAINT-GERMAIN- LES-ARPAJON MONTELOUP OLLAINVILLE 01 60 80 60 72 ANGERVILLIERS LISSES SAINTRY- ARPAJON SUR-SEINE SAINT-MAURICE- VILLABE secretariatmfg@ MONTCOURONNE VERT-LE-GRAND LA NORVILLE MORSANG- SAINT- EGLY SUR-SEINE