Katharine Graham Et Le Washington Post1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Oral History Interview – JFK#1, 07/30/1964 Administrative Information
C. Douglas Dillon Oral History Interview – JFK#1, 07/30/1964 Administrative Information Creator: C. Douglas Dillon Interviewer: Dixon Donnelley Date of Interview: July 30, 1964 Place of Interview: Washington, D.C. Length: 26 pages Biographical Note Dillon, Secretary of the Treasury (1961-1965) discusses his role as a Republican in JFK’s Administration and his personal relationship with JFK, among other issues. Access Open Usage Restrictions According to the deed of gift signed, February 26, 1965, copyright of these materials has been assigned to the United States Government. Users of these materials are advised to determine the copyright status of any document from which they wish to publish. Copyright The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material. Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or reproduction is not to be “used for any purpose other than private study, scholarship, or research.” If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excesses of “fair use,” that user may be liable for copyright infringement. This institution reserves the right to refuse to accept a copying order if, in its judgment, fulfillment of the order would involve violation of copyright law. The copyright law extends its protection to unpublished works from the moment of creation in a tangible form. Direct your questions concerning copyright to the reference staff. -

Personal History: Katharine Graham Free
FREE PERSONAL HISTORY: KATHARINE GRAHAM PDF Katharine Graham | 642 pages | 01 Apr 1998 | Random House USA Inc | 9780375701047 | English | New York, United States Personal History by Katharine Graham, Paperback | Barnes & Noble® Goodreads helps you keep track of books you want to read. Want to Read saving…. Want to Read Currently Reading Read. Other editions. Enlarge cover. Error rating book. Refresh and try again. Open Preview See a Problem? Details if other :. Thanks for telling us about the problem. Return to Book Page. Preview — Personal History by Katharine Graham. Personal History by Katharine Graham. In lieu of an unrevealing Famous-People-I-Have-Known autobiography, the owner of the Washington Post has chosen to be remarkably candid about the insecurities prompted by remote parents and a difficult marriage to the charismatic, manic- depressive Phil Graham, who ran the newspaper her father acquired. Katharine's account of her years as subservient daughter and wife is so In lieu of an unrevealing Famous-People-I-Have-Known autobiography, the owner Personal History: Katharine Graham the Washington Post has chosen to be remarkably candid about the insecurities prompted by remote parents and a difficult marriage to the charismatic, manic-depressive Phil Graham, who ran the newspaper her father acquired. Katharine's account of her years as subservient daughter and wife is so painful that by the time she finally asserts herself at the Post following Phil's suicide in more than halfway through the bookreaders will want to cheer. After that, Watergate is practically an anticlimax. Get A Copy. Paperbackpages. Published February 24th by Vintage first published More Details Original Title. -

Adrian Fisher Interview I
LYNDON BAINES JOHNSON LIBRARY ORAL HISTORY COLLECTION The LBJ Library Oral History Collection is composed primarily of interviews conducted for the Library by the University of Texas Oral History Project and the LBJ Library Oral History Project. In addition, some interviews were done for the Library under the auspices of the National Archives and the White House during the Johnson administration. Some of the Library's many oral history transcripts are available on the INTERNET. Individuals whose interviews appear on the INTERNET may have other interviews available on paper at the LBJ Library. Transcripts of oral history interviews may be consulted at the Library or lending copies may be borrowed by writing to the Interlibrary Loan Archivist, LBJ Library, 2313 Red River Street, Austin, Texas, 78705. ADRIAN S. FISHER ORAL HISTORY, INTERVIEW I PREFERRED CITATION For Internet Copy: Transcript, Adrian S. Fisher Oral History Interview I, 10/31/68, by Paige Mulhollan, Internet Copy, LBJ Library. For Electronic Copy on Diskette from the LBJ Library: Transcript, Adrian S. Fisher Oral History Interview I, 10/31/68, by Paige Mulhollan, Electronic Copy, LBJ Library. GENERAL SERVICES ADMINISTRATION NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS SERVICE Gift of Personal Statement By Adrian S. Fisher to the Lyndon Baines Johnson Library In accordance with Sec. 507 of the Federal Property and Administrative Services Act of 1949, as amended (44 U.S.C. 397) and regulations issued thereunder (41 CFR 101-10), I, Adrian S. Fisher, hereinafter referred to as the donor, hereby give, donate, and convey to the United States of America for eventual deposit in the proposed Lyndon Baines Johnson Library, and for administration therein by the authorities thereof, a tape and transcript of a personal statement approved by me and prepared for the purpose of deposit in the Lyndon Baines Johnson Library. -

Katharine Graham's Autobiography, Personal History Is a Retelling of a Tale of Two Cities
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by British Columbia's network of post-secondary digital repositories Katharine Graham's autobiography, Personal History is a retelling of A Tale of Two Cities. Graham was an owner and publisher of the Washington Post. She died last July, aged 84. Graham recounts a life filled with entertaining and influencing presidents, business leaders, and celebrities. Access to her world was largely constrained to rich American nobles. She affords fleeting glimpses of lower American classes across the chasm that separates hers from theirs. Graham’s life was centred around events defining Washington as a complex city state - a closed universe, but also the American political capital and a fulcrum of global events. She had remarkable friendships with exceptional people. She led a patrician's life launched by inherited wealth, but sustained by her intellect, resilience and terrier-like determination. Graham proved that women needn't be restricted to secondary roles as men rise to become the top dogs. Graham's father, a pup from a distinguished Jewish family, made a small fortune in California and on Wall Street between 1890 and 1916. Graham's mother was gentile and the daughter of a New York city lawyer. Katharine was raised on a manor by the Hudson River and in a large apartment in New York. She enjoyed an idyllic childhood interspersed with irritating episodes of anti-Semitism. Her wealth opened doors that for most of her contemporaries were forever locked regardless of their other personal attributes or potentials. -

What the Eulogists Didn't Tell You About Katie Graham and the {Post}
Click here for Full Issue of EIR Volume 28, Number 32, August 24, 2001 Book Review What the Eulogists Didn’t Tell You About Katie Graham and the Post by Edward Spannaus A most useful antidote to this falsification of history, is the book Katharine the Great by Deborah Davis. Two aspects Katharine The Great: Katharine Graham of it must be considered. First, what Davis wrote about the And Her Washington Post Empire Post and its relationship to U.S. intelligence community. And by Deborah Davis second, what happened when Davis tried to first publish the New York: Sheridan Square Press, 1991 (third edition) book in 1979. 322 pages paperbound, $14.95 In her preface to the third edition, Davis writes: “This is the third It would be hard to exceed the hypocrisy of the days following edition of a book origi- the official announcement of the death of Katharine Graham nally written shortly on July 17. Even in death, Graham still had the power to after President Nixon re- make those, otherwise considered powerful in their own right, signed as a result of the grovel at her feet. Washington Post’s in- Eulogy after eulogy cited Graham’s alleged courage, and vestigation of the Water- even gutsiness, with respect to two publishing events: the gate scandal. The con- Pentagon Papers, and Watergate. In both cases, the truth is ceptual center of the directly contrary to the legend. In both cases, the Post was book is the question: spoon-fed material from a section of the U.S. intelligence Could Katharine Gra- community, designed to discredit President John F. -
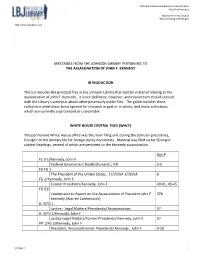
Materials from the Johnson Library Pertaining to the Assassination of John F
National Archives and Records Administration http://archives.gov National Archives Catalog https://catalog.archives.gov http://www.lbjlibrary.org MATERIALS FROM THE JOHNSON LIBRARY PERTAINING TO THE ASSASSINATION OF JOHN F. KENNEDY INTRODUCTION This list includes the principal files in the Johnson Library that contain material relating to the assassination of John F. Kennedy. It is not definitive, however, and researchers should consult with the Library's archivists about other potentially useful files. The guide includes those collections which have been opened for research in part or in whole, and those collections which are currently unprocessed or unavailable. WHITE HOUSE CENTRAL FILES (WHCF) This permanent White House office was the main filing unit during the Johnson presidency, though not the primary file for foreign policy documents. Material was filed under 60 major subject headings, several of which are pertinent to the Kennedy assassination. Box # FE 3-1/Kennedy, John F. Federal Government Deaths/Funerals, JFK 3-5 EX FG 1 The President of the United States, 11/22/64-1/10/64 9 FG 2/Kennedy, John F. Former Presidents/Kennedy, John F. 40-41, 43-45 FG 635 Commission to Report on the Assassination of President John F. 376 Kennedy (Warren Commission) JL 3/FG 1 Justice - Legal Matters/Presidential Assassinations 37 JL 3/FG 2/Kennedy, John F. Justice Legal Matters/Former Presidents/ Kennedy, John F. 37 PP 1/FG 2/Kennedy, John F. President, Personal/Former Presidents/ Kennedy, John F. 9-10 02/28/17 1 National Archives and Records Administration http://archives.gov National Archives Catalog https://catalog.archives.gov http://www.lbjlibrary.org (Cross references and letters from the general public regarding the assassination.) PR 4-1 Public Relations - Support after the Death of John F. -

Book Review: Laurel Leff. Buried by the Times: the Holocaust and America's Most Important Newspaper
Genocide Studies and Prevention: An International Journal Volume 1 Issue 3 Article 11 December 2006 Book Review: Laurel Leff. Buried by the Times: The Holocaust and America's Most Important Newspaper Janine Minkler Follow this and additional works at: https://scholarcommons.usf.edu/gsp Recommended Citation Minkler, Janine (2006) "Book Review: Laurel Leff. Buried by the Times: The Holocaust and America's Most Important Newspaper," Genocide Studies and Prevention: An International Journal: Vol. 1: Iss. 3: Article 11. Available at: https://scholarcommons.usf.edu/gsp/vol1/iss3/11 This Article is brought to you for free and open access by the Open Access Journals at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Genocide Studies and Prevention: An International Journal by an authorized editor of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Book Review Laurel Leff. Buried by the Times: The Holocaust and America’s Most Important Newspaper. New York: Cambridge University Press, 2005. Pp. 426, cloth. $29.00 US. Reviewed by Janine Minkler, Department of Sociology and Social Work, Northern Arizona University Why did the New York Times persistently bury news of the Holocaust? asks Laurel Leff in her dramatic historical account of ‘‘America’s most important newspaper.’’ Leff, associate professor at Northeastern University and former journalist for the Wall Street Journal and Miami Herald, examines the complex combination of forces that led the Times to relegate news of the Holocaust to secondary status. She also sustains an uncompromising critique of this period in New York Times history. ‘‘No American newspaper was better positioned to highlight the Holocaust than the Times, and no American newspaper so influenced public discourse by its failure to do so. -
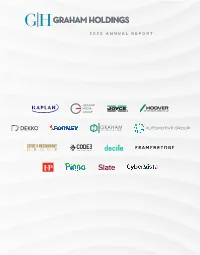
2020 Annual Report
2020 ANNUAL REPORT GRAHAM HOLDINGS 1300 NORTH 17TH STREET SUITE 1700 ARLINGTON, VA 22209 703 345 6300 GHCO.COM Revenue by Principal Operations EDUCATION 45% BROADCASTING 18% MANUFACTURING 14% HEALTHCARE 7% OTHER BUSINESSES 16% “2020 was a pivotal year at Graham Holdings Company. Against the backdrop of a global health crisis, we delivered stronger results than I would have forecast when COVID took hold in the spring…” Financial Highlights (IN THOUSANDS, EXCEPT PER SHARE AMOUNTS) 2020 2019 CHANGE Operating revenues $2,889,121 $2,932,099 (1%) Income from operations $ 100,407 $ 144, 546 (31%) Net income attributable to common shares $ 300,365 $ 327,855 (8%) Diluted earnings per common share $ 58.13 $ 61.21 (5%) Dividends per common share $ 5.80 $ 5.56 4% Common stockholders’ equity per share $ 754.45 $ 624.83 21% Diluted average number of common shares outstanding 5,139 5,327 (4%) OPERATING REVENUES INCOME FROM OPERATIONS ($ in millions) ($ in millions) 2020 2,889 2020 100 2019 2,932 2019 145 2018 2,696 2018 246 2017 2,592 2017 136 2016 2,482 2016 223 NET INCOME ATTRIBUTABLE TO COMMON SHARES RETURN ON AVERAGE COMMON ($ in millions) STOCKHOLDERS’ EQUITY 2020 300 2020 8.5% 2019 328 2019 10.5% 2018 271 2018 9.3% 2017 302 2017 11.3% 2016 169 2016 6.8% DILUTED EARNINGS PER COMMON SHARE ($) 2020 58.13 2019 61.2 1 2018 50.20 2017 53.89 2016 29.80 To Our Shareholders 2020 was a pivotal year at Graham Holdings for someone to get an item framed without Company. -

George Stevens, Jr., Lecturer the Seventh Annual Herblock Lecture April 15, 2010, the Library of Congress
George Stevens, Jr., Lecturer The Seventh Annual Herblock Lecture April 15, 2010, The Library of Congress The Herblock we know and honor really emerged when a young Herbert L. Block left his job at the Daily News in his native Chicago for Cleveland to be a cartoonist for the Newspaper Enterprise Service – a syndication company with the odd acronym NEA. He drew about the Depression and the New Deal and the rise of Fascist dictators in Europe – and he didn’t hesitate to let his readers know that he saw isolationism as a threat to Main Street America. After a time he couldn’t help but notice that NEA, which was owned by Scripps Howard, was getting “jittery” about his cartoons. His work expressed sharper opinions than his employers were accustomed to. And NEA was concerned that if a client cancelled Herblock, they might cancel the entire service. So when he was summoned to New York by Fred Ferguson, the NEA President – who was known around the office as Little Napoleon – and who started meetings by saying, “Well, have you seen what Roosevelt has done now?” It was pretty clear that Herb was about to be fired. He remembered sitting for a long time in the outer office cooling his heels, until Ferguson finally summoned him inside with what Herb remembered as an anguished smile – “an expression of mixed feelings never showed so clearly on a man’s face,” as Herb put it. It turned out that Ferguson had just been notified that Herblock had been awarded the Pulitzer Prize. -

Watergate Unstoppered
return to updates Watergate unstoppered by Miles Mathis A lot of people have known for a long time that there was more to Watergate than we have been told in the mainstream press. Many bestseller books have hinted at this over the years, although I now assume those bestsellers were also misdirection. They have been spun, and were probably spun by the same people who spun Watergate. Still, to spin information they have to release some information, and so to get the true story all someone like me has to do is de-spin it. Since this is like trying to unwind a closet full of tangled coathangers, most people don't get very far into it. But since I have the time and the patience for such things—as well as some natural talent at seeing through walls—I tend to succeed where others fail. It also helps that I am a lone researcher. I can follow my nose, without anyone else's interference. We are taught that committees get more done in the way of research, but I have not found that to be the case. The greatest success is achieved by a single person with a good nose for the truth, and a great eye for a lie. As it turns out, all the information I will use is already on the internet and is not seriously contested. There is no original research in this paper and I am not repeating any wild theories from the fringe. I am just compiling things admitted at places like Wikipedia, but unburying it, unspinning it, and putting it back into logical order. -

The American Press, the Central Intelligence Agency, and the Cold War
“A Rising Clamor”: The American Press, the Central Intelligence Agency, and the Cold War Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University By David Putnam Hadley, MA Graduate Program in History The Ohio State University 2015 Dissertation Committee: Peter L. Hahn (co-advisor) Robert J. McMahon (co-advisor) Jennifer Siegel Copyright by David Putnam Hadley 2015 Abstract This dissertation examines the development of relationships between the U.S. press and the Central Intelligence Agency (CIA) during the Cold War, from shortly before the official creation of the CIA in 1947 to the major congressional investigations of the CIA in 1975-76. This dissertation seeks to answer four related questions. First, what was the nature and origin of the relationships that developed between the press and the CIA? Second, to what use did the CIA attempt to put such relationships? Third, what was the actual impact of press/CIA relationships on reporting? Finally, how did the CIA’s relations with the press affect the development of the agency? The efforts to answer these questions involved two main methods. The first method was an extensive examination of the product of domestic newspapers and journals from 1945 to 1976 that examined the activities of the CIA and the development of the U.S. intelligence system. The second method was archival research in private and institutional collections. I conclude that there was no single relationship formed between the CIA and the press. The CIA did have a program of operationally using reporters, though details remain difficult to determine. -

The Media: 'Black Widow' Exposé Case Comes to Court
Click here for Full Issue of EIR Volume 13, Number 36, September 12, 1986 biotechnology. For his part, Rifkin has gloated in private The Media conversation that he and Robertson "think alike on econom ics." In 1979, Rifkin published The Emerging Order: God in the Age of Scarcity, in which he described the role of funda mentalism in replacing Western civilization with a "steady state society," an "age of conservation." Much of Rifkin's subsequent writings, including his better-known Entropy, elaborate the themes first developed there. Rifkin's major premise was that God created a "fixed universe," and that "anything [science and technology in 'Black Widow' expose particular] that undermines the 'fixed' purpose and order that God has given to the natural world is also sinful and an act of rebellion. ." case comes to court A zero-growth God A Washington Post legal spokesman has told EIR that Post Rifkin further argued that the notorious 19th-century sci owner Katharine Graham should decide during the week of entific fraud, the Second Law of Thermodynamics, consti Sept. 8-12, whether to contest the release of official records tuted God's "supreme law" of the universe. This "Entropy concerning the death of her husband. Law," wrote Rifkin, "tells us that every time available energy Richmond, Virginia, Circuit Court Judge Willard I. is used up, it creates disorder somewhere else in the surround Walker has scheduled a hearingfor Sept. 22. He will rule on ing environment. The massive flow-through of energy in a petition to release the death certificate and medical exam modem industrial society is creating massive disorder in the iner's reports, kept confidential since Philip L.