En Créole Haïtien Marc Picard
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
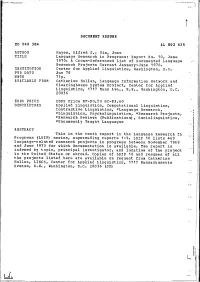
Language Research in Progress: Report No. 10, June 1970: a Cross - "Referenced List of Documented Language Research Projects Current January-June 1970
DOCUMENT RESUME ED 040 384 AL 002 435 AUTHOR Hayes, Alfred S.; Vis, Joan TITLE Language Research in Progress: Report No. 10, June 1970: A Cross - "Referenced List of Documented Language Research Projects Current January-June 1970. INSTITUTION Center for Applied Linguistics, Washington, D.C. PUB DATE Jun 70 NOTE 71p. AVAILABLE FROM Catherine Hollan, Language Information Network and Clearinghouse System Project, Center for Applied Linguistics, 1717 Mass Ave., N.W., Washington, D.C. 20036 EDRS PRICE EDRS Price MF-$0.50 HC-$3.60 DESCRIPTORS Applied Linguistics, Computational Linguistics, Contrastive Linguistics, *Language Research, *Linguistics, Psycholinguistics, *Research Projects, *Research Reviews (Publications), Sociolinguistics, *Uncommonly Taught Languages ABSTRACT This is the tenth report in the Language ResearchIn Progress (LRIP) series, superceding reports 1-9. LRIP 10 lists 469 language-related research projects in progress between November 1969 and June 1970 for which documentation is available. The report is indexed by topic, principal investigator, and location of the project in the United States or abroad. Copies of LRIP 10 andresumes of all the projects listed here are available on request from Catherine Hollan, LINCS, Center for Applied Linguistics, 1717 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, D.C. 20036 (JD) t CO re\ U,S, DEPARTMENT Of HEALTH, EDUCATION & WELFARE OFFICE OF EDUCATION THIS DOCUMENT HAS CEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE C:11 PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT,POINTS OF VIEW OR OPINIONS STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION 14.1 POSITION OR POLICY, Language Research In Progress :10 Center for Applied LinguisticsWashington, D. C. CENTER FOR APPLIED LINGUISTICS1717 MASSACHUSETTS AVENUE, N.W., WASHINGTON, D.C. -

Shakespeare's Narremes Helmut Bonheim
Cambridge University Press 0521023971 - Shakespeare Survey 53: Shakespeare and Narrative Edited by Peter Holland Excerpt More information SHAKESPEARE'S NARREMES HELMUT BONHEIM In Shakespeare's plays the chief ®gures are often Winter's Tale the statue of Hermione would not separated, usually at sea, and united again. In come to life. The narremes of closure today are Twelfth Night it is Sebastian and Viola (brother not those of Shakespeare's time. Some patterns and sister) who are separated by shipwreck; in seem merely conventional or arbitrary, others Pericles it is Pericles and Marina (father and re¯ect systematic changes both of taste and the daughter); in The Comedy of Errors it is Aegeon current sense of ®tness and closure, yet others and Aemilia (husband and wife). The separa- appear to be systematic, but elude explanation. tion-and-reunion pattern spans the play, the Narremes in prose and drama. The concept of span varying from days to decades. Variations of the narreme was developed three decades ago the pattern occur in Antony and Cleopatra, King by Eugene Dorfman,2 who saw the narreme as Lear, Much Ado and rather more marginally in a basic unit or quality of narration. His concept Hamlet, The Merchant of Venice and in Richard II, was expanded by Henri Wittmann,3 but Shake- again more obviously in Cymbeline, The Tempest speare criticism has given it scant notice.4 One and The Winter's Tale. Such recurring patterns reason is that narratologists concentrate on of action, place and time we call narremes. narrative prose and largely ignore drama, and Oddly enough, although the major play- thus have developed few tools that apply to it. -

Aspects D'une Comparaison Sociolinguistique Entre Le Québec Et Les Antilles Françaises
URSULA REUTNER !"#$%&'#() +,-./'01.&/ Aspects d'une comparaison sociolinguistique entre le Québec et les Antilles françaises « Le joual, c'est-tu un créole ? » F c'est une question posée et niée par Henri Wittmann en 1973. 30 ans plus tard, la recherche et la discussion sur 21.34 d'une part et 5&)14% d'autre part ont avancé, mais la comparaison n'a pas été entreprise de nouveau de manière systématique. Pour cette raison, il ne nous semble pas dépourvu d'intért de reprendre le sujet. Bien que la conclusion dHenri Wittmann soit confirmée par nos remarques, les arguments qui nous amènent à tre d'accord avec son résultat final diffèrent considérablement. Dans cette contribution, nous voulons rompre avec certains préjugés qui fourmillent autour des mots 21.34 et 5&)14%, et nous montrerons que les points communs entre ces deux réalités linguistiques se situent moins au plan de la linguistique tout court qu'au plan de lidéolinguistique,1 un domaine longtemps négligé par la linguistique. Après une proposition de définir le joual du Québec et le créole des Antilles françaises2, notre comparaison du joual et du créole dégagera quelques aspects parallèles et divergents qui se manifestent dans l'emploi des deux mots en question. Pour ce qui est des analogies, nous tiendrons compte du rle des deux réalités linguistiques dans la situation de diglossie, de leur langue d'origine, ainsi que des sentiments idéolinguistiques comme particulièrement les jugements ambivalents, l'adoration, la stigmatisation, et le préjudice de la mixité. De mTme, nous regarderons les possibilités d'élargissement des termes pour décrire un type de société. -

Le Créole, C'est Du Français, Coudon! Henri Wittmann Syndicat Des Professeurs De L'université Du Québec À Trois-Rivières R
Revue québécoise de linguistique théorique et appliquée 3:2 (1983), 187-202 Le créole, c'est du français, coudon! Henri Wittmann Syndicat des professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières Robert Fournier Université de Sherbrooke La substratomanie est une théorie spéculative du 19e siècle sur les relations entre les transferts d'appartenance linguistique d'une population et les changements introduits au cours du temps dans la structure même d'une langue. Elle a été conçue dans le but très précis de contester les thèses néogrammairiennes relatives à la régularité des changements et de trouver des contre-exemples aux principes de classification génétique des langues naturelles. Dans sa version forte, elle a donné naissance au mythe des langues génétiquement mixtes. La notion de langue mixte suppose un certain nombre de postulats qui, en fait, s'appuient tous sur l'observation que les adultes sont généralement incapables d'acquérir une langue seconde d'une facon parfaitement conforme au modèle, s'accommodant le plus souvent de l'utilisation du lexique de la langue seconde dans la structure syntaxique de la langue maternelle. La généralisation faite est de dire que, dans les transferts d'appartenance linguistique, les collectivités procèdent de la même façon que l'individu adulte et d'identifier l'adulte comme l'agent de "nativisation" d'une langue seconde. En qualifiant dans ce processus la langue disparue de "substrat" et la langue qui s'y est substituée de "superstrat", on arrive à concevoir un type de langue dont la composition reposerait sur deux sources phylogénétiquement distinctes, tout en satisfaisant à l'exigence d'être devenue la langue maternelle d'une population essentiellement unilingue. -

Bom Sadek I Bez Li: La Particule I En Français
Revue québécoise de linguistique théorique et appliquée 1 (1981), 177-96 Bom Sadek i bez li: la particule i en français Henri Wittmann Université du Québec à Trois-Rivières Robert Fournier Office de la langue française Comme l'a fait remarquer Yves-Charles Morin (1981), les études sur les origines du français moderne, au Québec aussi bien qu'en France, ont en grande partie mis l'accent sur les parentés lexicales. Les carences qu'on constate au niveau de notre connaissance de la phonologie et de la morphologie affectent non seulement notre vision de l'origine des parlers français "français" mais permettent également de perpétuer des préjugés quant à l'origine du français parlé par les différentes communautés de couleurs dont l'origine remonte au 17e siècle. Les études lexicales consacrées aux français créoles, qu'il s'agisse d'études anciennes ou modernes, ne permettent pas de faire de distinctions phylogénétiques catégoriques entre parlers français et créoles français. Même les méthodes lexicostatistiques les plus récentes n'ont rien changé à ça. C'est donc au niveau des spéculations sur la grammaire comparée qu'on retrouve le reflet des préjugés albocentriques qui ont marqué l'histoire de la linguistique dès ses débuts à l'heure du romantisme allemand naissant. Si aujourd'hui on ne parle plus sérieusement de déficience congénitale à manier "notre" langue, il reste néanmoins que nos meilleures hypothèses en matière de phylogénèse des parlers créoles cherchent encore carrément leur origine dans la grammaire d'une langue africaine ou pidgin du Tiers-Monde qui, à travers de multiples relexifications, aurait conservé intacte sa structure profonde. -

GLOTTOPOL Revue De Sociolinguistique En Ligne N° 27 – Janvier 2016 Langues Des Signes
GLOTTOPOL Revue de sociolinguistique en ligne n° 27 – janvier 2016 Langues des signes. Langues minoritaires et sociétés Numéro dirigé par Richard Sabria SOMMAIRE Richard Sabria : Présentation Yann Cantin : Des origines du noétomalalien français, perspectives historiques Mélanie Hamm : Langue des signes à Marseille Alex Giovanny Barreto Muñoz et Camilo Alberto Robayo : Neologismos en lengua de señas colombiana (LSC) : Desafíos entorno a la planificación lingüística en comunidades sordas Saskia Mugnier, Isabelle Estève et Agnès Millet : Dynamique du contexte sociolinguistique de la surdité en France : entre changement(s) et circularité Magaly Ghesquière et Laurence Meurant : L’envers de la broderie. Une pédagogie bilingue français-langue des signes Stéphanie Luna et Anne-Marie Parisot : Méthodes d’enseignement institutionnelles québécoises : effets sur la production d’oralisations en LSQ chez les ainés sourds Pierre Schmitt : Sourds et interprètes dans les arts et médias : mises en scène contemporaines de la langue des signes Suzanne Villeneuve et Anne-Marie Parisot : Procédés d’activation et de suivi de la référence dans un discours interprété en langue des signes québécoise Comptes rendus Amandine Denimal : Didactique du plurilinguisme, approches plurielles des langues et des cultures. Autour de Michel Candelier, 2013, sous la direction de Christel Troncy et avec le concours de Jean-François De Pietro, Livia Goletto et Martine Kervran. Presses universitaires de Rennes, 511 pages. Véronique Miguel Addisu : Violence verbale et école, 2014, sous la direction de Nathalie Auger et Christina Romain, L’Harmattan, collection Enfance et Langages, Paris, 268 pages. http://glottopol.univ-rouen.fr PRÉFACE LANGUES DES SIGNES - LANGUES MINORITAIRES ET SOCIÉTÉS Richard Sabria Université de Rouen, laboratoire Dylis Le présent numéro 27 de GLOTTOPOL fait suite au numéro 7, mis en ligne en 2006, dédié, de façon non exhaustive, aux recherches sociolinguistiques et linguistiques en langue des Signes française1 (http://glottopol.univ-rouen.fr/numero_7.html). -
Out of Africa
Out of Africa African influences in Atlantic Creoles Mikael Parkvall 2000 Battlebridge Publications i This volume is dedicated to the memory of Chris Corne and Gunnel Källgren two of my main sources of inspiration and support during the preparation of this thesis who sadly died before its completion. Published by: Battlebridge Publications, 37 Store Street, London WC1E 7QF, United Kingdom Copyright: Mikael Parkvall November 2000 <[email protected]> All rights reserved. ISBN 1-903292-05-0 Cover design: Mikael Parkvall Printed by Hobbs the Printers Ltd, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK. ii Contents Map showing the location of the Atlantic Creoles viii 1. Introduction 1 1.1 Aim and scope of the study 2 1.2 Methodology 1.2.1 Defining substrate influence 3 1.2.2 Choice of substrate languages 3 1.2.3 Sources used 5 1.2.4 Other issues 9 1.3 Terminological issues and transcription conventions 9 1.3.1 Names of contact languages 9 1.3.2 Names of African languages 10 1.3.3 Names of geographical regions 11 Map of geographical regions involved in the slave trade 12 1.3.4 Linguistic terminology 12 Map of the locations where selected African languages are spoken 13 1.3.5 Transcription of linguistic examples 13 1.3.6 Abbreviations and symbols used 14 1.4 Acknowledgements 15 2. Epistemology, methodology and terminology in Creolistics 16 2.1 First example: Universals, not substrate 20 2.2 Second example: Again universals, not substrate 21 2.3 Third example: Lexifier, not substrate or universals 22 2.4 Fourth example: Substrate, not lexifier 23 2.5 Conclusion 24 3. -
Complexity As L2-Difficulty: Implications for Syntactic Change George Walkden (University of Konstanz) & Anne Breitbarth (Ghent University)
Complexity as L2-difficulty: implications for syntactic change George Walkden (University of Konstanz) & Anne Breitbarth (Ghent University) Abstract: Recent work has cast doubt on the idea that all languages are equally complex; however, the notion of syntactic complexity remains underexplored. Taking complexity to equate to difficulty of acquisition for late L2 acquirers, we propose an operationalization of syntactic complexity in terms of uninterpretable features. Trudgill’s sociolinguistic typology predicts that sociohistorical situations involving substantial late L2 acquisition should be conducive to simplification, i.e. loss of such features. We sketch a programme for investigating this prediction. In particular, we suggest that the loss of bipartite negation in the history of Low German and other languages indicates that it may be on the right track. Keywords: sociolinguistic typology, syntactic change, L2 acquisition, simplification, Interpretability Hypothesis 1. Context and big picture 1.1. Typology, complexity, and language change The traditional notion that all languages are equally complex, as expressed in Hockett (1958), has recently come under attack from a number of quarters. Notably, in his seminal work Sociolinguistic Typology, Trudgill (2011) has suggested that different types of sociolinguistic situation lead to differential simplification and complexification: for instance, long-term co-territorial language contact is predicted to lead to additive complexification, whereas short-term contact involving extensive adult second-language (L2) use is predicted to lead to simplification. An example of the latter is Nubi, an Arabic-derived variety which has undergone a radical reduction in its verbal morphology, making no person, number or gender distinctions on the verb, unlike most other Arabic varieties. -
Le Français Populaire De Paris Dans Le Français Des Amériques1
Actes du Congrès international des linguistes 16 (Paris, 20-25 juillet 1997). Amsterdam: Elsevier (CD ROM). LE FRANÇAIS POPULAIRE DE PARIS DANS LE FRANÇAIS DES AMÉRIQUES1 Henri Wittmann Syndicat des professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières [email protected] Une comparaison de variétés basilectales du français parlées depuis le 17e ou le 18e siècle comme langues maternelles dans huit points de peuplement des Amériques, tous isolés les uns par rapport aux autres, avec les variétés historiques du français parlées en France fait ressortir dans les parlers de sept des huit points des continuités grammaticales non lexicales difficilement explicables comme développements indépendants, parallèles ou concurrents. La constatation première que les isoglosses syntaxiques je/i "nous", -i passé simple et -on 3PL séparent les patois français (moins le picard) à la fois du français populaire de Paris et du français colonial (moins l'acadien) se laisse approfondir par le biais d'une comparaison systématique typologiquement diagnostique. Les résultats rendent incontournable l'hypothèse d'un continuum grammatical microvariationnel préexistant à la dispersion et à l'isolement des communautés comparées et sont fortement incompatibles avec des visions d'un choc des patois en Nouvelle-France. Ces faits ne peuvent avoir un sens que si on présume que le français urbain de Paris du 17e siècle était phylogénétiquement une koïné et que cette koïné a servi de modèle linguistique et de lingua franca aux colons français des 17e et 18e siècles. Français populaire, lingua franca, phylogenèse, modèle flexionnel, décalage structurel, grammaticalisation, prédétermination, changement linguistique. 1L'orientation particulière qu'a pu prendre le traitement du sujet est venue de questionnements qui m'ont été présentés à l'Institut d'études créoles et francophones d'Aix durant mon séjour là-bas en octobre 1996 relativement au "français populaire des 17e et 18e siècles". -

Pawòl Gen Zèl: Language Legitimation in Haiti's Second Century
Pawòl gen zèl: Language Legitimation in Haiti’s Second Century by Matthew James Robertshaw A Thesis presented to The University of Guelph In partial fulfilment of requirements for the degree of Master of Arts in History Guelph, Ontario, Canada © Matthew James Robertshaw, December, 2016 ABSTRACT Pawòl gen zèl: Language Legitimation in Haiti’s Second Century Matthew Robertshaw Advisors: University of Guelph, 2016 Professor Karen Racine Professor Joubert Satyre “Le créole, est-il une langue?” mused Haitian poet and public intellectual Georges Sylvain in 1901. As the only language spoken by all Haitians, Sylvain believed that Haitian Creole should be recognized as the true language of Haiti. He called for its widespread use in Haitian literature and education. He and his contemporaries took the first steps toward establishing an authentic national literature, but it was another half century before Haitian authors began to use Creole as a versatile and self-sufficient literary language. The first innovative works of theatre and poetry in Creole did not appear until 1953, and the first Creole novel was not published until 1975. The Bernard Reform, which mandated the use of Creole in education, did not occur until 1979, and Creole was not named an official language, on par with French, until 1987. When one considers the long history of eloquent support for the popular language, it is surprising that Creole legitimation has advanced so fitfully. The country's political elites are often accused of using French to maintain their hold on power, but the Creole legitimation project is not simply a tug-of-war between the elites and the masses. -

Classification Linguistique Des Langues Signées Non Vocalement*
Revue québécoise de linguistique T&A 10:1 (1991), 215-88 CLASSIFICATION LINGUISTIQUE DES LANGUES SIGNÉES NON VOCALEMENT* Henri Wittmann Syndicat des professeurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières 0. Introduction Ceux qui ont eu à se familariser avec les premiers rudiments de la linguistique à une certaine époque, disons avant 1973, se rappelleront la définition caractérisant le langage, généralement tiré de Bloch & Trager (1942:5; ma traduction; cf. la reprise chez Dubois et al. [1973.274]), qu’il fallait décortiquer élément après élément: Le langage est un système de signes vocaux au moyen duquel les membres d’un groupe social coopèrent. Et au cas où quelqu’un n’avait pas compris, il y avait ce complément d’information sur la nature des signes non vocaux: Les autres moyens de communication, les gestes, les images, les signaux maritimes et l’écriture, sont ou bien inadéquats aux exigences de l’organisation sociale ou bien dérivés entièrement du langage oral et ne sont effectifs que dans la mesure où ils reflètent cette dépendance. Il faut espérer que la linguistique est moins monolithique aujourd’hui dans ses revendications et qu’on me pardonnera le titre de cet article qui suppose qu’il y a des langues dont les signes ne sont vocaux, ni au niveau de leur genèse sensorielle, ni dans les modes d’encodages qui leur sont coordonnées, et dont on peut faire un classement linguistique, par exclusion aussi bien que par inclusion. 1. Classification dichotomique 216 Wittmann Toute activité de classement d’objets peut se faire, figurativement parlant, selon deux axes de lecture, dichotomique ou analogique. -

Pamapla 21 Ac Alp a 21
PAMAPLA 21 Papers from the 21 st Annual Meeting of the Atlantic Provinces Linguistic Association Mount Saint Vincent University Halifax, Nova Scotia, Canada 7-8 November 1997 AC ALP A 21 Actes du 21ième Colloque annuel de l’Association de Linguistique des Provinces Atlantiques Mount Saint Vincent University Halifax, Nouvelle-Ecosse, Canada 7-8 Novembre 1997 Printed and bound by / Impression et reliure: Print Shop Services, Mount Saint Vincent University, Halifax, N.S., Canada Papers from the 21th Annual Meeting of the Atlantic Provinces Linguistic Association Actes du 21ième Colloque annuel de l’Association de Linguistique des Provinces Atlantiques v.21(1997) Legal Deposit / Dépôt légal: 1998 National Library of Canada Bibliothèque Nationale du Canada PAMAPLA 21 Papers from the 21st Annual Meeting of the Atlantic Provinces Linguistic Association Mount Saint Vincent University Halifax, Nova Scotia, Canada 7-8 November 1997 ACALPA 21 Actes du 21ième Colloque annuel de l’Association de Linguistique des Provinces Atlantiques Mount Saint Vincent University Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada 7-8 Novembre 1997 Printed and bound by / Impression et reliure: Print Shop Services, Mount Saint Vincent University, Halifax, N.S., Canada Papers from the 21th Annual Meeting of the Atlantic Provinces Linguistic Association Actes du 21ième Colloque annuel de l’Association de Linguistique des Provinces Atlantiques v.21(1997) Legal Deposit / Dépôt légal: 1998 National Library of Canada Bibliothèque Nationale du Canada APLA / ALPA 21st Annual Meeting / 21ième Colloque Annuel Sponsored by the Halifax Interuniversity Linguistics Program Committee Organizing Committee Ronald COSPER, Saint Mary‘s University Michelle DA VELU Y, Saint Mary‘s University Margaret HARRY, Saint Mary‘s University Marie-Lucie TARPENT, Mount Saint Vincent University (Chair / Présidente) The Atlantic Provinces Linguistic Association would like to thank the following for their contribution to the Twenty-First Annual Conference and the publication of this volume.