World Bank Document
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
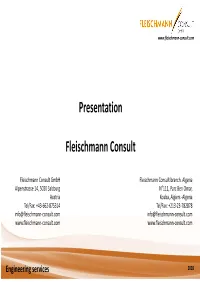
Presentation Fleischmann Consult
www.fleischmann‐consult.com Presentation Fleischmann Consult Fleischmann Consult GmbH Fleischmann Consult branch. Algeria Alpenstrasse 14, 5020 Salzburg N°111, Parc Ben Omar, Austria Kouba, Algiers ‐Algeria Tel/Fax: +43‐662‐875314 Tel/Fax: +213‐23‐782878 info@fleischmann‐consult.com info@fleischmann‐consult.com www.fleischmann‐consult.com www.fleischmann‐consult.com Engineering services 2018 www.fleischmann‐consult.com Railway Design and topographic works Engineering services 2018 Histoire www.fleischmann‐consult.com ‘10 ‘07 ‘97 70th Anniversary ‘71 Creation of the Algerian branch ‘40 Mr. Gernot Fleischmann integrates in the society Günter M. Fleischmann took over the office after the death Creation of the firm by M. Franz of founder Fleischmann in Salzburg, Austria Engineering services 2018 Entreprise www.fleischmann‐consult.com Activities Topography Geotechnical Railwaystudies Engineering services 2018 Entreprise www.fleischmann‐consult.com Key figures Founded in 1938 Creation of Fleischmann Consult as a spin off in 2007 Firm in Austria and Algeria Status : engineering firm Specialization: Railwaydesign and engineering surveying Surveyors, Civil works, Public works, Engineers Geotechnical and Architects Manager : M. Gernot Fleischmann (M.Sc.) Engineering services 2018 Entreprise www.fleischmann‐consult.com Key figures : Collaborators : Engineers: Technicians: others: Administration: Total: 55 Engineering services 2018 Entreprise www.fleischmann‐consult.com Equipement and Manpower: Type : Marque : Nombre : Total station 1200 Leica -

Recueil Des Textes Réglementaires 2008
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU BUDGET DIRECTION DE LA REGLEMENTATION BUDGETAIRE ET DU CONTRÔLE PREALABLE DE LA DEPENSE ENGAGEE RECUEIL DE TEXTES REGLEMENTAIRES Instructions, Arrêtés, Circulaires, Notes, Décisions, Directives, Recommandations, Avis Juridiques. Année 2008 SOMMAIRE 2008 RÉFÉRENCE DU N° DATE DOCUMENT OBJET (LIBELLE) Pages ARRIVÉE 000027 02/01/08 MF/DGB/DG Actes de nomination prorogation de 13 délai de clôture. (TELEX) 000029 02/01/08 MF/DGB/DRC Mise en vigueur de marchés de transport des étudiants et de fourniture de produits alimentaires au profit des résidences universitaires, avant son visa 14 par la commission des marchés. 000045 05/01/08 MF/DGB/DRC Formation pour un titulaire de fonction 15 supérieure. 000054 07/01/08 MF/DGB/DRC A/S de l’allocation pour salaire unique prévue par le décret exécutif n° 07-292 du 26 Septembre 2007 modifiant et complétant le décret n° 65-75 du 23 Mars 1965 relative aux indemnités à 16 caractère familial. 000056 07/01/08 MF/DGB/DRC A/S de l’indemnité compensatrice de 17 congé annuel des élus locaux. 000057 07/01/08 MF/DGB/DRC A/S de l’indemnité de performance et 18 d’amélioration des prestations. 000180 12/01/08 MF/DGB/DRC A/S du cumul de l’indemnité d’amélioration des performances de gestion et l’indemnité de performance 19 et d’amélioration des prestations. 000181 12/01/08 MF/DGB/DRC A/S de l’indemnité de l’amélioration des performances de gestion, attribuée au profit des personnels d’intendance relevant 20 certains départements ministériels. -

Countries Common Project
ABSTRACT An Erasmus+ project By „One fo all, All for Green” project members from Greece, Hungary, Italy, Portugal, Scotland and Spain. ALGERIA Contents Chapter 1 ................................................................................................................................................. 3 The Country ............................................................................................................................................. 3 Algeria .................................................................................................................................................. 3 History ................................................................................................................................................. 3 Culture, Music ..................................................................................................................................... 4 Literature ............................................................................................................................................. 4 Religion ................................................................................................................................................ 4 Cuisine ................................................................................................................................................. 5 Population ........................................................................................................................................... 5 Fun facts -

Modernizing Budgetary Management
Report No. 36270-DZ People’s Democratic Republic of Algeria Republicof Democratic Report No.36270-DZPeople’s Review A PublicExpenditure Vo Report No. 36270-DZ People’s Democratic Republic of Algeria A Public Expenditure Review Public Disclosure Authorized Assuring High Quality Public Investment (In Two Volumes) Volume I: Main Report August 15, 2007 Social and Economic Development Group Middle East and North Africa Region Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized lume I Document of the World Bank Public Disclosure Authorized ETUSA Entreprise des Transports Urbains et O&M Operation and maintenance Suburbains d’Alger ONA Office National de l’Assainissement EU European Union (National Agency for Sanitation) FAO UN Food and Agricultural Organization ONID Office National de l’Irrigation et du FCCL Local Government Common Fund Drainage FRR Fonds de Régulation des Recettes (Small and medium irrigation schemes) FNGIR (Hydrocarbon Stabilization Fund) ONM Office National de la Météorologie Fonds National de Gestion Intégré de la ONOU Office Nationale des Œuvres Universitaires Ressource ONS Office Nationale des Statistiques de GDP Gross domestic product l’Algérie GER Gross enrollment rates OPEC Organization of the Petroleum Exporting GNFS Goods and non-factor services countries GOA Government of Algeria OPI Office des Périmètres Irrigués GPI Grands Périmètres irrigués (Large PCD Programme Communal de Développement GTZ irrigation schemes) (local development program) German Agency for Technical Cooperation PCSC Programme Complémentaire -
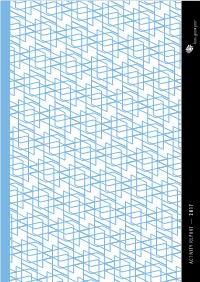
Activity Repor T
ACTIVITY REPORT — 2017 SUMMARY FOREWORD 03 ASIA 52 EXECUTIVE COMMITTEE 07 China 54 East Timor 54 TPF IN THE WORLD 08 Georgia 57 India 57 HIGHLIGHTS 11 Laos 60 Philippines 60 Saudi Arabia 60 AFRICA 12 Turkey 63 Vietnam 63 Algeria 14 Angola 16 EASTERN EUROPE 64 Burkina Faso 19 Cameroon 19 Egypt 19 Poland 66 Equatorial Guinea 21 Romania 68 Ivory Coast 21 Ukraine 70 Kenya 21 Mauritania 21 WESTERN EUROPE 72 Morocco 22 Mozambique 25 Belgium 74 Reunion Island 25 France 78 Sao Tome and Principe 26 Grand Duchy of Luxembourg 80 Senegal 26 Greece 80 Tunisia 28 Portugal 83 Spain 86 CENTRAL AMERICA 30 CENTRES OF EXPERTISE 89 Costa Rica 32 Guatemala 32 Building 90 Honduras 32 Transport infrastructures 93 Nicaragua 32 Water and environment 96 Panama 32 Energy 99 Salvador 32 TPF FOUNDATION 101 LATIN AMERICA 34 CONSOLIDATED ACCOUNTS 107 Argentina 36 Bolivia 36 Brazil 38 Chile 42 Colombia 42 Ecuador 44 Peru 46 NORTH AMERICA 48 Mexico 50 United States 50 FOREWORD 04 Since its creation, TPF has experienced many years of sustained growth, both organic and from acquisitions, which has allowed it to double in size every 3 years on average since its creation in 1991, growing from 20 to 4,200 employees. From 2016, we decided to focus on simplifying and improving the group and 4 200 no longer on acquisition growth. – We focused on simplification with mergers in Spain, Portugal, collaborators Brazil, India, Poland, an ongoing process which is expected to end this year. It can be a cumbersome process because it leads to groupings of teams, harmonization of management methods, change of manage- ment teams as well as redefinitions and more corporate projects. -

Journal Officiel
N° 57 Mercredi Aouel Dhou El Hidja 1433 51ème ANNEE correspondant au 17 octobre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION Algérie ETRANGER Tunisie SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ABONNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 Edition originale.................................. 1070,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d'expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 2 Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17 octobre 2012 S O M M A I R E DECRETS Décret exécutif n° 12-358 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2012............................................................................................................................... 4 Décret exécutif n° 12-359 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels................................................ -

Republique Algerienne Democratique Et Populaire Une Revue Des
Rapport N° 36270 - DZ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE UNE REVUE DES DEPENSES PUBLIQUES A la recherche d’un investissement public de qualité (En deux volumes) Volume II : Annexes et Suppléments Statistiques Le 15 septembre 2007 Groupe pour le Développement socioéconomique Région Moyen Orient et Afrique du Nord Document de la Banque mondiale ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES Unité monétaire locale = le dinar algérien (DA) Taux de change (72,6 DA pour 1 dollar) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 9,0 18,5 21,8 23,3 35,1 47,7 54,7 57,7 58,7 66,6 75,3 77,2 79,7 77,4 72,1 72,6 EXERCICE BUDGÉTAIRE Du 1er janvier au 31 décembre POIDS ET MESURES Système métrique ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS AAP Évaluation et Plan d’action EHS Établissement hospitalier spécialisé ABH Agences de bassins hydrographiques E&M Exploitation et maintenance ADE Algérienne des eaux EGSA Établissement de gestion des services aéroportuaires ADR Agriculture et développement rural EMA Entreprise du Métro d’Alger AFD Agence française de développement ENNA Établissement national de la navigation aérienne AGA Agence de gestion des autoroutes EP Entreprise publique AGID Agence pour l’irrigation et le drainage EPA Établissement public administratif ALOS Durée moyenne de séjour EPE Entreprise publique économique ANA Agence nationale des autoroutes EPIC Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial ANBT Agence nationale des barrages et des grands ETU Entreprise des transports urbains transferts ANESRIF Agence nationale d’études -

World Bank Document
Report No. 36270-DZ People’s Democratic Republic of Algeria Republicof Democratic Report No.36270-DZPeople’s Review A PublicExpenditure Vo Report No. 36270-DZ People’s Democratic Republic of Algeria A Public Expenditure Review Public Disclosure Authorized Assuring High Quality Public Investment (In Two Volumes) Volume I: Main Report August 15, 2007 Social and Economic Development Group Middle East and North Africa Region Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized lume I Document of the World Bank Public Disclosure Authorized ETUSA Entreprise des Transports Urbains et O&M Operation and maintenance Suburbains d’Alger ONA Office National de l’Assainissement EU European Union (National Agency for Sanitation) FAO UN Food and Agricultural Organization ONID Office National de l’Irrigation et du FCCL Local Government Common Fund Drainage FRR Fonds de Régulation des Recettes (Small and medium irrigation schemes) FNGIR (Hydrocarbon Stabilization Fund) ONM Office National de la Météorologie Fonds National de Gestion Intégré de la ONOU Office Nationale des Œuvres Universitaires Ressource ONS Office Nationale des Statistiques de GDP Gross domestic product l’Algérie GER Gross enrollment rates OPEC Organization of the Petroleum Exporting GNFS Goods and non-factor services countries GOA Government of Algeria OPI Office des Périmètres Irrigués GPI Grands Périmètres irrigués (Large PCD Programme Communal de Développement GTZ irrigation schemes) (local development program) German Agency for Technical Cooperation PCSC Programme Complémentaire -

Transport Infrastructure Spending in Algeria: State of the Art
Review MECAS V° 17/ N°1 / March 2021 Transport Infrastructure Spending in Algeria: State of the Art LARIDJI Mohammed Amin.1 Docteur en Ingénierie économique et entreprise. Tlemcen University [email protected] MALIKI Samir Baha Eddine. Professor MECAS laboratory .Tlemcen University (Algeria) [email protected] Received date: 25.02.2021 / Accepted date: 22.03.2021 Abstract This article aims to present a state-of-the-art on transport infrastructure spending in Algeria during a period when the country recorded the highest revenues from the oil and gas sector. We analyses all available statistics on the transport sector with all its components and different costs. This analysis is very important for future development programs in Algeria, given the huge budgets consumed. The description of the sector leads us to conclude that the economic efficiency of investment in this sector will depend on the ability to master maintenance and technological and managerial innovation to cover growing demand and ensure sustainable development. Keywords: Transport infrastructure, expenditure, development, Algeria Jel Classification Codes : H50 ; R42 ; R49 Introduction: Transportation is a -value but extremely important service to the economy and is one of the pillars of the growth in all nations' production (Jiwattanakulpaisarn et al., 2012). The transport and communications sector remains a major contributor to the Algerian economy, representing 14% of GDP in 2017, compared to 13.4% in 2016, according to the National Statistics Office (ONS) (Oxford Business Group, 2018). Investment in rail, maritime, airport, road, and highway transport infrastructure, the link between these different modes of transport can unlock the growth potential of an economy.