Atlas Régional Sud-Est : Commentaires Des Cartes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

EST Journal Des Proj
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON PAIX - TRAVAIL - PATRIE PEACE - WORK - FATHERLAND DETAILS DES PROJETS PAR REGION, DEPARTEMENT, CHAPITRE, PROGRAMME ET ACTION OPERATIONS BOOK PER REGION, DIVISION, HEAD, PROGRAMME AND ACTION Exercice/ Financial year : 2017 Région EST Region EAST Département LOM-ET-DJEREM Division En Milliers de FCFA In Thousand CFAF Année de Tâches démarrage Localité Montant AE Montant CP Tasks Starting Year Locality Montant AE Montant CP Chapitre/Head MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 07 MINISTRY OF TERRITORIAL ADMINISTRATION AND DECENTRALIZATION Bertoua: Réhabiloitation des servcices du Gouverneur de la Région de l'Est Nkol-Bikon 55 000 55 000 2 017 Bertoua: Rehabiloitation of Governor's Office Ngoura: Règlement de la première phase des travaux de construction de la Sous- NGOURA 50 000 50 000 Préfecture 2 017 Ngoura: Payement of the first part of the construction of the Sub-Divisional Office Bertoua II: Règlement des travaux de construction de la résidence du Sous-Préfet BERTOUA 3 050 3 050 2 017 Bertoua II: Payment of the construction of the residence of the DO Total Chapitre/Head MINATD 108 050 108 050 Chapitre/Head MINISTERE DES MARCHES PUBLICS 10 MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS DR MINMAP EST: Travaux de réhabilitation de la délégation régionale Bertoua 25 000 25 000 2 017 RD MINPC East : Rehabilitatioon woks of the delegation Total Chapitre/Head MINMAP 25 000 25 000 Chapitre/Head MINISTERE DE LA DEFENSE 13 MINISTRY OF DEFENCE 11° BA: Construction salle opérationnelle modulable -

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC SITUATION UNHCR REGIONAL UPDATE 38 25-31 October 2014 KEY FIGURES HIGHLIGHT 410,000 Idps Including
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC SITUATION UNHCR REGIONAL UPDATE 38 25-31 October 2014 KEY FIGURES HIGHLIGHT 410,000 IDPs including 62,326 On 27 October, UNHCR’s Regional Refugee Coordinator (RRC) for the Central African Republic (CAR) Situation, Ms. Liz Ahua, participated in a in Bangui roundtable consultation on the regional refugee dimension of the CAR situation, in Brussels, hosted by UNHCR and the United States Mission to 420,237 the European Union (EU). The objectives of the event were to draw Total number of CAR refugees in increased attention to the regional aspects of the CAR refugee situation, neighbouring countries seek to raise it higher on the EU’s policy, political and funding agenda, and to highlight UNHCR’s role, achievements and challenges in providing protection and assistance. It was also an opportunity to encourage 183,443 humanitarian and development support to cover basic and long term needs New CAR refugees in neighbouring for refugees, highlight the importance of creative strategies to address countries since Dec. 2013 longer-term issues, such as promoting self-sufficiency and refugee participation in reconciliation efforts. In order to secure media attention to 8,012 the regional refugee situation, Ms. Ahua also gave interviews on the latest Refugees and asylum seekers in developments to BBC Africa, VOA News and Channel Africa. CAR FUNDING Population of concern USD 255 million A total of 830,237 people of concern requested for the situation Funded IDPs in CAR 410,000 33% Refugees in Cameroon 239,106 Gap 67% Refugees in Chad 92,606 PRIORITIES Refugees in DRC 68,156 . -

II. CLIMATIC HIGHLIGHTS for the PERIOD 21St to 29Th FEBRUARY, 2020 I. INTRODUCTION
OBSERVATOIRE NATIONAL SUR Dekadal Bullandin from 21st to 29th February, 2020 LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Bullandin no 36 NATIONAL OBSERVATORY ON CLIMATE CHANGE DIRECTION GENERALE - DIRECTORATE GENERAL ONACC ONACC-NOCC www.onacc.cm; email: [email protected]; Tel (237) 693 370 504 CLIMATE ALERTS AND PROBABLE IMPACTS FOR THE PERIOD 21st to 29th FEBRUARY, 2020 Supervision NB: It should be noted that this forecast is developed Prof. Dr. Eng. AMOUGOU Joseph Armathé, Director, National Observatory on Climate Change using spatial data from: (ONACC) and Lecturer in the Department of Geography at the University of Yaounde I, Cameroon. - the International Institute for Climate and Sociandy Ing. FORGHAB Patrick MBOMBA, Deputy Director, National Observatory on Climate Change (IRI) of Columbia University, USA; (ONACC). - the National Oceanic and Atmospheric ProductionTeam (ONACC) Administration (NOAA), USA; Prof. Dr. Eng. AMOUGOU Joseph Armathé, Director, ONACC and Lecturer in the - AccuWeather (American Institution specialized in Department of Geography at the University of Yaounde I, Cameroon. mandeorological forecasts), USA; Eng. FORGHAB Patrick MBOMBA, Deputy Director, ONACC. - the African Centre for Applied Mandeorology for BATHA Romain Armand Soleil, Technical staff, ONACC. Development (ACMAD). ZOUH TEM Isabella, MSc in GIS-Environment. - Spatial data, from 1979 to 2018 relative to Ocean NDJELA MBEIH Gaston Evarice, M.Sc. in Economics and Environmental Management. Surface Temperature (OST) in the Atlantic and MEYONG René Ramsès, M.Sc. in Climatology/Biogeography. Pacific, as well as the intensity of the El-Niño/La ANYE Victorine Ambo, Administrative staff, ONACC Nina episodes in the Pacific, precipitation and ELONG Julien Aymar, M.Sc. Business and Environmental law. temperatures from local stations. -

Cameroon : Adamawa, East and North Rgeions
CAMEROON : ADAMAWA, EAST AND NORTH RGEIONS 11° E 12° E 13° E 14° E N 1125° E 16° E Hossere Gaval Mayo Kewe Palpal Dew atan Hossere Mayo Kelvoun Hossere HDossere OuIro M aArday MARE Go mbe Trabahohoy Mayo Bokwa Melendem Vinjegel Kelvoun Pandoual Ourlang Mayo Palia Dam assay Birdif Hossere Hosere Hossere Madama CHARI-BAGUIRMI Mbirdif Zaga Taldam Mubi Hosere Ndoudjem Hossere Mordoy Madama Matalao Hosere Gordom BORNO Matalao Goboum Mou Mayo Mou Baday Korehel Hossere Tongom Ndujem Hossere Seleguere Paha Goboum Hossere Mokoy Diam Ibbi Moukoy Melem lem Doubouvoum Mayo Alouki Mayo Palia Loum as Marma MAYO KANI Mayo Nelma Mayo Zevene Njefi Nelma Dja-Lingo Birdi Harma Mayo Djifi Hosere Galao Hossere Birdi Beli Bili Mandama Galao Bokong Babarkin Deba Madama DabaGalaou Hossere Goudak Hosere Geling Dirtehe Biri Massabey Geling Hosere Hossere Banam Mokorvong Gueleng Goudak Far-North Makirve Dirtcha Hwoli Ts adaksok Gueling Boko Bourwoy Tawan Tawan N 1 Talak Matafal Kouodja Mouga Goudjougoudjou MasabayMassabay Boko Irguilang Bedeve Gimoulounga Bili Douroum Irngileng Mayo Kapta Hakirvia Mougoulounga Hosere Talak Komboum Sobre Bourhoy Mayo Malwey Matafat Hossere Hwoli Hossere Woli Barkao Gande Watchama Guimoulounga Vinde Yola Bourwoy Mokorvong Kapta Hosere Mouga Mouena Mayo Oulo Hossere Bangay Dirbass Dirbas Kousm adouma Malwei Boulou Gandarma Boutouza Mouna Goungourga Mayo Douroum Ouro Saday Djouvoure MAYO DANAY Dum o Bougouma Bangai Houloum Mayo Gottokoun Galbanki Houmbal Moda Goude Tarnbaga Madara Mayo Bozki Bokzi Bangei Holoum Pri TiraHosere Tira -

Forecasts and Dekadal Climate Alerts for the Period 1St to 10Th June 2021
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland ----------- ----------- OBSERVATOIRE NATIONAL SUR NATIONAL OBSERVATORY LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ON CLIMATE CHANGE ----------------- ----------------- DIRECTION GENERALE DIRECTORATE GENERAL ----------------- ----------------- ONACC www.onacc.cm; [email protected]; Tel : (+237) 693 370 504 / 654 392 529 BULLETIN N° 82 Forecasts and Dekadal Climate Alerts for the Period 1st to 10th June 2021 st 1 June 2021 © NOCC June 2021, all rights reserved Supervision Prof. Dr. Eng. AMOUGOU Joseph Armathé, Director General, National Observatory on Climate Change (NOCC) and Lecturer in the Department of Geography at the University of Yaounde I, Cameroon. Eng. FORGHAB Patrick MBOMBA, Deputy Director General, National Observatory on Climate Change (NOCC). Production Team (NOCC) Prof. Dr. Eng. AMOUGOU Joseph Armathé, Director General, National Observatory on Climate Change (NOCC) and Lecturer in the Department of Geography at the University of Yaounde I, Cameroon. Eng. FORGHAB Patrick MBOMBA, Deputy Director General, National Observatory on Climate Change (NOCC). BATHA Romain Armand Soleil, PhD student and Technical staff, NOCC. ZOUH TEM Isabella, M.Sc. in GIS-Environment and Technical staff, NOCC. NDJELA MBEIH Gaston Evarice, M.Sc. in Economics and Environmental Management. MEYONG René Ramsès, M.Sc. in Physical Geography (Climatology/Biogeography). ANYE Victorine Ambo, Administrative staff, NOCC. ELONG Julien Aymar, M.Sc. in Business and Environmental law. I. Introduction -

October 2018 Edition
© Olivier Njounan WWF / Njounan Olivier © A monthly publication of WWF Jengi Programme in Southeast Cameroon October 2018 Edition © Ernest Sumelong WWF / Sumelong © Ernest Our Newsletter moves from a quarterly to a monthly. So much to capture within the Jengi landscape. We are always excited to share with you our stories. Jengi Newsletter, October 2018 Indigenous People WWF, 20 other NGOs and representatives of indigenous peoples have agreed to work in synergy to enhance access rights of Baka and Bagyeli people to protected areas in Southeast Cameroon. For this to be achieved, the NGOs agreed, a memorandum of understanding (MoU) initiated since 2006 between indigenous communities and conservation services of some protected areas, to secure their free access rights, has to be signed. The NGOs met in the town of Abong Mbang in the East Region of Cameroon in a bid to seek ways to accelerate the process for the signing of MoU and to extend the initiative to logging concessions and sports hunting zones. Participants including representatives of Baka and Bagyeli communities, © Ernest Sumelong / WWF WWF and RACOPY (Réseau Recherches Actions Concertées Pygmées) noted significant progress towards obtaining free access rights to natural resources for this vulnerable group. So far, WWF, working with local partners, initiated MoU processes that resulted in the signing of two agreements: one between Bagyelis and the conservation service of Campo Ma’an National Park and the other between Baka and the Ngoyla Wildlife Reserve. “Since the signing of the MoU we have greater access to natural resources in Campo Ma’an National Park,” says Jeanne Biloa, President of Bagyeli Cultural and Development Association (BACUDA). -

GE84/244 BR IFIC Nº 2829 Section Spéciale Special Section Sección
Section spéciale Index BR IFIC Nº 2829 Special Section GE84/244 Sección especial Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Date/Fecha : 27.09.2016 Expiry date for comments / Fecha limite para comentarios / Date limite pour les commentaires : 05.01.2017 Description of Columns / Descripción de columnas / Description des colonnes Intent Purpose of the notification Propósito de la notificación Objet de la notification 1a Assigned frequency Frecuencia asignada Fréquence assignée 4a Name of the location of Tx station Nombre del emplazamiento de estación Tx Nom de l'emplacement de la station Tx B Administration Administración Administration 4b Geographical area Zona geográfica Zone géographique 4c Geographical coordinates Coordenadas geográficas Coordonnées géographiques 6a Class of station Clase de estación Classe de station 1b Vision / sound frequency Frecuencia de portadora imagen/sonido Fréquence image / son 1ea Frequency stability Estabilidad de frecuencia Stabilité de fréquence 1e carrier frequency offset Desplazamiento de la portadora Décalage de la porteuse 7c System and colour system Sistema de transmisión / color Système et système de couleur 9d Polarization Polarización Polarisation 13c Remarks Observaciones Remarques 9 Directivity Directividad -

État Des Lieux De La Situation Économique, Écologique Et Sociale Actuelle De L'espace Camerounais Du TRIDOM
État des lieux de la situation économique, écologique et sociale actuelle de l’espace Camerounais du TRIDOM Roger Ngoufo, Nouhou Njoumemi, Marc Parren Congo Basin État des lieux de la situation économique, écologique et sociale actuelle de l’espace Camerounais du TRIDOM Par Pr Roger NGOUFO Nouhou NJOUMEMI Département de Géographie, Université de Yaoundé I et Cameroon Environmental Watch (CEW) Dr Marc PARREN Tropenbos International 2012 Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement l’avis de Tropenbos International. Cette étude est publiée sous la seule responsabilité des auteurs. Tropenbos International ne garantit pas l'exactitude des informations fournies dans le présent rapport. Publié par : Tropenbos International Programme du bassin du Congo Droit d’auteur : © 2012 Tropenbos International Programme du bassin du Congo La reproduction des textes pour fins non commerciales est autorisée, en citant la source. Citation : Ngoufo, Roger, Nouhou Njoumemi et Marc Parren (2012). État des lieux de la situation économique, écologique et sociale actuelle de l’espace Camerounais du TRIDOM. Tropenbos International – Programme du bassin du Congo, Wageningen, Pays-Bas. X + 145 pp. www.tropenbos.org ii Table de matières ACRONYMES ........................................................................................................................ V LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................... VI LISTE DES FIGURES -

Bulletin No27 on CLIMATE CHANGE
OBSERVATOIRE NATIONAL SUR Bulletin décadaire du 21 au 30 novembre 2019 LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES / o NATIONAL OBSERVATORY Bulletin n 27 ON CLIMATE CHANGE DIRECTION GENERALE-DIRECTORATE GENERAL ONACC Tel: (237) 693 370 504 www.onacc.cm; [email protected]; ONACC-NOCC A LERTE S CLIMATIQUE S ET IMPACTS PROBABLES POUR LA PERIODE DU 21 AU 30 NOVEMBRE 2019 Supervision Prof. Dr. Ing. AMOUGOU Joseph Armathé, Directeur de l’Observatoire National sur les NB: Il est à noter que ces prévisions sont élaborées à l'aide Changements Climatiques (ONACC) et Enseignant au Département de Géographie à l’Université de Yaoundé I, Cameroun. de données spatiales provenant de : Ing. FORGHAB Patrick MBOMBA, Directeur Adjoint de l’Observatoire National sur les - l'Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) de l'Université de Columbie (USA); Changements Climatiques (ONACC) . Équipe de réalisation (ONACC) - la National Oceanic and Atmospheric Administration Prof. Dr. Ing. AMOUGOU Joseph Armathé, Directeur de l’Observatoire National sur les (NOAA) (USA); Changements Climatiques (ONACC) et Enseignant au Département de Géographie de l’Université - AccuWeather (Institution Américaine spécialisée de Yaoundé I, Cameroun. dans les Prévisions Météorologiques) (USA); Ing. FORGHAB Patrick MBOMBA, Directeur Adjoint de l’Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC). - Centre Africain pour les Applications de la BATHA Romain Armand Soleil, Cadre Technique à l’ONACC. Météorologie au Développement (ACMAD) ; ZOUH TEM Isabella, Master en GIS-Environnement. - Données spatiales relatives aux Températures de la NDJELA MBEIH Gaston Evarice, Master en Economie et Management de l’Environnemental. Surface Océanique (TSO) dans l’Atlantique et le MEYONG René Ramsès, Master en Géographie Physique, Option climatologie et Biogéographie. -
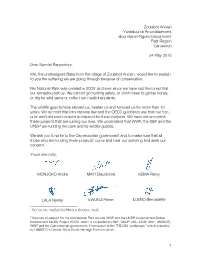
1 Zoulabot Ancien Yokadouma Arrondissement Boumba-Et-Ngoko
Zoulabot Ancien Yokadouma Arrondissement Boumba-et-Ngoko Department East Region Cameroon 24 May 2018 Dear Special Rapporteur, We, the undersigned Baka from the village of Zoulabot Ancien, would like to explain to you the suffering we are going through because of conservation. Nki National Park was created in 20051 and ever since we have lost the forest that our ancestors left us. We cannot go hunting safely, or climb trees to gather honey, or dig for wild yams or collect our medicinal plants. The wildlife guards have abused us, beaten us and tortured us for more than 10 years. We are told that international law and the OECD guidelines say that our free, prior and informed consent is required for these projects. We have not accepted these projects that are ruining our lives. We understand that WWF, the GEF and the UNDP are funding the park and its wildlife guards. We ask you to write to the Cameroonian government and to make sure that all those who are funding these projects2 come and hear our suffering and seek our consent. Yours sincerely, MONJOKO Andre MAYI Dieudonné KEMA Rémy LALA Nestor EWUNJI Pierre DJENO Bernadette 1 Decree No. 2005/3283/PM of 6 October, 2005 2 Sources of support for the Nki National Park include WWF and the UNDP-implemented Global Environment Facility Project #9155, which is co-funded by GEF, UNDP, ZSL, IUCN, AWF, UNESCO, WWF and the Cameroonian government. It forms part of the TRIDOM “landscape,” which is funded by UNESCO’s Central Africa World Heritage Forest Initiative. 1 KEMA Félix LESSA Michel NGONGO Denis 2 Ngoli Moloundou Arrondissement Boumba-et-Ngoko Department East Region Cameroon 29 May 2018 Dear Special Rapporteur, We here in Ngoli are suffering so much because of the Lobeke National Park and trophy-hunting zones.3 If the guards find you, even with just one antelope, they beat you and make you take your clothes off. -

II. CLIMATIC HIGHLIGHTS for the PERIOD 21St to 30Th JANUARY, 2020
OBSERVATOIRE NATIONAL SUR Dekadal Bulletin from 21st to 30th January, 2020 LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Bulletin no 33 NATIONAL OBSERVATORY ON CLIMATE CHANGE DIRECTION GENERALE - DIRECTORATE GENERAL ONACC ONACC-NOCC www.onacc.cm; email: [email protected]; Tel (237) 693 370 504 CLIMATE ALERTS AND PROBABLE IMPACTS FOR THE PERIOD 21st to 30th JANUARY, 2020 Supervision NB: It should be noted that this forecast is Prof. Dr. Eng. AMOUGOU Joseph Armathé, Director, National Observatory on Climate Change developed using spatial data from: (ONACC) and Lecturer in the Department of Geography at the University of Yaounde I, Cameroon. - the International Institute for Climate and Ing. FORGHAB Patrick MBOMBA, Deputy Director, National Observatory on Climate Change Society (IRI) of Columbia University, USA; (ONACC). - the National Oceanic and Atmospheric ProductionTeam (ONACC) Administration (NOAA), USA; Prof. Dr. Eng. AMOUGOU Joseph Armathé, Director, ONACC and Lecturer in the Department of Geography at the University of Yaounde I, Cameroon. - AccuWeather (American Institution specialized in meteorological forecasts), USA; Eng . FORGHAB Patrick MBOMBA, Deputy Director, ONACC. BATHA Romain Armand Soleil, Technical staff, ONACC. - the African Centre for Applied Meteorology ZOUH TEM Isabella, MSc in GIS-Environment. for Development (ACMAD). NDJELA MBEIH Gaston Evarice, M.Sc. in Economics and Environmental Management. - Spatial data for Atlantic Ocean Surface MEYONG René Ramsès, M.Sc. in Climatology/Biogeography. Temperature (OST) as well as the intensity of ANYE Victorine Ambo, Administrative staff, ONACC the El-Niño episodes in the Pacific. ELONG Julien Aymar, M.Sc. Business and Environmental law. - ONACC’s research works. I. INTRODUCTION This ten-day alert bulletin n°33 reveals the historical climatic conditions from 1979 to 2018 and climate forecasts developed for the five Agro-ecological zones for the period January 21 to 30, 2020. -
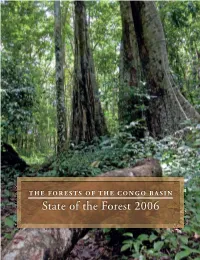
State of the Forest 2006
THE FORESTS OF THE FORESTS THE CONGO BASIN: For the Congo Basin Forest Partnership (CBFP), prepared in collaboration with: • COMIFAC and the forestry ministers of Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, Central African Republic, Republic of Congo, and the Democratic Republic of Congo • Conservation NGOs active in the Landscapes (African Wildlife Foundation, Conservation International, Wildlife Conservation Society, World Wildlife Fund/World Wide Fund for Nature) • Institutions and offi ces working on the implementation of sustainable exploitation (CIFOR, CIRAD, Forêt Ressources Management) • Governmental and non-governmental institutions monitoring resources through remote sensing (Joint Research Center, Université catholique de Louvain, South Dakota State University, University of Maryland, World Resources Institute) 2006 of the Forest State THE FORESTS OF THE CONGO BASIN State of the Forest 2006 680670 www.lannooprint.com THE FORESTS OF THE CONGO BASIN State of the Forest 2006 Th e Congo Basin Forest Partnership Partners (CBFP) Governments Th e CBFP is a non-binding Type II part- · Republic of South Africa (DWAF) nership composed of approximately 30 govern- · Germany (BMZ, GTZ) mental and non-governmental organizations. · Belgium (MAECECD) It was launched at the 2002 World Summit on · Cameroon (ONADEF) Sustainable Development in Johannesburg, South · Canada (ACDI) Africa in order to promote the sustainable man- · European Union (EC, ECOFAC, JRC) agement of the forests of the Congo Basin and · USA (DSPI, CARPE-USAID) improve the quality of life of the region’s inhabit- · France (MAE, AFD, MEDD, CIRAD) ants. Th e CBFP’s main objectives are to improve · Equatorial Guinea communication among its members and support · Gabon coordination between members’ projects, pro- · Japan (Embassy of Japan in France) grams, and policies.