Revue De Presse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Uw Cinematheque Announces Fall 2012 Screening Calendar
CINEMATHEQUE PRESS RELEASE -- FOR IMMEDIATE RELEASE AUGUST 16, 2012 UW CINEMATHEQUE ANNOUNCES FALL 2012 SCREENING CALENDAR PACKED LINEUP INCLUDES ANTI-WESTERNS, ITALIAN CLASSICS, PRESTON STURGES SCREENPLAYS, FILMS DIRECTED BY ALEXSEI GUERMAN, KENJI MISUMI, & CHARLES CHAPLIN AND MORE Hot on the heels of our enormously popular summer offerings, the UW Cinematheque is back with the most jam-packed season of screenings ever offered for the fall. Director and cinephile Peter Bogdanovich (who almost made an early version of Lonesome Dove during the era of the revisionist Western) writes that “There are no ‘old’ movies—only movies you have already seen and ones you haven't.” With all that in mind, our Fall 2012 selections presented at 4070 Vilas Hall, the Chazen Museum of Art, and the Marquee Theater at Union South offer a moveable feast of outstanding international movies from the silent era to the present, some you may have seen and some you probably haven’t. Retrospective series include five classic “Anti-Westerns” from the late 1960s and early 70s; the complete features of Russian master Aleksei Guerman; action epics and contemplative dramas from Japanese filmmaker Kenji Misumi; a breathtaking survey of Italian Masterworks from the neorealist era to the early 1970s; Depression Era comedies and dramas with scripts by the renowned Preston Sturges; and three silent comedy classics directed by and starring Charles Chaplin. Other Special Presentations include a screening of Yasujiro Ozu’s Dragnet Girl with live piano accompaniment and an in-person visit from veteran film and television director Tim Hunter, who will present one of his favorite films, Tsui Hark’s Shanghai Blues and a screening of his own acclaimed youth film, River’s Edge. -

Programme Notes
Red Front May 9 - May 30 2020 Trial on the Road (1971) by Aleksei German World War 2, or as it is known to Russians, The Great Patriotic proved too challenging for the authorities. The film was War is one of the few conflicts where we can attribute clear shelved for 15 years. moral judgement. Most international conflict carries ambivalence, it is hard to unpick which side, or indeed sides, The ambiguity that starts with Lazarev certainly does not end are ‘right’ or ‘wrong’. The general consensus on WWII has led to with him. When imprisoned by the partisans, his cellmate is an a conception of heroes and villains, which has penetrated 18 year old boy and a fellow defector. Lazarev’s commanding national and historical consciousness across Europe for the and stoic screen presence is the perfect counterbalance to the better part of a century. The Soviet death toll stands, according boy’s desperation. As the young man cries of his desolation to a 1993 study by the Russian Academy of the Sciences, at and regret, Lazarev says nothing, although he definitely 26.6million. The intense strength of pride and remembrance understands. It is a heartbreaking scene, one which shows the that still resonates through the region today is equivocal to way trauma envelopes individuals, and leaves them unable to the magnitude of the tragedy. However, whilst most of us can extend comfort to themselves, let alone to others. There are confidently say that Nazism and fascism were terrible forces, many scenes of this nature in German’s film, characters and that the war was largely just, this says nothing of the breakdown and their sorrow is met with silence. -

Time Unfrozen
Change of Focus—1 tony wood TIME UNFROZEN The Films of Aleksei German his is my declaration of love for the people I grew up ‘ with as a child’, says a voice at the beginning of Aleksei TGerman’s Moi drug Ivan Lapshin (My Friend Ivan Lapshin). There is a pause as the narrator struggles for the right words to express his feelings for the Soviet Union of the thirties; when they come—ob”iasnenie v liubvi—it is with a strained emphasis on ‘love’. The fi lm, released in 1984, is set in 1935 in the fi ctional provincial town of Unchansk, where a young boy and his father share a communal fl at with criminal police investigator Ivan Lapshin and half a dozen others. It weaves together elements from the director’s father Iurii German’s detective stories and novellas of the same period: a troupe of actors arrive to play at the town’s theatre; Lapshin tracks down a gang of crimi- nals trading in human meat; a friend of Lapshin’s, Khanin, becomes unhinged after his wife dies of typhus; the spirited actress Adashova falls in love with Khanin, and Lapshin with Adashova. The authorities are largely absent: it is a fi lm about people ‘building socialism’ on a bleak frozen plain, their town’s one street a long straggle of low wooden build- ings beneath a huge white sky, leading from the elegant stucco square by the river’s quayside out into wilderness. There is a single tram, a military band, a plywood ‘victory arch’ of which they are all proud—‘My father’, the narrator recounts, ‘would never take a short cut across the town’: he always went the long way round, under the victory arch. -
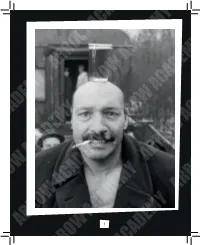
Arrow Academy Arrow Academy Arrow Academy Arrow Academy
ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY 1 CONTENTS 4 Film Credits 7 Khrustalyov, My Car! Admission to the Circus (2019) By Gianna D’Emilio 37 Khrustalyov, the Keys to My Car! (2003) by Joël Chapron ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY 50 Contemporary Reviews 54 About the Restoration ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY2 ARROW ACADEMY 3 ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY CAST Yuri Tsurilo General Klensky (as Y. Tsurilo) Nina Ruslanova The General’s Wife (as N. Ruslanova) Mikhail Dementyev The General’s Son (as M. Dementiev) Jüri Järvet Jr. The Swedish Journalist (as Y. Yarvet) Aleksandr Bashirov Fedia Aramyshev AKA Condom (as A. Bachirov) Mulid Makoev Lavrentiy Beria (as M. Makoïev) Ali Misirov Joseph Stalin (uncredited) CREW ARROW ACADEMY ARROWDirected by Aleksei GermanACADEMY (as A. Guerman) Written by Aleksei German (as A. Guerman) and Svetlana Karmalita (as S. Karmalita) Produced by Guy Séligmann, Aleksandr Golutva (as Alexandre Golutva) and Armen Medvedev Cinematography by Vladimir Ilin (as V. Ilyne) Film Editor Irina Gorokhovskaya (as I. Gorokhovskaïa) Sound Nikolay Astakhov (as N. Astakhov) ARROW ACADEMYMusic by Andrei ARROW Petrov (as A. Petrov )ACADEMY Production Design by Vladimir Svetozarov (as V. Svetozarov), Georgiy Kropachyov (as G. Kropatchiov) and Mikhail Gerasimov (as M. Geurassimov) ARROW ACADEMY4 ARROW ACADEMY 5 ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY ARROW ACADEMY Khrustalyov, My Car! Admission to the Circus by Gianna D’Emilio When the films of Aleksei Yuryevich German (1938–2013) have screened in the west, reviews have fallen into two camps. -

The Russian Idea in the Soviet and Post-Soviet Fantastika Film Adaptation
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Searching for Identity: The Russian Idea in the Soviet and Post-Soviet Fantastika Film Adaptation A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Slavic, East European and Eurasian Languages and Cultures by Jesse Brown O’Dell 2019 © Copyright by Jesse Brown O’Dell 2019 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Searching for Identity: The Russian Idea in the Soviet and Post-Soviet Fantastika Film Adaptation by Jesse Brown O’Dell Doctor of Philosophy in Slavic, East European and Eurasian Languages and Cultures University of California, Los Angeles, 2019 Professor Ronald W. Vroon, Chair What is the role of sociocultural history in the evolution of national identity? How is the worldview of Russian citizens reflected in contemporary art and popular culture? My dissertation, which examines narratives of national identity in the twentieth and twenty-first centuries, approaches these questions and others through an historical analysis of Russian fantastika film adaptations and the literary works upon which they are based. Illustrating transitions in perceptions of Russian identity as they are reflected in over thirty examples of Soviet and post-Soviet fantastika, this project provides a critical reconsideration of historical theories on the “Russian idea” and offers new perspectives on what it means to be Russian in the twenty-first century. My study employs a synthesis of approaches from the fields of cultural history, literature, film, and gender studies. The primary hypothesis is that it is possible, through an historical ii analysis of fantastika film adaptations (and their corresponding literary sources), to obtain a fundamental understanding of post-Soviet culture by examining crucial transformations in the Russian worldview over the course of a century; namely, from 1917 to 2017. -

Hard to Be a God
HARD TO BE A GOD A film by Aleksei German 2013 / Russia / 170 minutes / 35mm / DCP, B&W A Kino Lorber Release Kino Lorber, Inc. 333 West 39th St., Suite 503 New York, NY 10018 (212) 629-6880 Publicity Contact: Rodrigo Brandão – [email protected] Matt Barry – [email protected] CAST Leonid Yarmolnik – Don Rumata Aleksandr Chutko – Don Reba Yuriy Tsurilo – Don Pampa Evgeniy Gerchakov – Budakh Natalya Moteva – Ari CREW Director: Aleksei German Screenwriters: Svetlana Karmalita, Aleksei German, Based on the novel by Boris and Arkady Strugatsky Cinematography: Vladimir Ilyin, Yuri Klimenko Production Design: Sergei Kokovkin, Georgi Kropachev, E. Zhukova Costumes: Yekaterina Shapkaitz Makeup: Olga Izvekova, N. Ratkevich Music: V. Lebedev Sound: N. Astakhov Editors: Irina Gorokhovskaya, Maria Amosova Story Editor: Yevgeny Prtizker Production Manager: Marina Dovladbegyan Produced by: Viktor Izvekov, Rushan Nasibulin Production Companies: Studio Server (Russia), Russia 1 TV Channel (Russia) SYNOPSIS A group of research scientists has been sent to the planet Arkanar, living under an oppressed regime in a period equivalent to earth’s Middle Ages. The local population is suffering a ban issued on anyone who knows how to read and write. The scientists must refrain from influencing political and historical events on Arkanar. They must work incognito, and they must remain neutral. Don Rumata, recognized by the locals as a sort of futuristic god, tries to save the local intelligentsia from their punishment. He cannot avoid taking the stance: “What would you do in God’s place?” Adapted from the 1960s cult sci-fi novel “Hard to Be a God” by Arkady and Boris Strugatsky. -

Nancy Condee, the Imperial Trace. Recent Russian Cinema
The Imperial Trace This page intentionally left blank The Imperial Trace Recent Russian Cinema nancy Condee 1 2009 3 Oxford University Press, Inc., publishes works that further Oxford University’s objective of excellence in research, scholarship, and education. Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offi ces in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Copyright © 2009 by Oxford University Press, Inc. Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016 www.oup.com Oxford is a registered trademark of Oxford University Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Condee, Nancy. Imperial trace : recent Russian cinema / Nancy Condee. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-19-536676-1; 978-0-19-536696-9 (pbk.) 1. Motion pictures—Russia (Federation)—History. I. Title. PN1993.5.R9C66 2009 791.430947’09049—dc22 2008029349 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Printed in the United States of America on acid-free paper Acknowledgments Grateful acknowledgment is due, fi rst of all, to my home institution, the University of Pittsburgh, where the Dean’s Offi ce of the School of Arts and Sciences, the Department of Slavic Languages and Literatures, the University Center for International Studies, and the Russian and East European Studies Center are the primary units to which I am indebted for support and leave time. -

Summer Films Celebrate New Restorations, Philip Kaufman, Peter Greenaway, Miloš Forman, Michelangelo Antonioni, Aleksei Guerman, and More
Office of Press and Public Information Fourth Street and Constitution Av enue NW Washington, DC Phone: 202-842-6353 Fax: 202-789-3044 www.nga.gov/press Release Date: June 25, 2012 Summer Films Celebrate New Restorations, Philip Kaufman, Peter Greenaway, Miloš Forman, Michelangelo Antonioni, Aleksei Guerman, and More Film still f rom La Notte (1961, 35 mm, Italian with subtitles, 120 minutes) to be shown at the National Gallery of Art on Saturday , September 1, 2:30 p.m. as part of the f ilm series Michelangelo Antonioni Centenary. Image courtesy of Photof est. Washington, DC—This summer, the free film program at the National Gallery of Art celebrates the best in world film culture from the early 20th century to the present with an array of premieres, new restorations, and focused retrospectives of master filmmakers. Films are shown in original 35 mm format, unless otherwise noted. The season opens on July 1 with the U.S. premiere of the director's cut of Umbrellas, a documentary about Christo and Jeanne-Claude's dramatic attempt in 1991 to synchronize the opening of huge blue and yellow umbrellas positioned in locations in Japan and Southern California. Screening on July 14 in honor of Fête Nationale are two films that use Paris as a backdrop—Celine and Julie Go Boating and Souvenir. On July 29, The Unbearable Lightness of Being immediately follows a discussion of its director, the great American stylist Philip Kaufman, led by Annette Insdorf, director of film studies at Columbia University School of the Arts. Also screening in July is Peter Greenaway on Painting, a series presenting the English avant-gardist director's ideas on Rembrandt. -

National Gallery of Art Summer 2012 Film Program
FILM SUMMER 2012 National Gallery of Art 9 Art Films and Events 12 New American Architecture and Design: Saluting Checkerboard Film Foundation 14 Peter Greenaway on Painting 15 From Vault to Screen: Recent Preservation 20 American Originals Now: Mark Street 22 Michelangelo Antonioni Centenary 27 American Originals Now: Liza Johnson 29 Aleksei Guerman: War and Remembrance 33 Miloš Forman: Lives of an Artist Hidden in Plain Sight p. 20 National Gallery of Art cover: Bonjour Tristesse p. 19 Films are screened in the Gallery’s East Building Audito- From American premieres to restored silent cinema with rium, Fourth Street and Pennsylvania Avenue NW. Works live music, the Gallery’s summer season celebrates the are presented in original formats and seating is on a best in world film culture from the early twentieth century first-come, first-seated basis. Doors open thirty minutes to the present. Film scholar Annette Insdorf speaks on before each show and programs are subject to change. the work of American stylist Philip Kaufman; independent For more information, visit www.nga.gov/programs/film, filmmakers Mark Street and Liza Johnson discuss their e-mail [email protected], or call (202) 842-6799. work in the ongoing series American Originals Now; well-known pianists Ben Model, Andrew Simpson, and Philip Carli accompany restorations of important work from the silent era in a popular program of ciné-concerts; and international film scholar Michal Bregant from the Czech Republic speaks on Miloš Forman, followed by an overview of Forman’s work on the occasion of the filmmaker’s eightieth birthday. -

Engendering Genre: the Contemporary Russian Buddy Film
Engendering Genre: The Contemporary Russian Buddy Film By Dawn A. Seckler Colby College, BA 1998 University of Pittsburgh, MA 2001 Submitted to the Graduate Faculty of University of Pittsburgh in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2009 UNIVERSITY OF PITTSBURGH College of Arts and Sciences This dissertation was presented by Dawn A. Seckler It was defended on November 23, 2009 and approved by Professor Vladimir Padunov, Chair of Committee, University of Pittsburgh Professor Nancy Condee, University of Pittsburgh Professor Lucy Fischer, University of Pittsburgh Professor David MacFadyen, University of California, Los Angeles ii ENGENDERING GENRE: THE CONTEMPORARY RUSSIAN BUDDY FILM Dawn A. Seckler, PhD University of Pittsburgh, 2009 My dissertation situates itself at the intersection of several fields: Soviet cultural studies, film genre theory, and masculinity studies. It investigates the articulation of genre categories in Soviet and post-Soviet cinema industries, with a specific focus on the cultural context within which the buddy film emerges in late Soviet culture.This genre is unique within contemporary Russian cinema for providing a visual and narrative structure within which the masculine crisis—a topic widely written about by Russian sociologists and gender scholars—becomes visible. This masculine crisis is more often than not masked by compensatory, hyper-macho images in other genres (e.g., war films, gangster films, historical epics). The buddy film, by contrast, exhibits a type of masculinity rarely glimpsed on screen; these characters are the disillusioned, the marginalized, and the disenfranchised men of late- and post-Soviet society. My argument is grounded in a thorough examination of male-centered Russian buddy films from 1970 until the present day—specifically, I look at such films as A. -

Scarica Il Catalogo 2013
Fondatori Paolo Ferrari Roma Capitale Presidente Regione Lazio Provincia di Roma Lamberto Mancini Camera di Commercio di Roma Direttore Generale Fondazione Musica per Roma Marco Müller Collegio dei Fondatori Direttore Artistico Giancarlo Cremonesi Presidente del Collegio Presidente della Camera di Commercio di Roma Ignazio Marino Comitato di selezione Sindaco di Roma Capitale Concorso, Fuori Concorso, CinemaXXI, Nicola Zingaretti Prospettive Doc Italia Presidente della Regione Lazio Laura Buffoni Riccardo Carpino Marie-Pierre Duhamel Commissario Straordinario Massimo Galimberti della Provincia di Roma Manlio Gomarasca Aurelio Regina Sandra Hebron Presidente della Fondazione Musica per Roma Giona A. Nazzaro Mario Sesti Consiglio di Amministrazione Responsabile Ufficio Cinema Paolo Ferrari, Presidente Alessandra Fontemaggi Leonardo Catarci Carlo Fuortes Consulenti Massimo Ghini Chen Zhiheng Michele Lo Foco Isa Cucinotta Andrea Mondello Deepti D’Cunha Elma Hadzirdezepovic Tataragic Collegio dei Revisori dei Conti Babak Karimi Roberto Mengoni, Presidente Diego Lerer Massimo Gentile, Revisore Effettivo Paolo Moretti Giovanni Sapia, Revisore Effettivo Aliona Shumakova Maurizio Branco, Revisore Supplente Tomita Mikiko Marco Buttarelli, Revisore Supplente Direttore Generale Lamberto Mancini mibac2.pdf 01/09/2009 16.36.02 Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo è il dicastero del Governo Italiano preposto alla tutela della cultura e dello spettacolo, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e allo sviluppo del Turismo, un insieme di aspetti che, oltre a rappresentare l’identità culturale italiana, sono fattori rilevanti di crescita e di competitività per il Paese. Per svolgere tali C attività, il MiBACT si fa garante di un’attenta azione di conservazione M e tutela, unitamente ad un’efficacia politica di valorizzazione e promozione. -

BAM/PFA Program Guide
2012 AUG L/ U J UC BERKELEY ART MUSEum & PacIFIC FILM ARCHIVE PROGRAM GUIDE BARRY MCGEe LUTZ BACHEr D-L AlVAREz SUMMER CINEMA ON CENTER STREEt ITALIAN LEADING LADIES LES BLANk uNIVERSAL PICTURES: CELEBRATING 100 YEARS COOL WORLd RAJ KAPOOr AlEXEI GUERMAN BAM/PFA 1 EXHIBITIONS & FILM SERIES Barry MCGee P. 4 LutZ BACher / MATRIX 242 P. 6 D-L ALVareZ / MATRIX 243 P. 7 AT the Edge: RECent ACQuisitions P.8 2 The Reading Room P. 9 Himalayan Pilgrimage: Liberation through sight P.9 Bellissima: Leading Ladies of the Italian SCreen P. 11 ALWays for Pleasure: The Films of Les Blank P. 14 The Eternal Poet: Raj Kapoor & the Golden Age of Indian Cinema P. 16 Cool World P. 18 Free Outdoor SCreening P. 20 A Theater Near You P. 21 Russian Inferno: The Films of Alexei Guerman P. 22 UniVersal PICtures: Celebrating 100 Years P. 24 Summer Cinema on Center Street P. 26 3 GET MORE Want the latest program updates and event reminders in your inbox? Sign up to receive our monthly e-newsletter, weekly film update, exhibition and program announcements, and/or L@TE event updates Cover Barry McGee: Untitled, 2005 (detail); acrylic on glass bottles, wire; dimensions at bampfa.berkeley.edu/signup. variable; Lindemann Collection, Miami Beach. Photo: Mariano Costa Peuser. Download a pdf version of this and previous issues of the Program Guide 1. The Birds, 8.18.12, p. 25 from our website, bampfa.berkeley.edu/programguide. 2. Ed Wood, 7.14.12, p. 18 Subscribe to the BAM/PFA events calendar in iCal, 3.