Étude Originale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
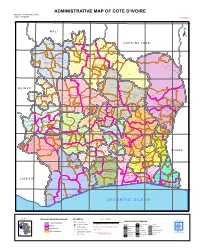
ADMINISTRATIVE MAP of COTE D'ivoire Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'ivoire 2Nd Edition
ADMINISTRATIVE MAP OF COTE D'IVOIRE Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'IVOIRE 2nd Edition 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W 11°0'0"N 11°0'0"N M A L I Papara Débété ! !. Zanasso ! Diamankani ! TENGRELA [! ± San Koronani Kimbirila-Nord ! Toumoukoro Kanakono ! ! ! ! ! !. Ouelli Lomara Ouamélhoro Bolona ! ! Mahandiana-Sokourani Tienko ! ! B U R K I N A F A S O !. Kouban Bougou ! Blésségué ! Sokoro ! Niéllé Tahara Tiogo !. ! ! Katogo Mahalé ! ! ! Solognougo Ouara Diawala Tienny ! Tiorotiérié ! ! !. Kaouara Sananférédougou ! ! Sanhala Sandrégué Nambingué Goulia ! ! ! 10°0'0"N Tindara Minigan !. ! Kaloa !. ! M'Bengué N'dénou !. ! Ouangolodougou 10°0'0"N !. ! Tounvré Baya Fengolo ! ! Poungbé !. Kouto ! Samantiguila Kaniasso Monogo Nakélé ! ! Mamougoula ! !. !. ! Manadoun Kouroumba !.Gbon !.Kasséré Katiali ! ! ! !. Banankoro ! Landiougou Pitiengomon Doropo Dabadougou-Mafélé !. Kolia ! Tougbo Gogo ! Kimbirila Sud Nambonkaha ! ! ! ! Dembasso ! Tiasso DENGUELE REGION ! Samango ! SAVANES REGION ! ! Danoa Ngoloblasso Fononvogo ! Siansoba Taoura ! SODEFEL Varalé ! Nganon ! ! ! Madiani Niofouin Niofouin Gbéléban !. !. Village A Nyamoin !. Dabadougou Sinémentiali ! FERKESSEDOUGOU Téhini ! ! Koni ! Lafokpokaha !. Angai Tiémé ! ! [! Ouango-Fitini ! Lataha !. Village B ! !. Bodonon ! ! Seydougou ODIENNE BOUNDIALI Ponondougou Nangakaha ! ! Sokoro 1 Kokoun [! ! ! M'bengué-Bougou !. ! Séguétiélé ! Nangoukaha Balékaha /" Siempurgo ! ! Village C !. ! ! Koumbala Lingoho ! Bouko Koumbolokoro Nazinékaha Kounzié ! ! KORHOGO Nongotiénékaha Togoniéré ! Sirana -

5 Geology and Groundwater 5 Geology and Groundwater
5 GEOLOGY AND GROUNDWATER 5 GEOLOGY AND GROUNDWATER Table of Contents Page CHAPTER 1 PRESENT CONDITIONS OF TOPOGRAPHY, GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY.................................................................... 5 – 1 1.1 Topography............................................................................................................... 5 – 1 1.2 Geology.................................................................................................................... 5 – 2 1.3 Hydrogeology and Groundwater.............................................................................. 5 – 4 CHAPTER 2 GROUNDWATER RESOURCES POTENTIAL ............................... 5 – 13 2.1 Mechanism of Recharge and Flow of Groundwater ................................................ 5 – 13 2.2 Method for Potential Estimate of Groundwater ....................................................... 5 – 13 2.3 Groundwater Potential ............................................................................................. 5 – 16 2.4 Consideration to Select Priority Area for Groundwater Development Project ........ 5 – 18 CHAPTER 3 GROUNDWATER BALANCE STUDY .............................................. 5 – 21 3.1 Mathod of Groundwater Balance Analysis .............................................................. 5 – 21 3.2 Actual Groundwater Balance in 1998 ...................................................................... 5 – 23 3.3 Future Groundwater Balance in 2015 ...................................................................... 5 – 24 CHAPTER -

République De Cote D'ivoire
R é p u b l i q u e d e C o t e d ' I v o i r e REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE C a r t e A d m i n i s t r a t i v e Carte N° ADM0001 AFRIQUE OCHA-CI 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W Débété Papara MALI (! Zanasso Diamankani TENGRELA ! BURKINA FASO San Toumoukoro Koronani Kanakono Ouelli (! Kimbirila-Nord Lomara Ouamélhoro Bolona Mahandiana-Sokourani Tienko (! Bougou Sokoro Blésségu é Niéllé (! Tiogo Tahara Katogo Solo gnougo Mahalé Diawala Ouara (! Tiorotiérié Kaouara Tienn y Sandrégué Sanan férédougou Sanhala Nambingué Goulia N ! Tindara N " ( Kalo a " 0 0 ' M'Bengué ' Minigan ! 0 ( 0 ° (! ° 0 N'd énou 0 1 Ouangolodougou 1 SAVANES (! Fengolo Tounvré Baya Kouto Poungb é (! Nakélé Gbon Kasséré SamantiguilaKaniasso Mo nogo (! (! Mamo ugoula (! (! Banankoro Katiali Doropo Manadoun Kouroumba (! Landiougou Kolia (! Pitiengomon Tougbo Gogo Nambonkaha Dabadougou-Mafélé Tiasso Kimbirila Sud Dembasso Ngoloblasso Nganon Danoa Samango Fononvogo Varalé DENGUELE Taoura SODEFEL Siansoba Niofouin Madiani (! Téhini Nyamoin (! (! Koni Sinémentiali FERKESSEDOUGOU Angai Gbéléban Dabadougou (! ! Lafokpokaha Ouango-Fitini (! Bodonon Lataha Nangakaha Tiémé Villag e BSokoro 1 (! BOUNDIALI Ponond ougou Siemp urgo Koumbala ! M'b engué-Bougou (! Seydougou ODIENNE Kokoun Séguétiélé Balékaha (! Villag e C ! Nangou kaha Togoniéré Bouko Kounzié Lingoho Koumbolokoro KORHOGO Nongotiénékaha Koulokaha Pign on ! Nazinékaha Sikolo Diogo Sirana Ouazomon Noguirdo uo Panzaran i Foro Dokaha Pouan Loyérikaha Karakoro Kagbolodougou Odia Dasso ungboho (! Séguélon Tioroniaradougou -

Statistiques Du SUD COMOE
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union-Discipline-Travail MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Statistiques Scolaires de Poche 2015-2016 REGION DU SUD-COMOE Sommaire Sommaire ..................................................................................... 2 Sigles et Abréviations ................................................................... 2 Méthodologie ............................................................................... 2 Introduction aux annuaires statistiques régionaux ........................ 2 1 / Résultats du Préscolaire 2015-2016 ......................................... 2 1-1 / Chiffres du Préscolaire en 2015-2016 ................................... 2 1-2 / Indicateurs du Préscolaire en 2015-2016 .............................. 2 1-3 / Préscolaire dans les Sous-préfectures en 2015-2016.......... 2 2/ Résultats du Primaire 2015-2016 .............................................. 2 2-1 / Chiffres du Primaire en 2015-2016 ....................................... 2 2-2 / Indicateurs du Primaire en 2015-2016 .............................. 2 2-3 / Primaire dans les Sous-préfectures en 2015-2016................ 2 3/ Résultats du Secondaire Général en 2015-2016......................... 2 3-1 / Chiffres du Secondaire Général en 2015-2016 ...................... 2 3-2 / Indicateurs du Secondaire Général en 2015-2016 ................. 2 3-3 / Secondaire Général dans les Sous-préfecture en 2015-2016 ................................................................ Erreur ! Signet non défini. 4 / Annexes ................................................................................. -

Intégrer La Gestion Des Inondations Et Des Sécheresses Et De L'alerte
Projet « Intégrer la gestion des inondations et des sécheresses et de l’alerte précoce pour l’adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta » Rapport des consultations nationales en Côte d’Ivoire Partenaires du projet: Rapport élaboré par: CIMA Research Foundation, Dr. Caroline Wittwer, Consultante OMM, Equipe de Gestion du Projet, Avec l’appui et la collaboration des Agences Nationales en Côte d’Ivoire Tables des matières 1. Introduction ............................................................................................................................................... 8 2. Profil du Pays ........................................................................................................................................... 10 3. Principaux risques d'inondation et de sécheresse .................................................................................... 14 3.1 Risque d'inondation ......................................................................................................................... 14 3.2 Risque de sécheresse ....................................................................................................................... 18 4. Inondations et Sécheresse : Le bassin de la Volta en Côte d’Ivoire ........................................................ 21 5. Vue d’ensemble du cadre institutionnel .................................................................................................. 27 5.1 Institutions impliquées dans les systèmes d'alerte précoce ............................................................ -

District De La Comoe
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVIRE Union - Discipline - Travail MINISTERED’ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ******************* ETUDES MONOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES DES DISTRICTS DE COTE D’IVOIRE DISTRICT DE LA COMOE NOTE DE SYNTHESE Novembre 2015 Avec l’appui financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) Etudes monographiques et économiques des Districts de Côte d’Ivoire (PEMED-CI) District de la Comoé Note de synthèse Etudes monographiques et économiques des Districts de Côte d’Ivoire (PEMED-CI) District de la Comoé Note de synthèse SOMMAIRE Contexte ............................................................................................................................................................................................................................................. 4 Méthodologie ..................................................................................................................................................................................................................................... 5 Introduction ....................................................................................................................................................................................................................................... 7 Axe I. Territoire et démographie ................................................................................................................................................................................................. 8 Chapitre 1. Caractéristiques -
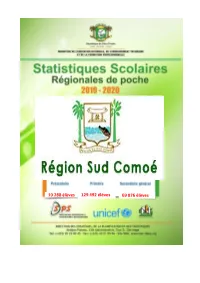
Statistiques Du SUD COMOE
10 288 élèves 129 492 élèves 69 876 élèves AVANT-PROPOS La publication des données statistiques contribue au pilotage du système éducatif. Elle participe à la planification des besoins recensés au niveau du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sur l’ensemble du territoire National. A cet effet, la Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DSPS) publie, tous les ans, les statistiques scolaires par degré d’enseignement (Préscolaire, Primaire, Secondaire général et technique). Compte tenu de l’importance des données statistiques scolaires, la DSPS, après la publication du document « Statistiques Scolaires de Poche » publié au niveau national, a jugé nécessaire de proposer aux usagers, le même type de document au niveau de chaque région administrative. Ce document comportant les informations sur l’éducation est le miroir expressif de la réalité du système éducatif régional. La possibilité pour tous les acteurs et partenaires de l’école ivoirienne de pouvoir disposer, en tout temps et en tout lieu, des chiffres et indicateurs présentant une vision d’ensemble du système éducatif d’une région donnée, constitue en soi une valeur ajoutée. La DSPS est résolue à poursuivre la production des statistiques scolaires de poche nationales et régionales de façon régulière pour aider les acteurs et partenaires du système éducatif dans les prises de décisions adéquates et surtout dans ce contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19. DRENET ABOISSO : Statistiques scolaires de poche 2019-2020 : REGION DU SUD COMOE 2 PRESENTATION La Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DSPS) est heureuse de mettre à la disposition de la communauté éducative les statistiques scolaires de poche 2019-2020 de la Région.Ce document présente les chiffres et indicateurs essentiels du système éducatif régional. -

World Bank Document
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE UNION – DISCIPLINE - TRAVAIL Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Immeuble COMETE - Av. Hédi Karray – ICI : Ingénieurs Conseils en Infrastructure 1082 Tunis –Mahrajène - BP 97 – 1002 Tunis (Tunisie) Plateau - 01 BP 8466 – Abidjan, Tél. : (+216) 71 707 800 Tél. : (+225) 20 30 01 55 / 20 30 01 56 Télécopie : (+216) 71 707 200 Fax : (+225) 20 21 86 15 E-mail : [email protected] E-mail : / Site Web : www.comete.com.tn Site web : www.ici-ci.com SOMMAIRE RESUME NON TECHNIQUE ........................................................................................................................ 5 I. INTRODUCTION ET CONTEXTE ................................................................................................... 11 1.1. Contexte du projet ................................................................................................................................... 11 1.2. Justification et objectif de l’étude ............................................................................................................ 11 1.3. Portée du présent document .................................................................................................................... 12 II. METHODOLOGIE DE L’ETUDE ...................................................................................................... 13 2.1. Recherche documentaire ......................................................................................................................... -

Annuaire Statistique D'état Civil 2020
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE ----------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA STATISTIQUE, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2020 Les personnes ci-après ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : - Dr Amoncou Fidel YAPI - Ange-Lydie GNAHORE Epse GANNON MIS/DESPSE - Taneaucoa Modeste Eloge KOYE - Hawa GBANE - Sadia Junior KOMO MIS/DGAT - Bouakary BERTE MIS/DGDDL - Botty Maxime GOGONE-BI MAIRIE DE COCODY - N’Guessan Solange AMESSAN Epse KRA MAIRIE DE KOUMASSI - Krotoum TIDJANE Epse SANOGO MAIRIE DE PORT-BOUET - Gnagby Léon YOPLO - Rigobert ZEBA MJDH/DECA - Kouakou Charles-Elie YAO - N'Guethas Sylvie Koutoua GNANZOU Epse BOHOUSSOU MIS/ONECI - Alimanta DOUMBIA Epse DIOMANDE - Kouadio Franck YAPO MSHPCMU/DIIS - Daouda KONE MSHPCMU/DCPEV - You Irène ABOH Epse GNAMBA SOUS-PREFECTURE D’ABOISSO - Mekei Rolande Francine BLEY SOUS-PREFECTURE D’ASSSIKOI - Séraphine Adjo DJE SOUS-PREFECTURE DE DIVO - Léopoldine KRAGBE SOUS-PREFECTURE DE GUIBEROUA - Stéphane Assamoi YAPO SOUS-PREFECTURE DE JACQUEVILLE - Saguidi BAKAYOKO SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - Gnanmien Raoul Hermann TANO SOUS-PREFECTURE DE SONGON - Fouéhi Stéphane GUIRIGA - Massoma BAKAYOKO MPD/INS - Koffi Séverin KOUAKOU MPD/ONP - Koudou Bienvenu KRAGBE MBPE/CF-MIS - Gui Paulin OKPO UNICEF - Mokie Hyacinthe SIGUI UNHCR - Clément KAMDEM INTELLIGENCE MULTIMEDIA - Gnekpié Florent YAO DGDDL DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 1 PREFACE La réforme du système de l’état civil a conduit à l’adoption des lois n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil et n° 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance. -

05-Sud-Comoe
ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE SCRUTIN DU 06 MARS 2021 LISTE DES CANDIDATURES RETENUES PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE Region : SUD-COMOE Nombre de Sièges 178 - ABOISSO, COMMUNE 1 Couleur(s) Dossier N° Date de dépôt RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET U-00489 21/01/2021 LA PAIX VERT ORANGE DIRECTEUR INGENIEUR EN T CISSE ABOUBAKARI M S ZINSOU MARCELLIN ISIDORE M BANQUE ET CHEF DES TP FINANCE Couleur(s) Dossier N° Date de dépôt INDEPENDANT U-00496 22/01/2021 JAUNE T MIAN BOSSON JEAN FERNAND M ETUDIANT S LOHOURI JEAN CLAUDE M SANS EMPLOI Couleur(s) Dossier N° Date de dépôt PARTI DEMOCRATIQUE DE COTE D IVOIRE - RASSEMBLEMENT U-01058 22/01/2021 DEMOCRATIQUE AFRICAIN / ENSEMBLE POUR LA DEMOCRATIE ET LA BLANCHE SOUVERAINETE DIRECTEUR DE CHEF T N'GOUAN JEREMIE ALFRED M S BENIE KAKOU JEAN-PAUL M SOCIETE D'ENTREPRISE Page 1 sur 13 T : TITULAIRE S : SUPPLEANT 178 - ABOISSO, COMMUNE Page 2 sur 13 T : TITULAIRE S : SUPPLEANT Nombre de Sièges 179 - ABOISSO, SOUS-PREFECTURE, ADAOU, ADJOUAN, KOUAKRO ET MAFERE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 1 Couleur(s) Dossier N° Date de dépôt INDEPENDANT U-00463 19/01/2021 JAUNE VERT GRIS T COULIBALY BAKARI M GERANT S KATCHE BOSSOMBIAN MICHEL M INSTITUTEUR Couleur(s) Dossier N° Date de dépôt INDEPENDANT U-00469 19/01/2021 ORANGE BLEU T KASSI ETCHIRY NOEL M COMPTABLE S KOUAME ANIMAND HANS HERVE M INSTITUTEUR Couleur(s) Dossier N° Date de dépôt RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET U-00490 21/01/2021 LA PAIX VERT ORANGE MEDECIN T AKA AOUELE M PHARMACIEN S KASSI AHOUBE JOSEPHINE -

CÔTE D'ivoire.Ai
vers BOUGOUNI 8° vers BOUGOUNI É 6° vers v. BOBO-DIOULASSO B KOLONDI BA SIKASSO a o g a CÔTE D'IVOIRE u GARALO in b BADOGO l f a é i l n é a k B n B a a K f KADIANA i 4° vers DIÉBOUGOU vers NANDOM n M A L I i BANFORA LAWRA u vers BOLGATANGA MANDIANA o B M HAN g a SINDOU é O g É B U R K I N A Z GOUA U D o MANANKORO é KOUÉRÉ H Tengréla O U É Pogo NIANGOLOKO GAOUA N Kanakoro MISS NI Kimbirila-Nord É ( LOROP NI V vers KANKAN B i Sa Tienko n O n a Niellé a L kar b é a o a T ni ndi É Kaouara o KAMPTI u FOLON ha BAGOU A l a m WA é Sianhala Minignan M Mbengué Diawala o N 10° Goulia K GALGOULI 10° O Barrage de É Kouto Ouangolodougou É I MALINK É É BATI R Farakoungouanan D E N G U L Kasséré MANGODARA E L Samatiguila Gbon ) é Doropo Kaniasso 848 Kolia S A V A N E S r Kimbirila- Bag a LOBI GA Gbéléban Sud oé Niofoin ba G Madinani PORO ï Sinématiali Ouango-Fitini Téhini Varalé a b Tiémé ur a Korhogo o n Seydougou 913 Ferkessédougou Kafolo K h Karakoro a Boundiali É Nassian PARC la Sirana Odienné S NOUFO Séguélon Komborodougou Tioroniaradougou 635 NATIONAL Bouna SOKOURALA 893 KABADOUGOU TCHOLOGO a Sirasso Napié b Guiembé c DIOULA DE LA C C n HA HE Bako m a e 824 l Kong G U I N É E i Dikodougou B T COMOÉ a BOUNKANI 1009 Morondo m Tafiré BOLE Dioulatiédougou a u d È vers BANDA NKWANTA S NKO Dianra o KOULANGO Booko n g 560 a a in o Djibrosso B 643 r Mont B Tortiya I B HAMBOL Boutourou BEYLA Borotou ou Tagadi WORODOUGOU Foumbolo Kotouba rédougo Koro Niakaramandougou Gansé Fé uba W O R BO B A a É Kani n Sarhala V A L L E D U B A N D A M A Z A N Z A N É -

Region Du Sud Comoe
REGION DU SUD COMOE LOCALITE DEPARTEMENT REGION POPULATION SYNTHESE SYNTHESE SYNTHESE COUVERTURE 2G COUVERTURE 3G COUVERTURE 4G ABIATY ADIAKÉ SUD-COMOE 1897 ABOISSO ABOISSO SUD-COMOE 45688 ABOULIÉ ABOISSO SUD-COMOE 1639 ABOUTOU ADIAKÉ SUD-COMOE 1722 ABROBAKRO GRAND-BASSAM SUD-COMOE 1245 ABY ABOISSO SUD-COMOE 3318 ABY-MOHOUA ADIAKÉ SUD-COMOE 1402 ADAOU ABOISSO SUD-COMOE 6093 ADIAHO GRAND-BASSAM SUD-COMOE 1245 ADIAKÉ ADIAKÉ SUD-COMOE 19055 ADJOUAN ABOISSO SUD-COMOE 3297 ADJOUAN-MOHOUA ADIAKÉ SUD-COMOE 7716 ADOSSO GRAND-BASSAM SUD-COMOE 1111 AFFIÉNOU ABOISSO SUD-COMOE 6559 AFFORÉNOU-POSTE ADIAKÉ SUD-COMOE 355 AHIGBÉ-KOFFIKRO ABOISSO SUD-COMOE 14928 AKAKRO ABOISSO SUD-COMOE 5853 AKOUNOUGBÉ ADIAKÉ SUD-COMOE 3346 AKPAGNE-POSTE ADIAKÉ SUD-COMOE 232 AKRESSI ABOISSO SUD-COMOE 2645 AKROABA-AKOUDJÉKOA GRAND-BASSAM SUD-COMOE 2906 AKROABA-BÉNIÉKOA GRAND-BASSAM SUD-COMOE 843 ALLAKRO TIAPOUM SUD-COMOE 3870 ALLANGOUANOU TIAPOUM SUD-COMOE 838 ALLIÉKRO ABOISSO SUD-COMOE 418 ALOHORÉ GRAND-BASSAM SUD-COMOE 2653 REGION DU SUD COMOE AMANIKRO ABOISSO SUD-COMOE 2507 AMOAKRO ABOISSO SUD-COMOE 695 ANDJÉ TIAPOUM SUD-COMOE 377 ANGA ADIAKÉ SUD-COMOE 972 ANGBOUDJOU ADIAKÉ SUD-COMOE 1020 ANZÉ-ASSANOU ADIAKÉ SUD-COMOE 262 APPOUASSO ABOISSO SUD-COMOE 5880 ASSÉ GRAND-BASSAM SUD-COMOE 3034 ASSÉ MAFIA GRAND-BASSAM SUD-COMOE 300 ASSINIE-FRANCE ADIAKÉ SUD-COMOE 1729 ASSINIE-MAFIA ADIAKÉ SUD-COMOE 5661 ASSINIE-SAGBADOU ADIAKÉ SUD-COMOE 1014 ASSOMLAN ADIAKÉ SUD-COMOE 1075 ASSOUANKAKRO ADIAKÉ SUD-COMOE 438 ASSOUBA ABOISSO SUD-COMOE 5802 ASSOUINDÉ ADIAKÉ SUD-COMOE 5766 ASSUÉ